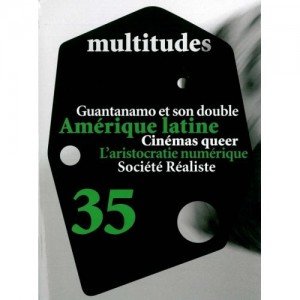Depuis presque vingt ans déjà, un art militant, politique et contre-culturel sévit et retrouve quelques galons de l’insolence révolutionnaire défaite par le backlash des années 1980. L’art post-gay débarque, la multitude queer prend les armes, le cinéma s’insurge. Tributaires du déni accordé d’ordinaire aux cinémas et arts politiques quant à leur potentiel d’invention formelle et d’imagination créatrice, redoublé de celui dans lequel sont tenus les cinémas trop marqués de problématiques identitaires en France, ils affirment ici leur place et leur puissance.
Héritiers du FHAR, des féministes pro-sexe puis post-sexuelles, de l’underground new-yorkais, des actionnistes viennois, de la vidéo intimiste, du ciné-tract et des narrations postcoloniales, le cinéma/art queer refuse à son tour le « baratin de la famille et du parti »( ), et poursuit la tentative de donner des images de nouveaux mondes. Pourtant, si ce cinéma/art que nous tenterons de cartographier émerge bien de cet héritage radical, les revendications et les manières de produire des images ne sont plus exactement les mêmes.
En filiation et en rupture avec l’art féministe des années 1970, l’art/cinéma queer déplace à son tour la frontière entre art spécifique et art universel, pour se positionner dans un art du minoritaire et remettre en question les territoires et les matériaux légitimes de l’art, mettre en discussion le statut de l’artiste. Il vient formuler un projet de contre-pratiques artistiques, un contre-cinéma( ), qui viendraient constituer et affirmer la multiplicité des regards absents des pédés, trans, intersexes, gender variant, sujets sexuels « abjectés », séropositifs, freaks, anormaux. Par la pratique du vidéo-tract dans de nombreux collectifs militants( ), ce cinéma donne lieu à un usage activiste et subversif visant la mise à mal du système hétérosexuel, du binarisme des genres, du technobiopouvoir, du capitalisme mondial, de l’entrecroisement entre sexisme et politiques nationales et racistes. Il est aussi le lieu d’une pratique de l’art située : dans l’expérience des trans’identités (Del LaGrace Volcano, Hans Scheirl), du sida (Hervé Guibert, David Wojnarowicz) ou d’oppressions croisées (Marlon Riggs, Isaac Julien, Coco Fusco, Stuart Gaffney). Il est également un travail visuel sur les puissances du corps, occupant les territoires formels de la vidéo d’artiste, de la fiction expérimentale, mais aussi de la vidéoperformance comme travail d’expérimentation et d’hybridation : les devenirs machiniques du cinéma cyborg de Hans Scheirl, les patchworks identitaires du « living art » de Steven Cohen, le cinéma monstrueux d’Ulrike Ottinger ou le queer créole de Pocha Nostra.
Dans ces contre-pratiques artistiques qui tendent à décoloniser les imaginaires se fabrique une autre forme de production des images, et notamment dans ce que l’on pourrait appeler le cinéma documentaire queer. Il s’agit d’un autre cadre éthique de représentation, dans lequel on ne produit plus pour ni avec, comme dans le grand cinéma politique des années 1970 (qui visait à donner – et à faire prendre – la parole) mais depuis ces expériences minoritaires. En nous intéressant à ce qui se travaille à l’intérieur de quelques-unes de ces œuvres, plutôt qu’à leur réception ou à leurs réappropriations et usages directement militants( ), nous verrons à quel point le cinéma documentaire queer, après la révolution de la vidéo féministe, déplace à son tour les limites du documentaire en y introduisant des écarts, des déplacements formels vers l’autofiction et la vidéo plasticienne.
Act Up, David Wojnarowicz et Hervé Guibert – Sida & autofictions filmiques : le retour des savoirs assujettis
À la fin des années 1980, face à l’expansion de l’épidémie du sida, Act Up et Gran Fury, tous deux collectifs militant contre le sida, ont déployé une série de manifestations d’un nouveau genre, faisant appel à une utilisation esthétisée et spectaculaire du corps dans l’espace public. Ces groupes inventaient une nouvelle manière de faire de la politique, d’une grande puissance visuelle d’interpellation, entre intervention artistique et politique : à la première personne, étonnamment efficace et joyeuse. Les malades eux-mêmes, mais aussi les pervers – ceux qui étaient désignés comme tels –, les objets abjects du savoir, devenaient sujets du savoir, produisant un savoir local, des discours et des images questionnant le savoir hégémonique et retournant ainsi le point d’énonciation, renversant les dispositifs de la représentation. Michel Foucault nommait un tel bouleversement épistémologique le « retour des savoirs assujettis »( ). Beatriz Preciado parle de « la nuit des morts-vivants de la connaissance »( ).
Lorsqu’on m’a appris que j’avais contracté ce virus, j’ai tout de suite compris que c’était surtout le virus de cette société malade que j’avais contracté( ).
Écrivain, vidéaste, photographe, plasticien, performeur néo-beat de l’East Village new-yorkais impliqué dans le combat d’Act Up à partir de 1989, David Wojnarowicz fut le premier artiste à pousser un cri contre le sida, « l’usine à tuer américaine », dès 1987, à travers ses films cauchemardesques et apocalyptiques en super-8 (Fire in My Belly / Le Feu dans mon ventre (1987), par exemple). La prose furieuse et flamboyante de ses spoken words et de ses chroniques fustige les politiques ultraconservatrices de restriction de l’accès aux soins et à la prévention, de pénalisation et de répression mises en place par Reagan et les pouvoirs publics, en collusion avec la sphère médiatique, les organismes de santé, les trusts pharmaceutiques, les catholiques fondamentalistes.
Sex Series and Others (1989-1998), co-réalisé avec la photographe Marion Scemama et constitué principalement de la lecture de ses textes, est le lieu d’existence de sa parole incarnée, portée et dite, qui rend publique, verbalise, permet de constituer les expériences des gays et des séropositifs. « Je brise les chaînes mentales/physiques qui m’asservissent au code linguistique. » À travers sa langue nouvelle, ses proférations frontales, ses images dissidentes, David Wojnarowicz a travaillé à la transformation et à la reformulation des normes d’intelligibilité des personnes atteintes du sida, face à leur négation par les discours publics. « Je ne me reconnais pas dans leurs lois »( ), « Je peux forger ma propre morale »( ), écrivait-il encore, s’arrachant aux lois illégitimes, œuvrant à déplacer et réinventer le dicible, et contribuant, à un moment charnière, celui de la montée en puissance d’Act Up, à une reconfiguration des discours efficients sur le sida dans l’espace social.
Exhortation à l’action, dissection des mécanismes de pouvoir, affirmation fière, la puissance de ses images tient au chiasme singulier entre expérience subjective et collective, faisant de son expérience du sida un prisme d’analyse politique d’une société tout entière. Réciproquement, c’est l’Amérique de la fin des années 1980 – sa machine capitaliste, impérialiste, homophobe et puritaine, son système migratoire raciste – qui se trouve diffractée par la vision exacerbée de la drogue ou de la brûlure orgastique, un monde d’entrechoquements fait de chagrin et de colère, son art se faisant l’expression d’un sujet, point de rupture et de condensation, frémissant sur la peau du monde. C’est depuis cet art situé, enchâssement d’une position intime et communautaire, que sa voix déporte l’espace du film vers l’espace politique de la société.
Il faut déjà avoir vécu les choses une première fois avant de pouvoir les filmer en vidéo. Sinon on ne les comprend pas, on ne les vit pas( ).
On peut dire qu’en France, l’écrivain Hervé Guibert, décédé du sida en 1992, s’est livré, en écrivant et filmant sa maladie et son corps, face notamment à l’institution médicale (et à ce qu’il a décrit parfois comme un « viol thérapeutique »( ), à une réappropriation de soi par le biais de son autoreprésentation.
La Pudeur et l’Impudeur, qu’il réalise en 1991, entre journal et mise en scène de soi, appartient au registre de l’autofiction filmique, et part du propre corps d’Hervé Guibert, dans sa nudité même, la vie de ce corps rendu à une forme d’autonomie douloureuse, celle de « la vie des organes », le dépossédant de lui-même et l’exposant à l’interpellation publique.
« Le processus de détérioration amorcé dans mon sang par le sida se poursuit de jour en jour. Bien avant la certitude de ma maladie, sanctionnée par les analyses, j’ai senti mon sang tout à coup découvert, mis à nu, comme si un vêtement l’avait toujours protégé, sans que j’en aie conscience. Il me fallait vivre, désormais, avec ce sang dénudé et exposé, à toute heure, dans les transports publics, dans la rue quand je marche, toujours guetté par une flèche qui me vise à chaque instant. Est-ce que ça se voit dans les yeux ? ( ) »
Corps nu, affaibli, médicalisé, stigmatisé, l’expérience du malade est au cœur du film, même si une transfiguration du vécu s’ordonne autour de la stylisation de soi. Dans son unique film, il atteint une forme d’épure dans le projet « du dévoilement de soi et de l’énoncé de l’indicible »( ), à l’épreuve du réel filmique documentaire, à l’aune de son corps disparaissant. L’élégance mélancolique et ironique, la confrontation sèche et intense des moments, le donné-à-voir sans commentaire, qui ordonnent la mise en scène du film, tendent à une récupération du contrôle de soi face à l’inexorabilité de son destin. Guibert échappe ainsi au dispositif injonctif ou aliénant du témoignage, dont il n’aurait probablement pu s’extraire dans le cadre du dispositif documentaire classique. En se mettant lui-même en scène, en abolissant l’opposition classique du cinéma documentaire filmeur/filmé, et en se déplaçant sur le terrain de l’autofiction, le cinéma de Guibert reconfigure le cadre éthique de la représentation et sa rhétorique de la bonne distance. Enfin, bien que ne s’inscrivant pas directement dans une démarche politique, le cinéma de Guibert aura rendu possible la figuration de corps souffrants, qui étaient jusque-là, et notamment dans leur quotidienneté, exilés en-deçà du champ du visible.
Del LaGrace Volcano – Gender Terrorism
« En tant qu’artiste visuel gender variant, j’ai utilisé les technologies du genre pour amplifier plutôt qu’effacer les traces hermaphrodites de mon propre corps. Je me nomme moi-même une ‘mutation intentionnelle’ ou un ‘intersexe design’ plutôt que simplement ‘intersexe’, afin de souligner la singularité de mon parcours. Mon but est de cartographier de nouveaux territoires qui ouvrent des possibles pour ceux d’entre nous qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se réduire au paradigme du genre binaire et qui créent des espaces où la différence est valorisée, respectée, désirée( ). »
Photographe, vidéaste et performeur queer/transgenre, Del LaGrace Volcano développe depuis l’extrême fin des années 1970 un travail de représentation photographique des communautés queer, transgenres et lesbiennes.
Avec ses Tranz Portraits ou les portraits de Lesbian Boys, qui ont été parmi les premiers à mettre en scène, de l’intérieur de ces communautés, des personnes issues notamment des scènes trans FTM, Del LaGrace se plaçait dans une posture d’identification à ses modèles, qu’il préfère appeler des « sujets parlants »( ). Les photographiant « dans leurs/nos propres termes »( ), il a œuvré à produire un queer sublimant et héroïsant ses modèles.
De même, dans son travail qui fait appel au registre pornographique, Del LaGrace explicite la place du regard du photographe, mettant en scène avec ironie le dispositif photographique lui-même, allusion directe aux procédés de la représentation médicale.
La série de photographies Hermaphrodyké – Self-Portraits of Desire (1995) est à ce titre significative : le pommeau qui commande le déclencheur photo est un objet dans l’image, il participe aux ébats sexuels mis en scène, sur fond d’imagerie photographique à l’esthétique scientifique dix-neuviémiste, aplat sépia. Il s’agit ainsi d’un travail d’explicitation et de surlignage du dispositif représentatif, qui n’est plus invisibilisé ni naturalisé, mais au contraire énoncé en tant qu’espace de négociation et d’échange de pouvoir, à l’intérieur des relations forcément désirantes qui impulsent la nécessité de photographier.
Il s’agit de travailler selon une méthodologie queer féministe pour produire ces images. « C’est le jeu des regards que je veux explorer à l’intérieur des relations de désir »( ), écrit Del LaGrace Volcano. Del LaGrace se met en scène, dans cette série, regard caméra, avec son amant-e Simo Maronati : figures jumelles, corps indissociables, redoublement troublant renforcé par les effets de surimpression entre les deux corps, le double comme autoportrait décliné, miroir et mis en abyme. C’est ainsi que s’installe une deuxième dimension du travail de Del LaGrace Volcano, indissociable de la première, un travail d’autoreprésentation sur les limites de soi, sur l’hybridation des identifications allant jusqu’à la défiguration/dé-visagéité, sur la non-ressemblance à soi-même parfois, où perce une inquiétude au cœur de sa propre mutation physiologique. CarnoVulva (2003), The Artist as a Young Herm (2004), Transliminal Landscapes (2005, en collaboration avec Indra Windh) et la série Gender Optional – Mutating Self-Portrait (2000) sont les lieux de cette exploration.
Dans sa fameuse série Xenomorphosis (1992), des corps nus et glabres, créatures mutantes d’allure androïde, mettent en scène de multiples « advenirs » du corps et leurs métamorphoses chimériques, entre parthogenèse et branchements pornographiques. Dans les Transgenital Landscapes (1996-1998), où il photographie en gros plans des sexes transgenrés comme autant de paysages poétiques, le rapprochement scalaire, jeu entre micro et macro-vision, offre une approche cellulaire et minérale de la chair.
Del LaGrace Volcano insiste sur les disruptions visuelles. Une image qui paraît se lire très simplement renvoie le spectateur à un doute, à un trouble quant à ce qu’il identifie. Il n’y a pas de vérité ultime du corps ; ce sont infiniment les substances incertaines du corps qui se donnent à voir et renvoient le spectateur à sa position de regardeur, dans la perspective volontariste et militante d’une mise à mal de la fabrique hétéronormative, qui accompagne nécessairement sa recherche post-identitaire.
Del LaGrace Volcano brouille la carte des oppositions binaires et, avec d’autres artistes, il va jusqu’à se définir comme cyborg, comme corps post-organique et hybride, incorporant les biotechnologies. En faisant proliférer des représentations sexe/genre dissonantes, Del LaGrace développe, face à l’État et au système de régulation et de contrôle du genre, une éthique de hacker. Il invente ainsi une contre-grammaire gendercopyleft( ).
Maria Beatty / Gilrswholikeporno – Post-pornographies
Rituels de soumission, durées étirées jusqu’à l’extinction de la raison, le souffle coupé, un corps archaïque et aveugle, la montée asphyxiante du désir, avec The Black Glove (1993), Maria Beatty, accompagnée de la musique lancinante de John Zorn, déploie un art des sensations porté jusqu’à ses extrêmes. The Black Glove, nouveau pays mental, défait et cartographie un autre territoire du corps féminin, du corps lesbien, qui se redéploie depuis ses géographies érogènes. Le film de Maria Beatty est construit autour d’une unique cérémonie érotique, au cours de laquelle la réalisatrice et actrice est soumise à divers jeux et supplices sexuels. La caresse et les exercices violents y redessinent les contours d’un corps ordonné par les lois de la résistance physique et de la jouissance. Maria Beatty est la représentante brillante d’un cinéma fétichiste lesbien, où le sexuel s’infiltre partout, dans les rituels, dans les détails, dans l’omniprésence du métal, des ombres, des ralentis, autant que dans la présence explicite de jouets et actes sexuels. Inspirées notamment du cinéma expressionniste allemand et du film noir, l’épure du noir et blanc et la spatialisation sonore (respirations, résonances, crépitements et cliquetis) dessinent un espace/temps nocturne et onirique, aux visions étouffées, aux perceptions cauchemardesques, occupant des zones sensitives infra-mentales.
Maria Beatty s’inscrit dans un courant cinématographique de pornographie critique, post-pornographique( ), comme tentative de production d’une représentation pornographique échappant à la fois aux représentations médicales objectivantes et à la pornographie majoritaire hétérosexiste. Le dispositif pornographique devient un espace de lutte revendiqué et un espace possible de re-signification, réinvention de l’ordonnancement des corps et des usages du plaisir( ). Ainsi, face au courant féministe de rejet de la pornographie, considérée comme ontologiquement aliénante, le féminisme pro-sexe et le mouvement queer posent une critique de la pornographie traditionnelle comme entreprise de normalisation des corps et développent un contre-projet pornographique ayant pour visée de « ne nier aucun corps, aucune pratique ». Tel était par exemple le projet manifeste des Girlswholikeporno( ), collectif de vidéastes anarcho-queer-féministes de Barcelone (2003-2008). Avec leurs vidéo-tracts acides et décomplexés, issus d’ateliers post-pornos qu’elles mettaient elles-mêmes en place, les activistes barcelonaises rencontraient les pratiques anarcho-queer d’autoproduction, d’auto-fabrication des images Do It Yourself (DIY/Fais-le toi même) et d’auto-expérimentation pratiquées par les post-pornographies féministes, queer, trans, gay, lesbiennes. De nombreux ateliers ont ainsi vu le jour, à Barcelone tout particulièrement, ainsi que de nombreuses vidéos. Leur projet réside notamment dans la déconstruction des pratiques sexuelles dites « naturelles », pour redéfinir une nouvelle cartographie de la sexualité qui tente de déplacer les zones corporelles sexualisées, essentiellement génitales, vers des zones dites « non sexuelles », s’appuyant sur la tradition fétichiste, par exemple, ou sur une certaine idée du corps sans organe d’Artaud et Deleuze.
Hans Scheirl – Décoloniser l’imaginaire
Hans Scheirl, cinéaste et peintre anglo-autrichien transgenre, appartient pour sa part à ce cercle d’artistes de l’avant-garde queer des années 1990 qui a retravaillé le cinéma expérimental à partir de pratiques « illégitimes » comme la pornographie. Ses premiers courts-métrages, co-réalisés avec Ursula Pürrer, sont le lieu d’explosion d’un corps violent et frénétique, sur fond de musique électronique hardcore et sous forme de journal contre-culturel trépidant, qui a pour décor le New York underground et défait des squats. La recherche effrénée du plaisir et la fouille brutale de corps fiévreux donnent le tempo de films qui défilent au rythme de la pulsion sexuelle, manifestes contemporains d’un cinéma identifié à la vitalité sexuelle. Flaming Ears (1991), long-métrage co-réalisé avec Ursula Pürrer et Dietmar Schipek, met en scène les branchements électriques du désir, la poésie détailliste et enchantée de l’univers industriel, des couleurs explosées, saturées, des devenirs punk et post-humains, à la désinvolte abjection revendiquée. En 1998, il réalise Dandy Dust, film culte qui emprunte à de multiples genres cinématographiques (les séries de live-action des mangas japonais, les films d’horreur, le féminisme et l’actionnisme viennois). Les hybridations sexuelles hermaphrodites répondent à la violente crudité d’un univers sexuel proliférant. Hans Scheirl mélange fluides et matières organiques (vomissures, squelettes, insectes, fœtus, sang), auxquels renvoient figures jumelles, dédoublements et jeux de reflets, scènes de baise, téléportations, dématérialisation des corps et embrasements subliminaux. Dans une scène qui révèle l’économie générale du film, les corps sont reliés par des attaches qui relèvent à la fois du lien ombilical, du circuit intégré ou de la chaîne productive, pour créer des unités polyorgastiques. L’ouverture du corps, et notamment du cerveau, une réflexion sur la mémoire perturbée et la manipulation cérébrale, l’ubiquité des espaces (qui sont autant des fils narratifs que des scènes figurées par les effets spéciaux) donnent à voir une esthétique de l’intrusion, de la contamination, de l’échange, de la perméabilité. Hans Scheirl explore le potentiel utopique du cinéma à la fluidité des identités, entre masculin/féminin, humain/machine, XVIIIe siècle décadent/science fiction (une époque post-apocalyptique et la poésie de la technoculture) dans un récit éclaté et polymorphe, rêverie utilisant art, médias, développements technologiques, médecine, corps artificiels. « L’humain devient cyborg quand le cyborg entretient des liens de sang entre ordinateur, vidéo et technologies interactives », dit Hans Scheirl( ). Le cinéma sexuel de Hans Scheirl s’arrache aux usages de la pornographie majoritaire et se fait lieu d’exploration d’un corps redessiné, où les circulations de flux connectent directement défilement des images, des transformations chimiques, cérébrales et corporelles, et des jouissance et pratiques sexuelles désintégrées. Dans son travail sur les limites physiques de l’identité, le devenir, le passage entre mutation et recréation de soi, Hans va chercher, comme il le dit, quels sont ses monstres( ), tentant de capturer les « fragrances visuelles surgies de son inconscient, pour les modeler dans des paysages qui peuvent être visités »( ). Les effets spéciaux, les prothèses, la modification hormonale, mais aussi le cinéma et la science-fiction constituent autant de virtualités d’exploration des puissances du corps. Une « nouvelle chair », de nouvelles zones désirantes déterritorialisent et défont le corps straight, en ébauchant d’autres agencements corporels, des personnages et identifications fluctuants, mouvants et vibratiles. L’entremêlement des récits, l’utilisation maximale des ressources du cinéma expérimental (narration non linéaire, refilmage et mixture entre super-8, 16 mm et vidéo) sont ici envisagés dans le cadre d’une perspective politique, projet et tentative de transformation radicale de l’économie libidinale( ). Tentative de décolonisation de l’imaginaire, Dandy Dust, en déstructurant les formes narratives, les corps et les identifications, lutte contre les fictions établies. Ainsi, il ne s’agit plus seulement d’une dynamique de réhabilitation, de donner un chant à ce qui était muet, de se contenter de rendre la parole ou de favoriser la prise de parole mais de créer, pour paraphraser Félix Guattari, les conditions d’un exercice total, paroxystique de cette énonciation( ).
Marlon Riggs – Black Queer Art
Tongues Untied (Langues déliées), à ce titre, tient du film manifeste. Réalisé en 1989 par le cinéaste afro-américain Marlon Riggs, mort du sida en 1994, il décrit la mort sociale, engendrée par la violence homophobe et raciste de la société américaine, de cette humanité qui, en recourant à l’injure, cherche à s’extraire du non-dit et de la colère non exprimée. Son film se fait la chambre d’échos de récits singuliers d’hommes noirs et gay, en butte au mépris homophobe de la communauté noire et au déni de reconnaissance des Noirs dans la communauté gay californienne. Depuis une double appartenance vécue comme contradictoire, ses personnages se trouvent tous exilés d’eux-mêmes. Le poète Essex Hemphill, qui est l’une des voix du film, dit ainsi : « J’étais un homme invisible, je n’avais ni ombre, ni substance, ni place, ni histoire, ni reflet. » Le film agit sur le mode de l’interpellation (du « je » au « tu », du « nous » au « vous »), en interrogeant la représentation, la visibilité et la reconnaissance. Ces récits autofictionnels qui s’entrecroisent et s’affranchissent du mutisme tressent une communauté d’expérience et, à la fin, on le verra, une communauté d’action. « Des hommes noirs aimant des hommes noirs, c’est l’acte révolutionnaire », dit le film en s’achevant.
Appartenant aux registres du témoignage pamphlétaire et de l’appel à l’action, Tongues Untied est un brûlot, une opération contre-culturelle qui vise à renverser le système de domination. La beauté incantatoire du style, écrin pour l’assomption de ces résistances, la précision musicale de l’entrelacement des registres narratifs et des régimes d’images (prise de vue documentaire, récit intime et reconstitution onirique, entremêlés de poèmes somptueux, de performances rap, de chansons de Nina Simone ou de Roberta Flack) en font un chef-d’œuvre du genre.
Variation sur le thème du silence et de l’agir, il est par lui-même un bruissant morceau de rap, utilisant une esthétique du montage proche du collage, des ralentis, un récit choral aux voix multiples qui retranscrit l’hybridité des identités, tissant magnifiquement la narration de deux expériences minoritaires, qu’il amplifie et fait résonner comme fondamentalement existentielles. Il retranscrit aussi ce qui peut être considéré comme le processus de constitution d’une communauté et de sensibilités minoritaires (réappropriation, humour, parodie, contre-culture musicale et langagière).
Ainsi, il fait appel à la formidable inventivité de la subculture du « voguing ». Danse urbaine de réappropriation, graphique et sensuelle, elle est née dans les ballrooms, ces lieux où les communautés gay, drag queen black et hispanic se travestissent lors de défilés de mode extravagants, mélangeant sapes de grands couturiers, défilés façon catwalk et poses empruntées aux photos de mode.
Le travail de Marlon Riggs s’inscrit dans un renouveau de l’art issu de la diaspora noire qu’on a pu appeler le new black queer cinema. Tongues Untied est sorti la même année que Looking for Langston, le film du cinéaste gay noir anglais Isaac Julien. Ils marquent tous deux, avec les écrits de poètes et essayistes gay afro-américains (Essex Emphill, Joseph Beam, Reginald Jackson, etc.) et les productions audiovisuelles de Jocelyn Taylor ou Jenny Livingstone, l’entrée dans le cinéma indépendant d’une problématique queer noire. Ce cinéma donnera naissance, en Angleterre, à des structures de production d’artistes noirs gay et féministes (notamment Sankofa Films). Aux États-Unis, Frameline, Third World Newsreel, Women Make Movies distribuent les films d’artistes qui entrecroisent les questions de genre, de sexualité et de race.
Film-essai, Tongues Untied exploite les puissances de ré-ordonnancement et de re-signification du réel propres au documentaire, et travaille la forme du témoignage, d’abord par la mise en œuvre aboutie d’une transmission et traduction de cette condition minoritaire. C’est ainsi qu’est travaillée, par exemple, la mise en images de la force performative de l’injure, mise en scène vocale de l’insulte, répétition qui se déploie de manière musicale, telle une ritournelle. Pour travailler, perturber et finalement déjouer le dispositif même du témoignage, le film fictionne, les personnages mettent en scène leur récit, sous forme de poèmes performés, dits, chantés. Chaque monologue, rendu commun, fruit d’une histoire partagée, vient se collectiviser, esquisse de l’invention d’un peuple. « J’ignore où nous irons( ). » Tongues Untied dessine un peuple en errance, qui se cherche, ne trouve nulle part son identification ou son territoire. « Un nouveau langage nous fait signe. Son parler est actuel( ). »
Ruins – Communauté et exil
Ruins est la trace d’un long voyage à travers l’Europe de l’Ouest, dans différentes communautés queer autonomes.
Enfin, il est possible d’envisager le film Ruins (2007), du vidéaste Raphaël Vincent, à travers la dynamique minoritaire d’un art de l’exil.
Les squats anarcho-queer sont les espaces autogérés où Raphaël Vincent a vécu et tourné son film, zones alternatives, comme entre plusieurs mondes, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur d’un système dont on ne percevra qu’à peine la présence hors champ. Le vidéaste cherche les traces des vies vécues et fantasmées, identifications, travestissements, rituels et intensités, qui ont été laissés dans les lieux. Ruins développe une grammaire visuelle autonome pour représenter ceux qu’il filme, les séquences filmées échappant à une narration causale immédiatement lisible et à la psychologie. La présence énigmatique des personnages et leurs relations affectives, sexuelles, poétiques, gestuelles, quasi chorégraphiques avec les lieux désormais vides sont déclinées selon des parcours déambulatoires et mutiques. Chaque personnage est ainsi relié à un univers qui lui restitue sa singularité d’existence, tout en le déliant de toute finalité explicative. Ainsi, les gestes répétés, les regards frontaux, les mises en scène érotiques, les allées et venues, le défilement dans l’espace d’éléments oniriques – fragments de corps, bijoux, fourrures, godes, flacons de gel ou de poppers –, les éléments chorégraphiques disjoints ainsi que la bande son abstraite et déréalisante de légion cérébrale ne laissent percevoir qu’en demi-teinte une atmosphère faite de mélancolie et de démesure.
Raphaël Vincent signe souvent ses films Ruinsproduction, volonté de suspension et de trouble du statut d’auteur. Il explique d’ailleurs le geste éthique par lequel il a tenté de rendre compte de cette vie commune, de ces fragments « d’identités qui échappent à l’œil du système ». « C’est à l’intérieur des ruines que se trouvent nos objets, fragments de genre, pièces éparses de nos histoires, des bouts de sexe, des images floues. Il fallait inventer des scènes, des attitudes et des performances. Nous réapproprier. Les maisons comme des squelettes autour de nous, les déchets et le reste. Le béton comme ami( ). » À l’invitation de R. Vincent et de retour sur ces squats, lieux de leur vie passée, les personnages-acteurs de Ruins ont co-écrit, rêvé, inventé des performances. C’est par ce quadruple processus d’une narration disjointe, d’une signature auctoriale multiple et désamorcée, de la conception partagée des performances avec ses actants et du déplacement et de la transposition hors de l’espace documentaire, que Ruins arrache ses personnages aux identifications réifiantes (voir l’entretien dans ce dossier).
Ce film, à l’instar du cinéma et des pratiques visuelles queer proposant un nouvel espace pour la représentation des sujets filmés, redessine une posture d’auteur qui échappe à l’idéologie de sa complète autonomie, celle-ci se jouant souvent, dans le documentaire classique, à l’aune d’un arrachement à lui-même du sujet filmé, entraîné vers une vérité supérieure qui le dévoilerait, celle du point de vue de l’auteur.
Il s’agit à l’inverse, dans les pratiques visuelles queer, d’un projet toujours en chantier, dont la force s’ancre dans cette esthétique du minoritaire et, par sa frontalité même, dans une adresse à la société toute entière. Davantage qu’une simple subversion des dispositifs de la représentation ou qu’une simple transposition d’une lutte dans le champ des arts plastiques, le cinéma queer utilise toutes les ressources de production des images, du cinéma expérimental à la captation rageuse, en passant par le documentaire, en les rattachant à une expérience située et à l’ensemble d’un mouvement politique, dans un aller retour entre activisme et micropolitique, puissance du corps et revendication, intime et révolution. De sa proximité avec les mouvements anarchistes, autonomes ou altermondialistes pourrait alors émerger un débordement des questions de genre et de sexualité vers tous les espaces de revendication, tout en gardant cette même charge de poésie corrosive. Autrement dit une fabrique contemporaine du cinéma politique, plus vaste, qui puise dans la capacité toute particulière du cinéma queer à reconfigurer les espaces symboliques, dans son recours aux puissances plastiques des images qui recèlent autant de virtualités de formulations de nouveaux mondes possibles.