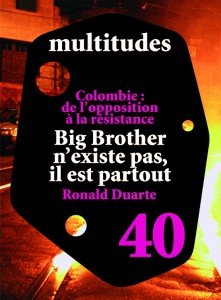Face à une dictature qui ne dit pas son nom
Un entretien avec
Antonio Morales Riveira
Multitudes : Dans une Amérique Latine qui a pris un virage à gauche, la Colombie apparaît de plus en plus isolée et contestée. Qu’y a-t-il de particulier dans l’histoire, la société ou la culture colombienne pour qu’elle diffère autant de ses voisins ?
Antonio Morales Riveira : Pour parler seulement des pays andins, comme l’Équateur et surtout la Bolivie et le Pérou, le narcotrafic y est apparu dans les années 1970, voire postérieurement. Nous l’avons eu dès la fin des années 60 avec le boum de la marimba[1] qui se termine dans les années 70. Arrive la cocaïne et très vite la frontière des zones de culture de la coca s’est déplacée, pour des raisons de transports et répression, de la Bolivie et du Pérou vers la Colombie. La plupart de la production et de l’exportation vers le nord passe alors aux mains des grands cartels colombiens de Medellin et Cali qui ont mis en place un véritable processus d’industrialisation de la cocaïne. La Colombie a commencé à dériver du reste de l’Amérique Latine car nous avons eu le narcotrafic, les autres pays non, ils sont simplement consommateurs ou petits producteurs. Pourquoi la Colombie n’a-t-elle pas suivi le tournant à gauche et les tentatives de rénovation des moeurs et du pouvoir politiques ? Justement parce que le narcotrafic a pénétré toutes les instances de la société et qu’il s’est produit une fragmentation de l’éthique nationale. L’extrême droite a utilisé le narcotrafic pour s’enrichir et maintenir une guerre anti-subversive en armant les autodéfenses (paramilitaires) et les FARC[2], la guérilla la plus puissante, pour se financer et se renforcer tout autant. La droite, c’est clair, a été capable de suffisamment de barbarie pour s’emparer de tous les pouvoirs et les concentrer dans les mains d’Alvaro Uribe Velez au pouvoir depuis sept ans. Mais pourquoi ne s’est-il pas passé la même chose qu’en Équateur, avec Rafael Correa, ou avec Evo Morales en Bolivie, pour parler de pays où existe à petite échelle le narcotrafic ? Parce qu’en Colombie, alors que cela aurait dû être plus facile, vu qu’il y avait les conditions dites objectives du marxisme, les luttes populaires ont été disqualifiées par les actions indiscriminées de la guérilla qui ont nui aux organisations populaires et aux partis de gauche. Les FARC, qui ont conservé une structure marxiste-léniniste, ont volé, par la violence, le droit des gens à s’organiser, en se faisant passer pour ce qu’ils ne sont pas, l’avant-garde du peuple colombien. Du coup, celui-ci s’est en grande partie détaché de la gauche, ce qui a pour le moins ralenti le processus d’un vrai changement dans la politique générale du pays. Aujourd’hui, le Polo Democrático[3] fait campagne pour les présidentielles, sachant bien qu’il ne gagnera pas, notamment parce que chaque fois qu’il prend un peu du poil de la bête, les FARC font quelque chose pour qu’il soit vu comme une organisation proche d’eux, ce qui n’est pas le cas.
M. : Depuis les années 1980, la Colombie a été marquée par une escalade des violences aux responsabilités intriquées entre État, armée, politiciens, narcos, paramilitaires, guérillas[4]. La sécurité démocratique d’Alvaro Uribe, au pouvoir depuis 7 ans, a-t-elle amélioré la situation ?
A. M. R. : Non, en aucune manière. L’unique résultat positif de son « plan de paix » est la démobilisation des groupes d’autodéfense (AUC). Mais de quelle démobilisation s’agit-il ? Les AUC étaient soi-disant 12 000, ils semblent aujourd’hui 35 000, comme si l’on n’avait pas démobilisé les vraies troupes et qu’on les avaient réarmées. On sait qu’il y a plus de 10 ou 12 000 nouveaux paramilitaires, las Aguilas negras, etc. Ceux qui se sont démobilisés ont bien rendu leurs armes, mais c’est insignifiant. En réalité, les vraies structures logistiques de l’armée paramilitaire sont intactes, je parle des réseaux de communication, des réseaux d’exportation de la cocaïne qui est leur source de financement principale, de l’appui de certains secteurs de la bourgeoisie colombienne, des grands propriétaires terriens et de l’armée. Le paramilitarisme n’est pas mort en Colombie. En fait, selon le dernier rapport de la fondation Nuevo Arco Iris, ces nouvelles bandes narco-paramilitaires, sont présentes dans la plupart des départements.
M. : Donc Uribe n’a pas du tout pacifié le pays…
A. M. R. : On aurait pu penser que d’avoir repoussé la guerre et les FARC dans les maquis les plus lointains du pays aurait arrêté le phénomène le plus atroce de la politique colombienne, c’est-à-dire les déplacements forcés. En réalité, ils ont augmenté, avec la protection d’Uribe et de ses alliés. Deux millions de paysans ont été déplacés depuis 2002. L’occupation des territoires continue au service du narcotrafic et pour voler les terres aux paysans. Le plan paramilitaire est devenu, pour ainsi dire, une politique d’État. La sécurité démocratique a produit, c’est vrai, une série d’effets, mais qui sont de façade ou virtuels, et elle a été remplacée par une sécurité mafieuse qui constitue la véritable politique du gouvernement associé à la mafia du narcotrafic, les parapolitiques, et le paramilitarisme. De telle façon que ce n’est pas l’État qui garantit la sécurité mais l’alliance État-paramilitaires. De l’autre côté, il y a une crise profonde dans l’armée, les militaires en ont marre de combattre les FARC et que leurs généraux soient expulsés de l’armée par Uribe qui sanctionne ainsi les permanentes violations du droit international humanitaire. Il y a une espèce d’opération tortue. Depuis l’opération Jaque[5] et la mort du commandant Raul Reyes dans un bombardement aérien sur le territoire équatorien, il ne se passe quasiment rien. La grande poussée contre les FARC qui, selon l’uribisme, allait conduire à la mort ou la capture des commandants Alfonso Cano et Jorge Briceño (alias Mono Jojoy) s’est affaiblie, et même s’il est vrai que le centre du pays est libéré des FARC, ceux-ci sont en train de se recomposer dans certains endroits où pourtant leurs structures militaires et leurs bases paysannes ont été vraiment affectées. Pour la première fois en sept ans de nouveaux fronts de la guérilla sont apparus dans la cordillère. C’est normal d’ailleurs, dans une guerre irrégulière qui s’est transformée depuis 2002 de façon atroce en une guerre équilibrée, qui produit un nombre de morts statistiquement acceptable mais aucun changement fondamental, une de ces guerres éternelles qui sont les plus immorales de toutes. En réalité, le conflit colombien n’a pas baissé d’intensité, ce qui a changé est que les acteurs du conflit, d’un côté comme de l’autre, s’accommodent des nouvelles conditions. Les FARC ont compris qu’ils devaient renoncer aux mobilisations de grandes troupes et à la guerre de positions et de contrôle territorial qu’ils avaient commencée à développer comme étape antépénultième à la prise du pouvoir. Ils sont revenus à une guérilla traditionnelle, du style si l’ennemi se retire, on le poursuit, mais on ne fait rien de plus… De telle façon que dans les territoires « libérés » de la guérilla, les gens ont pu retourner à leur finca[6], ce qui concerne peut-être une petite minorité qui a une finca, mais le conflit perdure. D’autant que sa résolution n’implique pas seulement un problème de territoire ou de guerre, mais celui, historique et social, de structures pourries et exsangues qui datent de la colonie, ayant traversé les cycles de l’histoire sans jamais trouver de solution. Seule une option de changement rénovatrice, me semble-t-il, sur le modèle de ce qui se passe dans les autres pays latino-américains, pourrait y parvenir, mais il existe des facteurs de poids qui s’y opposent, comme la sécurité démocratique, pour y revenir. Il faudrait parler des violations énormes des droits humains qu’elle a engendré dans les sept dernières années, les faux positifs, par exemple, la possibilité que l’armée assassine des gens innocents pour les comptabiliser dans ses résultats comme des guérilleros. La sécurité démocratique n’a pas fait diminuer le conflit, elle a endormi le pays, notamment sur les conséquences de celui-ci sur la vie quotidienne de tout le monde, et pas seulement de 10 000 finqueros. Certains endroits, comme Medellin, atteignent à nouveau les indices de violence les plus élevés du monde, comme à l’époque de Pablo Escobar. Des bandes narco-paramilitaires, liées aux pouvoirs locaux de l’uribisme, se battent. Résultat : 2000 morts dans les rues de cette ville de 4 millions d’habitants (chiffres d’octobre 2009). Tout l’argent et les efforts du gouvernement sont dédiés à la guerre contre les FARC, car ce n’est pas dans l’intérêt de la sécurité démocratique de toucher aux gangs, tous étant uribistes et paramilitaires. L’État ne peut combattre ses associés.
M. : Quel est l’avenir de la démocratie en Colombie ?
A. M. R. : Il faudrait déjà qu’il y en ait une. Celle que nous avions jusqu’à Andres Pastrana – car il faut quand même faire la différence avec ce qu’a mis en place Uribe –, n’existait pas vraiment non plus. C’était une contrefaçon, avec l’unique obligation que tous les quatre ans se produisent des élections présidentielles et parlementaires. Avant Alvaro Uribe, il n’avait jamais été nécessaire de toucher aux structures de cette pseudo-démocratie pour maintenir l’expoliation, l’exploitation, l’assujettissement des couches inférieures et les conditions sociales atroces de ce pays. Et il y avait même eu des avancées comme la constitution de 1991 qui nous avait considérablement rapproché de cette idée générale et utopique de la démocratie – car ça ne fonctionne pas bien dans le Nord non plus, n’est-ce pas ? Mais c’est une autre histoire. Eh bien ces structures, Uribe les a touchées. D’abord en abolissant la non-réélection, qui avait été mise en place pour répondre à l’absence d’alternance au pouvoir, avec deux partis historiques, le libéral et le conservateur, qui n’en étaient en réalité qu’un seul, le parti des riches. On savait que l’accumulation du pouvoir donnait ce qui s’est appelé au début du vingtième siècle les hégémonies. Conservatrice ou libérale, c’était toujours l’hégémonie d’une oligarchie. La constitution de 91 a essayé de répartir un peu plus le pouvoir en accordant une autonomie populaire dans les régions, aux minorités raciales et ethniques, etc. Concernant la réélection, le pays savait donc que ce n’était pas bon. Alors on a vu surgir toutes les combines bien connues pour acheter les consciences et les votes au Parlement et assurer la première réélection d’Uribe. Là, on va quasiment vers une seconde réélection, au risque de supprimer tous les contrepoids institutionnels et les jeux d’équilibre entre le pouvoir et l’opposition. Uribe a déjà la majorité au Congrès, une majorité complètement illégitime puisque 40% des élus sont en prison pour parapolitique et ont cédé leur poste à leur second de liste. Voilà qui sont ceux qui approuvent la réélection d’Uribe ! Si on avait appliqué la théorie de « la chaise vide », chaque personne qui a été condamnée pour assassinats ou complicité devrait non seulement être expulsée de la politique colombienne, mais son parti devrait perdre son siège. Actuellement, sans parler de l’église et de l’armée, Uribe concentre le pouvoir législatif, celui sur les instances de contrôle du fonctionnement de l’État et toutes les instances de la justice, en particulier la Cour constitutionnelle[7] qui est fondamentale dans ce pays depuis 1991. La seule qui résiste encore, c’est la Cour suprême de justice. Pour le dire autrement, nous sommes à la veille d’une dictature et si on ajoute le projet de ce qu’Uribe a nommé l’état d’opinion, c’est-à-dire que les majorités, par le fait d’être majoritaires à un moment donné, peuvent réformer les conditions structurelles de la démocratie à leur façon, il n’y a plus aucun obstacle à un régime de facto pseudo démocratique. L’état d’opinion d’Uribe est le même état de la société qui a permis dans les années 1930 l’ascension au pouvoir des Nazis. Une confluence de majorités avec une volonté autoritaire de manipulation de ces majorités qui en réalité ne sont pas plus majoritaires que l’état d’opinion d’Uribe n’est vrai. Tout cela est virtuel, médiatique et immoral. Parce qu’en réalité Uribe n’a pas de majorité. Il a été élu avec 7 millions de voix, c’est-à-dire 25% de l’électorat. 20 à 25% votent pour l’opposition, entre le Polo et le Parti Libéral, et surtout 55% des gens s’abstiennent. Est-ce que cette grande majorité qui ne vote pas est uribiste ? Fait partie de l’état d’opinion ? Pas du tout, l’état d’opinion qui veut remplacer l’état de droit, c’est les 25 % manipulés par l’unanimisme des médias au service d’Uribe. Et maintenant pour faire passer le référendum (pour approuver une seconde réélection), je suis persuadé qu’Uribe peut en arriver à des choses comme dissoudre le Congrès, appeler à de nouvelles élections et régénérer un congrès encore plus corrompu, et ainsi infiniment.
M. : Tu présentes un tableau très pessimiste, quelle pourrait en être une issue favorable ?
A. M. R. : Sans prétendre penser à de grandes choses, la première tâche fondamentale serait de résister depuis l’opposition dans une coalition large de tous les secteurs qui croyaient en cette pseudo-démocratie d’avant, qui était quand même une garantie. Résister en essayant de construire une option capable d’arrêter l’horreur d’une dictature intelligente qui n’a pas besoin de s’appeler dictature pour en être une. À court terme, je ne vois pas d’issue. Je ne sens pas que les organisations de gauche, divisées comme elles le sont, pour certaines touchées par la relation avec les FARC, pour d’autres par la corruption et le clientélisme, les mêmes perversions que les partis traditionnels et l’uribisme, y compris à l’intérieur de certains secteurs du Polo, pourraient parvenir rapidement à un point de rupture, mais on peut toujours avoir des surprises… D’un autre côté, l’espoir que l’arrivée de Barack Obama allait changer quelque chose n’a pas duré longtemps. En réalité, on n’y croyait pas tellement, qu’il était un démocrate… ou alors à l’ancienne mode des USA dont la démocratie a toujours été à leur seul usage, organisée pour imposer l’anti-démocratie au reste du monde. Donc, grande désillusion. Et maintenant, Obama est carrément devenu corresponsable des processus uribistes en accordant la certification en droits de l’homme à la Colombie, en dépit des faux positifs et des écoutes téléphoniques par les services secrets. Obama a ainsi donné un signal clair que les USA n’ont pas changé d’un pouce leur politique, ils considèrent toujours la Colombie comme leur allié inconditionnel. C’est le cas en effet des 25% qui gouvernent, comme le prouve le fait que les USA vont maintenant pouvoir utiliser sept bases militaires, incluant même des aéroports civils. L’UNASUR (Union des nations sud-américaines) s’est opposée un peu, considérant que les explications en termes de lutte contre le narcotrafic n’étaient pas convaincantes. C’est un coup dur porté à la souveraineté nationale, avec une potentialisation du conflit dans la mesure où les gringos sont entrés et que Chavez s’arme. Mais le fond du problème, c’est que nous ne voyons pas clairement comment contrer le triomphe de l’extrême droite colombienne qui a combiné toutes les formes de violence, c’est-à-dire massacré 40, 50, 60000 personnes – on ne sait pas, il faudrait ouvrir les fosses –, déplacé les paysans par milliers, fait une contre-réforme agraire sans avoir fait la réforme et s’est arrogé tous les pouvoirs.
M. : Il existe pourtant des formes de résistances, non ? En regard du désenchantement vis-à-vis de la politique traditionnelle, on a vu surgir d’autres formes d’expression politique comme la Minga, les manifs des gay parades, les marches convoquées par Facebook… Quelles sont celles qui te paraissent aujourd’hui les plus innovantes ou les plus susceptibles de transformer la réalité colombienne ?
A. M. R. : Dans d’autres pays du monde, toutes ces formes de résistance face aux tendances dominantes sont fondamentales tant pour la mobilisation de la pensée que des personnes elles-mêmes, jusqu’à la possibilité d’ouvrir de nouvelles expectatives pour perfectionner les démocraties. Je pense qu’en Colombie, les vertus qu’auraient au Nord toutes ces manifestations, ne sont d’aucun effet. Ces formes de résistance sont certes efficaces en tant qu’événements isolés, mais dans ce pays, on en a par-dessus la tête des phénomènes isolés de résistance. Il me semble qu’il y a certains mouvements très engagés dans la défense de leurs intérêts, mais qui d’une certaine manière se regardent le nombril. Quand nous devrions commencer à penser que nous nous battons contre une vraie dictature, ce que nous n’avons jamais eu à faire, ni sous Turbay[8], ni même sous Rojas Pinilla[9]. C’était une dictature de rustres qui ont tué dix étudiants et restreint la liberté de la presse. Aujourd’hui, la presse n’a même pas besoin d’être réprimée, elle est l’amie du pouvoir et nous manipule. Donc, tous ces secteurs d’opposition, la Minga, les secteurs gays, les secteurs ethniques, vivent et travaillent pour assurer leur survie. Mais on pourrait passer à d’autres choses plus nationales, s’organiser dans une opposition unitaire et élargie. Par exemple, dans le mouvement de la Minga de résistance des Indiens du sud du pays[10], il y aurait matière à des idées nationales d’opposition, ce qui serait cohérent et plein de sens. Cela permettrait d’aller au-delà des phénomènes non organisés et aussi de cesser de valoriser la débrouille (el rebusque)[11]. Car je pense que cette grande capacité colombienne à surmonter l’enfer quotidien, à trouver les 15000 pesos du jour, à s’offrir un peu de bonheur en s’achetant une fringue, ça en reste là et cela convient très bien aux secteurs les plus réactionnaires de la société qui n’ont à s’occuper ni des retraites, ni de la santé ou de la sécurité sociale, parce que 70% de la population ne participe pas du marché du travail mais de celui du secteur informel. De telle manière que la débrouille, cette chose individuelle qui paraît être de la résistance, finalement c’est une politique de la bourgeoisie, qui n’en a pas fini avec le travail légal et organisé et a créé le salaire intégral (sans prestations sociales) de telle sorte qu’aujourd’hui la majeure partie des gens qui ont un emploi ont un statut précaire… sans parler des 20 millions de pauvres et des 8 millions de mendiants. Alors, c’est quoi ça ? Mon point de vue, je n’en mettrais pas ma main au feu, mais je m’aventure à le dire, est que seulement des organisations qui ont à voir avec la politique nationale ont un sens aujourd’hui. La Minga en est une potentiellement, mais il faut créer des ponts. Il y a d’autres types d’organisations, comme celle des mères communautaires par exemple, qui gardent à leur domicile les enfants des quartiers populaires et qui ont des organisations néo-syndicales dans lesquelles il n’y a pas de patron, elles s’auto-organisent. Je pense que ces secteurs peuvent inventer une pédagogie du collectif. Les mères communautaires non seulement s’occupent des enfants, mais leur inculquent la pédagogie du collectif depuis l’enfance. Il faudrait ajouter à cela une éducation au sens formel du terme, un peu comme cela s’est fait à Bogotá, investir dans l’infrastructure éducative, les classes, les instituteurs, pour que les gens sachent au minimum distinguer le jaune du vert et créer du lien social. Mais si on ne tisse pas tout ça ensemble, les partis d’opposition avec les organisations populaires qui se battent à l’extérieur des partis, comme la Minga, la lutte des Noirs de Quibdo, comme mille choses qui existent localement et qui sont certes de grande valeur, si on ne tisse pas ensemble l’éducation, la communauté et la grande politique nationale, on ne va nulle part.
M. : Et des projets comme Planeta Paz qui cherchait à générer des espaces d’alliance, et justement à articuler des intérêts distincts autour d’un grand problème comme la paix nationale…
A. M. R. : Oui, mais tu vas voir au fond et qu’est ce que ça articule ? Cela en reste à cette nouvelle chose qu’on désigne d’un néologisme, l’ONGisme ! Des ONG qui viennent du Nord blanc, paternaliste et européen. Des organisations qui se convertissent en une structure mentale répétitive et deviennent vite conservatrices… Sans toutes ces ONG, beaucoup de gens seraient sans doute dans la merde, mais les ONG ne remplacent pas les organisations populaires. Les ONG ne luttent pas pour conquérir, mais pour soulager en général. Même les plus évoluées disent : « nous ne faisons pas de la politique ». En revanche, les organisations populaires et les partis de gauche ont à se coltiner les problèmes structurels. Dans l’erreur ou non, avec un futur ou non… Les erreurs, pour l’instant, sont de tous les côtés, des mingas et des partis. Ce ne sont peut-être pas des erreurs, d’ailleurs, mais des manques, des choses qui sont encore à faire, comme croire vraiment que la pédagogie, ce n’est pas seulement l’éducation, savoir lire ou écrire, ou l’accès gratuit jusqu’au bac, mais aussi la mobilisation politique, la politique même. Il faut s’engager socialement et politiquement pour faire que 55% des gens qui ne votent pas, votent. Si ce pays qui s’en fiche d’Uribe, qui n’est pas avec lui, votait contre lui, on aurait pas eu à le supporter, ni Turbay, ni Cesar Gaviria ou tant d’autres qu’on a du supporter parce que les gens ne se mobilisaient pas, par manque d’éducation politique, parce qu’ainsi en ont voulu l’État et la bourgeoisie. C’est pour cela que, dans ce pays, finalement chacun tire de son côté. On a des Shakira, des cyclistes, plein d’individus talentueux, mais collectivement… Il n’y a qu’à voir, tout est comme la sélection colombienne pour le mondial de football : éliminée.
Propos recueillis par Mara Viveros Vigoya & Pascale Molinier.
Traduction Pascale Molinier.
Sur le même sujet
- Les Implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du capitalisme global: transmodernité, pensée-frontalière et colonialité globale
- Le stade esthétique de la production / consommation et la révolution du temps choisi
- Emmanuelle Lainé
- Soutenir et multiplier les lanceurs d’alertes
- L’algorithmique a ses comportements que le comportement ne connaît pas