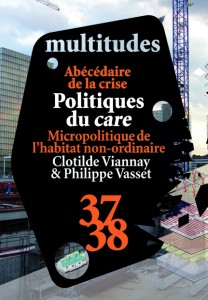Entre réciprocité du care et souhait de dépersonnalisation
Le travail domestique ne se réduit pas à une série de corvées. « Je me suis surprise souvent à mettre de ‘l’amour’ en rangeant la chambre de la petite fille, et de me dire : «je ne suis pas chez moi » écrit Sylvie Esman dans un article où elle analyse son activité en tant que femme de ménage[1]. Que perçoivent les employeuses de cette dimension de care, de souci, de travail attentionné ? Comment y répondent-elles ? C’est notamment ce que j’ai cherché à explorer, en réunissant pour trois séances de trois heures, des femmes féministes qui emploient des femmes de ménage[2].
Les féministes occupent, selon Teresa de Lauretis, une position excentrique vis-à-vis du système de genre, celle d’être à la fois en dehors de celui-ci, puisque que dotées d’une conscience critique sans laquelle le féminisme n’existerait pas, mais en même temps dedans, dans la mesure où nul ne peut prétendre vivre, travailler et aimer, sans une certaine complicité avec les institutions et les appareils culturels. Le genre « colle à la peau comme une robe de soie mouillée »[3]. C’est à partir de l’analyse de ce qui lui « résiste » – pas seulement du côté des hommes ou des femmes qui ne se disent pas féministes –, qu’on peut continuer à investir le potentiel subversif du féminisme ainsi que sa capacité d’agir à un niveau individuel ou plus politique. Tel était le pari de ce groupe de discussion : accepter l’empêtrement, l’embarras, privilégier la « mauvaise conscience » comme une voie d’accès à ce qui d’habitude n’a pas d’expression publique. Vue par ce prisme, la relation avec la femme de ménage rend manifeste une tension psychologique entre le désir d’être servi sans avoir à y penser – où l’on retrouve ce que Joan Tronto désigne comme « l’irresponsabilité des privilégiés » – et le désir de créer un lien réciproque qui « domestique» cette relation (voir Martin-Palomo, ici). Cette tension n’est pas propre à la relation entre ces employeuses et leurs employées domestiques, elle interroge plus largement notre rapport au care en tant que nous en sommes tous bénéficiaires.
Faire bon ménage
Le groupe de discussion (formé par la méthode dite « boule de neige ») est très homogène : 7 femmes, blanches et hétérosexuelles, entre 37 et 60 ans avec un niveau d’études supérieures, pour la plupart des intellectuelles, certaines avec des préoccupations professionnelles concernant le travail féminin. Le propos se situe sur cette fameuse frontière entre le privé et le public que les féminismes de la seconde vague ont tous souhaité défaire. La formule est célèbre : le personnel est politique. La femme de ménage vient mettre le doigt exactement là où ça fait mal : dans la contradiction entre les théories et les pratiques, les idéaux et les compromis.
Les propos amers de Nadège[4] résument bien la situation :
La pacification conjugale est, dans ce groupe, à une exception près[5], le motif principal pour lequel la femme de ménage devient un jour nécessaire. Bien sûr, avoir été élevé avec des femmes de ménage ou des nounous favorise la décision d’en employer une à son tour, surtout avec l’arrivée des enfants. La femme de ménage est une solution bourgeoise pour réduire de façon efficace (jamais totale) le conflit avec le conjoint qui renâcle au partage des tâches. À partir de là, même si les participantes disent résister fortement aux injonctions masculines du style « tu diras à la femme de ménage que », le management et le malaise domestiques deviennent leur affaire.
Des patronnes « cool » pour des employées politiquement correctes
Maïté évoque sa belle-mère bourgeoise et, comme disait celle-ci, « ses petites bonnes ». Quel serait le modèle adéquat de la patronne féministe ? Précisément, ne pas « exploiter », ne pas être patronne. On est entre « patronnes cool » dit encore Maïté.
Les participantes du groupe reconnaissent unanimement que le travail domestique constitue un vrai métier. Il est d’ailleurs assez paradoxal de constater que c’est plutôt leur travail à elles qui n’apparaîtrait pas, dans leur foyer, comme un « vrai » travail. Lire un livre, écrire, ne serait pas perçu comme tel, ni par leurs enfants (qui les dérangent quand elles le font), ni supposent-elles, par les femmes de ménage. À moins qu’elles ne projettent sur ces dernières une gêne, dont on peut se demander si elle n’est pas spécifiquement féminine : la culpabilité de réaliser une activité intellectuelle pendant qu’une autre femme réalise leurs tâches domestiques ? Les participantes s’accordent à limiter les « ordres » et les consignes au maximum. Mieux vaudrait parfois que le travail soit mal fait plutôt qu’il soit source de conflit avec l’employée et de tracas supplémentaires (faire une liste détaillée des tâches, vérifier le travail en douce, chercher comment dire au mieux sans froisser)[6]. Elles décrivent favorablement des situations où l’employée à un niveau d’expertise domestique supérieur au leur. Celui-ci n’est pas seulement un gage d’efficacité, mais tendrait aussi à rendre la relation plus égalitaire, chacune ayant son domaine d’expertise, son « métier ». Cette « égalité » reste cependant relative, comme le dit Audrey :
Ainsi, même celles qui considèrent pourtant le travail domestique comme « un vrai métier » ne pourraient pas demander du ménage à n’importe qui. Selon Nadège, certaines féministes tendraient à réduire le malaise en ayant recours à « un homme de ménage », une stratégie qu’elle juge hypocrite. Elle-même se dédouane en ayant recours à la médiation d’une association de réinsertion de femmes en difficulté qui assure le respect des salaires et conditions de travail, en même temps qu’elle offre des ouvertures en termes de formation, ainsi qu’une indépendance pour les deux parties.
Elsa raconte qu’une « Marocaine très émancipée » nettoie habituellement la maison de villégiature familiale. La dernière fois, elle n’était pas disponible. Il a fallu aller chercher sa sœur dans un village éloigné, ne parlant pas bien français, voilée et accompagnée de sa petite sœur de huit ans, à la fois pour l’aider à communiquer et « sûrement pour la surveiller ». « Tout dépend de la personne et de la façon de vivre », commente Elsa qui n’a pas supporté de demander à cette femme incarnant pour elle « l’enfermement total», ce qu’elle demandait sans problème à sa sœur « émancipée ». Comme si trop d’asymétrie brisait la possibilité d’établir une relation sur des bases moralement acceptables.
Se sentir « exploiteuse » dépendrait en grande partie des représentations que les participantes se font du destin social de leur employée. Les femmes en réinsertion, les filles de l’employée d’Audrey, la « Marocaine émancipée » incarnent des formes supposées de mobilité sociale où faire le travail domestique chez les autres n’est qu’un moment dans une biographie personnelle ou familiale. D’autres situations sont au contraire jugées inacceptables en raison du niveau élevé de qualification : une Polonaise avait un diplôme d’opticienne, une Burkine, professeur d’histoire. Elsa se demande cependant si sortir du village, voir des gens, ne serait pas profitable à la « sœur voilée ». Sa perplexité est intéressante : il n’existe pas de profil politiquement correct de La femme de ménage. On ne peut juger de la situation de chacune qu’en fonction de la singularité de celle-ci, ce qui implique de d’abord créer un lien.
Éloge de la transparence
« Si je dois décomposer les tâches avant qu’elle le fasse, c’est du travail en plus ».(Nadège )
Le travail domestique, on le sait, pour être bien fait ne doit pas se voir et ne pas gêner la vie quotidienne de qui en bénéficie, sinon, il est raté. Nadège estime avoir actuellement l’employée parfaite. Elle est « transparente ». « Elle remet à l’identique. Sûrement… ça prend plus de temps… ». Mais plus souvent les employées se rendent visibles à travers un style ou des objets qui portent la marque de leurs propres goûts esthétiques, de leur culture. L’échec du travail discret trouve ainsi son expression la plus manifeste dans la « faute de goût ». Maïté, après avoir dit en début de séance, « j’adore cette femme, on cuisine ensemble, on jardine ensemble… », ajoute :
« Il y a quand même des choses qui me gênent. Tous les ans, elle va au Portugal, elle ramène des trucs, la dernière fois une assiette de porcelaine… un truc très moche. Dans ma cuisine, il faut savoir que j’ai une œuvre d’art, faite par une copine, enfin, on en pense ce que l’on veut… Elle (la femme de ménage) dit : « ça, on l’enlève » et elle met l’assiette portugaise à la place. Qu’est-ce qu’on fait ? On a remis notre… On a fini par se débarrasser de l’assiette. Une autre fois, c’est une petite Vierge de Fatima pour porte-bonheur, c’est très laid. Elle impose que ça soit visible. Elle trouve ça beau. C’est pour marquer son territoire. »
L’asymétrie sociale et culturelle, pourtant combattue par Maïté à travers des gestes de réciprocité et des tâches partagées, est exprimée brutalement dans un a priori qui oppose le beau qui peut faire l’objet de jugements appréciatifs et de débats (l’œuvre d’art de l’amie) et le laid qui relève d’un jugement péjoratif sans appel (c’est moche) entre gens partageant le même style de vie et d’esthétique (femmes occidentales très qualifiées).
Il arrive aussi que les initiatives des employées fassent l’objet d’un jugement esthétique favorable, et que soit alors pointée la menace d’intrusion :
Les participantes apprécient donc particulièrement les savoir faire discrets de leurs employées. Toutefois, leurs propos mettent en évidence un point important : non seulement le travail doit disparaître, mais la personne physique et la personnalité des employées avec. Or, toute intervention sur le monde implique un processus d’activité subjectivante[7]. Pour être efficace dans le travail, il s’agit de faire corps avec l’environnement, le sujet percevant celui-ci comme un prolongement de lui-même. Le travail domestique, comme tout travail, nécessite ce type d’appropriation sensible de l’environnement. Le soin qu’on apporte à un espace domestique – même si ce n’est pas le sien – est personnalisé à l’image de soi. Les participantes s’accordent à penser que les femmes de ménage font « comme elles feraient chez elles »[8]. D’où une contradiction majeure : le travail domestique pour être réussi devrait être discret, mais on ne pourrait le faire sans y imprimer son propre style de vie, ses caractéristiques personnelles et culturelles. Il ne pourrait donc jamais pleinement satisfaire ceux ou celles qu’il sert ?
La poudre à disparaître
Dans La société décente, Margalit utilise également la terminologie de la « transparence » pour parler de la relation humiliante à l’indigène. Il évoque « ’la poudre à disparaître’ que l’on répand pour ainsi dire sur les Arabes des territoires occupés qui travaillent en Israël – une poudre qui les rend invisibles : ’Un bon Arabe doit travailler, pas être vu’ »[9]. Ici, le territoire n’est pas indûment occupé – « c’est quand même chez nous ». Pourtant, pour que le travail soit apprécié, la personne qui le fait doit également disparaître. « On attend des serviteurs, écrit aussi Margalit, qu’ils fournissent l’effort nécessaire pour que leurs maîtres les ignorent aisément et en toute sécurité ». C’est ce à quoi parvient l’employée appréciée par Nadège dont la transparence est le résultat d’une combinaison entre son savoir-faire et l’absence de Nadège[10]. On peut toutefois se demander si cette dépersonnalisation de la relation n’est pas à mettre en relation avec l’usure que Nadège mentionne également : « Il y a un cycle de la femme de ménage en association. Elle démarre très très fort. Passée la deuxième année, ça va en se délitant… » Comme le souligne Elsa : « On sent bien qu’elles ont besoin de nous voir. Seule, c’est pas rigolo. »
Dans les relations de plus longue durée, la présence et les expressions de la personnalité de l’employée provoquent parfois de la gêne. Selon les différents récits, elles peuvent être vécues comme une menace d’envahissement (« c’est quand même chez nous ») ou de fusion-confusion. Ainsi Elsa évoque « une certaine prise de pouvoir sur son espace », avant de dire : « Elle fait comme moi. Si je fais des travaux dans ma salle de bain, elle en fait aussi, ça me culpabilise… » Nadège s’exclame avec une sorte d’effroi : « Oh elle s’identifie à toi ! Mais moi, je trouverai ça très inquiétant ! »
Véronique évoque une situation ancienne où elle a « profité d’un déménagement » pour « se séparer » d’une femme qui réalisait des tâches ménagères et gardait ses enfants. « C’était une femme isolée », dira-t-elle. « Sa solitude, ça m’arrangeait… » Véronique nuancera ensuite ce premier tableau : « Mais ce n’est pas vrai ! Il y avait un homme avec qui elle vivait. Cet homme est mort, elle m’en a voulu de n’être pas allée à son enterrement ». « C’était lourd, c’était pesant » dit Véronique pour qualifier son vécu de la période durant laquelle cette femme savait déjà qu’elle « ne suivrait pas ». « Ce qui était oppressant, c’était de me sentir plus ou moins pas gentille de ne pas l’emmener, de ne pas poursuivre une relation qui a duré dix ans. De ne pas lui donner toute la reconnaissance, de me séparer d’elle. » Mais en même temps, « se séparer d’elle, ça me soulageait (…) Elle était tout le temps à valoriser ce qu’elle avait fait. Elle adorait mes parents, mes beaux-parents… Elle m’en voulait. Elle n’a pas apprécié de ne pas avoir mon troisième enfant en nourrice, comme les deux précédents, elle avait vécu ça comme une première trahison ». Véronique raconte alors comment son premier-né étant bébé, au retour du travail, elle demandait si cela s’était bien passé : « oui, oui ». Bien des années plus tard, l’employée a révélé que l’enfant en réalité pleurait très longtemps. « Je comprends qu’elle ne disait rien, parce qu’elle avait besoin de ce boulot, mais si j’avais su… j’aurais pu expliquer autrement à l’enfant… » « C’était quelqu’un de pas clair, conclut-elle, une image qui s’embrouille un peu, une personnalité qui ne se laisse pas saisir… » L’histoire de Véronique fait apparaître de l’opacité : une épaisseur psychologique, des motifs qui échappent, une présence qui « pèse », « une sorte d’emprise », dit-elle encore.
24 On ne peut pas dire que le désir que l’employée s’efface en tant que personne soit le fruit d’une volonté de l’humilier pour la soumettre, comme on l’interprète dans les analyses classiques des relations entre maître et domestique, colon et colonisateur. Pourtant, on retrouve bien ici la dépersonnalisation et l’isolation, deux traits saillants de « la condition de bonne à tout faire », théorisée dans les années 50 par le psychiatre Louis Le Guillant pour qui celle-ci illustrait « avec une force particulière les mécanismes psychologiques et psychopathologiques liés à ces composantes de la condition humaine que sont la servitude et la domination »[11].
La dépersonnalisation consiste, pour le dire dans les termes de Margalit, à créer les conditions qui permettent de « ne pas voir les personnes dans le détail », de neutraliser les expressions de leur individualité, comme s’ils étaient des objets dans le décor[12]. Le souhait que l’employée se fasse transparente renvoie à un voeu inconscient dont Jean Cocteau a donné une traduction poétique dans La Belle et la Bête : le vœu d’un care sans sujet où les serviteurs sont réduits à des bras candélabres ou des mains verseuses de carafe, une disponibilité sans visage n’attendant aucun retour.
À deux reprises, les participantes du groupe se sont attardées sur leur irritation cyclique devant l’ordonnancement symétrique des objets – coussins en rang d’oignon, bibelots aux quatre coins de la table, plaid plié au carré. Cette mise en ordre perturbe et conteste l’esthétique bobo du déstructuré faussement négligé. On pourrait n’y voir qu’un indice anecdotique de l’irréductibilité des rapports de classe. Pourtant, si on accepte d’accorder à ces propos l’importance que les participantes leur ont accordés, on se trouve confronté à une vraie difficulté théorique : la scène tout à fait particulière sur laquelle se jouent les antagonismes domestiques : la maison en tant qu’elle est le corps, l’espace psychique, ce qui interroge « la relation étroite entre l’ordre des choses dans le monde où nous vivons et la structure intérieure de cet ordre ».[13] La bonne employée, c’est donc celle qui ne perturbe pas l’ordre psychique des choses[14].
Chez soi : il faudrait envisager ce terme comme un concept-clé dans l’analyse du partage du care domestique. Les employées voudraient « marquer leur territoire ». On peut entendre cette métaphore comme particulièrement péjorative : comme si les employées domestiques étaient des animaux. Mais on peut aussi penser que « le territoire » renvoie, pour l’employeuse également, à des dimensions archaïques qui ont à voir avec la préservation de sa propre intégrité. Comme on l’a déjà souligné, des fantasmes de menace d’intrusion et de confusion ont été clairement exprimés dans le groupe.
Ainsi que le souligne Margalit, « l’humiliation n’exige pas d’humiliateur », et l’on ne sait pas comment les employées perçoivent et ressentent les stratégies « poudre à disparaître » de leurs employeuses « cool ». Pour Le Guillant, le ressentiment des bonnes était intrinsèque à leur condition, on peut se demander si l’irritation et le sentiment d’être envahie ne sont pas intrinsèques à la centralité psychique de « l’habiter ». Cela chaufferait toujours, et des deux côtés. L’expression du trop de présence des employées prend des formes culturelles du fait de leur origine sociale. L’irritation des employeuses est alors teintée de condescendance, de jugements de classe et de race, quand bien même elles s’en défendent.
Où s’attendrit la domination
Le care dans le travail réalisé par l’employée s’exprime avec plus ou moins de succès et de discrétion dans le soin apporté à l’environnement domestique. Mais d’elle, qui se soucie ? Le care, en tant qu’attention portée à l’employée par son employeuse, est en contradiction avec le souhait de dépersonnalisation et cette tension traverse la plupart des relations décrites par les participantes. Le souci, l’attention, sont exprimés dans les cadeaux échangés, dans les gestes de réciprocité, de prohibition ou de partage des tâches désagréables. Plusieurs participantes décrivent aussi des stratégies de réciprocité ritualisées, comme le café, parfois servi par l’employeuse, qu’il soit pris ensemble ou séparément selon les cas.
La dimension du souci de l’autre est explicite dans la tonalité attentionnée des propos d’Elsa, la seule à désigner sa femme de ménage par son prénom. Elle décrit une relation très étroite et affective. « Quand elle me dit, ton canapé, il est pourri, je l’écoute . Elle a mal aux épaules, son avenir m’inquiète, elle a 54 ans, mais elle est abîmée, je lui cherche du travail pas trop dur. » Elsa évoque les transformations de son chez soi comme relevant d’un souci, d’une attention teintée d’affection. « C’est fait avec vachement de soin, avec de la conscience professionnelle. C’est attendrissant Elle cherche à mettre sa pâte esthétiquement chez moi. » Le travail de l’employée domestique est alors pleinement reconnu dans ses dimensions esthétique et éthique : créer un bel environnement pour que les personnes y vivent bien (voir aussi le canapé oriental chez Audrey). L’interprétation en termes « d’attendrissement », de petits détails qui pourraient être irritants – les objets déplacés ou arrangés différemment – suggère qu’Elsa admet aussi que son intérieur porte l’empreinte personnalisée de Rachida, comme elle semble admettre une certaine perméabilité entre leurs vies personnelles sans (trop de) crainte de confusion : le mimétisme dans les travaux. Finalement, Elsa décrit une relation où ce qui fait énigme pour elle, c’est précisément l’implication affective de part et d’autre dans une relation où chacune se sent responsable de l’autre. « J’ai souvent pensé, dit-elle encore, comme je vis seule, que s’il m’arrivait quelque chose, c’est elle qui me trouverait . »
Alors que, pour Nadège, le conflit moral de « l’exploitation » est résolu par le recours à l’association et par son faible niveau d’exigence domestique, dans la relation entre Rachida et Elsa, il semble que le conflit moral soit toujours susceptible de se réactiver dans des situations concrètes où se renégocient les limites de ce qu’il est acceptable de demander ou de faire. Elsa raconte avoir un jour demandé à Rachida de servir dans un baptême qui réunissait une quarantaine de pieds-noirs de sa famille. L’origine des convives rendait la situation plus servile, motif d’un refus initial qu’Elsa a réussi à transformer en proposant qu’elles serviraient ensemble. Elsa suggère aussi qu’il ne serait pas toujours facile d’évaluer pourquoi une tâche est vécue comme plus pénible ou servile que d’autres. Rachida n’aimerait pas nettoyer les cuivres, particulièrement la poignée extérieure de la porte, parce que, selon Elsa, ce serait un travail « somptuaire » et non simplement utile. Elsa laisse ainsi soupçonner qu’elle comprend qu’un travail « somptuaire » pourrait être un travail humiliant. Les participantes font une hypothèse supplémentaire : ce n’est peut-être pas seulement parce que la poignée de porte est en cuivre, que l’employée répugne à la nettoyer, mais aussi qu’elle est située à l’extérieur de l’appartement. Des personnes peuvent la voir travailler dans l’activité dévalorisée de femme de ménage, ce qui redoublerait l’humiliation.
Si c’est maman…
Le dilemme de la « séparation » racontée par Véronique comme le témoignage d’Elsa suggère que la relation employeuse-employée n’est supportable dans la durée que si elle se « domestique », devient affective et morale. À propos des travaux dans la salle de bain, Elsa commente :
« Pour régler la question de l’exploitation, on introduit un rapport de famille, ce qui évite la culpabilité », dit encore Elsa. « Si c’est maman » passe cependant à la trappe que les « mamans » pourraient être exploitées par leurs enfants ! On aime sa mère aussi pour ce qu’elle nous sert discrètement, et on la hait, surtout à l’adolescence, quand elle ne répond pas idéalement à l’entrelacs confus et contradictoire de nos attentes[15]. Joan Tronto a raison de critiquer la réduction de l’ensemble des situations de care à celle, mythique, de la dyade mère-enfant. L’occultation du travail de care dans l’amour maternel constitue néanmoins la matrice principale des fantasmes de disponibilité illimitée qui sous-tendent les requêtes adressées par les bénéficiaires du care à ses pourvoyeuses. Et la perspective du care n’aurait d’ailleurs sûrement pas émergé sans l’exaspération de certaines mères en rébellion contre la naturalité de leur position de subalterne dans leur propre famille.
L’inquiétante étrangeté de l’ordinaire
Les résistances masculines au partage des tâches ne sont pas affrontées jusqu’au bout par les femmes de ce groupe, mais stratégiquement contournées grâce à l’emploi d’une femme subalterne. Le recours à une femme de ménage afin d’éviter la scène de ménage participe d’un déplacement qui permet de tenir la posture féministe dans un féminisme individualiste, mais sans changement social, en maintenant une culture qui continue de favoriser les hommes et implique une réserve de main d’œuvre féminine non qualifiée. Même si elles s’en défendent parfois, les participantes le savent, tout comme elles savent bien ce qu’elles sont en train de transmettre à leurs enfants comme modèle. Et la « soie mouillée » continue de coller à la peau. Que le lien soit évacué au profit d’un registre impersonnel (Nadège) ou surinvesti dans un registre pseudo filial (Elsa), dans les deux cas, se réduisent les occasions de penser sa propre compromission dans le système de genre, de classe et dans l’héritage colonial. Car, si entre la fille de pieds-noirs et la Marocaine, l’histoire coloniale « pèse » inévitablement, elle est l’un des pivots invisibles autour duquel se nouent la plupart des relations employeurs et employées domestiques dans la France d’aujourd’hui. Dans le groupe de discussion, toutes n’ont d’ailleurs parlé que de femmes venant de pays du tiers-monde ou de pays européens plus pauvres que la France : le Portugal et la Pologne.
De la prise de notes à leur interprétation, tout au long de ce travail, j’ai éprouvé un sentiment tenace d’insécurité et de scepticisme face à une « évanescence du réel », un réel si proche et si quotidien que l’on pourrait mettre en relation avec ce que Stanley Cavell appelle « l’inquiétante étrangeté de l’ordinaire ». Une étrangeté sans doute mieux servie par le cinéma et la littérature, qu’on pense à La Porte de Magda Sazbo ou aux nouvelles de Grace Paley. Mais du point de vue de l’analyse psychologique ou sociologique ? Quel intérêt, par exemple, de relever que Dominique a dû renoncer aux produits ménagers bio, la femme de ménage n’en voulant pas car elle devrait frotter plus ? Ce fading constitue en soi une donnée importante de cette incursion dans le monde du domestique. Sous condition de prendre le care au sérieux, la question est : Comment se soucier d’écologie sans aggraver les troubles musculo-squelettiques de la femme de ménage ? Plus largement, dans quel cadre théorique peut-on formuler de façon pertinente ou significative les questions soulevées par le care ? Comme le souligne Sandra Laugier, le care nous invite non pas à révéler l’invisible, mais à voir le visible, celui qui est juste là, sous notre nez. Pour en tenir compte éthiquement et politiquement. Ainsi défamiliarisés, maintenant, ces produits sous l’évier, cette boule de cuivre astiquée sur la porte d’entrée, allons-nous les voir plus… précisément ?
Notes
[ 1] S. Esman, « faire le travail domestique chez les autres », Travailler, 2002, 8 : 45-72.
[ 2] L’investigation a été réalisée avec Valérie Moreau, psychologue du travail.
[ 3] T. de Lauretis, Théorie queer et cultures populaires, Paris, La Dispute, 2007 (voir le chapitre La technologie du genre).
[ 4] Tous les prénoms ont été changés.
[ 5] Audrey décrit un couple où le partage des tâches est égalitaire, mais la femme de ménage nécessaire du fait des cinq enfants de cette famille recomposée.
[ 6] Certaines femmes (même profil) m’ont fait savoir que, pour leur part, elles avaient renoncé à employer une femme de ménage, car elles rangeaient et nettoyaient tout avant son arrivée.
[ 7] F. Böehle, B. Milkau, De la manivelle à l’écran. L’évolution de l’expérience sensible des ouvriers lors des changements technologiques. Paris, Eyrolles, 1998.
[ 8] S. Esman (op. cit.) note : Deux expressions que l’on m’adresse souvent résument l’ambiguïté: « Faites comme pour vous » et « mettez-vous à ma place… »
[ 9] A. Margalit,1996, La société décente, Paris, Flammarion 2007.
[ 10] Manier « la poudre à disparaître », c’est aussi partir avant que la femme de ménage n’arrive, de sorte qu’on ne la voit ni ne lui parle, une stratégie utilisée par plusieurs personnes du groupe.
[ 11] Le troisième serait le ressentiment des domestiques qui génèrerait une « haine ravalée ». L’histoire de Véronique suggère en creux le ressentiment de son ancienne employée.
L. Le Guillant, 1957, Incidences psychopathologiques de la ’condition de bonne-à-tout-faire’ », ré-ed in Le drame humain du travail, Toulouse, Éres, 2006.
[ 12] Par le port de l’uniforme par exemple.
[ 13] R, Kuhn, « L’errance comme problème psychopathologique ou déménager », Présent à Henri Maldiney, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1973.
[ 14] Une affaire de savoir-faire, mais pas seulement. Dans le roman de Nathalie Kuperman, J’ai renvoyé Marta (Folio, 2005), la folie de l’héroïne s’amorce avec l’embauche d’une femme de ménage qui porte, entre autres coïncidences, le même prénom que sa grand-mère et sa fille.
[ 15] Voir Lise Gaignard, dans « À plusieurs voix autour de Teresa de Lauretis », Mouvements, 57, 2009, p.148-154.