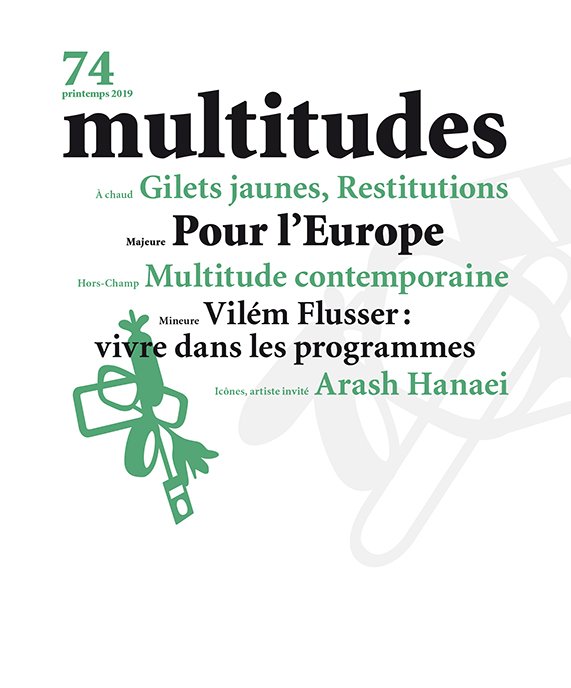La science de la Renaissance doit à l’Islam un de ses modèles de la connaissance : la curieuse idée que la nature est (comme) un livre (natura libellum)1. Cela suppose que la nature a un auteur (Dieu), une signification extérieure à elle-même (la métaphysique), une structure de séquences linéaires (la causalité), et un accord préalable entre l’auteur et le lecteur de la nature (une foi). C’est la dernière supposition qui mérite une attention plus proche.
L’auteur d’un livre compose des symboles spécifiques (des lettres, des chiffres) en lignes pour former un texte. Le lecteur doit avoir appris la signification de ces symboles avant la lecture. Il lui faut disposer d’un dictionnaire pour déchiffrer le code du livre. Selon l’Islam, l’auteur de la nature a effectivement publié une telle clé de son code : l’Alcoran. Celui qui veut déchiffrer la nature doit avoir lu l’Alcoran.
La science de la Renaissance n’a pas pu accepter cette partie du modèle : il lui manquait la foi en l’Alcoran. Mais elle disposait d’une clé comparable : de la mathématique et de la logique grecques. Bien sûr, la substitution de l’Alcoran par la mathématique avait pour conséquence un changement profond du livre de la nature. Il n’était plus écrit en arabesques, mais mathématiquement, et son auteur se transformait, pendant son déménagement de l’Espagne en Italie, d’un écrivain du destin (maqhtub) en un mathématicien divin (Newton). Mais la structure du modèle restait la même : la nature était toujours un livre, et la science moderne est toujours plus cordobaise qu’elle n’est byzantine.
Ce n’est pas dire que l’interprétation de la connaissance scientifique n’ait pas changé au cours des siècles : elle a tellement changé qu’on ne reconnaît plus l’épistémologie originelle (l’adéquation de l’intellect à la chose) dans les épistémologies de l’actualité. C’est la praxis de la connaissance scientifique qui est restée la même : la lecture du livre de la nature. On apprend d’abord son code (la mathématique et la logique), et on déchiffre ensuite le texte pas par pas. La science doit sa progressivité (le fait qu’elle « découvre ») à la structure linéaire de son modèle livresque, et elle doit sa dialectique entre la théorie et l’observation, à la dialectique entre code et message qui caractérise le livre.
Le modèle « livre » devenait de plus en plus refoulé par l’abandon successif de ses suppositions. La science ne suppose plus qu’il y a un auteur de la nature, ni qu’elle signifie quoi que ce soit, et elle doute même de sa structure causale. Comment donc parler d’un « livre » en l’absence d’un auteur, d’une signification et d’une structure linéaire ? Néanmoins, quoique refoulé, le modèle est toujours effectif : la science déchiffre toujours la nature sur la base du code mathématique et logique2.
On peut expliquer l’origine de ce modèle de diverses manières. Par exemple, par la foi juive, selon laquelle Dieu se « révèle » dans ses textes. Ou par le fait que les scientifiques médiévaux étaient des scribes, avaient donc la praxis des livres, et les utilisaient comme modèles. Mais peu importe l’explication du curieux modèle3 : il est certain qu’il ne se prête pas comme modèle de la connaissance pour les illettrés. Ni pour ceux qui, comme nous, ont perdu la confiance dans les textes. La crise du livre est aussi une crise du livre comme modèle de la connaissance.
Cette crise permet de voir que l’hypothèse de l’infrastructure mathématico-logique de la nature est un article de la foi, comparable à la foi coranique. Ainsi, l’homme peut être considéré comme mémoire qui emmagasine des informations codées. Il se trouve dans le monde selon les informations qu’il emmagasine : il vit, connaît, juge et agit selon ce programme. Un homme programmé par la mathématique connaît mathématiquement, et un homme programmé par l’Alcoran connaît coraniquement.
La question quant à l’origine du programme (« qui programme qui, comment et pourquoi ? ») ne se pose pas d’un tel point de vue : la communication productrice et accumulatrice des informations se présente comme un réseau composé de mémoires individuelles (des « esprits », des « intellects »), liées par des fils (« situations culturelles ») et formant une mémoire collective (une « société », une « culture »). L’affirmation que la culture est un produit de l’esprit est aussi fausse que l’est l’affirmation que l’esprit est le produit de la culture : de ce point de vue, les deux sont le produit du programme fondamental de la communication. Ou : la foi ne naît pas dans « l’intimité de l’âme », ni dans un contexte culturel, mais c’est la foi qui soutient et l’individu et la société, et c’est elle qui permet qu’on puisse parler d’un individu et d’une société. On n’a pas un programme, on est programmé. On n’a pas une foi, on est dans une foi.
Tout code exige sa méthode de décodage. Les codes linéaires sont décodés comme des colliers : on les compte, raconte et calcule. Les informations codifiées en lignes sont des additions, des histoires. Ceux qui sont programmés par ce type de codes se trouvent dans le monde « historiquement » : être, pour eux, est devenir, et vivre, pour eux, est avancer. C’est cela le programme de l’Occident. La science est la dernière manifestation de ce programme. En elle, le programme occidental se réalise, et donc, la foi occidentale s’épuise.
Cela se manifeste par la crise de l’objectivité. L’objectivité est la thèse selon laquelle une connaissance sans jugement préalable de la chose à être connue serait possible. Une connaissance « sans préjugé » et « sans valorisation préalable ». Il s’agit du dernier avatar de la foi occidentale. La foi occidentale est une foi de salvation progressive, car elle est programmée linéairement. Le chemin de l’histoire mène vers Dieu en dépassant le péché, ou le chemin de la sagesse mène vers les idées en dépassant les apparences. La dernière formule est la science : elle mène vers la connaissance objective en dépassant les idéologies.
Notre crise nous montre que l’objectivité est impossible et qu’elle serait indésirable. Elle est impossible, car on ne connaît que cela qui intéresse (c’est-à-dire sur quoi on a déjà porté un jugement de valeur). Et elle serait indésirable, car suspendre tout jugement de valeurs serait amputer une dimension humaine et devenir monstre. Cela se montre théoriquement et pendant la praxis scientifique, mais cela se montre surtout dans l’application de ladite « science pure » : les expériences médicales dans les camps de concentration, la physique nucléaire dans les laboratoires de recherche militaire, les technocrates dans les systèmes totalitaires. La foi en l’objectivité, en la pureté salvatrice de la science, se montre « mauvaise foi ». Le but du programme occidental, ce sont les propositions scientifiques : elles articulent ce programme à perfection, car elles sont le calcul (propositionnel) parfait. Et notre crise montre que ce but est monstrueux. La foi occidentale est, finalement, épuisée.
Notre crise n’est pas seulement la perte de la foi en l’objectivité scientifique. Notre programme est menacé partout, aussi bien dans le monde codifié qui nous entoure que dans notre intimité. Ce n’est pas telle ou telle manifestation du programme occidental qui bascule, c’est l’existence occidentale elle-même, cette existence historique, dramatique, conceptuelle, progressive, qui est à la mort. Néanmoins, la crise de la foi en la science illumine notre situation par une lumière pénétrante, car les dernières générations étaient programmées pour la science, comme le Moyen-Âge a été programmé pour l’église. Nous croyons toujours que les propositions scientifiques sont valables « toujours », partout et pour tout le monde (qu’elles sont « catholiques »), quoique nous sachions qu’elles sont codifiées par un code spécifique, et donc déchiffrables (croyables) seulement pour ceux qui en possèdent la clé. La crise de la science va jusqu’au fond de notre crise, qui est une crise de programme.
Nous sommes « tombés en dehors de la foi », nous sommes capables de voir le programme occidental de dehors, et donc la science dans son contexte. Elle se présente comme un point de vue possible. Ce point de vue projette une vision mathématique, comme le point de vue islamique projette une vision coranique, et le point de vue des indiens Kra une vision magique. On ne peut pas vouloir distinguer entre points de vue « plus ou moins vrais » ou « plus ou moins valables ». Pour ceux qui sont programmés pour la science, seule la vérité scientifique est acceptable, et seules les techniques scientifiques sont valables, comme, pour ceux programmés pour la culture Kra, seule la vérité mythique est acceptable, et seules les techniques magiques sont valables. Donc, il n’y a pas de mystères ou miracle dans le fait que la nature se comporte mathématiquement, ou que la science fonctionne « réellement » : c’est ainsi pour nous, qui sommes programmés pour la science, mais non nécessairement pour nos petits-fils. Pour les indiens Kra, la nature se comporte mythiquement, et la magie fonctionne « réellement».
Mais, tout point de vue rend visible tout autre point de vue. Je peux expliquer l’islam et la magie Kra, et le théologue islamique peut condamner la science comme un péché. Avoir perdu la « foi », ce n’est pas tolérer avec indifférence tous les points de vue, comme c’était le cas de tous les athées croyants du XVIIIe siècle. Avoir perdu la « foi » ne mène pas vers le scepticisme, car une telle perte est beaucoup plus radicale. Donc : non pas « tous les points de vue sont faux, car il n’y a pas de point de vue véritable ». Mais : « tout point de vue a sa propre validité, sa propre expérience, sa propre valeur, sa propre vérité, et tout point de vue englobe tous les autres ». Donc : non pas « la science se trompe et elle est impuissante ». Mais : « la science peut tout expliquer et tout faire, comme le peut faire n’importe quel autre point de vue. Ou non pas : « le livre comme modèle de la Renaissance est un mauvais modèle ». Mais : « le livre est un des modèles de connaissance possibles ».
Dans le manque de programme qui est le nôtre, on peut sauter de point de vue à point de vue. Et on verra que les points de vue ne « montrent » pas, ils ouvrent un panorama. Nous ne « sommes » pas pendant le saut : nous sommes ce que nous sommes en fonction du point de vue que nous occupons. Le point de vue scientifique « réalise » l’univers de la science et l’homme moderne. C’est le point qui est le « concret », dont la vue et le voyeur sont des abstractions. Donc : plus nous changeons de points de vue, plus nous vivons (plus nous « sommes »).
Aussi, dans le manque de programme qui le nôtre, on verra que la solidité d’un point de vue dépend du nombre de ceux qui l’occupent. Le point de vue scientifique est plus solide que celui de la théosophie, car le nombre de ceux qui l’occupent est plus grand. La vérité, la valeur, l’expérience est une fonction du nombre de ceux qui le partagent. Donc, sauter de point de vue en point de vue est les solidifier tous, et le faire ensemble avec les autres qui sont avec nous (qui « doutent » comme nous). L’intersubjectivité substitue l’objectivité perdue, ce qui, bien sûr, ne constitue pas encore un programme.
Mais cela constitue une deuxième lecture du monde possible. Et, curieusement, elle englobe la première lecture, la scientifique qu’elle substitue. La science reste « valable », même après la chute du programme occidental, quoiqu’elle soit « valable » pour des valeurs nouvelles que nous ne pouvons pas encore articuler par manque de programme (foi).
1 La date de rédaction de ce texte n’est pas indiquée, il date probablement du milieu des années 1980. Ce document porte le no 2942 dans les Archives Flusser ; il a été retranscrit du tapuscrit et édité par Daphné Lacasse.
2 Le manuscrit donne : « à la base ».
3 Le manuscrit donne : « Mais n’importe quelle explication ».