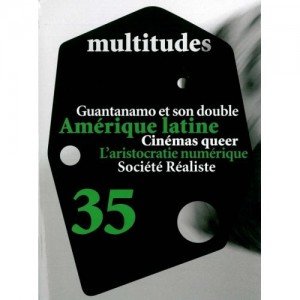De l’effondrement du pouvoir néolibéral au combat pour l’hégémonie indigène et populaire
Après deux années et demi de gouvernement du Movimiento Al Socialismo (MAS), nous ne pouvons que constater une certaine léthargie des mouvements sociaux . L’explication ne réside peut-être pas tant dans la cooptation des organisations paysannes et urbaines par le gouvernement que dans la dynamique propre des mouvements sociaux depuis le début de la mise en place du modèle néolibéral en 1985.
Les réformes ont entraîné un affaiblissement décisif de la Central Obrera Boliviana comme acteur politique principal et représentatif de la force de travail bolivienne. Mais, de manière plus remarquable encore, elles ont d’une certaine manière précipité la fin de l’héritage national-développementiste de 1952, la fin du discours de l’inclusion nationale basé sur le métissage et la modernité, et la fin d’une conception de l’état comme outil décisif d’orientation des investissements en vue d’un développement industriel autocentré et diversifié.
L’émergence du bloc indigène et populaire
Pour comprendre la composition politique récente des mouvements sociaux, il faut prendre en compte les transformations sociales importantes opérées par les réformes néolibérales :
– La Ley de Participacion Popular de 1994, qui promeut la décentralisation administrative, accorde au niveau local davantage d’importance dans la discussion, l’accord et le conflit politique. Ce scénario a permis l’apparition de nouveaux groupements électoraux de nature locale, ainsi que des initiatives d’autogouvernement de la part des communautés, représentées par des listes électorales municipales de gauche ou par les syndicats paysans.
– La “capitalisation” des entreprises et la fermeture des mines au moment de la crise du prix de l’étain ont provoqué une forte immigration vers les villes, où la force de travail a expérimenté des transformations qui l’enracinaient dans de nouveaux lieux et de nouvelles identités hybrides( ). Celles-ci s’accompagnaient d’une existence informelle sur le marché de l’emploi et d’une extrême précarité, les seuls soutiens venant des puissants réseaux de coopération sociaux, familiaux et communautaires. Ces privatisations ont accentué le sous-développement capitaliste bolivien et ont mis l’état dans une position d’appareil de gestion des élites qui servent d’intermédiaires avec les centres de l’économie-monde.
– Enfin, toujours sous le coup de l’échec économique du gouvernement de l’Union Democratica y Popular, tombé en 1985 dans un contexte d’effondrement des supposées alternatives du « socialisme réel », la perte de prestige de la gauche ouvrière menée par les secteurs urbains atteint des niveaux dramatiques face à la poussée irrésistible du discours néolibéral. Non pas que les protestations aient diminué, mais parce que les appels à l’imaginaire national-populaire jouissent de moins en moins de crédit, alors que l’imaginaire socialiste n’en est qu’un dérivé ouvriériste. Aucun parti ne pouvait évidemment s’emparer du mécontentement diffus mais généralisé devant le transfert massif de richesse des classes populaires vers la nouvelle élite technocratique formée aux États-Unis et la vieille oligarchie intermédiaire et dépendante avec ses appareils clientélistes. Il n’y avait pas non plus de force syndicale capable de recomposer politiquement les groupes subalternes. La COB répétait obstinément un discours concédant l’avant-garde politique de la lutte au prolétariat minier et industriel urbain. Bien que la composition technique de classe prolétarienne ait toujours été minoritaire en Bolivie, son poids économique et les expériences national-développementistes ont pu faire penser à un rapide accroissement quantitatif qui justifierait sa suprématie politique. Les réformes néolibérales n’ont toutefois fait que fragmenter les poches du prolétariat industriel, poussant des centaines de milliers de travailleurs dans la précarité et le travail informel. Ceux-ci, tout en partageant parfois l’imaginaire industrialiste de la gauche ouvrière, ont commencé à s’organiser en comités de voisins, de quartier, de vendeurs informels( ) ou selon des structures communautaires antérieures. Ces structures n’avaient jamais été tout à fait oubliées et cohabitaient avec l’identité ouvrière dans une sorte de « syncrétisme de classe ».
D’autre part, l’action autonome de la campagne visait à rompre l’infâme « pacte militaire-paysan » – pacte par lequel l’état se garantissait la paix sociale à la campagne et suffisamment de stabilité pour affronter brutalement et frontalement le prolétariat des mines. Le « Massacre del Valle » perpétré par le gouvernement de Banzer contre les paysans du Cochabamba en lutte contre la hausse du prix des aliments de base( ) fit tomber non seulement la dictature, mais aussi chanceler tous les gouvernements qui ont suivi. Bien que l’unité tant acclamée des travailleurs paysans et ouvriers ne se soit concrétisée que rarement dans la pratique, la résistance des paysans – plus nombreux et constituant traditionnellement la base social du clientélisme – rendait difficile tout projet de gouvernement réactionnaire. Née en 1979, la Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) cristallisa institutionnellement l’émergence plus que vigoureuse d’un indigénisme katariste( ) qui mettait au premier plan l’identité ethnique, mais en la liant aux projets de classe via la dénonciation des mesures économiques régressives, de l’expropriation des ressources naturelles, de la discrimination et de la colonialité du pouvoir. Cet indigénisme sera, finalement, le discours hégémonique qui servira de soubassement à l’action collective d’une force subalterne multiple et hétérogène durant le Cycle Rebelle.
La revendication portant sur la récupération des ressources naturelles (l’eau dans la province de Cochabamba en 2000, le gaz dans la province de El Alto en 2003) permit de mettre en lien dans une certaine mesure le national-populaire (dans le sens de René Zabaleta) et l’indigène. Autour des revendications visant la défense du commun – « l’eau est à nous », « le gaz n’est pas à vendre, bordel » – il y a moyen d’articuler politiquement une multitude dont les composantes constitutives, communautaires, syndicales, de quartiers, ne renoncent pas à leur autonomie ni à leur pratique quotidienne de coopération et de construction de relations sociales non capitalistes, non coloniales. La multiplicité, structurée en pratiques d’autoreprésentation et de démocratie communautaire, converge autour de la défense du commun, sans pour autant céder son autonomie.
C’est précisément cette « organicité » qui rend inefficace la répression brutale. L’état fait face à un réseau social plus vieux et plus profond que lui, d’une plus grande extension géographique et d’une plus grande implantation sociale. Un réseau aujourd’hui mobilisé dans le conflit, qui jouit de davantage de légitimité que les institutions nationales dans la mesure où il en appelle à une origine communautaire précédant dans de nombreux cas la Conquête coloniale et dans pratiquement tous les cas, émanant du sein même des pratiques et identités locales.
Face à cette machine de guerre – décrite aussi passionnément que précisément par Raul Zibechi dans son livre Dispersar el poder – l’état et les sociétés transnationales qui s’enrichissent de la vente des secteurs économiques clefs du pays apparaissent comme une superposition autoritaire, dorénavant sans aucune justification historique : elle ne redistribue pas la richesse, elle ne garantit pas la coopération sociale au-delà des communautés, elle ne rend pas cohérent le territoire. En outre, elle ne garantit pas la reproduction sociale, et est incapable de maintenir un certain consensus général. Elle est pur commandement, pure violence et dépossession.
Finalement les mouvements font s’effondrer l’État colonial et néolibéral, ou plutôt l’épuisent petit à petit. C’est alors que ressortent les limites de la multiplicité : aucune alternative de pouvoir ayant une capacité nationale et instantanée n’apparaît. Des études plus détaillées manquent qui permettraient de dire s’il y avait déjà des processus locaux constituants en marche au-delà de l’organisation en vue du combat politique. Nous n’entrevoyons en tout cas aucune alternative à l’intérieur de la temporalité étatique et moderne. Le rapport de forces se caractérise par l’incapacité des classes subalternes comme des élites traditionnelles à résoudre la crise politique en leur faveur. Dans ces conditions, la victoire électorale du Movimiento Al Socialismo – Instrumento Politico para la Soberania de los Pueblos (MAS-IPSP) joue en même temps le rôle de catalyseur et de limite. Catalyseur, dans la mesure où il réussit à faire sauter les verrous institutionnels empêchant une reconstruction depuis la base de l’état bolivien. Tant et si bien qu’il s’agit d’une alternative qui confirme l’effondrement de l’hégémonie néolibérale et offre une nouvelle institutionnalité. Limite, parce qu’elle suppose la clôture du temps insurrectionnel et la conservation de l’ordre étatique, avec le respect de l’état colonial et de la propriété privée. C’est l’unique issue qui, dans le cadre de la « gouvernabilité », assume l’agenda des mouvements sociaux en essayant de le rendre compatible avec une alliance sociale plus ample et respectueuse de la légalité héritée.
On entre ainsi dans une autre phase de la crise étatique bolivienne : celle marquée par l’arrivée au gouvernement en décembre 2005 du MAS de Evo Morales – avec plus de 54% du suffrage populaire, résultat historique en Bolivie – et l’ouverture du processus constituant qui solidifie et consolide les transformations sociales et économiques que le gouvernement assume dans son mandat. Celles-ci émanent de l’« Agenda de Octubre » forgé durant la Guerre du Gaz en 2003 par les mouvements. Cet agenda comporte trois axes fondamentaux : la nationalisation des ressources naturelles, la réforme agraire et la décolonisation de l’état.
Le déploiement du pouvoir constituant lors les luttes qui firent s’effondrer le pouvoir néolibéral constitue la véritable force à l’origine du processus de transformation politique et culturel en Bolivie. Nonobstant la forme historique concrète qu’a pris ce processus, qui n’a pas été insurrectionnel mais bien le résultat d’une élection, il a déplacé substantiellement la centralité politique des mouvements sociaux.
Ceux-ci, sans l’articulation que suppose le conflit, s’effilochent dans la vie quotidienne( ). Il ne s’agit pas de lobbies mais de forces en mouvement. Quand le gouvernement s’engage à suivre l’« Agenda d’Octobre » et demande aux mouvements leur aide mais aussi leur esprit critique, il demande en quelque sorte une clôture du temps de la rébellion. Mais en dehors de ce temps, les mouvements sont difficilement distinguables des lieux qu’ils composent. Leur géographie se dilue et les syndicats régulent à nouveau des questions de propriété de la terre et même des questions de mariage, les associations de quartier se chargent de l’électricité et de la sécurité, les vendeurs de rue continuent d’établir en commun les prix et les irrigateurs assurent l’approvisionnement sous contrôle public – non étatique – de l’eau. Malgré tout, la possibilité de survie et de continuation du processus de changement réside dans les forces sociales qui ont produit ce moment historique. La légitimité institutionnelle et électorale est nécessaire à la survie du gouvernement du MAS, mais la réaction de l’oligarchie ne peut être contrée qu’en approfondissant la montée en puissance des réseaux sociaux et des organisations populaires.
La résistance du passé : origines et nature de l’oligarchie orientale
La dictature du colonel Hugo Banzer Suarez (1971-1978) fut une réaction contre l’expérience frustrée de l’Asamblea Popular composée par les organisations syndicales et politiques de la classe des travailleurs en 1971. Ce soi-disant organe de pouvoir populaire s’était constitué grâce à la tolérance du régime militaire-nationaliste de Juan Jose Torres, dans un contexte de polarisation et d’intensité croissantes de l’affrontement de classe, y compris armé, en Bolivie. De telle sorte que quand Banzer arrive au pouvoir, après une première tentative de coup d’état contrée par l’aile “nationaliste” de l’armée et l’action du mouvement ouvrier, il impose à la gauche une répression féroce et se tourne vers Washington, et les boys de Milton Friedman pour établir son programme économique. Anticipant ce qui allait arriver au Chili sous la dictature de Pinochet, l’état bolivien entreprend un programme de réformes qui pourraient être cataloguées de néolibérales, n’était-ce leur peu de consistance et de cohérence interne. Davantage qu’un projet néolibéral, il s’agit d’un engagement vis-à-vis des investisseurs étrangers et des exportateurs agricoles : on élimine toutes les mesures de protection de la fragile industrie bolivienne, on dérégule le marché du travail et on le discipline en réprimant la force de travail. On met également en place une redistribution fiscale massive destinée à subventionner les grandes propriétés agricoles de l’est de la Bolivie, et plus concrètement Santa Cruz. C’est de là dont provient le dictateur et où se trouve le véritable soutien de son régime : le Comité Civico de Santa Cruz, qui fait office de chambre de commerce du département.
Cet appui politique va dès lors moduler une politique visant à exploiter les bénéfices liés à une position périphérique dans le système-monde. Les activités économiques subventionnées créent très peu de valeur ajoutée, et sont déconnectées des autres secteurs de l’économie bolivienne. Leur essor n’impliquent donc aucun effet positif indirect. Il s’agit de cultures exclusivement dédiées à l’exportation, et non à satisfaire les nécessités du marché interne : café, soja, riz et surtout coton (et plus tard, dans les années 1980, transformation et exportation de cocaïne, quand le coton entre en crise et que la narco-économie acquiert un poids équivalent à celui des exportations légales). Cette région compte également d’importantes réserves de gaz et des gisements de pétrole. En raison du type d’exportations et de la nature du secteur, les subventions destinées aux élites agro-exportatrices de Santa Cruz consistent en des transferts massifs de capitaux publics au bénéfice du secteur privé. Par ailleurs, les importations et les investissements étrangers en Bolivie ont un caractère hautement spéculatif et volatile et bénéficient d’une fiscalité très basse qui permet de rapatrier tous les bénéfices en perpétuant la situation de sous-développement en Bolivie.
N’importe quelle transformation politique aura face à elle ces secteurs agro-exportateurs-acheteurs qui s’imaginent plus proche du Brésil et des États-Unis que de l’Altiplano ou des communautés indigènes où ils vont puiser les travailleurs destinés à leurs plantations. Ces secteurs sont dirigés par un nombre réduit de familles qui ont construit une relation quasi aristocratique avec l’état central et la préfecture du département. Une partie de ces familles appartient au « clan des Croates », formé par des immigrants de l’ex-Yougoslavie arrivés après la seconde Guerre Mondiale, en raison de leurs relations avec les milices fascistes des « oustachis( ) », pour un nombre significatif d’entre eux,. Le nom même de Media Luna avec lequel les capitalistes de l’est bolivien se plaisent à se représenter, est un symbole géopolitique alarmant. Il établit en effet un parallélisme entre d’une part les dernières régions « chrétiennes, blanches et civilisées » en Europe de l’Est face à l’Empire Ottoman, et d’autre part les pôles orientaux de développement capitaliste dépendant. Il s’agit d’affirmer l’hégémonie blanche-métisse face à l’émergence historique des groupes subalternes dans l’altiplano et la vallée de Cochabamba.
En l’absence d’un horizon politique capable de réorganiser le pays, et d’idées qui construisent une légitimité alternative pour les groupes sociaux exclus du pouvoir, le noyau dur et véritable agent politique de la réaction qui prend forme en Bolivie est celui composé par les secteurs agro-exportateurs et les intermédiaires du capital financier et commercial situés dans les départements de l’est du pays. Cette force politique n’est pas née dans l’opposition au gouvernement de Evo Morales et du MAS. En janvier 2005 déjà, la Media Luna récemment constituée, le bloc régional de pouvoir, organise une « grève civique » contre le gouvernement de Carlos Mesa, gouvernement intérimaire après la chute de Gonzalo Sanchez de Lozada lors de l’insurrection d’octobre 2003, plus connue sous le nom de « guerre du gaz ». Pendant cette grève de trois semaines, elle a réussi non seulement à paralyser les départements orientaux (Santa Cruz, Beni, Pando et Tarija) pour forcer le gouvernement à continuer de subventionner le carburant agroindustriel, mais aussi à déployer la première initiative réactionnaire depuis le début du cycle de rébellion initié par la victoire en 2000 à Cochabamba contre la multinationales Aquas del Tunari. La droite parvient ainsi à profiter de la faiblesse de Carlos Mesa et à lui faire prendre position contre les mouvements sociaux et en faveur des multinationales du gaz et du pétrole. En dépit d’une nouvelle vague de protestations des mouvements provoquant la chute du président en juin 2005, la réaction a été depuis lors capable de freiner la nationalisation des hydrocarbures et de forcer un combat électoral. Elle espère de la sorte se réorganiser et récupérer une partie de l’initiative qu’elle avait perdu au sein des institutions durant les cinq longues années de conflit entre les groupes subalternes et l’état néolibéral.
Pour gagner cette capacité d’intervention politique, les élites orientales ont dû s’approprier deux discours présents à l’état latent. Le premier est celui de l’autonomie territoriale : le gouvernement institue en code départemental ce que les communautés indigènes et les organisations sociales réclamaient déjà depuis au moins deux décennies comme manière d’articuler les formes d’organisation et de convivialité non modernes et non libérales dans le cadre d’une citoyenneté bolivienne commune. Le second est celui du vieux racisme colonial, capable d’être mobilisé avec virulence et de menacer d’affrontement civil les multitudes indiennes, taxées d’improductives et d’être un fardeau rendant difficile l’insertion de la Bolivie dans les circuits globaux de production et d’échange. En définitive, c’est le vieux projet politique créole et libéral d’éliminer politiquement la présence de l’indien pour son bien, de renforcer la domination de l’élite blanche afin de produire une richesse qui bénéficie à tous les secteurs du pays, y compris aux masses indiennes qui, laissées à elles-mêmes, ne pourraient que faire marche arrière. C’est cette conversion discursive de l’espace en temps( ), selon laquelle El Alto représente un vestige du passé et Santa Cruz la plus brillante représentation du développement futur, qui garantit à la droite un certain appui des masses en vue d’un projet de modernisation et d’ouverture au monde face à l’hostilité et au retard que représenterait le bloc indigène et populaire.
Derrière cette grande épopée du progrès et de la modernité, fonctionnent évidemment des mécanismes clientélistes tandis que les épisodes de fascisme classique, explicites et organisés, se répètent de plus en plus fréquemment. Les fils de la classe prospère de Santa Cruz envoient les secteurs du lumpen, véritables escadrons de choc, contre les organisations syndicales ou populaires, et contre tout ce qui peut être identifié comme « colla( ) » ou indien. Dans les revendications régionalistes de l’est se mélangent un anticommunisme diffus et un racisme très concret derrière lesquels se barricade une classe dominante qui a perdu l’hégémonie à l’échelle nationale et pour cette raison prétend arracher les compétences clefs de l’état pour les exercer depuis les départements. De manière significative, les points centraux du récent « statut d’autonomie » de Santa Cruz sont ceux qui réclament pour les autorités départementales le pouvoir sur les terres, sur les ressources, naturelles et énergétiques, les télécommunications, les transports et la fiscalité. Ce statut a été rédigé par un comité d’experts non élus démocratiquement mais nommés par le Comité Civique, et voté à l’occasion d’un referendum illégal, organisé sur base de l’ancienne constitution politique de l’état qui ne reconnaît pas les autonomies départementales.
Face à son incapacité actuelle à fonder un projet national qui réponde au gouvernement du MAS, l’oligarchie orientale prétend se blinder dans ses départements, où resteraient lettres mortes les réformes du gouvernement sur les latifundio, les redistributions progressives des impôts ou les récupérations étatiques des hydrocarbures ou des télécommunications.
Reste à voir la capacité d’initiative politique des « statuts » illégaux – celui approuvé à Santa Cruz et récemment à Beni et Pando, celui de Tarija n’ayant pas été approuvé au moment d’écrire cet article – difficilement matérialisable institutionnellement ou économiquement en dehors de la légalité de l’état et sans la reconnaissance des pays de la région et du continent. Ces statuts ont suscité la méfiance d’une armée qui, à défaut d’être ouvertement progressiste, est fortement nationaliste et de composition métisse et indigène.
La stratégie régionaliste s’est montrée terriblement payante pour affaiblir le gouvernement et le faire entrer sur un terrain de discussion qui brise le bloc indigène et populaire – comme s’est arrivé à Chuquisaca au début de l’année 2008, quand la demande de changement de capital du pays à ouvert une brèche régionaliste par laquelle le MAS a perdu l’hégémonie politique dans un département dans lequel il n’était pas a priori menacé. Il reste à voir toutefois de quelle manière cette série d’obstacles posés au gouvernement de Evo Morales sont susceptibles de s’articuler dans une opposition nationale capable d’intégrer, même de manière subordonnée, les secteurs de la classe travailleuse bolivienne. Tant qu’elle reste incapable de le faire, il n’y aura aucune issue qui ne comporte un certain degré de pression violente pour retourner le processus politique mené par la gauche indigène.
La rupture démocratique du « ballottage catastrophique »
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la convocation des referendums du 10 août prochain : comme un affrontement dans les urnes entre le bloc social ascendant et le vieux bloc de pouvoir qui, à défaut d’être capable d’inverser l’hégémonie indigène et populaire peut faire obstacle à sa consolidation au point de pousser les appareils d’état et le reste des forces sociales à un scénario d’affrontement, pas nécessairement violent, mais certainement décisif.
Face à un tel scénario, le gouvernement de Evo Morales cherche sa légitimité dans un autre locus. Si le MAS, de par sa composition sociale et politique et les circonstances historique de son arrivée au pouvoir exécutif, est l’expression des mouvements sociaux et le fruit de la politique de la multitude, son gouvernement dérive techniquement de la légitimité électorale libérale, et sa crédibilité ne peut plus se baser sur des références au passé mais sur sa capacité à gouverner. Il est donc compréhensible que face à l’offensive de la droite des provinces orientales, il cherche à repositionner le conflit à nouveau dans les urnes, via les referendum révocatoires du président et du vice-président du gouvernement et des préfets départementaux. Le gouvernement se maintiendra très certainement en place, confirmé par le vote populaire – il faudrait plus de 54% des votes pour faire tomber Evo Morales( ) – et les préfet orientaux de la droite ré-avaliseront leur légitimité électorale, peut-être même avec davantage de votes. Ce que le gouvernement espère, dans tous les cas, c’est faire basculer la balance du pouvoir régional, en faisant pencher en sa faveur les départements où les organisations syndicales et populaires sont fortement implantées, comme à Cochabamba et à La Paz, actuellement aux mains de préfets non acquis au bloc indigène et populaire et au MAS.
Le processus politique ouvert en Bolivie par les attaques massives des politiques néolibérales se caractérise par une difficile combinaison de temps et de discours. C’est qu’à la chaleur de la contestation de politiques, que David Harvey appelle « accumulation par dépossession( ) », émergent, entrecroisées, deux « mémoires » qui ne sont pas forcément complémentaires : la mémoire courte du national-populisme et de l’état développementiste, et la mémoire longue des insurrections indigènes anticoloniales.
Les transformations de la structure de classe associée au néolibéralisme en Bolivie pourraient être, paradoxalement, les conditions de possibilité pour l’émergence de propositions plurielles et pluriculturelles. L’épuisement des promesses jamais satisfaites de la modernité eurocentrée, l’altération des hiérarchies traditionnelles aux différents niveaux géographiques (localité – région – état – international) engendrée par les formes dans lesquelles se manifeste la globalisation dans les périphéries, et le retour – volontaire et planifié – à une souveraineté étatique qui n’a jamais été qu’une aspiration créole-urbaine, ont rompu les certitudes traditionnelles : les futurs imaginables, les formes d’organisation classiques, les sujets de changement et leurs identités, les classifications géographiques et raciales.
Dans ces conditions, le gouvernement du MAS s’est vu confronté, et l’est toujours aujourd’hui, à au moins quatre tâches dont la réussite est cruciale pour la continuité du processus :
– En premier lieu, l’exécution du programme minimal de gouvernement exprimé par les mouvements sociaux dans l’« Agenda de Octubre » (2003) et ensuite dans le « Pacto de Unidad » (2006). Les points centraux de ce programme sont la nationalisation des hydrocarbures et des autres ressources naturelles (dans le projet de nouvelle constitution de l’État, l’eau ou les forêts sont également protégés contre de possibles privatisations), la réforme agraire qui modifie en particulier la structure latifondiste et hyper-subventionnée dans l’est bolivien, et l’impulsion d’une nouvelle Constitution Politique de l’État qui habilite des « foyers » pour l’exercice d’une citoyenneté construite non sur l’appartenance juridique définie par des critères ethniques, mais comme pratique quotidienne de droits fondés sur les capacités de coopération et de communication sociale.
– En second lieu, et pour mener à bien la première tâche, le respect de l’autonomie des mouvements et des réseaux sociaux n’est pas seulement une exigence éthique, mais une condition imprescriptible pour que le véritable pouvoir constituant des multitudes boliviennes puisse se déployer. Cette autonomie ne doit pas être confondue avec une mise à distance ou un isolement, mais consiste en une montée en puissance et une hybridation. Les outils productifs sont ceux qui permettent la redistribution de la richesse produite collectivement à travers les mouvements – et non, comme ce fut le cas jusqu’à présent dans l’histoire du pays, au travers les réseaux privés et clientélistes –, la reconnaissance juridique de leurs formes politiques, la décolonisation de la connaissance et la valorisation de tous les savoirs et formes culturelles. Les multitudes boliviennes font preuve d’une stupéfiante capacité à produire en commun. L’état, peut-être en agissant aussi comme organe subsidiaire dans la prestation de services et dans la cohésion territoriale, deviendrait un mécanisme d’émancipation s’il est capable de se mettre au service de la coopération sociale élargie. Ce qui revient à dire qu’il doit se fondre dans les pratiques démocratiques déjà existantes, là où elles existent, et se renforcer pour les faciliter là où elles sont absentes.
– En troisième lieu, le gouvernement doit résister au boycott actif de la droite, mais il ne peut le faire depuis l’affrontement ouvert à moins qu’il n’ait toutes les garanties que cela ne se convertisse pas en excuse pour une violation de la souveraineté territoriale bolivienne. La sympathie affichée de nombreux gouvernements du sous-continent, la distance respectueuse des autres, et les difficultés militaires que traverse l’armée américaine dans ses occupations en Irak et en Afghanistan peuvent constituer une garantie momentanée pour le gouvernement de Evo Morales.
– Toutefois, les transformations doivent viser les ressources de pouvoir de ce que Gunder Frank appelait la « lumpenbourgeoisie », les secteurs qui se sont enrichis en se faisant les intermédiaires de l’extraction de la plus-value depuis les campagnes, les villes et les mines de Bolivie, vers les pays du centre de l’économie-monde. Il faut s’attaquer aux structures sociales qui les soutiennent, en premier lieu la contrebande illégale et le latifundio, en second lieu la gestion des secteurs économiques nationaux toujours privatisés, et en troisième lieu le monopole sur les ressources juridiques et intellectuelles, héritage de la colonialité de la connaissance.
– Corrélativement aux deux derniers éléments, il faut également régler le problème territorial : une décentralisation de l’état qui ne consisterait qu’à ré-agencer l’architecture institutionnelle n’aboutirait qu’à un transfert des fonds publics de la capitale nationale vers les capitales départementales. En revanche, la Bolivie peut être le premier pays à tenter une organisation « postnationale » de son territoire : en prenant en compte les entités antérieures à la conquête, et en articulant les formes d’organisation spatiales autonomes aux institutions. Dans une complexification de la carte des « lieux » de Bolivie, résident beaucoup de possibilités de traverser le pays avec les différents projets d’émancipation existant, en prenant l’état comme colonne vertébrale territoriale.
Les autonomies, qui furent une revendication des mouvements sociaux avant que les oligarchies orientales ne s’en emparent, peuvent constituer un bon début. Contrairement à ce que le harcèlement envers l’état pourrait faire croire, le centralisme n’est pas la solution à la crise politique et aux attaques de la droite. La solution passe par la transformation de l’état dans un sens plurinational et décolonisateur, qui reconnaisse les autonomies indigènes et les dote d’outils positifs pour défendre leur souveraineté territoriale, qui produise des institutions plurielles pour des réalités nationales plurielles et des formes politiques plurielles (de la représentation quantitative et individualiste libérale à la démocratie communautaire, de la justice libérale à la justice communautaire, de la propriété individuelle ou étatique à la propriété communautaire, publique mais non étatique) en même temps qu’un substrat consistant de citoyenneté commune autour de la dé-marchandisation des biens qui assurent la reproduction sociale et en ouvrant des droits collectifs qui garantissent l’existence des peuples qui constituent la Bolivie.
L’état nourri du mythe moderne de l’universalité, l’état aveugle à la différence ethnique, est un reproducteur de la colonialité du pouvoir, de la hiérarchie globale de la connaissance, et de l’exclusion sociale qui en résulte. Tel a été traditionnellement l’état en Bolivie, accompagné par l’idéologie métisse-nationaliste qui en venait à rompre avec l’état oligarchique : d’une part prétendument for dans son homogénéisation des groupes subalternes, et par conséquent dans son maintien du colonialisme interne et l’exploitation ; d’autre part ostensiblement faible dans sa production de souveraineté populaire et de biens collectifs.
Pour que l’état produise plus d’émancipation que de domination, il faut le rendre sensible à la race et au lieu, le dépouiller de sa fiction d’homogénéité culturelle et territoriale, de neutralité culturelle et raciale et d’universalité des formes de production des décisions politiques. Un réagencement territorial qui inclut tous les habitants de Bolivie, mais une inclusion qui puiserait ses forces dans la multiplicité et non dans l’unicité.
Malgré le fait qu’il n’y ait pas de solution unique, ces deux questions sont inséparables. Ce ne sont précisément pas les effets des processus de périphérie et de colonialité qui ont produit la fausse dualité entre centralisme et décentralisation administrative. C’est la vieille polémique à laquelle se sont attachés tant Mariategui que Gunder Frank : l’affrontement des fractions de l’oligarchie entre elles en l’absence d’un projet national autre que celui d’être les intermédiaires de l’extraction de plus-value de la métropole. Le projet des groupes subalternes est fondamentalement inverse : face au régionalisme de l’oligarchie, une démocratie plurinationale et une souveraineté populaire.
La Bolivie dans le contexte américain
La Bolivie fait indubitablement partie du « virage à gauche » latinoaméricain. Mais elle le fait avec des particularités très marquées, qui sont celles qui permettent de concevoir une évolution différente du retour généralisé aux panoramas universalistes, développementistes et étatistes des années 1960.
Les classes subalternes boliviennes, après avoir tenu en échec le modèle néolibéral et les gouvernements de la « périphérisation », posent une question très pertinente sur la possibilité d’entrecroiser des processus globaux avec des concrétions nationales – et interculturelles – d’émancipation sociale.
Ce qui est novateur en Bolivie, c’est que l’émancipation s’ébauche dans des formes nécessairement basées sur la puissance sociale, les formes politiques indigènes et les mouvements sociaux des groupes subalternes dans la trame du pouvoir capitaliste et colonial. Ces forces sociales supposent une pression sur le gouvernement afin qu’il habilite des mécanismes qui ne referment pas complètement le pouvoir constituant, et qui mettent les institutions au service de l’autonomie et de la coopération sociale.
Les possibilités historiques qui se sont ouvertes échoueraient si l’oligarchie et le capital international réussissaient à résoudre à leur avantage le « point de bifurcation » dans lequel se trouve, selon l’analyse du vice-président Garcia Linera, la crise historique de l’état bolivien. Une crise qui ne peut durer éternellement, pas plus que l’extraordinaire capacité mobilisatrice du bloc indigène et populaire, mais qui ne peut que très difficilement revenir aux stades passés de l’état de dépendance externe et de colonialisme interne.
Au contraire, les espoirs des multitudes boliviennes s’enracinent dans leur capacité à soutenir le gouvernement face à la droite dans ces mois décisifs, pour isoler les factions irréductibles de l’oligarchie et forcer le reste à une inclusion subordonnée dans un réagencement plurinational, souverain, « décolonial » et populaire de l’état et de la société bolivienne.
Cette analyse ne signifie toutefois pas que la situation politique décrite ait quoique ce soit de « nécessaire » dans l’évolution de l’affrontement de classes et de projets de civilisation en Bolivie. Le scénario politique répond à l’heure actuelle au relatif déplacement des mouvements de la centralité politique, à l’intransigeance et au pouvoir croissant de la droite retranchée dans les identités régionales, et à la décision du gouvernement de promouvoir un grand accord qui isole les secteurs minoritaires de l’oligarchie. Cet accord s’appuie sur un vaste consensus national, indigène et populaire qui se concrétise dans une architecture institutionnelle inclusive conçue non comme un point d’arrivée mais de départ, dans une perspective beaucoup plus large de transformations émancipatrices. Ce ne sont pas seulement les renoncements que cette stratégie implique, mais aussi ses possibilités réelles de succès dans ce scénario politiquement tendu, (ou au contraire dans des scénarios alternatifs qui déterminent d’autres corrélations de forces), qui verront le jour dans les mois qui viennent, une période historique décisive pour la Bolivie. Cela ouvrira des possibilités pour tout le continent américain et pour les luttes des classes subalternes dans tout le système-monde.
Traduit de l’espagnol par Mouss