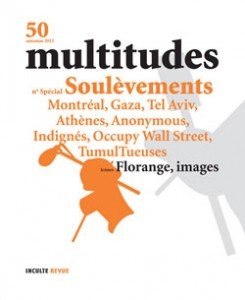Dans cet ensemble de soulèvements connus directement, en première ou seconde main, de l’un ou l’autre des membres du comité de rédaction, une lutte médiatisée comme les autres fait exception : la résistance des sidérurgistes d’Arcelor-Mittal à Florange contre la fermeture des derniers hauts-fourneaux lorrains. En 1979, la radio Lorraine-cœur d’acier, le sac de quelques magasins près de l’Opéra et d’autres actions spectaculaires avaient fait des sidérurgistes les champions de la lutte pour un monde nouveau. Aujourd’hui cent mille travailleurs lorrains partent chaque jour vers le Luxembourg gagner le salaire que les vallées sidérurgiques ne leur offrent plus. L’aciérie de Florange reste un des derniers témoins du manque de soin des gouvernements successifs pour une population et ses qualifications. Les centres d’apprentissage ont fermé il y a trois ans. Plus encore que Mittal, c’est l’État, qui ferme la sidérurgie, et produit une population jugée inemployable, condamnée à la débrouille individuelle.
Cette lutte a aussi son correspondant dans le comité de rédaction. Il n’y a pas que les médias à braquer leurs caméras sur le petit groupe de sidérurgistes. Un retraité CFDT de Florange, Jean-Paul Steunou, a suivi le mouvement avec son appareil photo et mitraillé régulièrement, avec ses angles de vision propre, souvent à contre-courant de celui des caméras vidéo. Il tient une chronique. Florange suit au jour le jour une lutte titanesque entre une poignée de sidérurgistes et une firme mondiale, « féodale » puisque familiale, basée en Inde et à Londres. Florange se bat pour toute l’Europe continentale qui a créé le modèle social dont tous sont fiers. Et Florange se bat pour son aciérie, un monde inconnu, le rougeoiement des aciers dans les fours, les vapeurs, les ambiances, un monde duquel on ne peut pas se défaire. Et au nom duquel s’organise la résistance.
Dans les photos du mouvement, ce monde aimé ne se voit pas ; l’usine est fermée, à l’arrêt, protégée, sécurisée, et les militants tiennent autant que le patron à ce qu’elle ne soit pas abîmée, à ce qu’elle puisse resservir, re-séduire. Le mouvement est tempéré par ce respect. Il s’adresse à l’État médiateur, en vain. Une commission de technocrates travaille au « redressement productif » sous la houlette d’Arnaud Montebourg. Les premières conclusions qui ont fuité sont celles-là mêmes de la firme Mittal : maintenir quelque chose sur le site mais pas les fours, le cœur de l’acier. Inadmissible. La résistance continue, mezzo voce ; les vacances, les campagnes électorales terminées sont autant d’édredons pour étouffer la voix de l’acier. Des voix et des images que les enregistrements du mouvement garderont, à la recherche de nouveaux surgeons. Les images de Jean-Paul Steunou témoignent de cette fabrication du souvenir.
Les militants d’Arcelor ne se disent pas « Indignés ». Ils le sont par un patron qui condamne une usine qui marche bien, qui produit des aciers de qualité pour toute l’Europe. Les ouvriers ne comprennent pas cette famille lointaine, cette « féodalité », qui leur préfère des moins formés et plus disciplinés, qui n’a acheté en Europe que pour mieux fermer. Ce n’est pas une usine, c’est toutes qui sont menacées. Et le gouvernement n’a rien fait que parler. Sarkozy a juré qu’il se battrait pour Gandrange, qu’il investirait, rien n’est venu. Cinq ans plus tard, il ne reparaît plus et enfume de grenades lacrymogènes un rendez-vous spontané à Paris. Mais Hollande est monté au milieu des drapeaux sur le toit de la camionnette d’où se font les annonces importantes. Il s’est s’engagé ; Ayrault l’a suivi, il a même signé un papier. Et la déconfiture suit. Ce ne sont pas les coûts que la finance mondiale pourchasse ; ce sont les hommes debout qui jouissent encore de conditions de travail hors du commun, normales, qu’une entreprise mondialisée ne reconnaît plus. Ils ont servi d’appâts transitoires à des commandes globales ; toutes les industries automobiles viennent s’approvisionner de tôles performantes auprès d’eux. Mais les brevets laborieusement mis au point filent ; le centre de recherches plein d’ingénieurs sait retraduire en équations et en modes d’emploi les recettes inventées par approximations. Le métier fout le camp, témoin la suppression des formations professionnelles. L’État ne reconnaît plus aucun avenir à la sidérurgie, et surtout pas le rôle de leader, la connaissance fine des aciers, que les ouvriers se sont targués d’avoir inventée. Il faut obéir à une norme, et la norme ne se découvre pas par hasard, elle se calcule.
Le petit groupe sait que ses membres sont plus ou moins vieillissants, que les plus jeunes, mal payés, n’arrivent pas à trouver les moyens de leur autonomie, que les plus vieux vont partir bientôt à la retraite. Le petit groupe de résistants s’amenuise, et s’acharne, à trouver les moyens d’une gestion plus rationnelle, plus brillante, plus européenne. Le patron a choisi la sélection naturelle par la retraite, et l’assèchement de la connaissance par le départ des anciens. Le groupe revendique une « veille industrielle » paritaire dans laquelle les informations seraient mises en commun : les perspectives de fermeture et de maintien, mais aussi les découvertes de nouveaux traitements, les besoins de main d’œuvre, les besoins de formation. La volonté de coopération européenne s’affirme, acquise dans la représentation des salariés au comité européen central d’entreprise. Et à l’échelle nationale, il faut aussi que les entreprises coopèrent, comme en Italie ; qu’elles se mettent en réseau pour développer la recherche. On rêve à une sidérurgie unie, où chacun tiendrait son rôle, où pouvoirs publics, élus locaux, industriels et associations d’environnement collaboreraient dans une nouvelle gouvernance.
Et le petit groupe continue de déambuler tant qu’il reste uni, d’inventer des espaces à occuper, des barrages à établir, des prises de parole à assurer. Les caméras, les appareils photos, les téléphones portables l’accompagnent, enregistrent une mémoire brute, des heures de paroles et d’images. Il est doublé, enregistré, conservé, transformé.
Quelle mise en forme de tout ce matériel ? Des souvenirs de famille, gardés avec les images de mariages, ou de vacances ? Ou bien le matériau d’une analyse collective de ce qui émerge et diffère des traits ordinaires des mouvements sociaux. Qu’est-ce qui fait coupure dans ce grand calme, que redouble le caractère muet de l’écran ou du tirage papier ? Qu’est-ce qui fait coupure quand on a retiré le son, et le sens prédéfini ? Quel est le commun construit ici ? Qu’est-ce qu’un soulèvement entre amis, en bande organisée, en résistants ?