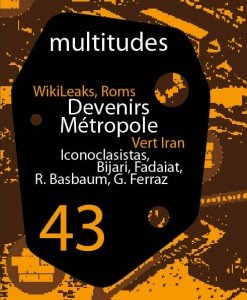Au cours des trois décennies qu’a connues l’Iran post-révolutionnaire, la part de la classe ouvrière dans la force de travail est passée de 40% en 1976 à 30% en 2006. Il est indubitable que, aux côtés des couches inférieures de la petite bourgeoisie et des chômeurs, la classe ouvrière iranienne compte aujourd’hui parmi les plus démunis sur le plan économique. Ceux qui sont communément désignés comme l’aristocratie ouvrière forment dans le meilleur des cas un effectif moindre parmi les travailleurs en col blanc, majoritairement dans l’industrie du pétrole, les grandes manufactures, et le secteur financier, la plupart étant employée par l’État. Bien que les travailleurs des grandes corporations aient réussi à maintenir leur rémunération dans un rapport stable relativement au taux d’inflation au cours des années de libéralisation économique qui ont suivi la guerre avec l’Irak, les autres n’y sont, en revanche, que difficilement parvenu. Il faut relever que tous les gouvernements post-révolutionnaires ont toujours tenté, et avec succès, de prévenir l’organisation de toute activité ouvrière collective et indépendante, sans compter la formation de syndicats indépendants.
Ayant cela en tête, on ne prendrait probablement pas au sérieux des inquiétudes quant aux obstacles éventuels à une coalition entre la classe ouvrière et les élites politiques d’un Mouvement Vert, qui a pris la rue avec courage pour protester contre les fraudes de l’élection présidentielle de 2009 ; inquiétude qui s’avère pourtant bien réelle. Depuis la Révolution de 1979, la classe ouvrière iranienne a dû faire face à deux opposants parfois alliés contre elle, cela sur deux fronts distincts : le front du rapport capital-travail et celui qui oppose autoritarisme et démocratie. De nombreuses actions ouvrières déterminées ont en effet été réprimées tant par le gouvernement autoritaire d’Ahmadinejad que par ses prédécesseurs réformistes néo-libéraux Au cœur de la lutte actuelle contre l’establishment autoritariste et pour la démocratie, il devient donc plutôt discutable d’envisager une coalition entre la classe ouvrière iranienne et les élites néo-libérales du Mouvement Vert.
Le déclin des tactiques d’affrontement
Pour illustrer au mieux la répression salariale des gouvernements capitalistes-réformistes post-révolutionnaires, il faut avant tout évoquer le cas des enseignants. En janvier 2001, Téhéran et de nombreuses autres villes iraniennes ont connu une série de rassemblements publics sans précédent depuis la Révolution Islamique de 1979. À Téhéran, des milliers d’enseignants ont pris part à des rassemblements massifs, et ce à quatre reprises, pour obtenir l’égalité de rémunération pour toute la fonction publique, une consolidation des politiques de promotion, ainsi que des budgets plus importants pour le financement de l’éducation. Si l’on met à part le contenu des revendications des enseignants, le fait même que tout cela ait eu lieu dans la rue a sans nul doute favorisé la poursuite de cette vague de protestations et rassemblé les opposants au gouvernement en des temps et lieux plus concrets. Les enseignants manifestants y ont d’ailleurs été rejoints par d’autres citoyens qui ont versé leurs propres doléances à la contestation.
Cette série de rassemblements a marqué le point culminant du mécontentement des enseignants, cela jusqu’en mars 2003 où une seconde vague de protestations s’est amorcée sur un tout autre mode. Au cours de ce mois précis, dans plusieurs villes, Téhéran comprise, les enseignants ont entamé une grève et n’ont plus assuré de cours pendant une semaine. Pendant ces grèves, des groupes de manifestants se sont rassemblés dans les espaces clos des écoles, rompant ainsi avec le mode d’action de l’année 2001 et le déploiement dans un espace commun.
Il a fallu attendre 2004 et le début de l’année 2005 pour assister à une transformation radicale de l’expression de ce mécontentement. Cette troisième vague de contestation enseignante a été marquée par l’envoi de pétitions aux autorités. Le 19 janvier 2005, le journal Sharq a finalement publié une lettre ouverte à l’Assemblée nationale signée par un grand nombre d’enseignants, et bien que de telles pétitions aient été mises à disposition du grand public, l’élément de l’espace commun qui avait imprimé tant d’énergie aux manifestations de 2001 était résolument absent.
La décision commune des enseignants – en réalité un cumul de résolutions émises par de petits groupes – de passer à des tactiques d’affrontement toujours moins radicales a révélé la diminution corrélative de leurs opportunités politiques d’engagement dans des actions collectives de masse. Avec la victoire des forces conservatrices aux élections législatives de février 2004, suivie du triomphe d’Ahmadinejad l’été suivant, les mesures d’austérité salariales se sont intensifiées, cette fois-ci à l’égard des chauffeurs de bus.
L’expansion
de l’austérité salariale
Le principal syndicat de chauffeurs du pays s’est réorganisé en 2004 autour de quelques travailleurs activistes sans autorisation officielle. Les conducteurs, agents et mécaniciens ont alors tenu avec succès une assemblée générale et mené à terme une élection de représentants, ressuscitant le syndicat sous le nom de Syndicat de la Compagnie de Bus de Téhéran et des Banlieues, représentant les travailleurs employés par cet établissement public.
En décembre 2005, pour obtenir de meilleures rémunérations, les chauffeurs de Téhéran ont commencé, après un appel syndical, à refuser les paiements des voyageurs. Le 22 décembre, la police a procédé à des arrestations de douze responsables syndicaux à leurs domiciles, sur le motif de « troubles à l’ordre public », et a immédiatement fait fermer le bureau du syndicat à Téhéran. Le 23 décembre, les leaders syndicaux qui ont échappé à l’arrestation ont invité tous les conducteurs et travailleurs de la Compagnie à prendre part à une grève générale le jour suivant. En conséquence, la plupart de ceux qui furent arrêtés furent relâchés à minuit, à l’exception de Mansour Osanlou, secrétaire général du syndicat. Malgré tout cela, les conducteurs de cinq districts de Téhéran sur dix se sont mis en grève le 25 décembre, en conséquence de quoi seize grévistes ont été arrêtés. À la suite des déclarations favorables du maire de Téhéran relatives à la libération et à la satisfaction des demandes salariales de tous les chauffeurs arrêtés, les grévistes ont finalement décidé d’appeler à la reprise du travail dans la soirée. De son côté, la direction de la Compagnie a alors menacé de licencier les travailleurs favorables à la grève. Tous les chauffeurs ont été relâchés dans les deux jours suivants, à l’exception, une fois encore, de Mansour Osanlou.
Le mois suivant a connu une autre vague de contestations et d’arrestations. Le 24 janvier 2006, le syndicat a émis un nouveau préavis de grève illimitée à compter du 28 janvier. Afin de prévenir cela, le Tribunal Révolutionnaire a émis une demande officielle d’arrestation des principaux organisateurs de la grève dans la nuit du 27 janvier, parfois même avec leurs épouses[1].
Le 28 janvier les rues de la capitale ont connu de nouveaux évènements d’envergure. Les travailleurs des transports téhéranais devaient engager une nouvelle grève, appelant entre autres à la libération d’Osanlou. Depuis les premières heures de la grève, à l’aube, la police et les forces de sécurité ont sévèrement réprimé les protestataires, arrêtant près de 500 grévistes sur 2000 au total. Le maire de Téhéran a alors mentionné l’illégalité du syndicat, assurant que les autorités ne permettraient pas la poursuite de leur mouvement. Plus de 200 chauffeurs grévistes ont passé les mois qui suivirent dans les limbes. 43 d’entre eux ont été convoqués au bureau des ressources humaines de la Compagnie en vue de leur licenciement.
Malgré tout cela, grâce aux luttes de pouvoir entre les factions de réformistes et de conservateurs à la tête de l’État, la classe ouvrière iranienne, qui subit la répression incessante des deux parties, semble depuis l’élection présidentielle de 2009 avoir conquis l’opportunité politique de raviver l’activisme ouvrier.
Divisions au sein de l’élite
Le Mouvement Vert est né des divisions profondes de l’élite au sein de la République Islamique au moment-charnière du trentième anniversaire de la Révolution. Les structures anti-démocratiques de l’État post-révolutionnaire ont depuis résisté à de nombreuses velléités de changement profond. Le « moment réformiste » iranien des années 1997-2004 est remarquable en ce qu’il a illustré l’incapacité des réformateurs parlementaires à rallier les forces populaires, dont les doléances étaient bien souvent trop radicales pour les politiciens islamistes. Les bouleversements de 2009 avaient une autre teneur qualitative, alors que des millions d’iraniens manifestaient en soutien d’un membre d’élite de l’État post-révolutionnaire, Mir-Hossein Moussavi, contre un autre, l’extrémiste Mahmoud Ahmadinejad.
Cette division au cœur de l’élite est fondée sur le conflit d’intérêts politico-économique conséquent à la tentative des proches soutiens d’Ahmadinejad pour s’approprier plus fermement les leviers du pouvoir. Depuis la victoire d’Ahmadinejad en 2005, son administration a la plupart du temps travaillé à huis-clos, ne cherchant que rarement à atteindre ses objectifs politiques par les procédures démocratiques, ni même par l’établissement d’un consensus minimal avec les autres instances de la République Islamique. Ce mouvement d’appropriation a également touché le domaine économique, en l’espèce notable de l’extension des intérêts des Gardiens de la Révolution dans le domaine des affaires, marqué par la déclaration du porte-parole Gholan-Hossein Elham pour lequel désormais, « les bassijis [devraient] consacrer tous leurs efforts au contrôle du secteur industriel iranien »[2].
Mais la division la plus profonde tient sans doute à l’attitude adoptée à l’égard de l’institution électorale. D’une part, les réformistes et tous ceux qui demeurent attachés aux valeurs républicaines de la République Islamique ont eu tendance à considérer le processus électoral comme le meilleur moyen d’apaiser les dissensions internes de l’élite. Ainsi, dans les limites imposées par la République Islamique, la faction dont les idées sont les plus soutenues par le peuple seront vouées à gouverner. D’autre part, les conservateurs font de moins en moins montre d’égards quant au concept même de participation populaire en politique, manipulant les votes en leur faveur, pour finalement demander que les résultats officiels soient acceptés sans remous. Pour eux, les élections assurent désormais la fonction de simple sceau d’approbation. Pour l’autre faction, l’institution électorale n’en a dès lors plus aucune. Partant de cela, le Mouvement Vert nourrit l’antipathie entre les deux parties de l’élite, attirant ainsi l’attention sur leur principal objet de discorde.
Pendant ce temps, les manigances des conservateurs ont poussé leurs rivaux de l’intérieur à s’allier aux forces de la rue. Au milieu des années 2000, les clercs réformistes et même les conservateurs modérés ont, au moins en pratique, perdu le droit à l’élection, et les citoyens iraniens se sont logiquement vus privés d’un choix déjà largement restreint au niveau électoral. Il y a également un aspect économique à cette alliance. Le Mouvement Vert est en grande partie (mais pas en totalité) composé de membres de la classe moyenne urbaine dont les aspirations sont liées à une libéralisation plus vaste, que les réformistes soutenaient globalement. Ce sont des technocrates : ils ont face à eux une base conservatrice politiquement moins éduquée et loyaliste ; ils veulent l’ouverture de l’Iran au commerce global de biens et d’idées ; ils sont souvent pieux mais désirent que l’Iran se débarrasse de son image puritaine et des aspects les plus « islamiquement » oppressifs de la République post-révolutionnaire. À la fin des années 1990, il semblait qu’un tel changement prendrait corps par les urnes, mais ce n’est aujourd’hui plus le cas. Avec la consolidation de cette coalition d’intérêts, l’institution électorale est passé du statut de lieu de lutte politique au statut de l’enjeu de lutte politique.
Le nouveau lieu de cette lutte est désormais la rue. Pendant huit mois, après le 12 juin 2009, date de l’élection présidentielle contestée, les affrontements dans les rues de Téhéran ont connu des hauts et des bas, générant tous types de prédictions quant à une rapide transformation du champ politique. Mais après quelques temps, il est apparu qu’un palier de lutte avait été ainsi atteint. Aucune des parties n’avait touché au but, ni amendé sa position initiale : les Verts continuèrent à demander que l’État révise le résultat officiel de l’élection, et l’État a continué à rejeter leur requête.
Le 11 février, célébré chaque année comme « jour de la victoire » de la Révolution Islamique, a été anticipé par beaucoup comme le jour où les Verts réaffirmeraient leur domination dans la rue. L’État finançant à cette occasion de grands rassemblements, les Verts ont pensé avoir trouvé l’occasion d’intimider les conservateurs en organisant de grandes contre-manifestations. Contre toute attente, les conservateurs leur ont volé la vedette en faisant descendre dans la rue des centaines de milliers de leur effectif pour contre-balancer les actions de Verts, dont les rangs étaient déjà amoindris par une intense répression policière. L’impasse décisive coïncida avec la date du 12 juin, premier anniversaire de l’élection contestée. Des manifestants occupèrent les grands boulevards, mais le nombre important de policiers et de bassijis déployés par les conservateurs empêchèrent les Verts de s’approprier la rue.
L’espoir d’un relais ouvrier
Depuis le 11 février, l’une des réactions à cet état de choses s’est identifiée à l’espoir d’un relais de la classe ouvrière iranienne. L’idée était que les ouvriers s’associent à la classe moyenne sur la scène d’une politique de masse pour instituer les lieux mêmes de la production comme nouveau site de lutte. Malgré tout, et même si l’Iran a été le témoin de nombreuses actions ouvrières déterminées au cours des dernières années, ces actions n’ont pu se cristalliser en ce qu’on pourrait envisager comme un mouvement militant coordonné des travailleurs.
Cette attente de la part des Verts semble toutefois reposer sur un schème d’analyse proche de celui de la « main invisible », motivée par l’impression que les laissés pour compte de l’économie rejoindraient la lutte en masse comme par combustion spontanée. Plus que tout autre élément, c’est le plan d’Ahmadinejad pour la suppression des subventions aux prix des biens élémentaires comme le carburant, le pain, l’eau et l’énergie qui a donné fond à cette analyse. La réforme des subventions laissait en effet présager une hyperinflation combinée à des sanctions économiques internationales qui toucherait la classe ouvrière de plein fouet.
Espoir malgré tout
Mais l’analyse « à la main invisible » du Mouvement Vert est viciée en deux aspects au moins. Il n’est d’abord pas si évident que la classe ouvrière soit prête à se joindre aux Verts malgré son mécontentement sans précédent à l’égard de l’establishment. Mir-Hossein Moussavi fait certes de vastes emprunts au thème de la justice sociale dans ses propres discours sur l’économie, mais le noyau dur de la direction Verte pense malgré cela que les masses n’embrasseront une vie meilleure que dans la mesure où les élites auront frénétiquement prospéré.
Le Mouvement Vert n’a par ailleurs quasiment rien proposé en termes de plan de redistribution, plan sans lequel la classe ouvrière ne saurait lui offrir ses forces. Du point de vue des travailleurs, la bataille actuelle concerne donc en réalité les deux factions en question, l’une souhaitant distribuer les richesses du pays aux diverses officines de l’élite, l’autre, cherchant tout bonnement à monopoliser ces mêmes richesses. L’un comme l’autre connaîtraient donc dans tous les cas l’opprobre de la classe ouvrière.
En second lieu, il semble raisonnable de remettre en question un tel récit linéaire au sein duquel la pression économique mène nécessairement à l’entrée des travailleurs dans la lutte et à l’action politique victorieuse, l’un des maillons faibles demeurant ici l’organisation. Bien que les deux dernières décennies aient connu de nombreuses actions, elles n’ont pas été moins sporadiques, la classe ouvrière ayant cruellement manqué d’une structure nationale indépendante depuis la mort du Chah. Depuis l’établissement de l’État révolutionnaire, et particulièrement depuis l’adoption de la législation relative au travail de 1990, l’activisme ouvrier a connu trois types d’opposants farouches : le management d’entreprise, public comme privé ; le Conseil Islamique du Travail présent dans toute entreprise de plus de 35 employés et supervisé par le Bureau du Travail sous la responsabilité de l’État ; et, en dernier lieu, les idéologues économistes pour qui toute forme d’action syndicale est dans l’illégalité. La volonté commune de ces trois catégories d’opposants trouve son soutien dans les lois de 1990, selon lesquelles tout syndicat de travailleurs indépendant formé dans un établissement où le Conseil Islamique est présent doit automatiquement être interdit.
La Maison des Travailleurs est la seule organisation d’envergure nationale autorisée. Même si son Conseil Islamique du Travail a connu des pressions de la base au cours des cinq dernières années, il demeure composé d’opportunistes et de carriéristes bien trop frileux pour initier des grèves générales. Alors que le 1er mai approchait, la Maison des Travailleurs a annoncé une semaine de cérémonies pour les travailleurs, inaugurée par un rassemblement au mausolée de l’Ayatollah Khomeini, suivi d’une audience avec le Guide Suprême[3], s’achevant par un meeting géant d’Ahmadinejad.
On compte néanmoins quelques initiatives prometteuses visant à donner une voix authentiquement indépendante aux travailleurs iraniens. Pour citer deux des plus importantes, il faut mentionner le Syndicat de la Compagnie de Bus de Téhéran et des Banlieues, et le Syndicat indépendant de la Production de Canne à Sucre de Haft Tapeh. Au cours d’une intersyndicale à la veille du 1er mai, dix organisations indépendantes de travailleurs ont formulé des demandes comprenant « le droit d’établir des organisations indépendantes, une hausse des rémunérations et un arrêt des coupes dans les subventions gouvernementales ». On peut également citer le Réseau d’Unions des Travailleurs Iraniens, fondé à la suite des actions des chauffeurs et l’emprisonnement arbitraire de leur leader, Mansour Osanlou. Selon un porte-parole, le Réseau tente actuellement d’établir une presse ouvrière indépendante nationale pour encourager une plus grande autonomie vis-à-vis de la Maison des Travailleurs. Malgré des signes clairs de sympathie mutuelle, ces organisations indépendantes de travailleurs et les Verts ne composent rien qui pourrait ressembler à un front commun. Répondant à une question sur la position de Moussavi relativement aux droits des travailleurs, le porte-parole a déclaré : « Nous ignorons sa position. Il semble globalement favorable aux droits des travailleurs, mais quoiqu’il en soit, notre plate-forme n’est en rien identique à la sienne ».
Ironiquement, l’élite Verte qui nourrit l’espoir, aussi peu réalisable soit-il, de la mobilisation de la classe ouvrière n’est pas pour rien dans les mesures coercitives à l’encontre de l’établissement d’une organisation ouvrière d’envergure nationale. La « gauche islamique », corps de clercs embrassant la rhétorique de la justice sociale sans conditions et comptant de nombreux réformistes d’aujourd’hui, a naguère ouvertement attaqué l’autonomie de Conseils laïcs du travail, cela dès les premières années de l’ère révolutionnaire. Pendant une grande partie de la guerre Iran-Irak des années 1980-1988, quand ces attaques ont pris de l’ampleur, le Premier ministre (poste depuis dissolu) n’était autre que Moussavi. Le Président Akbar Hashemi-Rafsandjâni a élevé cette attitude répressive au statut légal avec la loi de 1990 dont la sixième clause établit le contrôle exclusif du Conseil Islamique du Travail dans les entreprises. Les réformistes, sous Mohammad Khâtami, certes connus pour leur promotion des droits civiques et individuels, ne l’étaient pas pour leur volonté d’établir des droits de négociation collective des travailleurs. Les organisations de la société civile telles que les chambres de commerce, les organisations non-gouvernementales et les journaux réformistes trouvaient alors des soutiens amicaux aux places les plus hautes de l’administration Khâtami ; soutiens dont n’ont jamais bénéficié les syndicats, aux revendications trop éloignées de la tendance globalement néo-libérale des réformistes, qui n’ont à aucun moment cherché à assouplir les restrictions touchant à l’organisation indépendante sur les lieux de travail. Travail par ailleurs affaibli par les conditions économiques globales d’alors : depuis la fin de la guerre Iran-Irak, le pays a connu des hausses chroniques du taux de chômage, exacerbées par l’arrivée constante de jeunes iraniens sur le marché du travail. Taux qui demeure officiellement depuis les deux dernières décennies à 14%, et qui a sans doute été bien plus élevé. Ainsi, la force de travail iranienne semble être moins qu’une force d’attaque, soit une force défensive limitée par la dégradation des conditions économiques.
Conditions de possibilité
Plutôt que d’attendre une main invisible qui placerait les travailleurs sur le devant de la scène, les Verts devraient apprendre à se servir des deux mains bien visibles à leur disposition pour mobiliser cette force sociale latente. La première « main » consiste en un virage discursif relativement à la théorie économique néolibérale dominante au sein du Mouvement, pour emprunter la voie d’un programme orientée vers la justice sociale et la franchise à l’égard des travailleurs. La seconde « main » consiste dans le soutien concret aux efforts des activistes ouvriers pour s’organiser sur les lieux mêmes de la production.
Traduit de l’anglais par Kosumi Abgrall