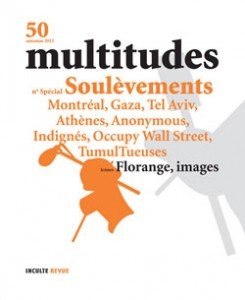Nous nous sommes accoutumés à nous servir du terme « politique » pour qualifier un fait ou un phénomène relatif à cette sphère d’activités définie par la conquête et l’exercice du pouvoir de diriger une société. Cette inclination contribue à entretenir une conception du politique limitée à ce qui recouvre l’action de ceux qui tiennent les rênes des instances de gouvernement, font fonctionner l’édifice constitutionnel et législatif, dirigent les administrations d’État, organisent l’opposition aux détenteurs du pouvoir, contribuent à la formation de l’opinion, créent et animent des associations, luttent au sein de groupes militants ou contestent les formes de la domination légitime.
Ces usages courants du terme « politique » reflètent et consolident une ligne de partage que les sciences politiques ont théorisée sous la forme d’une distinction entre le et la politique. Les travaux en sociologie et en anthropologie sociale ont, depuis longtemps, mis la pertinence de cette distinction en doute. Ils ont en effet établi trois faits : le domaine du politique est diffus au sein d’une société ; son institutionnalisation se réalise d’une multitude de manières et ne se cantonne pas à celles que proposent les instances officiellement mandatés à cet effet ; et les formes d’action politique débordent celles qui sont légitimement fixées dans le cadre d’un régime institué. En un mot, la recherche empirique a établi la validité d’une conception ouverte et pluraliste du politique, en démontrant que les instances de direction dont une entité politique se dote se reconfigurent continûment et que l’ensemble des membres de cette entité participent à ces incessants mouvements de reconfiguration.
Deux idées accompagnent cette conception ouverte et pluraliste. La première postule que le seul fait d’être ressortissant d’une société d’État fait d’un individu un praticien du politique. La seconde affirme que toutes les initiatives qui participent à la formation et à l’expression des opinions au sujet de la manière dont l’activité de gouvernement devrait être conduite doivent être envisagées comme des formes d’action politique de plein droit. Et ces formes, dont les individus savent se servir de manière appropriée au moment opportun, se présentent sous de multiples figures : élections, opposition partisane, luttes syndicales, manifestations, grèves, revendications portées par des associations, assemblées participatives, négociations avec les autorités publiques, mais aussi abstention, jeu avec les sondages d’opinion, calomnie et rumeurs, sarcasme, dénigrement ; voire même indifférence et retrait volontaire de la vie civique. Aux marges de ces formes policées de l’activité politique, des modalités plus sauvages émergent régulièrement : incivisme, boycotts, occupations, sit-in, rébellion, troubles ou résistance.
On sait, depuis Weber au moins, que la détention et l’exercice du pouvoir reposent sur la légitimité de la forme de domination que ceux qui gouvernent parviennent provisoirement à s’assurer. Cette caractéristique est déterminante : elle permet d’exclure la violence de l’ordre des relations politiques courantes. Mais cette exclusion reste conditionnelle. Rien n’empêche jamais des citoyens de recourir à la violence pour manifester leur désapprobation. Il peut ne s’agir que d’une éruption d’exaspération ou de colère (émeutes, pillages ou insurrections), mais également renvoyer à un usage direct de la violence, c’est-à-dire au choix délibéré d’en faire un moyen exclusif d’expression d’une revendication en visant le renversement d’un pouvoir en place et la destruction du mode de domination qu’il impose (terrorisme, guérilla, ou révolution).
En règle générale, c’est la répugnance des dominants à considérer les exigences des dominés qui justifie la nécessité de recourir à la violence pour obtenir satisfaction. Si la lutte armée semble légitime dans le cas de régimes autoritaires ou de pouvoirs qui bafouent délibérément les libertés fondamentales, elle l’est moins dans le cadre d’un État de droit accompli. Dans ce cas, un principe domine : force doit rester à la loi dans la mesure où elle est l’émanation de la souveraineté populaire et qu’elle peut être modifiée à l’occasion d’une alternance. Pour les tenants de l’usage direct de la violence, cette souveraineté n’en est pas une : gouverner en étouffant la contestation sous le poids du consensus – fût-il démocratique – revient à conforter un ordre établi qui reconduit les conditions de l’inégalité, de l’injustice ou de l’exploitation. Et seule une rupture brutale avec ce consensus permettrait de rétablir l’égalité, la justice, l’autonomie et la liberté. Mais l’histoire porte un sérieux démenti à la simplicité de cet argument : les projets politiques qui se sont construits sur l’usage direct de la violence ont fini par susciter la crainte, tant les dangers qui leur sont associés sont aujourd’hui notoires. Lorsqu’elle ne s’avère pas contre-productive, la violence provoque de graves atteintes aux biens et aux personnes, engendre des destructions ruineuses, voire débouche sur l’instauration d’une tyrannie.
La question de l’usage de la violence en politique est le plus souvent formulée en termes tranchés : doit-on l’admettre ou la rejeter ? Il me semble cependant que c’est une tout autre question qu’il convient de poser : à quelles conditions et dans quelles circonstances l’expression d’une revendication politique en vient-elle à envisager un recours à une forme de violence ? Pour y apporter des éléments de réponse, je vais considérer deux formes d’action politique qui respectent le principe de non-violence : la désobéissance civile et les « rassemblements » (occupations, « indignés », marches de masse) qui fleurissent aujourd’hui à travers le monde, que ce soit en régime démocratique ou despotique. Ces engagements qui défendent toutes deux des revendications radicales (l’extension des libertés publiques et individuelles, la démocratie réelle, la fin des privilèges, la mise au pas du système financier international) soulèvent une certaine perplexité : comment croire que les puissants ou les milieux qui tirent bénéfice d’un système d’exploitation abandonneraient leur pouvoir et leurs privilèges sans y être contraints par la force ? L’écart entre le but poursuivi et le moyen adopté pour l’atteindre heurte les plus militants des activistes, qui condamnent la non violence en la tenant pour une attitude irréaliste ou naïve. Mais la défense obstinée de ce mode de protestation défie également nos habitudes de pensée et détrompe nos catégories d’analyse usuelles. On peut se demander pourquoi il remet en cause nos façons courantes de concevoir le politique et son rapport à la violence.
De la violence en politique
La question du rapport entre violence et politique est écrasée par la célèbre définition que Weber a donnée de l’État, en tant que « détenteur du monopole de la violence légitime ». Cette définition trace une frontière : l’État a mission de garantir la paix civile et ses interventions sont, tant que la légitimité du pouvoir en place n’est pas remise en cause, inattaquables. Toute la question est donc de savoir d’où vient cette légitimité. En démocratie, elle procède du peuple dans la représentation qu’il donne de lui-même à l’occasion d’élections. Mais certains considèrent que cette représentation est faussée : les institutions d’État se chargent d’inculquer et de soutenir la domination des puissants tout en s’arrangeant pour contrôler les forces qui viendraient la dénoncer. En conséquence de quoi les actions qui prétendent contester la violence de l’ordre établi (c’est-à-dire le travail de la police, des services secrets ou des officines qui font taire les contestataires les plus virulents ou dangereux) tombent sous la qualification de « violence » alors que celles qui les répriment ne relèvent que du rétablissement de la sécurité publique. Ce double registre de qualification est souvent présenté, à l’exemple de ce que fait A. Brossat, en termes moraux : « Le mouvement de pacification de la vie sociale et du domaine politique a pour enjeu un formatage rigoureux des perceptions collectives de « la violence » et une réforme radicale du code destiné à séparer le violent du non-violent […] Dans ces conditions, « la violence » tend à devenir d’une manière exclusive le fait de l’autre – du pauvre, de l’immigré, de la plèbe mondiale, de l’islamiste, de l’État-voyou. Elle tend toujours davantage à faire l’objet de rites de détestation et d’exorcismes, à devenir une question morale plutôt que politique ou sociale. Son évocation péjorative devient un moyen de gouvernement des populations à la peur et à la sécurité, davantage qu’à la paix. »
Le mouvement de pacification des mœurs produit peut-être cet effet. Mais, avant de se prononcer sur ce point d’histoire, on peut se demander comment l’usage de la violence comme mode de régulation des conflits interpersonnels pourrait jamais être collectivement adopté comme un système acceptable et viable. Qu’on pense simplement à la situation qui naît lorsque la loi du plus fort fait droit – comme lorsque les pouvoirs despotiques, la corruption généralisée, les mafias ou la « culture de rue » des bandes font régner l’arbitraire et la peur. Que ce soit pour des raisons de sensibilité ou de principe, on peut donc admettre que la violence fait l’objet d’une aversion et d’un rejet, tant de la part du personnel politique que de celle des citoyens. La meilleure illustration en serait le discrédit qui, dans les démocraties avancées, frappe les mouvements de type Action directe, Bande à Baader ou Brigades rouges. Et ce constat est aussi celui que font les adeptes de la lutte armée, lorsqu’ils admettent qu’ils sont voués à être minoritaires (les gens préfèrent l’ordre au chaos) ou préconisent le recours à une violence ciblée (concentrer les attaques contre des biens matériels ou symboliques et être attentifs à ne pas faire de victimes).
En dépit du consensus moderne au sujet de la validité des principes de la démocratie et de l’État de droit, la violence n’a pas totalement disparu de la vie politique. D’une part, des saccages, des pillages, des émeutes ou des révoltes éclatent de façon sporadique, même si ce n’est qu’en des cas extrêmes. La rareté de ce genre d’événement conduit à le tenir pour une flambée de rage sans justification autre qu’un « malaise » ou une « injustice » ; et il n’est pas toujours facile de leur conférer une nature politique. D’autre part, une figure pacifiée du rapport entre violence et politique se présente sous la forme de la « construction d’un rapport de forces », qui s’apparente à la violence au sens où elle récuse l’idée d’une identité de vues entre parties en conflit, conteste la possibilité d’un consensus et rejette la volonté d’y parvenir ; et surtout parce qu’elle peut se développer en « grève générale ».
L’éventualité d’un tel développement met en lumière un phénomène : la violence est inhérente à l’action politique. Pour illustrer cette affirmation, considérons une action – par exemple la mobilisation pour l’obtention de cartes de séjour pour des travailleurs devenus clandestins du fait d’un durcissement de la loi ou du zèle d’un directeur de service. Pour ceux qui la formulent, cette revendication est juste et légitime, ce que confirme le fait qu’elle est soutenue par des syndicats, des associations ou des comités. Imaginons que des négociations s’ouvrent avec les pouvoirs publics et que ceux-ci se montrent inflexibles. La lutte monte d’un cran : les travailleurs occupent des locaux et entament une grève de la faim. Imaginons encore que les autorités réagissent en faisant évacuer les locaux et en nourrissant de force les grévistes de la faim. Se pose la question : renoncer (ou accepter de négocier au cas par cas de façon clandestine l’attribution de cartes de séjour pour que le gouvernement ne perde pas la face) ou décider de poser des actes plus forts. Il est rare d’observer que ceux qui ont conduit une action politique avec ténacité n’en viennent, au moment où elle doit cesser sans avoir réussi à satisfaire la revendication pour laquelle elle a été engagée, à se poser la question du passage à la violence.
En somme, de son usage direct à ses usages pacifiés en passant par ses usages sporadiques et son usage légitime à des fins de maintien de la paix civile, la violence ne cesse de figurer l’arrière-plan du politique qu’on cherche à la contenir ou à l’exprimer ouvertement.
Les raisons de la non violence
Les arguments en faveur de la légitimité de l’usage direct de la violence en politique sont connus : 1) les intérêts de groupes sociaux réunis au sein d’une même entité politique (qu’ils soient de classes, ethniques ou existentiels) sont totalement irréconciliables ; 2) l’exercice du pouvoir est une domination sans partage ; 3) cette domination est généralement celle d’un système qui opprime les peuples et exploite les êtres humains et la nature ; 4) cette oppression et cette exploitation sont injustes, indignes, immorales ; 5) le souci de maintenir la sécurité, la paix civile et l’ordre établi vise uniquement à reproduire l’aliénation des dominés, donc les conditions de l’inégalité et de l’injustice sociales comme celles de la destruction de la planète. Ces arguments dessinent donc une conception agonistique de la société, qui permet de disqualifier toute forme d’action qui renoncerait à la violence en la tenant pour inepte, « réformiste » ou confortant un « consensus » qui profite aux puissants. Et dans ce lot sont versées toutes les modalités de négociation avec un pouvoir en place, comme est dénoncé l’engagement dans les procédures de la démocratie participative ou délibérative.
Longtemps apanage des insurgées ou des révolutionnaires, l’appel à la violence directe est aujourd’hui le fait de groupes d’activistes qui luttent pour l’avenir de la planète et des générations futures et contre l’exploitation à leurs yeux éhontée et suicidaire des ressources naturelles. Ce qui introduit une différence de taille : alors que la révolution parvient à définir un ennemi (le système capitaliste et ses agents), le combat écologique s’attaque à la somme des atteintes à la nature qu’on peut rapporter à un système productiviste. S’attaquer, dans un cadre national, aux conduites des individus et des consommateurs ou aux processus de production d’une entreprise qui contribuent à dégrader l’environnement, suffirait-il à gagner le combat ? On sait bien qu’il faudrait que l’humanité entière et tous les États de la planète agissent de concert en prenant ensemble des mesures drastiques. Mais comment imaginer que l’usage direct de la violence puisse parvenir à entraîner cette conséquence ? Et comment accepter, à l’inverse, que les puissants continuent à se moquer des menaces qu’ils font courir à la vie et persistent, en pleine connaissance de cause, à porter atteinte à la biosphère, à l’humanité et aux espèces animales et végétales sans réagir ?
Ces difficultés et ces irritations posent, sans la formuler, une question générale : le politique sert-il à aménager la hiérarchie et l’inégalité des conditions des citoyens ou à préserver un mode de vie dont le caractère insoutenable est avéré ; ou bien sa fonction consiste-t-elle à y mettre un terme en imposant les conditions d’une véritable égalité, la fin de la domination et de l’exploitation, des êtres humains comme de l’environnement ? Deux options s’affrontent sur ce point : d’un côté, les réalistes proposent de composer avec la force des oppositions aux mesures drastiques et d’opter pour une politique des petits pas ; de l’autre, les militants et activistes pensent que ce compromis masque les intérêts de quelques-uns et qu’il faut en dévoiler le caractère trompeur ou aliénant, ce qui requiert la destruction des pouvoirs mortifères qui en sont responsables. C’est de ce second point de vue que la non violence est condamnée pour sa nature irénique et vaine. Comment ceux qui revendiquent cette option parviennent-ils à échapper à cette condamnation ?
Désobéissance et rassemblements
Le refus de la violence en politique est fonction de l’aversion que suscitent les dangers et les drames que son usage porte en elle. Il est, depuis longtemps, au principe de la désobéissance civile. Ce qui n’empêche pourtant pas que le recours à cette forme d’action politique continue, en démocratie, à être rejeté. Elle peut en effet être critiquée pour des raisons de justice (se soustraire à la loi républicaine est une option inacceptable), de légitimité (les intérêts des individus ne peuvent pas prévaloir sur les intérêts de la collectivité), de stabilité (l’État ne doit pas céder à ceux qui le contestent ostensiblement) ou d’efficacité (refuser de remplir une obligation est une démarche qui ne s’attaque pas aux racines de la domination et de l’inégalité). C’est pour toutes ces raisons que la décision de ne pas respecter une prescription d’un texte légal ou réglementaire est un geste que certains peuvent présenter comme une violence qui menace ou met en danger un pilier de la démocratie et de la paix civile qu’elle institue : la règle de la majorité.
Une autre forme d’action politique a fait de la non violence une stratégie : les rassemblements. La nature libre et ouverte de ces manifestations donne souvent l’image d’un bric-à-brac, d’un collage peu cohérent de revendications, qui varie de pays à pays, selon les circonstances locales et les regroupements d’individus, de militants et d’activistes qui s’y forment. On peut cependant leur trouver des caractéristiques communes. La première est une même détestation du pouvoir, qui se lit dans une série de choix : inorganisation volontaire, pluralisme, rejet des modalités de la représentation politique instituée, liberté d’expression, décision par consensus. Comme l’a bien montré Héloïse Nez, tout est organisé dans ces mouvements pour interdire l’émergence de dirigeants. La seconde, qui est immédiatement liée à la première, est l’exigence d’une démocratie réelle, qui se traduit dans des pratiques quotidiennes d’organisation de la vie collective dans l’action. La troisième est l’unanimisme : il faut faire nombre et s’appuyer sur le plus infime dénominateur commun sans exclusive. L’unanimisme gomme toutes les distinctions sociales existantes, qu’elles soient de classe, de condition, de confession ou d’appartenance. La seule condition de la révolte est le sentiment d’être victime d’un système qui bafoue la dignité des individus, que ce soit par le mépris ou l’impuissance des gouvernements ou par l’avidité, l’impunité et la corruption des puissants. Dans les pays démocratiques, ce constat se double d’un autre : celui d’une « inégalisation » croissante des conditions ou du développement d’une société duale. Une quatrième caractéristique commune est le fait que la revendication se situe directement au plan international, en sautant le niveau national, comme si la conscience de la nature planétaire des rapports de pouvoir était devenue une donnée indiscutable. D’une certaine manière, cette mondialisation de la revendication politique est le reflet de cet activisme qui, depuis une quarantaine d’années, recrute des adhérents qui rejettent les affiliations partisanes mais s’engagent pour des causes humanitaires, politiques ou écologiques (Greenpeace, WWF, Amnesty International, Médecins du monde, ATTAC, Transparency International, etc.)
Les rassemblements se constituent autour de mobiles politiques très généraux. D’abord celui d’un contrôle effectif sur l’activité de la finance et sur les décisions des grands groupes multinationaux afin de maîtriser les conséquences que leurs engagements font subir aux peuples. Le second motif de récrimination est la montée des injustices et des atteintes à l’égalité entre citoyens dont le désengagement de l’État social est rendu responsable. Il n’est cependant plus question d’émancipation ou de renversement d’un système d’exploitation impérialisme ou capitalisme. En fait, un seul mobile politique englobe tous les autres, en prenant des sens différents selon les lieux : celui de la démocratie terme générique qui renvoie au respect de la dignité individuelle et des droits fondamentaux attachés au statut de citoyen. Une autre dimension politique des rassemblements tient au fait qu’ils sont organisés par la « jeunesse », avec le soutien de nombre de leurs aînés et parfois celui des dirigeants et des autorités officielles.
C’est d’ailleurs là un phénomène sur lequel il faut s’arrêter : indépendamment du danger minime que représentent les maigres foules d’indignés ou d’occupants qui plantent leurs tentes sur des places des centres ville ou face à certaines Bourses et Banques Centrales, la compréhension ou le soutien que leur manifestent les plus hautes autorités politiques (Présidents et Pape) et financières (Directeurs de la Banque Centrale Européenne, de la Federal Reserve américaine, du Fonds Monétaire International ou de la Banque Mondiale) atteste que l’organisation actuelle du monde place les jeunes générations qu’elles vivent dans des pays riches ou pauvres dans une condition inacceptable et lourde de risques : un avenir bloqué, dans une société qui ne leur ménage guère de place et retarde leur envie d’accéder tout simplement à une vie normale. Bref, cette revendication obtient sa légitimité politique sans avoir à exercer un rapport de force : il lui a suffi de rendre publique la protestation. Ce qui conforte le choix de la non violence.
Une configuration un peu semblable vaut pour la question environnementale : en dépit des contestations et de l’incrédulité que suscitent l’annonce de l’effondrement prochain de notre écosystème et l’obligation de renoncer à des modes de vie trop voraces en énergie, l’idée qu’il faut agir pour sauver la planète et l’humanité de leur perte programmée est unanimement admise. Et pourtant, rien d’essentiel ne se fait pour modifier ce cours inexorable des choses.
Le recours à la désobéissance civile et aux rassemblements dont il y a tout lieu de penser qu’il ne va pas s’éteindre de sitôt signe l’émergence d’un certain sens universel de la démocratie radicale, qui affirme à la fois l’exigence d’une vie politique qui respecte pleinement l’autonomie des citoyens et réclame l’extension de leurs droits sociaux et politiques ; et la nécessité de s’atteler aux défis collectifs que l’avidité et le productivisme posent à l’humanité et à la planète. Tout en formulant des revendications radicales, ces formes d’action politique respectent le principe de non-violence. Cette option est justifiée par cinq arguments : 1) ne pas donner prise à la répression (dont on sait qu’elle sera implacable et disproportionnée) ; 2) ne pas disqualifier la revendication (en donnant des armes de propagande aux pouvoirs en place) ; 3) mettre au jour la violence du pouvoir au cas où il s’opposerait par la force à l’expression d’une voix discordante ; 4) maintenir l’unanimisme, qui permet de réunir le nombre le plus important de gens qui est la seule arme sur laquelle les mouvements non violents peuvent compter ; 5) œuvrer, par l’exemple personnel d’une protestation légitime, à une transformation des mentalités à long terme en pensant impossible la perspective d’un changement immédiat et brutal de système économique et politique (qui est pourtant la seule réponse sérieuse à l’interrogation soulevée).
Quand on considère le refus délibéré de faire un usage direct de la violence, tel qu’il s’exprime dans ces deux types de mouvements de contestation contemporains, on observe qu’il obéit à un choix stratégique. Qu’il est politique en ce sens. Et si on devait prendre ce choix au sérieux, il faudrait se poser une question : le développement de ces nouvelles formes d’action signe-t-il un adieu à une ère ancienne du politique fondée sur la confrontation ou sommes-nous toujours pris dans une lutte entre intérêts antagoniques qui justifierait la nécessité d’un recours à la violence (ce qui placerait les désobéissants et les rassemblés du côté des idiots utiles du capitalisme et de la domination ou les tiendraient pour des agents objectifs de l’aliénation) ? Telle est la situation dans laquelle l’actualité des mouvements de protestation nous plonge et qui oblige à revenir sur les évidences reçues au sujet de l’exercice du pouvoir, de la démocratie et du savoir-faire politique du citoyen.