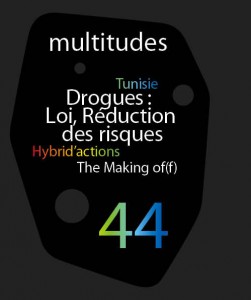L’approfondissement de la recherche sur l’utopie,
le rôle décisif de la justice
La rencontre avec la justice, et avec la société de justice, intervient ici au long d’une recherche sur l’utopie, sur son histoire et sur son sens. L’utopie littéraire et philosophique, de Platon, Thomas More, et Campanella à Fourier et William Morris, ne pouvait à elle seule expliquer ce phénomène trop grand pour elle. Les histoires de l’utopie écrites au XXe siècle (comme celle de Mumford ou Manuel et au delà) se centraient sur le fait littéraire mais ne pouvaient se passer de dédier un petit espace à des faits historiques, comme le messianisme hébraïque, le millénarisme, le christianisme. Karl Mannheim et Ernst Bloch évaluent l’utopie comme le constituant le plus profond et le plus dynamico-constructif de l’histoire, comme le « processus » historique par excellence. Ernst Bloch nous invite même à découvrir dans l’histoire « le principe espérance », apte à soutenir l’humanité dans sa lutte pour la justice. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de son matérialisme évolutionniste qui ferait de la « démocratie vraie » l’aboutissement de l’évolution de la matière elle-même.
Notre recherche a formé un itinéraire qui s’appuie sur des mouvements de peuples, et avant tout sur les « mouvements religieux de salut » : messianisme hébraïque, sur lequel se greffe ensuite l’annonce évangélique, alors que, deux siècles auparavant, était déjà apparu le millénarisme. Enfin, dans le christianisme, se développe l’hérésie médiévale et moderne qui, avec le puritanisme et sa transposition du projet du niveau religieux au niveau politique, aurait amorcé la seconde série des mouvements, les « modernes mouvements révolutionnaires ». Les uns et les autres, porteurs du projet utopique comme projet d’une société de justice, et ensuite d’une société fraternelle.
La rencontre avec la justice était advenue déjà, dans une certaine mesure, dans la phase précédente et préhistorique, celle du mythe : le mythe de l’âge d’or dans les débuts de l’humanité, tout au moins dans l’élaboration des poètes, Hésiode avant tout, Catulle, Ovide. Mais la justice s’est révélée ensuite comme la catégorie dominante du messianisme hébraïque. Ainsi, dans Jérémie, le « messie », c’est-à-dire le consacré, le libérateur, a pour nom « Yahvéh-notre-justice », et sa ville porte le même nom (23, 6 ; 33, 16) ; et dans tout le prophétisme il est annoncé comme le porteur de justice pour son peuple opprimé par d’autres peuples, surtout par les grands empires, l’assyrien, le babylonien, le persan, l’alexandrin, le romain ; et comme bâtisseur d’une société de justice où auraient disparu le tyran et l’oppresseur, et dans laquelle les faibles – le pauvre, l’orphelin, la veuve – seraient protégés. Il est également significatif que la figure charismatique et prophétique qui donna naissance au mouvement essénien ait porté le nom de Maître de justice. En outre on doit préciser que dans tout le messianisme, on ne traite pas seulement de la justice dans son sens fondamental biblique de transcendante perfection de Dieu en soi et dans son rapport avec la créature, perfection à laquelle cherche à s’assimiler l’homme de foi ; mais elle est vue aussi précisément comme rapport correct entre les hommes, dans la société et dans la cité.
Rapport correct : c’est à dire qui correspond à la dignité et au droit de la personne humaine. C’est le sens de la justice : correspondance avec la dignité et avec le droit de la personne, de chaque personne, dans son être et son co-être, la personne étant de par sa constitution un co-être ; en tant qu’être d’espèce, modèle qui existe en une multiplicité et une totalité potentielle indéfinie d’individus (néanmoins personnes ; non seulement espèce, mais espèce-esprit ; ce dernier mot, qui le plus souvent est aujourd’hui évité ou refusé, est nécessaire) ; à travers la génération, et puis à travers la croissance et la formation jusqu’à l’autonomie ; processus qui se réalise dans le co-être, dans des moments très intimes comme le coït, la grossesse, l’allaitement, mais aussi ensuite dans l’école et dans le travail, dans l’universelle coopération humaine. Correspondance, par conséquent, de la personne et à la personne en elle-même, et dans les ambiances où s’étend son co-être : la famille, l’amour, l’amitié, l’association, l’école, l’église, l’entreprise. Et enfin la cité, l’État, qui par une cession de droit de la part de la personne même, est principe de droit, et entraîne la correspondance mutuelle de la cité à la personne et de la personne à la cité.
La fameuse définition d’Ulpien, « stabilis et perpetua voluntas [la volonté stable qui fait la vertu] ius suum cuique tribuendi » (une volonté stable et perpétuelle d’attribuer à chacun son droit) peut être encore significative si ce « ius suum » est assigné à la personne comme telle, et non en considération d’une de ses prérogatives particulières : biens, intelligence, culture, position économique et sociale.
Ce fondement et cet éclaircissement de la justice dans la personne sont certes refusés par les postmodernes et les postmétaphysiciens ; ils refusent tout ce qui a consistance d’être ; ou ils le déconstruisent afin qu’il perde – pensent-ils – cette consistance : la personne comme interlocuteur du « discours », toute la réalité étant réduite au discours (c’est la théorie de Habermas) ; la personne comme « unité narrative d’une vie » (voir l’essai de Paul Ricœur dans « Esprit », Approches de la personne, mars-avril 1990, pp. 115-130). Mais de l’aliénation philosophique des postmodernes, de leur « pensée destructive », j’ai déjà parlé suffisamment dans mon livre sur l’utopie (L’utopia. Rifondazione di un’idea e di una storia, Bari 1997) ; et aussi de Rawls, de sa figuration mentale, de sa justice faite de liberté et d’inégalité, de sa théorisation idéologique du système bourgeois (§§ 43.3, 59).
La justice étant ainsi établie comme correspondance à la dignité et au droit de la personne dans son être et son co-être, ses facteurs constituants se révèlent être la liberté, l’égalité, la solidarité. La liberté, qui coïncide avec la dignité et le droit de la personne ; la dignité se rangeant dans l’autoconscience, l’autodécision, l’autoconstruction et l’autonomie de la personne dans laquelle prend corps son droit qui s’affirme et s’impose, où nul ne peut s’interposer d’aucune manière, mais que chacun doit reconnaître, respecter, et accomplir, dans les limites du lien éthique auquel chacun est lié. L’égalité, qui consiste essentiellement en la même dignité et le même droit de chaque personne en tant que telle ; mais aussi en tout ce que cette dignité et ce droit comportent de biens matériels, de biens spirituels et culturels, de biens sociaux. La solidarité, qui a sa source dans le co-être, dans la coopération, dans la grande entreprise humaine où la personne naît, grandit et se construit jusqu’au niveau historique des besoins et de la culture : la nécessaire participation de chacun, l’engagement effectif de tous.
Le processus historique, les mouvements religieux de salut, le projet d’une société de justice et d’une société fraternelle
On peut dire qu’à la base du processus utopique il y a une tension et réaction humaines, populaires, d’un peuple qui vit dans l’injustice et qui en ressent et y réagit. Trois grands phénomènes le démontrent (contre la théorie de la servitude volontaire) : la révolte populaire, présente dans toute l’histoire humaine ; les processus de démocratisation (Athènes, la lutte de la plèbe romaine, les communes du Moyen-Âge), les révolutions modernes. Il y a donc une conscience populaire et il y a, plus universellement, un lien éthique qui pousse à l’action : « homme, sois juste, c’est ton devoir, tu dois être juste ».
Mais, à un certain moment, se déclenchent les mouvements de salut, les deux premiers avant tout, dans lesquels le projet utopique se déclare, se formule. Le messianisme juif – comme on le disait déjà – dont la catégorie centrale est la justice ; on l’a vu. L’annonce évangélique, qui reprend le principe de justice (dans deux grands thèmes surtout : le refus de la richesse expropriatrice et le refus de la puissance et du pouvoir oppressif), mais qui le transcende avec le nouveau principe du rapport fraternel, la loi de l’amour fraternel. Le messianisme juif est un mouvement de grand envergure, qui s’étend du VIIIe siècle avant J.-C. (les premiers prophètes, Amos, Osée, puis Isaïe) à l’âge alexandrin.
On peut dire qu’avec ces deux mouvements l’humanité – parce que dans ces mouvements il s’agit toujours d’une annonce universelle, destinée à tous les peuples – a tracé son projet utopique, d’une société de justice et d’une société fraternelle.
Le fait décisif, dans une prospective historique, est que ces deux mouvements appartiennent certes à un petit peuple, Israël, mais qu’avec la diffusion du christianisme, leur annonce pénètre l’esprit de l’Europe, surtout de l’Occident chrétien. Et, bien que l’église se soit mondanisée, et plutôt que le modèle évangélique d’une communauté fraternelle, elle ait poursuivi le modèle hiérarchique et impérial romain (avec surtout la papauté), le projet est reprit par les mouvements hétérodoxes qui parcourent le Moyen-âge et la première modernité : le millénarisme ; l’hérésie médiévale qui est une chaîne de mouvements qui essayent de reprendre l’annonce évangélique aux pauvres, c’est-à-dire au peuple qui est pauvre, et l’esprit fraternelle en refusant la hiérarchie ecclésiastique ; c’est pourquoi ils sont, l’un après l’autre, persécutés et anéantis.
C’est par cette chaîne de mouvements, en particulier par Wiclef et Hus, qu’on arrive à la Réforme, laquelle prône aussi une église du peuple, bien qu’elle cherche dans les princes son soutien pour ne pas périr écrasée par la papauté et l’empire ; on arrive aux mouvements hétérodoxes de la Réforme, à l’Anabaptisme, au Puritanisme anglais, le mouvement décisif qui transfère un projet jusque là religieux dans le politique et déchaîne la première des révolutions modernes, la Révolution anglaise du Long Parlement, 1940-1953.
Le processus historique, les mouvements révolutionnaires modernes, la construction d’une société de justice
Après le projet, la construction. Les mouvements de salut ont tracé un projet et ont essayé son développement communautaire ; c’est avec la modernité que se déclenche la phase constructive d’une société de justice. À commencer par les grands principes éthiques qui y viennent à maturation. Le principe d’homme, qui émerge avec l’Humanisme du XVe siècle, qui s’éclaire et s’affirme le long de cette époque : dignité de l’homme, de la personne humaine, dignité et droit. Le principe de liberté et des libertés (conscience, pensée, parole, presse, action, association), d’égalité, de souveraineté populaire qui s’affirme dans la Révolution anglaise ; mais le principe d’égalité est toujours fortement combattu par les classes privilégiées et par leurs idéologues, par le capital et la bourgeoisie (qui dans mon propos s’identifient, la bourgeoisie détenant le capital). Le principe de raison et d’intériorité – par lequel l’homme a le droit et le devoir d’agir sous la force d’une raison intérieure –, qui mûrit dans l’esprit de la raison moderne. Le principe de solidarité qui se forme dans l’expérience de la lutte solidaire et fraternelle des révolutions, dans l’expérience solidaire des luttes de la classe ouvrière ; et dans le processus d’unification de l’humanité, à partir peut-être des grandes découvertes géographiques, puis avec l’apparition et la diffusion d’une pratique politique et d’une technologie universelles, pratique de la communication et de l’information jusqu’à l’ubiquité et à l’omniprésence, jusqu’à la constitution d’une communauté internationale à caractère planétaire, d’une économie globale.
La maturation et l’affirmation de ces principes trouvent leur sanction historique dans les chartes des peuples. J’en indique quelques-unes : le Pacte du peuple (anglais) de 1647 ; la Déclaration d’indépendance américaine de 1776 ; la première Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 ; les Constitutions de l’Amérique et de la Révolution française, puis les constitutions démocratiques ; la Charte atlantique, le Pacte de l’ONU, les autres documents et pactes souscrits dans le cadre de l’ONU. Là est le lieu de la conscience éthique moderne et de ses principes. Non dans la pensée et les écrits des philosophes, souvent aliénés et aberrants, surtout après la crise de la conscience moderne. Dans le refus du « fondement », dans l’impuissance d’établir une fondation, dans le refus de la vérité et de la certitude, même limitées (comme ne peut que l’être la vérité humaine), le lien éthique perd son caractère péremptoire, « catégorique » selon le mot kantien ; il devient « faible », valide seulement – par exemple – s’il est accepté par la « communauté [supposée] universelle du discours » (encore la théorie « prestigieuse » de Habermas).
Compte tenu de cette incertitude multiple, il s’agit de savoir si « ne pas tuer », « ne pas faire esclave son semblable » sont ou non des liens éthiques péremptoires et insurmontables. En effet s’ils sont faibles, ils ne contraignent pas la conscience de façon insurmontable et l’homme peut tuer ; s’ils ne sont pas acceptés par la communauté du discours, on pourra tuer également. Quelle force insurmontablement contraignante peut avoir la « communauté du discours » ? Si les liens éthiques ne sont pas catégoriques, l’arbitraire individuel prévaut, et l’humanité est abandonnée au chaos social. Réapparaît alors – mais cette fois non comme simple hypothèse – le bellum omnium contra omnes. Le philosophe poursuit donc sa déclaration d’impuissance et de défaitisme, dans les livres et les journaux ; mais fort heureusement les principes et les liens éthiques acquis par la conscience moderne, sont solidement ancrés dans les chartes des peuples.
Un autre pas important dans la construction d’une société de justice est constitué par le modèle démocratique né de la Révolution anglaise. Qui a ses points fondamentaux dans la loi (et non plus dans l’arbitraire du monarque ou de l’aristocratie) ; dans le parlement en tant qu’organe législatif choisi par le peuple, de telle sorte que l’auteur de la loi soit le peuple lui-même à travers ses représentants, et que personne ne soit sujet sinon d’une loi dont il est l’auteur ; enfin dans une organisation judiciaire unique, valide pour tous. À l’origine, la base élective du parlement est très restreinte et peu populaire ; en outre l’une des Chambres est héréditaire et issue de l’aristocratie. Mais la base élective s’élargira jusqu’au suffrage universel ; la Chambre héréditaire résistera seulement en Angleterre, mais seulement avec un pouvoir limité. Le modèle démocratique s’imposera au niveau planétaire.
Un premier grand pas dans la restitution et la gestion du pouvoir par le peuple ; qui cependant reste à mi-chemin, dans la démocratie représentative, la gestion indirecte ; où le peuple intervient seulement comme électeur tous les quatre ou cinq ans (par le référendum aussi, là où il existe), sans possibilité d’une audition préalable du candidat, d’un mandat précis, d’un compte-rendu de son activité. Dans la représentation intervient l’organisation des partis qui gèrent seuls le fait électoral, manipulant l’opinion publique de toutes les façons à travers la clientèle et les mass médias ; ainsi gèrent-ils seuls le pouvoir en dehors du parlement, et tendent-ils à se l’approprier de façon polyvalente et globale : c’est le « gouvernement des partis », dont nous avons fait une large et triste expérience, et que nous continuons à faire.
Le pas complet, c’est la démocratie directe, la gestion populaire directe du pouvoir politique à tous ses niveaux, gestion en assemblée ; celle qui a eu son plus ancien et plus haut exemple dans l’Athènes antique, modèle non dépassé, point lumineux vers lequel va toujours la pensée et le désir. Point de tension du processus démocratique moderne déjà dans les projets politiques de la Guerre paysanne de 1524-25, puis dans la Révolution anglaise (Winstanley en particulier) ; puis dans la Révolution française, dans la Constitution de 1793, dans les sections révolutionnaires de la Municipalité de Paris, dans le mouvement de Babeuf ; dans tout le filon utopique français du XIXe siècle de Fourier à Proudhon ; dans la Commune de Paris de 1871 ; dans la Révolution des soviets de février 1917, début authentique de la Révolution russe ; dans la Contestation des années 1960-70 ; dans le projet politique de la perestroïka. Ce retour insistant de la démocratie directe est le signe d’une tension historique et éthique, vers la réalisation de la souveraineté populaire.
Les théoriciens bourgeois disent que c’est impossible – Rousseau le disait déjà – et s’en moquent : ce serait possible seulement dans un petit état, disent-ils, au niveau d’un canton ou d’une province ; alors qu’aujourd’hui déjà les villes sont grandes, sinon énormes. Mais l’Athènes antique n’était pas petite, avec ses 500 000 habitants ; même si ses citoyens, les membres de droit de l’assemblée, étaient seulement 30 0000 ; un chiffre qui nous étonne, nous modernes, pour un régime d’assemblée. En réalité ces théoriciens, dans leur scepticisme, n’ont jamais affronté sérieusement le problème ; nous-mêmes l’avons affronté sans le trouver insoluble. Le grand est composé du petit (voir un projet de ce genre dans mon livre La Russia e la democrazia. Il riemergere della democrazia diretta, Bari 1994, pp. 63-153 ; et dans G. Schiavone (ed.), La democrazia diretta. Un progetto politico per la società di giustizia, Bari 1997). La décadence du parlement en proie au gouvernement des partis, aux lobbies, à la corruption, à l’avidité des partis pour l’argent ; la désaffection et le dégoût des gens pour la politique, sont un signe de la tension historique vers la démocratie directe.
Ultérieurement d’autres pas ont été franchis vers la construction d’une société de justice. Avec la Révolution française la démolition du pouvoir monarchique et aristocratique qui avait dominé l’entière histoire humaine : les monarchies, les empires, le début d’une époque qui verra leur fin ; à partir de 1848 le processus se généralise, les monarchies cèdent leur pouvoir à la loi, au parlement. Avec la première guerre mondiale on assiste ensuite à la fin des empires continentaux, celui des Habsbourg, de la Prusse, de la Russie, l’empire ottoman ; l’empire chinois avait pris fin en 1912 ; restait celui du Japon qui se terminera avec la seconde guerre mondiale ; lors que s’effondrent aussi les empires coloniaux et s’affirme le principe d’autodétermination des peuples.
C’est aussi au cours de la Révolution française qu’intervient l’abolition de l’esclavage ; réintroduit ensuite par Napoléon, grand despote et grand boucher ; aboli de nouveau en France en 1815 et partout dans le monde le long de ce siècle. L’abolition de la peine de mort au XIXe siècle, et de façon plus décisive au XXe, avec toutefois de graves exceptions et de gros retards comme aux Usa ; qui prétendent néanmoins être les guides du monde, même sur le plan moral ; prétention mesquine. L’État n’a pas le droit de tuer un citoyen, parce que son pouvoir est né d’une cession de droit des citoyens eux-mêmes et cette cession ne peut être totale, sous peine de disparition du cédant (« la souveraineté et les lois […] ne sont qu’une somme de portions minimes de la liberté privée de chacun », disait Beccaria avec une force singulière, Des délits et des peines, 28) ; d’autre part l’homme n’a pas un droit de vie et de mort sur lui-même, qu’il puisse céder.
Un pas d’énorme portée, le plus grand et le plus décisif de l’histoire humaine peut-être, s’accomplit au XIXe et au XXe siècles, avec l’ascension de la classe ouvrière et de la condition populaire : dans le travail, dans le revenu, dans la sécurité sociale, dans l’instruction et la culture, dans le bien-être. Un processus encore en cours, même dans les pays économiquement et culturellement les plus avancés : le travail étant encore en grande partie dépendant et exploité ; il le sera tant qu’existera le contrat salarial et jusqu’à ce que soient rejointes l’autopossession et l’autogestion de l’entreprise, et que le capital disparaisse. Le revenu est réduit par l’exploitation au profit du patron ; il est réduit encore plus par le travail noir, le travail sous-payé sous toutes ses formes ; pour être ensuite dévoré par la consommation, par l’achat forcé souvent superflu, souvent inutile : la société « opulente », société de bien-être matériel qui se gonfle dans le gaspillage, avec de graves problèmes de justice, de distribution des biens entre ses membres, problèmes de ressources, d’environment. La sécurité sociale, assistance et assurance, a rejoint un bon niveau, du moins dans l’espace européo-occidental ; avec cependant de gros problèmes dans l’extension et la qualité de l’assistance sanitaire, dans l’assistance et la réduction de la pauvreté, dans la répartition des retraites.
Un point clef est celui de la sûreté du poste de travail, dans un système où manque encore une providence globale de la communauté vis à vis de tous ses membres. Il manque en particulier la société que nous appelons « société de cadre », une société dans laquelle l’ensemble production-travail-richesse soit géré rationnellement (les moyens pour le faire, en particulier informatiques, ne manquent pas aujourd’hui) en termes tels qu’il assure à chacun non seulement le travail mais « son » travail, celui qui correspond à sa personnalité « formée ». L’instruction obligatoire et gratuite, sans parler de sa qualité, est encore trop brève, réduite à l’école élémentaire et moyenne, alors qu’elle devrait rejoindre pour tous au moins le diplôme universitaire, si l’on veut que la personne parvienne à une possession suffisante du patrimoine culturel humain qui lui appartient ; qu’elle parvienne à une possession réelle de la culture ; et que prenne fin, à ce point crucial, la disparité de toujours, l’ignorance, l’impuissance du peuple en face de l’œuvre d’art, du temple grec, de la musique classique. Le bien-être, la prospérité sont des structures de toujours du projet utopique, structures de son archétype (cf. L’utopia, cit., § 4).
L’énorme portée du processus d’ascension économique et culturelle de la classe ouvrière dans la construction d’une société de justice, tient au fait d’avoir dépassé enfin et pour la première fois cette condition dans laquelle l’homme était enlisé, dans la pauvreté et dans l’ignorance, dans la dure matérialité du travail qui dévorait ses énergies et son temps, limitait son développement mental et personnel. Une petite minorité de privilégiés seulement pouvait rejoindre l’humanité, humanitas, homo humanus ; la très grande majorité était prisonnière de l’inhumain. Et cela en régime de civilisation, tandis que la condition « primitive » était meilleure : rappelons nous les récits de Christophe Colomb, son admiration pour ces « primitifs ». D’où la portée du processus, la mutation épocale, le début d’une « histoire » au sens marxien, non plus inhumaine mais humaine.
À la base de cette ascension, de sa possibilité, il y a certes les deux grandes inventions de la bourgeoisie moderne : la technologie et le capital. La technologie, ou mieux la science-technologie-industrie, est la production par des modèles universels rendant possible la satisfaction de l’universel besoin humain ; la « technique », la production par des modèles et des objets singuliers, ne pouvait parvenir à cette satisfaction et restait bloquée dans la pénurie. Le processus de capitalisation à travers le réinvestissement d’une partie du profit, et par conséquent l’expansion continue, prépare une base matérielle – financière et instrumentale – qui permet l’expansion indéfinie de la production technologique, de la globale richesse humaine, de la disponibilité des biens au service du besoin humain. Mais l’ascension ne se produit pas, et en fait elle ne s’est pas produite, sinon par la lutte de la classe ouvrière, lutte de plus d’un siècle, lutte et révolution.
Avec la Contestation des années 1960-70, qui est la quatrième des révolutions modernes, même si elle est atypique, c’est la fin de la société répressive ; de cette société qui, même quand elle reconnaît les droits, en empêche l’exercice à travers les coutumes, la pression idéologique – fausse raison, fausse morale –, la loi ; pour des motifs de privilège et de pouvoir : pouvoir masculin, pouvoir religieux, pouvoir de l’adulte dit « normal », d’une race (terme utilisé habituellement, mais de signification incertaine), d’une ethnie. C’est aussi la fin de toute forme de discrimination et de marginalisation. L’affirmation de la dignité et du droit de l’enfant, de la femme, du jeune, du différent, de l’handicapé, du malade (spécialement mental, la réhumanisation de la folie à tout ses niveaux) ; la dignité et le droit du noir dans une société blanche (en Amérique, la grande lutte pour les droits civils), les droits des minorités raciales, ethniques, religieuses ; la révision de la morale sexuelle. Ici encore le saut épocal, même si le processus est toutefois en cours.
Avec la crise écologique qui s’ouvre dans les années 1970, perd sens la prétention d’une domination inconditionnelle de l’homme sur la nature : prétention insensée parce que l’homme est lui-même une partie de la nature, et ne peut vivre et survivre que dans une nature ambiante qui lui corresponde. L’usage instrumental inconditionné de la technologie par le capital-profit avait porté à une instrumentalisation inconditionnée de la nature, à sa destruction potentielle pour le profit. Se réaffirme donc la nature comme principe ; non qu’elle soit une personne, mais elle existe avant l’homme et le conditionne ; par conséquent le rapport correct avec celle-ci (il ne s’agit pas de justice mais d’une notion analogue), sa reconnaissance, son respect, sa sauvegarde : la « correspondance » qui constitue la justice. En particulier le respect de l’animal comme frère mineur de l’homme (« frère adolescent », dit Péguy) : encore ici par analogie, en ce sens que l’animal a préparé et mûri, à travers l’évolution des espèces, l’apparition de l’homme sans le rejoindre ; et l’homme doit le reconnaître, il lui doit reconnaissance, « correspondance ».
Avec la perestroïka, avec la chute des blocs hégémoniques opposés, non seulement prend fin la course aux armements, mais – pour la première fois dans l’histoire – débute la destruction des armes, la réduction des armées permanentes. La volonté de paix, exprimée durant ce siècle par les mouvements, sanctionnée par la Charte atlantique et par le Pacte de l’ONU, se renforce ; et on espère que le Conseil de sécurité (bien qu’injuste dans sa composition, et faible dans son pouvoir de décision) devienne plus efficace dans ses interventions de prévention et de solution des conflits locaux. On voit s’ouvrir la prospective d’une ère de paix plus diffuse, et de dissolution des armées nationales au profit d’une armée internationale de paix, gérée par la communauté des peuples.
La construction d’une société de justice est en cours, éloignée encore de son accomplissement (mais on peut jamais parler d’accomplissement dans la finitude et l’historicité des choses humaines) ; même dans les pays où elle est le plus avancée en raison du niveau éthique, politique et économique de ceux-ci : en Europe et en Amérique du Nord. De profondes différences persistent parmi nous : les tranches de pauvreté par exemple (environ 7 millions de personnes vivent dans la précarité en France, 40 millions aux Usa) ; les tranches de chômage ; la drogue, les névroses, la criminalité ; les insuffisances et la médiocrité de l’instruction, de la santé, de l’assistance ; l’inégalité, les différences encore énormes entre les revenus. Innombrables problèmes non résolus.
La construction se poursuit de façon inégale selon les continents et les peuples ; il y a entre eux des différences politiques, économiques et culturelles parfois abyssales, parfois très grandes : on pense à l’Afrique ou à l’Amérique latine. Pauvreté diffuse, analphabétisme, absence de services ; bidonvilles, favelas ; dictatures, fondamentalismes, luttes tribales et massacres. Différences qui, certes, peuvent être comblées comme il est déjà advenu dans de nombreux peuples ; mais qui perdurent néanmoins avec des effets désastreux et très douloureux.
Le processus est heurté, il n’est pas linéaire, sinon peut-être dans la globalité de l’itinéraire que la recherche et la conscience recomposent. Une ligne brisée, interrompue, avec des tournants, des arrêts, des reculs, des retours. Un chemin difficile à cause de la variété complexe des positions, des forces qui s’y opposent et s’y combattent, des intérêts contradictoires ; du reflux et de la pression du passé sur le présent-futur ; de l’incidence de l’erreur, de la transgression.
Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un processus européen ou occidental, même si la phase particulièrement constructive qui part de la Révolution anglaise, naît et se développe surtout en Occident ; toutefois la première phase du processus, les mouvements religieux de salut, le messianisme hébraïque, le millénarisme, le christianisme même, sont du proche Orient. Mais tout cela a peu de poids parce que le processus est universel, concernant l’homme en tant qu’homme. Ce n’est pas que la dignité de la personne humaine, la liberté et l’égalité soient valables pour le Nord et non pour le Sud de la planète ; ni que les préceptes « ne pas tuer », « ne pas faire esclave son semblable » s’imposent à la conscience européenne et non à celle des asiatiques. Les principes éthiques, le modèle démocratique, les structures de la société de justice sont universelles ; comme sont universelles la science-technologie et l’accumulation du capital qui confluent dans le processus.
Le sens de l’histoire, le fondement de l’espérance
La construction d’une société de justice se présente donc comme un processus qui rassemble en lui-même l’entière histoire humaine, qui l’unifie, d’abord intentionnellement, puis effectivement, à travers la réalisation de sa valence universelle ; de telle sorte que l’humanité se rassemble en une histoire unique et, justement, universelle. Qui mûrit en notre temps. Actuellement on parle surtout de « globalisation de l’économie » ; mais le processus est plus profond et plus étendu ; c’est un processus d’universalisation qui embrasse le monde entier en commençant par les principes éthiques, le modèle politique, la science-technologie ; et donc aussi l’industrie, le monde des objets et les comportements de leur usage, l’économie, la culture, l’information et la communication jusqu’à l’ubiquité et à l’omniprésence. Il est vrai aussi que de notre temps existent des cultures historiques qui affirment leur identité en se différenciant, et en s’opposant à l’Occident : la première de toutes étant l’Islam ; avec un patrimoine éthique et juridique en partie archaïque et injuste (polygamie, asservissement de la femme de multiples façons, peine du talion) ; avec des modèles politiques, cléricaux et/ou despotiques, injustes également. Mais ces points d’injustice commencent à être compris même à l’intérieur de ces cultures.
Le processus utopique, le projet et la construction d’une société de justice à travers les mouvements populaires, les mouvements religieux de salut et les mouvements révolutionnaires modernes, se dégage de l’histoire même. Un fil d’histoire qui est en même temps le sens de l’histoire entière. Cette histoire est un fondement d’espérance. Nous avons construit durant les trois derniers siècles, à travers les révolutions modernes, la lutte de la classe ouvrière, son sacrifice, les autres mouvements, des apports innombrables, dont nous jouissons déjà maintenant. Une condition incomparablement plus humaine, malgré ses limites, malgré tout ce qui reste encore à accomplir. C’est pourquoi, précisément à notre époque, parmi nous, peuples d’Occident, le pessimisme et le scepticisme historiques deviennent difficiles à comprendre.
Toutefois la peur pénètre, et envahit même, la conscience populaire. Les motifs de cette peur ne manquent pas, même s’ils sont contingents et ne touchent pas le grand fondement historique de l’espérance. À commencer par la précarité, les oscillations et les craintes pour l’existence dans l’incertitude du poste de travail, l’incertitude et la médiocrité du revenu, la pauvreté économique et culturelle. Il est nécessaire que contre les porteurs de peur se renforce la personnalité, la culture, la capacité critique et créative ; capacité de résistance, de lutte, volonté de liberté. Il est nécessaire que de nouveaux mouvements de libération se développent.
Mais le parcours historique évoqué ici constitue aussi une garantie pour le futur, le parcours de trois millénaires, la construction poursuivie pendant trois siècles, et donc le fondement de notre espérance dans le présent-futur, de notre confiante certitude. La catégorie de l’espérance a été introduite par Bloch, qui lui a consacré son œuvre monumentale et pléthorique, Le principe espérance (Frankfurt a.M., 1953-59). C’était une grande intuition, qui compensait l’autre tonalité existentielle, l’angoisse : la perception dans la psyché, et dans la conscience, du néant de l’homme ; elle compensait son angoisse en lui faisant ressentir l’être de ce néant, sa capacité opérationnelle, constructive et rédemptrice, tout ce qu’en fait il a construit et racheté. Cette espérance, cette certitude confiante nous réconfortent dans le chemin tourmenté de l’existence et de l’histoire, elles nous donnent de la force ; elles nous poussent à l’engagement, elles nous soutiennent dans l’engagement. Pour une société de justice : engagés pour la construire, pour l’édifier ensemble.