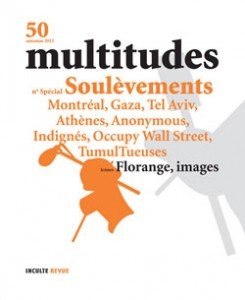« Le seul mythe moderne, c’est celui des zombis. »
Le 3 octobre 2011, les zombies ont marché sur Wall Street. Ils ont cessé d’errer solitaires sous les traits qui les rattachaient encore au mirage de leur individualité. Chaque visage s’est défait dans le même rictus et les mêmes tics, mâchant stochastiquement des billets de banque de Monopoly. En trouvant en Wall Street le lieu symbolique de leur ralliement, ils se sont incorporés en une seule masse à la marche lente et titubante : « Corporate Zombies ». Ils boitent, ils grognent. Le corps massif des zombies dévore et digère toute vie sur laquelle il marche irrésistiblement. Courez, vivants ! Ils marchent sur vous. La morsure du zombie anthropophage vous zombifie. La masse homogène s’accroît et accroît sa puissance à mesure qu’elle avance et se densifie.
Que célèbre cette parade carnavalesque ? Initiée au début des années 2000 dans certaines villes des États-Unis, la « zombie walk » est un phénomène de type flashmob, rassemblement spontané et réticulaire dans un centre-ville d’une foule de manifestants maquillés en zombies. Devenu un rite annuel dans certaines villes, ce happening ne relève pas d’une tradition politique ; c’est une manifestation gratuite, sans message, qui introduit dans la vie quotidienne l’inquiétante étrangeté du cinéma de genre, faisant boiter pour quelques heures la cadence urbaine métronomique. La rencontre de cette forme de manifestation avec le mouvement « Occupy Wall Street » (OWS) n’est cependant pas fortuite. Je voudrais montrer que l’imaginaire politique de cette marche révèle malgré elle l’essence même de ce mouvement, dans sa force politique, mais aussi dans sa fatale ambiguïté, oscillant entre vitalité et morbidité.
Le système sorcier
Qui sont les zombies de Wall Street ? À un premier niveau apparent, ce sont les banquiers, les « banksters » : « money-hungry fascists are dead inside ». La pulsion nutritive du zombie représente la cupidité des agents du capitalisme financier. Mais cette dénonciation simpliste tombe sous l’effet même de l’image qu’elle surcode ; masse contagieuse, les zombies sont toujours plus nombreux. Nous sommes les 99 %, nous sommes les zombies.
Le « zombi » de la mythologie vaudou est un être littéralement « sans volonté », cadavre sorti de sa tombe par le pouvoir d’un sorcier. La parade du 3 octobre 2011 reprend cette imagerie pour dénoncer la morbidité des formes de vie qui nous sont offertes et inoculées par l’époque. Tel qu’il est théorisé par Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, le système capitaliste est en effet un « système sorcier ». Comme tout régime de pouvoir, il n’ignore certes pas la police et la contrainte. Les flux de capitaux prétendument « déterritorialisés » ne vont en réalité jamais sans la sécurité des frontières et des territoires. Mais la force ne suffit pas au pouvoir. Loin d’écraser ceux qu’elle se soumet, la force sert toujours de point d’appui à une résistance potentielle. La force nue donne prise à son propre renversement. C’est la brutalité policière qui a renforcé OWS et attiré sur lui la sympathie de l’opinion. Le pouvoir est d’autant plus efficace qu’il est moins coercitif, plus incitatif. C’est pourquoi il encode toujours les rapports de forces dans une idéologie ou un « esprit » sans cesse renouvelé, qui lui sert de justification théorique. Mais ce n’est pas tout : le capitalisme ne se contente pas de gagner nos esprits, en nous convertissant à l’idéologie industrielle du « progrès » ou à l’idéologie connexionniste du « projet ». Comme le sorcier vaudou annihile la volonté de celui qu’il zombifie, la « sorcellerie capitaliste » capture nos âmes. Le soutien que Woody, la fameuse vache des glaces Ben & Jerry’s, a apporté à OWS est à cet égard un symptôme de la réversibilité tactique de la contestation, de sa convertibilité en instrument spectaculaire du pouvoir qu’il conteste. L’efficacité non répressive du pouvoir consiste en cette étrange magie à distance par laquelle il prend possession de nos âmes sans même convertir nos esprits. Zombis, nous sommes sans volonté face à ce que nous savons et voyons quotidiennement des effets pervers du capitalisme financier, sans volonté face à la misère rationalisée et rentabilisée. Il n’est plus besoin de la rendre intellectuellement acceptable par les dogmes libéraux de l’utilité globale ou de la main invisible (« what is good for Wall Street is good for Main Street »). Le sortilège opère en séparant les effets de leurs causes, en les isolant comme autant de symptômes orphelins sur lesquels notre conscience glisse. L’âme de la contestation est simulée et capturée par le système sorcier, vendue au diable des marchés financiers.
L’invasion des zombies comme épochè
Mais ce n’est pas si simple. Il n’y a pas de grand sorcier manipulateur derrière le fonctionnement de la machine capitaliste. Patrons, banquiers, traders, gouvernants, aucun de ceux qui contribuent à la fluidité de ce fonctionnement et qui en profitent diversement n’en sont les maîtres cyniques. Sous les slogans qui la trahissent, la parade du 3 octobre propose une autre vision du pouvoir, moins manichéenne. Sa référence n’est pas le mythe vaudou originel, elle est très visuelle, stylisée, cinématographique. Le mot d’ordre de la marche prenait expressément pour modèle Thriller de Michael Jackson et, à travers lui, le cinéma de genre de George A. Romero, qui a réinventé le mythe du zombie. Dans La Nuit des Morts-vivants, la cause de la survie qui frappe soudainement les morts demeure méconnue et impersonnelle. Elle ne relève pas d’une finalité, comme la volonté d’un sorcier, mais d’une causalité strictement mécanique, d’une émanation de radioactivité. Face à l’horreur, les interprétations téléologiques et apocalyptiques du phénomène (Jugement dernier, etc.) sont critiquées par Romero comme des falsifications religieuses du réel. Personne ne détient le pouvoir, il est partout sans être à personne. Ben et Barbara, les deux protagonistes de l’histoire, barricadés dans une maison isolée, attendent la vérité de la télévision devant laquelle ils s’installent. Le pouvoir de fascination des médias sera thématisé par Romero jusque dans Diary of the Dead, qui définit le phénomène zombie comme objet d’une pulsion scopique fondamentale. L’être du zombie ne fait qu’un avec son apparaître, dans sa présence saturée, sans cesse démultipliée. L’approche « naturaliste » de Romero n’est pas gratuite : le gros plan, l’effet gore de l’orgie carnivore sont des images-affects qui valent par elles-mêmes. La force politique des zombies de Romero tient à leur présence même, massive, irréductible, « qui insiste dans le cadre, refuse d’être écartée du champ ». La « zombie walk » exprime cette essence proprement phénoménale de la manifestation : manifester, c’est toujours se manifester, en chair et en os, avant même de porter un discours ou un drapeau.
Même si des groupes sociaux dominants ou intégrés peuvent bien se l’approprier, la manifestation est par essence minoritaire. Elle est manifestation de ceux qui d’habitude n’apparaissent pas. Les morts qui se relèvent, ce sont toutes les vies qui n’ont pu se soulever, dont le pouvoir a systématiquement écrasé ou défait les possibilités de défense. Ce sont tous les parias et les quantités humaines que l’Amérique croyait pouvoir enterrer. Le cinéma de Romero opère ainsi un renversement de perspective. De prédateurs, les zombies deviennent des proies. Leur pulsion nutritive manifeste la pulsion de mort latente de l’Amérique, à commencer par la pulsion destructrice et racialiste des milices, meutes et commandos qui les exterminent joyeusement. Par l’épochè qu’ils introduisent dans la banalité quotidienne, les zombies fonctionnent comme révélateurs de notre propre violence. Critique du racisme dans La Nuit des Morts-vivants, du consumérisme dans Zombie, du militarisme dans Le Jour des Morts-vivants, ces trois critiques sont intégrées et systématisées dans Land of the Dead, où les vivants ont surmonté la crise en réorganisant leur vie quotidienne dans une ville-forteresse cerclée de fleuves et de miradors. C’est encore en pénétrant ce paradis artificiel que les zombies en révèleront la violence sociale intérieure.
Occuper un territoire
Il y a certes un fort pessimisme de Romero. Dans Le Jour des Morts-vivants, la possibilité de l’île déserte, accessible en hélicoptère, apparaissait comme une ultime issue pour la renaissance des forces de vie hors du bunker souterrain où elles avaient trouvé refuge. Le film se terminait par une scène paradisiaque de robinsonnade, comme on n’en aperçoit peut-être qu’en rêve à l’heure d’une mort trop violente. Dans Survival of the Dead, les zombies ont envahi l’île elle-même. Ainsi en va-t-il à notre époque de toute résistance en îlots, qui cherche à fuir le pouvoir dans les niches territoriales qui fonctionnent comme des « oasis de décélération », coupées du rythme social commun. Contrecoup réactif du pouvoir qu’elle fuit, elle est vouée aux replis identitaires et aux rivalités fratricides, comme entre les deux clans familiaux de Survival. Dans Land of the Dead, le ciel n’est plus l’espace libre de l’envol en hélicoptère, mais l’espace de l’illusion pyrotechnique, celle des feux d’artifice que les vivants envoient de la terre pour détourner l’attention des zombies.
Le pessimisme de Romero est en ce sens porteur d’un message géopolitique positif. La résistance des forces de vie ne peut prendre que sur terre, dans la manière d’occuper et de partager un territoire. Land of the Dead se termine sur une note pacifiste : les zombies qui ont fait tomber la forteresse humaine renoncent à l’ultime carnage pour chercher un territoire. « Big Daddy », le leader de l’insurrection des zombies, se relie en boucle avec les héros à la peau noire des trois précédents films de la tétralogie, à commencer par Ben dans La Nuit. Alors que le vivant Ben était tué par un tireur qui le prenait pour un zombie, le zombie Big Daddy est au contraire épargné par Riley au moment où, comme les vivants, il part en quête d’un territoire.
Ce chiasme à distance constitue le parachèvement de toute la trajectoire politique du cinéma de Romero : par un retournement, c’est la masse toujours croissante qui apparaît comme la véritable minorité. La majorité n’est pas définie par le nombre statistique. Dans la ville-forteresse des vivants, les quelques habitants du luxueux quartier central, nommé Fiddler’s Green, sont majoritaires au sens où ils incarnent la forme de vie normale à partir de laquelle les frontières protectrices sont tracées avec l’extérieur et à l’intérieur même de la ville. Le danger viral de la population invasive sert de point d’appui tactique au pouvoir majoritaire pour rendre acceptable la misère qu’il gère à l’intérieur. Parqués par l’armée qui les protège du dehors, précarisés, divertis par les jeux comme les zombies le sont par les feux d’artifice, les habitants des banlieues pauvres mènent une vie qui a plus d’affinité objective avec celle de la masse extérieure qu’avec celle de l’oligarchie qui les domine. Ils rappellent les zombies portoricains, hispaniques et afro-américains entassés dans la cave de l’immeuble au début de Zombie. L’agent Wooley, dans sa fureur raciste, tuait indifféremment les nègres et les morts-vivants. C’est pourquoi le soulèvement le plus puissant ne peut venir que de la population la plus minorisée et la plus erratique. En traversant les frontières érigées par l’un pour cent majoritaire, la masse ouverte et expansive des zombies libère la masse fermée du peuple et l’ouvre à une réappropriation du territoire urbain.
Comme les buildings de Fiddler’s Green, Wall Street marque le séparatisme social qui organise l’espace urbain. Mais plus encore que la frontière d’un ghetto gentrifié, c’est une frontière symbolique, une rue-limite qui norme les puissances du travail et de la vie. Les flux du capitalisme ne sont jamais absolus, ils sont aiguillés, distribués, calculés dans des centres névralgiques territorialisés. Occuper les rues en zombies, c’est ainsi déterritorialiser un territoire, le rendre étranger à lui-même. La lenteur et la claudication de la « zombie walk » signent une manière de hanter le territoire sans l’habiter.
« Nous sommes les 99 % » : le peuple zombie
« Occupy everything » : ce mot d’ordre exprime le principe de la masse zombie, vouée à s’assimiler tout ce qui lui est extérieur. Peut-être plus qu’une résonance par sympathie, l’essaimage du mouvement espagnol des « indignés » jusqu’à Wall Street a été un phénomène de type contagieux. Dans l’imaginaire fantastique, la contagion n’est certes pas le propre du zombie. La morsure du vampire peut également transformer en vampire. Mais la séduction du vampire tient à sa distinction aristocratique, à son appartenance de caste. Il ravive l’imaginaire de la vieille société du sang et de l’alliance. La morsure du vampire érotise la transgression de l’ordre matrimonial et familial. Avec le zombie, la contagion devient vitale, virale. Il fait signe vers un autre type de société, biopolitique, dans laquelle la pandémie est devenue la hantise typique. La contagion zombie en tant que contagion de masse révèle notre paranoïa.
Cette paranoïa passe dans le mouvement OWS. Comment en effet faut-il interpréter l’absence d’individualité qui marque le style uniforme des zombies en parade ? Elle est fatalement ambiguë. D’un côté, la masse anonyme est une puissance. L’anonymat du mouvement est le propre d’une individuation collective. Dans Zombie, le supermarché géant constituait le lieu de convergence des vivants qui y trouvaient un opium et des morts-vivants qui y retrouvaient les réflexes consuméristes de leur vie antérieure. Le supermarché rassemblait la masse sans l’unifier, en divisant les zombies dans les rayons et les escalators. Dans Land of the Dead, l’individuation de Big Daddy s’est justement constituée dans la lutte contre la technique de diversion du pouvoir : en baissant les yeux de l’éclat des feux d’artifice, il a mis fin à son errance. En même temps, l’accession de Big Daddy à la conscience qui l’individualise coïncide avec l’accession de la masse des zombies à une forme de conscience collective qui l’unifie en direction de la ville à prendre. C’est en renonçant à sa puissance d’expansion illimitée qu’elle s’individue.
De manière analogue, l’individuation collective d’OWS est inséparable de la subjectivation de chacun de ses membres par et dans sa résistance vitale. Le fameux slogan « Nous sommes les 99 % » se décline en une série de cas individuels, de visages et de pancartes : « J’ai trois boulots, sans aucune couverture sociale. Mon fils à Medicaid. La WIC nous accorde une aide. On est à un mois de salaire près d’une catastrophe. Je suis les 99 % », etc. « Je suis les 99 % » : ce paradoxe sémantique exprime la force du mouvement, son alliance du commun et du singulier. « Nous sommes les 99 % » doit se comprendre comme un énoncé performatif, un acte de conscience où chacun ne fait nombre avec les autres qu’en se ressaisissant lui-même dans sa situation objective.
Mais de l’autre côté, le mouvement est travaillé par le désir paranoïaque de gestion statistique et de régulation de sa propre population. Par son anonymat, le slogan « nous sommes les 99 % » déjoue certes le piège de l’identité, mais c’est pour tomber dans l’indifférenciation statistique. On peut bien y voir une sorte de retournement tactique des instruments du capitalisme contre lui-même : sa logique comptable est détournée et appropriée pour la subjectivation de l’inégalité. Le calcul statistique devient une arme contre le pouvoir précisément là où le pouvoir prend le calcul pour instrument. Mais il y a une ironie de ce retournement, car le problème essentiel que la praxis d’occupation n’a cessé de se poser est un problème biopolitique : comment faire masse ? Comment rester en nombre pour passer l’hiver ? L’ambiguïté d’OWS se cristallise sur la place qu’il a accordée aux sans-abri. Le sans-abri est l’emblème du rassemblement, l’ange exterminateur du capitalisme financier. Dénonçant la précarisation de masse, OWS érige en style politique le mode de survie du sans-abri, ses pancartes de mendicité et sa pratique de l’occupation illégale. En même temps, il reproduit cependant le mécanisme d’exclusion du système contre lequel il lutte, en traitant le sans-abri comme un danger sanitaire, parasite et contagieux, dont il a cherché à épurer sa population. Les 99 % sont traversés par des lignes de fracture irréductibles entre les classes sociales qu’ils comptabilisent. Comme le zombie de Romero, le SDF pour OWS est ambivalent, à la fois héroïque et improductif, discréditant le mouvement qui se réclame de son image.
Zombies en haillons
Suivant l’intuition de Deleuze et Guattari, le mythe du zombie « est un mythe du travail et non de la guerre ». Le zombi du mythe vaudou était corvéable à merci. Chez Romero, l’omniprésence de la force armée est trompeuse ; sous leur guerre permanente se cache une plus profonde proximité des vivants avec les zombies qui les symbolisent et les révèlent à eux-mêmes. Romero souligne souvent la vanité de la guerre d’extermination qu’il met en scène, notamment à travers les mots du prêtre noir et unijambiste de Zombie. Dans ce film, c’est en cédant à la fureur virile de la guerre contre les zombies que Roger, comme Wooley au début de l’histoire, se condamne à la morsure mortelle. Au contraire, Peter survit car il abandonne son arme, lui qui subit les insultes racistes du chef de meute des motards et dont la négritude résonne avec la condition des zombies. Les mutilations que les zombies font souffrir aux vivants résultent certes de la guerre, mais elles sont toujours déjà présupposées par le pouvoir majoritaire pour l’organisation du travail, pour la gestion des masses laborieuses : il a besoin que les hommes naissent déjà infirmes, mortifiés, zombifiés, pour pouvoir les différencier tactiquement.
À la fois instrument du pouvoir et puissance révolutionnaire, le zombie est l’avatar biopolitique du lumpenprolétaire. L’armée des morts est l’« armée de réserve » des travailleurs errants, sans emploi ou sans statut social, dont le capitalisme invoque le spectre pour imposer sa discipline aux travailleurs qu’il emploie. Comme Cholo le mercenaire mexicain dans Land of the Dead finit par se retourner en zombie contre le riche Kaufman qui l’a exploité, le lumpenprolétariat est en même temps pour le pouvoir une force rebelle à sa stratégie, « plèbe » dangereuse, toujours rejetée à la limite du bon peuple souverain. Le peuple zombie n’est pas une classe, mais un impétigo de praxis incubé par la société toute entière. Le prolétariat prolifère.
Le zombie est une figure polysémique, dont le sens varie avec les époques dans lesquelles elle reparaît. Aujourd’hui, la masse zombie ne symbolise plus comme en 1978 la classe moyenne ivre de consommation ostentatoire, mais cette masse en haillons, clochardisée, racaille, rom, pute, nomade. Le mythe du zombie est le symbole d’une force politique informe, qui résiste à toute organisation, et sur laquelle se réfléchissent les désirs morts-vivants d’une société.