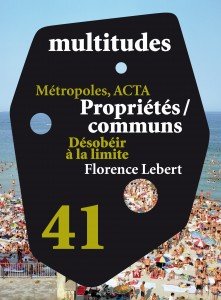L’actualité intemporelle du projet d’architecture utopique de Constant
Constant a bâti un futur à base de chutes de plexiglas et de roues de bicyclettes[1]. Il dira plus tard que les merveilleux modèles de sa New Babylon d’il y a un peu plus d’une trentaine d’années ont été appréciés au même titre que les masques africains l’étaient en temps surréalistes, comme des formes intéressantes, mais tronquées de leur signification magique. Ce que nous avons perdu de New Babylon, c’est une passion, un désir de saisir le monde comme objet de désir, de trouver une forme pour la vie en sa totalité. New Babylon offrait une forme, une architecture conceptuelle pour penser le monde, qui, en l’espèce, faisait autant écho à la culture indigène, aux communs médiévaux, aux charmes de la piraterie qu’aux possibles technologiques de la modernité même. Chez Constant, notre monde tient lieu de registre des modes de vie qu’il a effacés, mais aussi de ses futurs, forclos dans l’archive en tant que vulgaires curiosités utopistes.
Une architecture abolissant
toute distinction entre privé et public
Constant a documenté New Babylon par la photographie et par un film. Il lui a consacré un périodique, et donné à son propos de célèbres conférences-performances. Tout cela pour conjurer dans l’être un paysage qui laissait entrevoir ce qui était possible ici et maintenant, tout en demeurant captif de relations de production obsolètes. Ce n’était pas une utopie. « Je préfère en parler comme d’un projet réaliste parce qu’il s’écarte d’une condition présente qui a perdu tout contact avec la réalité, et parce qu’il se fonde sur ce qui est techniquement faisable, sur ce qui est désirable d’un point de vue humain, sur ce qui est inévitable d’un point de vue social »[2]. La question persistante ne porte pas tant sur le « rêve » de New Babylon, que sur un cauchemar réel propre aux constructions existantes.
L’architecture moderne, née parmi tant de promesses, avait hérité sa position initiale du fonctionnalisme, soit une division de la ville selon les fonctions relatives au travail, au transport, au loisir et à la domesticité. Sa passion régulatrice avait pour nom efficacité. La ville était une machine dévouée à la libre circulation du capital, du travail, des matériaux et de leurs produits. Les planificateurs ne prenaient en compte les relations sociales qu’au titre d’un simple « donné ». Ils embrassaient pleinement la division entre public et privé. D’une part donc, la propriété privée, la famille bourgeoise, la voiture. De l’autre, les pathétiques petits Bantoustans de la vie publique, repoussés aux marges. Cette division abolit en effet la possibilité d’un monde en commun.
L’héritage de Van Eyck
et de ses « seuils » où l’on s’attarde
New Babylon est un détournement non de l’art ni de la littérature, mais de l’architecture et de la planification urbaine modernes. S’il est un architecte en phase avec le détournement de New Babylon, c’est bien l’ami, maître et mécène de Constant, Aldo Van Eyck (1918-1999), qui, bien que saisi dans le mouvement moderniste, restait critique à l’égard de l’architecture, « pseudo-science », et de la forme moderne construite et ses « kilomètres sur kilomètres de non-lieu organisé »[3]. De la modernité, il puisait davantage son inspiration dans l’art et la physique que dans l’architecture. Il concevait l’art et la science comme des expériences de création qui réduisaient en pièces les restes d’un univers platonicien à l’ordre statique et aux formes éternelles. Un temps renommé pour les centaines d’aires de jeux pour enfants qu’il a bâties à Amsterdam, il comptait aussi parmi les théoriciens les plus originaux. Il a maintenu l’élan de ce qu’il appelait la « grande émeute » du modernisme, jusque dans la forme bâtie.
La forme-clé de l’architecture de Van Eyck est sans doute le seuil, qu’il n’imaginait pas comme division de l’espace (par exemple entre public et privé), mais comme connexion d’une possibilité à une autre. Ainsi, plutôt que l’efficace d’une architecture qui divise l’espace par fonctions, il a transformé un lieu, le seuil, en horizon, en occasion à saisir pour une architecture où l’on s’attarde. Comme il l’écrit plus avant dans The Situanionist Times, « une maison est une petite ville, une ville est une grande maison ». L’élément déterminant tenait au fait de penser la forme bâtie en termes de temps plus qu’en termes d’espace, un temps qui ne connaîtrait pas de mesure. Pour une population qui peut ainsi s’y attarder, la ville permet des moments de pleine participation, la richesse de l’expérience. La ville advient au moment où « la conscience associative modifie et étend la perception, en la rendant transparente et profonde par la mémoire et l’anticipation ». Le « dissimulateur » urbain prend conscience de la durée. Le temps gagne ainsi en profondeur et en subtilité, et « la conscience de la durée est aussi gratifiante que la conscience de l’instant fugitif est oppressante. La durée délivre le temps, et le rend transparent, tandis que l’instantanéité le forclôt, le rend impénétrable »[4].
Inscrire la durée dans la ville
La sensation de la durée est la sensation de l’être même. L’architecture devrait faire de chacun un familier de la durée, et non un captif de l’espace ni d’un temps mesuré comme s’il relevait de l’espace. Van Eyck ne cherche pas à bâtir une demeure pour l’être, mais le nexus d’un avènement du familier. De tels lieux « entre-deux », ou de tels seuils échappant à toute notion de propriété peuvent contribuer à « résoudre les conflits qui séparent l’homme du temps (et qui ainsi lui présentent une porte close sur lui-même). » Les gens « font » des lieux, mais pas avec les espaces de leur choix. Van Eyck requiert une architecture qui porte la capacité de charger le « faire » de sens, de changer les espaces en lieux. C’est la raison pour laquelle ses aires de jeux n’exhibent que des formes abstraites, que le jeu rend signifiantes d’une façon inimitable. Constant radicalisera le programme de Van Eyck, en étirant l’aire de jeu à l’échelle de la Terre. Il réalisera que le problème est total, et que si l’architecte-planificateur ne tient pas compte de la totalité de la forme bâtie, alors comme le disait Van Eyck « les gens peupleront tout le globe et ne se sentiront chez eux nulle part »[5]. Le monde est commun ou il n’est rien.
Des espaces aériens pour que la vie soit un jeu
Si Constant emprunte son programme à Van Eyck, le langage architectural qu’il détourne provient de groupes d’architectes utopistes français des années d’après-guerre. On en dénombre au moins trois. Il y a d’abord le groupe Architecture Principe, qui élaborait la « Bunker Archéologie » de Paul Virilio. Ils proposaient des formes massives, des sols inclinés, dans le dessein de produire une architecture qui figerait le flux rapide de la vie contemporaine. Le groupe Utopie prit le chemin inverse, favorisant les structures gonflables, une architecture temporaire et ludique. Parallèlement, des architectes comme Yona Friedman proposaient la construction d’espaces aériens, juchés sur des pylônes. Comme Le Corbusier, Friedman pensait que cette forme permettait la séparation de réseaux qui mobilisent des choses de nature différente, à des vitesses variées[6]. C’était également le type de forme que favorisait Constant, même s’il faisait usage des espaces surélevés à des fins différentes[7]. De tous les projets de l’époque liés à l’utopie, celui de Constant est le seul pour lequel la transformation de la forme bâtie ne peut se produire qu’en chamboulant les relations sociales.
Plutôt que de démolir l’ancien monde pour bâtir une cité radieuse, plutôt que de construire une cité jardin sur des étendues vertes existantes, Constant introduit des espaces aériens qui laissent intacts la ville comme la campagne. Les usines automatisées sont dès lors souterraines, la surface demeurant un lieu de transport, surplombée par un nouveau paysage de libre jeu, une superstructure imposante de secteurs interreliés, au sein desquels tout est malléable, modifiable à loisir. Considérée dans sa verticalité, comme « élévation », New Babylon littéralise le diagramme marxien de la base et de la superstructure. Ses secteurs aériens sont littéralement des superstructures, rendus possibles par une infrastructure souterraine où la reproduction mécanique a aboli la rareté et délivré le temps de toute nécessité. Cela à l’image de ce que Constant conçoit comme le champ de possibilités ouvert par le développement des forces productives, mais dont les brides des relations de production existantes retiennent l’avènement.
New Babylon répond à la fois au phénomène de l’expansion des ressources matérielles et à celui de la population. Comme la famille pavillonnaire, qui construit un nouvel étage à la naissance du cadet, Constant construit un second seuil – pour la planète entière. Plutôt que d’imiter le déferlement suburbain sur tous les terrains exploitables, il laisse intacte une grande part de l’ancien monde – il est intéressant de noter à ce titre que les espaces canoniques de la dérive, au cœur de vieilles villes comme Paris et Amsterdam, demeurent tels quels. Son nouveau monde abandonne l’horizontalité pour le développement vertical. C’est « une nouvelle peau qui recouvre la Terre et multiplie son espace vital »[8]. L’un des aspects les plus enchanteurs de New Babylon consiste dans l’idée que la planète offre des fondations assez solides pour la construction d’une extension aussi vaste.
Quand la cybernétique devient technique de libération sociale
Comme beaucoup en son temps, Constant reconnaissait l’influence des théories cybernétiques de Norbert Wiener, et en particulier la notion de seconde révolution industrielle. Après avoir arpenté les rues de Londres et de Manchester, Friedrich Engels enregistrait avec émoi la misère humaine qui résultait du développement de la première. Ce qui ne manquait pas de semer la confusion chez les artistes modernes, qui se sentaient acculés soit à embrasser soit à rejeter l’industrie. Les visions utopistes alternatives de William Morris et Edward Bellamy instanciaient ces deux options apparemment incompatibles[9]. Mais ce débat était alors réduit à l’insignifiance. La première révolution industrielle avait donné lieu à la seconde, révolution dans l’usage de l’information comme moyen de contrôle.
La cybernétique promettait peut-être de fournir les moyens de nuancer les dommages de la première révolution industrielle, tout en catalysant son énorme expansion du potentiel productif. Elle pouvait aussi résulter dans ce que Wiener appelait l’« État-fourmilière fasciste »[10]. Constant chérit la formule de Engels selon laquelle le communisme réduit l’État à l’administration des choses. La cybernétique comme technique de contrôle est dès lors refoulée, sous la surface, dans le monde de l’administration des choses. C’est au-dessus du sol que la cybernétique comme technique de liberté, comme moyen de liaison avec tout lieu, en tout temps, entre en jeu. Constant étend le débat sur la technique aux deux extrêmes à la fois : celui du contrôle total et celui de la liberté totale. En poussant les tendances à l’instrumentalisation du contrôle cybernétique à la limite, se libérer de la nécessité semble alors du domaine du possible.
Constant n’était pas le seul à concevoir l’automation cybernétique comme développement transformatif ; il l’était davantage en revanche pour l’envisager en contexte de révolution sociale. « Et donc, comment une telle automation intégrale pourrait être accomplie sans appropriation sociale des moyens de production ? »[11]. L’automation modifie les relations de production, qui en retour modifient les structures sociales. L’intensification de la productivité délivre la liberté de la nécessité, mais génère un surplus qui requiert une dissémination quelconque. New Babylon engage l’horizon d’un nouveau type de nécessité. Comme l’exprime Constant, « l’automation nous a confronté sans détours à la question du lieu dans lequel dépenser l’énergie humaine si ce n’est plus dans le travail »[12]. Ici est engagé l’un des thèmes majeurs de l’œuvre de Georges Bataille : le fait que le surplus présente pour les sociétés humaines des problèmes plus fondamentaux que ceux qui sont liés à la nécessité. Alors que pour Bataille la solution implique des sacrifices extatiques à un impossible absolu, Constant se pose plus volontiers la question de permettre des relations sociales ludiques et stimulantes.
Contre la propriété privée :
un nouveau nomadisme ludique
L’artéfact stratifié que livre Constant emprunte une composante reconnaissable de l’architecture moderne – la plateforme suspendue sur pylônes – lui conférant par ailleurs une signification conceptuelle plus large. Entre les mains de Constant, elle devient l’image d’un monde dans lequel le temps de la liberté de mouvements prend le pas sur l’espace de la propriété privée. L’acte de clôturer un espace pour en faire de la propriété privée relève pour Constant de la « déshumanisation de la Terre »[13]. Plutôt que de faire des lignes qui deviendront frontières, la géographie expérimentale de Constant propose des lignes vouées aux connexions. Ses vastes secteurs aériens, de la taille de villes modestes, s’embranchent et s’étendent au-dessus du paysage comme du chiendent bétonné.
La détention de propriété permet d’habiter un endroit familier, au prix de devenir un « sans domicile du monde ». Liquidez la propriété, liquidez la séparation, et le sentiment d’être bêtement jeté dans le monde s’estompera du même coup. Notre être-espèce pourrait dès lors donner cours à sa pulsion de dérive, en familier d’une bâtisse-monde. Constant pensait que la modernité engageait dès le départ un retour accéléré à l’existence nomade. New Babylon réalise pleinement une telle vie nomade. Elle constitue une architecture de la durée, des seuils, du « faire-lieu » collaboratif, à grande échelle. Libéré de la fixité et de l’uniformité de la propriété, l’espace peut dès lors regagner ses qualités. Une courte excursion à New Babylon devrait ainsi offrir davantage de variété que les séjours les plus interminables à travers la concentration urbaine de la société spectaculaire. « La vie est un voyage sans fin à travers un monde qui change si rapidement qu’il semble toujours être un autre ». Les New Babylonians pourraient ainsi dériver sur la surface entière d’un monde sans cesse changeant, sans cesse différent. « New Babylon n’a pas de limite (la Terre est ronde) »[14].
L’anticipation d’Internet
comme ressource d’une vie sans temps mort
Sous la surface, les usines, et au-dessus, des routes sans fin ; au-delà, un réseau global d’infrastructures, où se déploie le jeu. Sans frontières, a-central, il serpente et bifurque de toutes parts. New Babylon « est organisée selon des rapports collectifs et individuels à la distance, à l’errance : un réseau d’unités, reliées entre elles, formant ainsi des chaînes capables de se développer, de s’étendre dans toutes les directions »[15]. Au-delà encore, du moins figurativement, se tient un autre réseau, celui de la communication. Constant envisage deux ou trois choses de ce qui sera plus tard l’Internet. « Le monde fluctuant de secteurs requiert des moyens (un réseau de transmission et de réception) à la fois public et décentralisé. Étant donnée la participation d’un grand nombre de gens dans la transmission et dans la réception d’images et de sons, le perfectionnement des télécommunications devient un facteur important pour le comportement social ludique »[16].
Par un réseau décentralisé de communication, une espèce nomade d’êtres-joueurs coordonne ses joutes, conçoit et transforme son propre habitat, et produit une vie où « l’intensité de chaque moment annihile la mémoire qui ordinairement paralyse l’imagination créative »[17]. Constant expérimente la géographie d’un monde qui se tient au-delà du spectacle, où la dérive et le détournement sont des pratiques généralisées, et fusionnent en une seule pratique. L’espace physique comme celui de l’information appartiennent à tous, et constituent les ressources d’une vie sans temps mort. C’est un monde non seulement fait pour mais par l’homo ludens, dont l’être spécifique est dans le jeu. La question est de savoir si nous sommes, ou pouvons seulement devenir de tels êtres.
Homo ludens versus homo faber
Écrivant dans les années 1930, Johan Huizinga a proposé la figure de l’homo ludens pour penser notre être spécifique hors du discours de l’économie politique synthétisé par la figure de l’homo economicus. Nous ne luttons pas les uns contre les autres pour maximiser notre utilité, si cela signifie quelque chose, mais pour le plaisir du jeu, pour le renom que peut apporter un coup virtuose[18]. Huizinga opposait également sa figure de l’homo ludens à celle de l’homo politicus du juriste pro nazi Carl Schmitt, dont la nouvelle popularité est sans doute l’un des indices les plus étranges de la faillite de la pensée critique du début du XXIe siècle[19]. Pour Schmitt, la lutte ne peut être ludique, elle ne peut être menée qu’à mort. Mais, soutient Huizinga, si la victoire est totale, qui demeure pour reconnaître le vainqueur ? La contribution de Constant tient dans la proposition d’une forme spatiale qui porterait les conditions d’une contestation ludique plutôt que fatale, en distinguant la lutte du contrôle des ressources. La production automatisée rend disponible le surplus pour tous, et pas seulement pour les vainqueurs. Une dépense ludique de l’énergie excédante peut dès lors devenir un pur jeu, avec pour seul enjeu la reconnaissance, et non la domination.
Huizinga oppose également homo ludens et homo faber (le travailleur-fourmi productiviste du discours stalinien). Mais ainsi que le découvre Constant (par l’expérimentation plus que par la recherche universitaire), l’idée fixe de Marx relevait de la réconciliation entre quantité et qualité. Le surplus productif généré par la révolution industrielle pouvait réhabiliter, à un niveau élevé, l’être qualitatif du monde prémoderne. En bref, quelque chose de plus proche de l’homo ludens. La lutte du prolétariat vise à réduire la journée de travail, de dix heures à huit et – pourquoi pas ? – à six, quatre, deux, zéro. Quand le temps devient libre, pourquoi l’espace ne le serait-il pas du même coup ? L’homo ludens ne produira plus d’art, mais produira la vie quotidienne, altérant l’ambiance du monde, comme l’on programmait un nouveau morceau dans les juke-boxes des cafés de Saint-Germain que Constant fréquentait dans sa jeunesse.
New Babylon versus New Moloch
Voici l’architecture dont Guy Debord et Ivan Chtcheglov se contentaient de rêver alors qu’ils erraient dans les rues de Paris : « Chaque mètre carré de la surface de New Babylon représente un champ inépuisable de situations inouïes et nouvelles, parce que rien ne reste tel quel, tout change constamment ». Constant s’aventure bien plus loin que ses camarades de jadis, au risque certes d’une certaine griserie. Pour Constant, l’Internationale Situationniste « ne constituait pas un mouvement réel. Ses adhérents allaient et venaient avec pour seule vision partagée le mépris pour les pratiques actuelles de l’art »[20]. Il crédite en revanche le mouvement d’une analyse de la fin de la culture conçue dans un schème de rareté et de propriété, possibilité ainsi poussée jusque dans ses conclusions. « Contrairement à d’autres situationnistes, j’ai tout de suite réalisé que la théorie de l’urbanisme unitaire n’avait pas originellement à voir avec les micro-structures ou les ambiances intimes. Au contraire, elles dépendent largement de la macro-structure (…) »[21]. Ceux qui conçoivent le futur à moitié ne font que creuser leur propre tombe.
Dans les années 1960, New Babylon est peu à peu apparue comme une expérience déphasée. « Pour beaucoup l’action directe et spontanée semblait plus importante que l’étude analytique ». Les lectures courantes étaient partagées entre Marx et Bakounine. « Cette mentalité a perduré jusqu’au milieu des années 1960 et a connu son apothéose, mais aussi sa fin à… Amsterdam avec l’apparition des Provos, mouvement anarchiste qui se délectait de ridiculiser les notables et attirait une attention internationale »[22]. Au début des années 1960 les Provos ont créé un style d’action directe en tant que performance artistique. Même s’ils reconnaissaient une source d’inspiration dans les travaux de Constant, et s’il a contribué à leurs publications, leurs projets étaient sensiblement différents.
« J’avais donné priorité aux problèmes structurels de l’urbanisme au moment où les autres se focalisaient sur le contenu, le jeu, la libre création de la vie quotidienne »[23]. En rétrospective, pour qui considère les ruines du spectacle désintégrant, il semble que Constant avait raison d’être sceptique à l’égard des effusions politiques des années 1960. New Babylon n’est pas tant la négation la plus profonde du monde de la fin du XXe siècle que celle d’un monde qui ne voit le jour qu’à l’heure actuelle. C’est bien Constant qui semble être le plus en phase avec le développement historique réel du XXe siècle, et le plus proche de la possibilité de le quitter. Il a compris le pouvoir transformatif de la seconde révolution industrielle (cybernétique), et ses conséquences sous les auspices d’une vaste reconfiguration de l’espace. En l’absence d’une révolution sociale, cette transformation des moyens de production aura produit un résultat totalement opposé, New Moloch plutôt que New Babylon. Bienvenue, donc, à New Moloch, où règne une division globale des fonctions, où les usines sont mises au ban, relocalisées sur les sites du travail bon marché, en Chine et ailleurs, et où s’accomplit la concentration massive du contrôle sur les réseaux du monde surdéveloppé. L’État-fourmilière fasciste a gagné l’échelle globale. Le monde de communs chéri de Constant semble de plus en plus hors de portée.
Le New Moloch chinois
Pourtant New Babylon semble plus plausible que bien des horizons qui sont supposés exister aujourd’hui. Prenons l’exemple d’une jeune chinoise, Min, qui « a eu dix-sept ans le jour où elle est entrée en poste. Une fois, elle a posé une demi-journée de congés et a marché seule dans les rues, puis elle a acheté des bonbons et les a mangés seule. Elle n’avait aucune idée de ce que les gens faisaient pour s’amuser »[24]. Comme cent millions d’autres, Min a quitté la campagne pour trouver du travail dans une des nouvelles villes industrielles chinoises. Elle a atterri à Dongguan, une ville de quelque dix millions d’âmes dans le delta de la rivière des Perles. Elle a d’abord pensé qu’il serait amusant de travailler à la chaîne, parmi des gens qui discutent et qui blaguent, mais il n’en était rien. Le travail en usine est bruyant, épuisant et ennuyeux. Les dortoirs y sont le lit de la petite criminalité, des gangs, des petites coteries et des amours condamnés. Le seul lien qui reste entre les gens est assuré par le téléphone mobile. Le temps est gouverné par les plages des machines et le rythme de la consommation globale. Quand les nuits se réchauffent et que les jours s’allongent, les Américains pensent alors à remplacer leurs chaussures de sport.
Comme tant d’autres au cours des années du « boom » chinois, Min change souvent de travail, mais finit toujours par se retrouver dans la même situation. Rien de bien différent par rapport à l’Europe des années 1960, seulement un report de ses conditions à une plus grande échelle. La jeunesse s’est affranchie des provinces, de la ferme, elle est devenue prolétaire, et a découvert ainsi que l’usine émousse les muscles autant que l’esprit. Mais la coupure est avérée, l’ancienne vie est derrière eux, ils expérimentent la nouveauté sur le tas. La seule différence est que contrairement à la majorité de la jeunesse des années 1960, Min n’a jamais entendu parler du Président Mao. Les musées locaux s’évertuent à ne pas le mentionner. Quand le boom a commencé, le gouvernement chinois a engagé des millions à promouvoir son « New Moloch ». Qui aurait pensé, au milieu du XXe siècle, qu’au début du XXIe, le destin du capital mondialisé pourrait dépendre, au moins en partie, de la scrupuleuse intendance du Parti Communiste chinois ?
Peut-être que le portrait de Mao pourrait être retiré de la place Tienanmen et être remplacé sur le champ par celui d’Adam Smith. Ou peut-être serait-il même plus approprié d’y faire figurer cet escroc notoire de Charles Ponzi. Même le New York Times se voit contraint d’admettre que la désintégration spectaculaire ressemble chaque jour davantage à une « chaîne de Ponzi » : « Nous avons élaboré un système de croissance qui dépend de la construction de toujours plus de magasins où se vendent de plus en plus de produits fabriqués dans toujours plus d’usines chinoises, alimentées par autant de charbon entraînant de plus en plus de conséquences négatives pour le climat mais garantissant l’enrichissement de la Chine en dollars, lui permettant d’acquérir toujours plus de bons du Trésor de sorte que l’Amérique puisse s’enrichir pour construire davantage de magasins et vendre encore plus de produits en employant toujours plus de Chinois »[25]. Notre spectacle désintégrant n’a pas produit de pyramides, si ce n’est ce grand schème pyramidal.
L’échappée belle vers un monde commun
Est-il donc possible d’envisager la puissance humaine collective comme un moyen de production de quelque chose de ludique, de joyeux, de beau et de commun ?
« La culture de New Babylon n’est pas le produit d’activités isolées, de situations exceptionnelles, mais de l’activité globale de la population mondiale dans sa totalité, soit de la relation dynamique de chaque être humain avec son entourage »[26]. New Babylon étend l’éthos des communs à sa limite, à l’échelle de l’histoire mondiale. C’est, en dernier lieu, un travail philosophique. « New Babylon n’est pas un projet de planification urbaine, mais plutôt un mode de pensée, d’imaginer, d’appréhender les choses et la vie »[27]. Soit le spectacle désintégrant en négatif. Le temps de la grande abondance est réellement advenu, mais plutôt que de se libérer du travail, notre espèce a décidé de travailler davantage et de produire encore plus. Comme Constant le souligne sèchement : « La présence croissante de l’excès d’énergie humaine commence à se faire sentir »[28]. À la place de joyeux points de fuite, nous avons des points de vente. Peut-être que le spectacle désintégrant est en réalité le monde le plus utopique de tous, précisément à cause de son insistance sauvage sur le fait qu’il a aboli la possibilité même de l’utopie, pour tous les temps.
New Babylon est une œuvre d’architecture conceptuelle en au moins deux sens. Elle instancie un concept de ce que l’architecture, poussée à sa limite, peut engager. Mais c’est également une proposition sur la façon dont les concepts peuvent être structurés en relation les uns avec les autres. C’est en particulier le cas pour deux plans conceptuels qui sont traditionnellement désolidarisés. Sur le premier plan, il y a le réseau de relations dans l’espace physique, et sur le second, le réseau des relations de communication. Dans New Babylon, les deux espaces sont conçus comme des communs globaux, et comme lieux de détermination mutuelle. Le réseau de formes bâties de New Babylon n’a pas de centres. C’est un réseau quasi-parfaitement distribué. Constant a aboli non seulement la propriété privée qui divise l’espace, mais aussi les formes de pouvoir qui concentrent les flux réticulaires dans des centres. L’abolition de la propriété et du pouvoir dans l’espace des communications trouve son pendant dans l’espace de la forme bâtie. Un type de monde commun en implique un autre.
Éloge des dérives, réelles comme virtuelles, au défi de toute propriété…
Dans cette architecture conceptuelle des communs du monde, la dérive devient le principé-clé de connexion des différents niveaux. La pratique ancestrale de ce que les aborigènes australiens appellaient le walkabout, la dérive situationniste, le fantasme aujourd’hui défraîchi de surfer dans le cyberespace, acquiert les propriétés d’un concept plus général du mouvement dans les espaces communs. Mais l’architecture conceptuelle de Constant n’émet aucune prescription si ce n’est l’abolition de la propriété et du pouvoir, de la séparation de la cybernétique ludique et de la cybernétique de contrôle. Soit une infrastructure conceptuelle dans laquelle l’homo ludens peut être envisagé comme l’inventeur de multiples formes de jeu coopératif.
New Babylon n’est rien de moins qu’une architecture conceptuelle pour la fin de l’histoire. C’est sans doute ce que la disparition des centres au sein de ses réseaux veut signifier. Compris de façon littérale, elle semble surtout être le plus extrême des projets utopiques : le commun des communs. Mais la saisir comme telle serait manquer son potentiel d’objet ludique pour l’esprit. En tant que telle, elle fonctionne a minima de deux façons différentes. Elle réalise tout d’abord l’inscription en négatif de notre (si familier) monde du spectacle désintégrant. Constant pousse cette négation à ses limites, rendant pensable l’architecture conceptuelle de notre monde. En second lieu New Babylon renferme un dessein affirmatif. Elle offre peut-être plus qu’un plan de construction : une architecture pour les concepts, pour ce qui ne peut demeurer séparer et intégrer un réseau.
Un nouvelle Babylone dont la technologie serait de l’art
On ne peut survivre longtemps sur des réserves énergétiques d’emprunt, qu’il s’agisse de dollars, de charbon, de force de travail ou de créativité. Ce monde-là, c’est la mort à crédit. Comme l’écrit Constant, « la technologie remplace la nature, la technologie devient nature, le medium, le sens par lequel nous interprétons la nature »[29]. Du moins est-ce ce qu’il espérait. Constant révèle l’artificialité de la distinction entre art et technologie, produite par la marchandisation de la technologie. Peut-être que l’art apparaît, par une cécité volontaire à l’égard de sa marchandisation, comme une sorte de refuge contre la technique, un refuge dans lequel seuls quelques croyants résident, qui ont de toute façon perdu la foi. Pour Constant, la bonne nouvelle est que la technologie promet d’offrir la même dimension ludique, la même marge qualitative que l’art, mais il faudra sans doute une transformation totale des relations de production pour le réaliser.
Walter Benjamin a un jour établi la distinction entre la tendance fascisante à esthétiser la politique et le potentiel révolutionnaire d’une esthétique politisée. Constant ravive la formule en direction d’une ère qui a fait des promesses de l’art une chose du passé. Soit un choix entre une technologisation « techno-fasciste » de l’esthétique et la possibilité d’une esthétisation de la technologie. Constant n’entretient ainsi aucun fétichisme, la technologie n’est pour lui ni l’opération de la grâce ni une cage de fer. Il s’agit plutôt de penser conjointement les possibilités de la transformation sociale et de la transformation technique[30]. L’essence de la technologie ne relève donc pas de la technique. Mais peut-elle constituer quelque chose de ludique ? Peut-elle constituer une façon non d’instrumentaliser la nature, mais de produire une relation commune avec elle, en tant que totalité ? Telle était l’échelle des ambitions de Constant, du seul point de vue d’une manière de vivre. Manière qui laisse derrière elle de beaux objets, aussi indéfinissables que des masques africains.
Traduit de l’anglais par Kosumi Abgrall