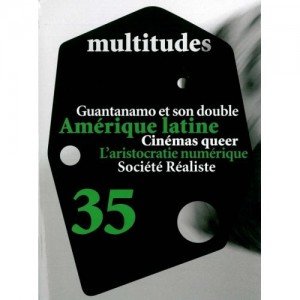(…) parce qu’en réalité, notre nord est le Sud.
Manuel Torres García
1.
Je vais essayer dans le cadre de cette courte note de caractériser la situation en Amérique du Sud, d’esquisser un panorama politique de ses caractéristiques et orientations principales, des problèmes et obstacles qu’elle rencontre. On assiste sans aucun doute à l’émergence d’un nouvel acteur politique et d’une nouvelle modalité de l’apparition publique – Cf. la popularité de Lula, Evo Morales ou Hugo Chavez –, qui n’est pas simplement médiatique mais qui bénéficie d’un fort soutien électoral de la part de larges couches de la société. Dans le même temps, il faut tenir compte des différences d’un leader à l’autre et du fait que les processus sociaux qui les ont portés au pouvoir sont extrêmement divers. Pour cette raison, parler de l’Amérique du Sud dans son ensemble relève du pari ou, mieux encore, de la recherche d’une forme d’unité. Le continent a et conserve des racines historiques communes profondes, mais il a eu aussi son lot de rencontres manquées et d’inimitiés intéressées. Il est marqué plus encore par une histoire coloniale commune qui persiste à ce jour. Ce qui autorise à parler à nouveau de l’Amérique du Sud comme d’un projet, d’une capacité et d’une fraternité, c’est le fait d’accepter que les histoires républicaines de chaque pays ont été élaborées à partir de cette situation coloniale commune persistante et adaptée aux nouvelles nécessités du capitalisme.
Parler de l’Amérique du Sud revient, d’un côté, à assumer le défi que représente la possibilité d’une unité régionale. On commence à se donner les conditions qui permettent de traiter simultanément de sujets économiques, énergétiques, environnementaux, alimentaires et, peut-être, sociaux et culturels. D’un autre côté, il ne sera pas possible d’avancer dans cette construction si l’on ne renforce et n’approfondit pas les processus démocratiques en cours dans chaque pays, avec leurs particularités et temporalités propres, qui ont permis jusqu’à présent de modifier le contexte et la capacité politique de la région. On peut affirmer, en reprenant le travail de Luis Tapia, que la capacité des processus de démocratisation – qui sont habituellement traités dans les cadres nationaux, avec des territoires, des populations et des structures étatiques donnés –, doivent être repris et recontextualisés dans une vision géopolitique. Il faut surtout comprendre les tâches démocratiques qui se jouent entre ces unités nationales, parce que les relations ne sont ni équitables ni symétriques, a fortiori si l’on tient compte des conditions coloniales existantes( ).
Pour cette raison, l’émergence du bloc régional sud-américain a réveillé différentes inquiétudes à travers ses déclarations, ses intentions et ses premiers mécanismes de travail. Rappelons à ce propos la rencontre récente de Bahia, qui a entrepris d’organiser différentes activités en parallèle : UNASUR (Union des nations sud-américaines), MERCOSUR (le marché commun entre le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay). Pour la première fois, les délégations d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada), d’Espagne et du Portugal étaient absentes ; il convient d’ajouter à cela la demande d’intégrer Cuba dans le processus, tout en exigeant la fin de l’embargo commercial auquel il est soumis.
2.
Penser l’Amérique du Sud revient à abandonner par principe tout ce que l’on pouvait entendre jusqu’ici par l’Amérique latine : ce qui nous unissait, qui relevait de la famille ou de la langue, et qui permettait de tracer une frontière avec le Brésil (tout particulièrement) et avec les Guyanes et les Antilles (qui exigeraient une analyse plus détaillée). Cette frontière était devenue un véritable mur, interdisant de dialoguer et de tisser le moindre projet commun dans les domaines politique, social et culturel, parce que la crainte du pouvoir économique – la capacité technologique et financière – et la crainte du pouvoir politique – territorial et démographique – nous incitaient à chuchoter, en proie à une angoisse certaine : « Nous sommes en train d’assister à la naissance d’un impérialisme brésilien. » C’est de là que proviennent les différentes stratégies, déployées tout au long du XXe siècle, qui allaient dans le sens d’une intégration hispano-américaine, ibéro-américaine, latino-américaine ou andine, tournant toujours le dos, ou prétendant du moins ignorer, le géant qui s’accroissait – notre ennemi le plus proche, et qui ne se déclarait même pas comme ennemi.
Si nous passons en revue les politiques d’intégration de la région, cette attitude revient avec une fréquence scandaleuse, sinon de rejet ouvert, du moins de silence diplomatique ; et cela s’harmonisait finalement très bien aux intérêts de la politique américaine dans la région. Si nous assistons aujourd’hui à un reflux de l’impérialisme américain au niveau mondial, nous percevons aussi l’occasion qui se présente à l’Amérique du Sud dans une certaine urgence. Les crises ont cette force paradoxale de marquer à la fois la fin d’un processus et l’ouverture de nouvelles possibilités, l’occasion d’entamer, de rendre visible et d’inventer des processus nouveaux. René Zavaleta considère, dans le cas spécifique de la Bolivie, que les crises constituent une méthode de connaissance : nous pouvons étendre cette méthode à la région tout entière et envisager la situation coloniale dans cette perspective. Par voie de conséquence : « la crise n’agit pas comme une forme de violence sur l’ordre routinier mais comme l’apparition pathétique des pointes avancées de la société, qui seraient demeurées souterraines et visqueuses dans d’autres circonstances( ). »
Quel est le potentiel du bloc régional ? Sous un angle économique, il représente une population de près de 600 millions d’habitants et constitue une grande puissance commerciale. Mais, évidemment, la possibilité de construire un marché commun sud-américain exige une monnaie, une banque et un Conseil économique communs, des traités commerciaux et financiers équitables et solidaires, un « projet à géométrie variable », pour reprendre la formule qu’affectionnent les peuples indigènes des campagnes. Nous trouvons des traces de ce potentiel dans les missions d’UNASUR, ALBA (Alternative bolivarienne pour l’Amérique latine et les Caraïbes) et MERCOSUR, qui rencontrent évidemment des obstacles et des difficultés énormes, mais qui ouvrent une brèche importante en proposant des accords dans le domaine de l’énergie – immédiatement en ce qui concerne les hydrocarbures, à terme dans les secteurs hydrique et électrique, et par la suite dans les secteurs alimentaire et manufacturier.
Ces initiatives n’auront d’avenir qu’à la condition d’être confirmées par des accords politiques, si elles s’accordent autrement dit avec les processus de démocratisation en cours dans chaque pays. Il s’agit d’établir un cadre de relations qui garantit les formes singulières des luttes démocratiques dans la région ; d’où il s’ensuit que le soutien au caractère institutionnel démocratique – les élections et les consultations des citoyens – est décisif. N’oublions pas que nous avons connu dans le passé des dictatures et, plus récemment, des politiciens enrichis et corrompus. Les luttes des mouvements sociaux et indigènes sont importantes, elles aussi, dans la perspective d’une démocratisation des structures étatiques, parce qu’elles revendiquent la participation institutionnelle, la distribution des terres et de la richesse, la garantie minimale des conditions d’existence – logement, travail, éducation, santé, communication, justice et dignité. Cela peut être observé dans l’exigence exprimée dans les différents pays pour mettre en œuvre de nouvelles Constitutions – Cf. les processus les plus radicaux dans ce sens (Bolivie, Équateur, Venezuela), mais aussi les réformes du fonctionnement de l’État (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay).
3.
Le projet sud-américain ne serait ni intelligible ni possible s’il consistait en de simples changements de route ou prise de conscience des États nationaux. Il faut plutôt l’aborder à partir des crises qui affectent le système politique et les formes étatiques existantes. Nous devons observer la manière dont les luttes et les conquêtes des mouvements sociaux et indigènes ouvrent la possibilité, simultanément, de transformer la composition politique au sein de chaque pays et de précipiter la remise en cause de la composition et du rôle de l’État.
Depuis quelque quinze années, dans chaque pays de la région, une activité intense de la société a gagné une visibilité et permis l’articulation de différents types d’organisation et de participation capables d’entretenir les protestations et revendications, et, selon les cas, d’influencer ou de transformer le pouvoir gouvernemental et étatique. Ils ont constitué en tout cas des résistances et des luttes contre les mesures et le commandement néolibéral, un énorme déploiement de points de lutte et un vaste éventail de revendications et d’exigences. L’énumération parle d’elle-même : Chiapas en 1994 ; Amazonie brésilienne avec le Mouvement des sans-terre ; Sierra péruvienne avec l’occupation militaire du territoire ; « caracazo » au Venezuela ; mobilisations de peuples indigènes en Équateur ; piqueteros à Buenos Aires ; violences urbaines à Sao Paulo ; « guerre de l’eau » à Cochabamba et « guerre du gaz » à El Alto et La Paz.
Malgré leur diversité, les formes de mobilisation et les revendications ont permis de remettre en question l’État et la forme État-nation. Les stratégies visant à transformer la nature et le fonctionnement de l’État sont donc appelées à se développer selon une intensité et une temporalité différentes. Il serait intéressant, pour avoir un panorama plus complet, d’établir la carte comparative des réformes, des nouvelles constitutions, des changements de gouvernement, des mouvements sociaux et indigènes, de la crise du système politique, des structures de proposition des mouvements et de la transformation de la politique. Dans cette perspective, le débat sur l’État apparaît centré dans un premier temps sur l’exigence de la démocratie ; la remise en cause institutionnelle portée par les mouvements porte sur les instances énonciatrices de la loi, sur leur absence de légitimité et sur le siège nécessaire de l’ordre institutionnel et des structures d’autorité. L’exigence de démocratie, en ces temps de démocratie et d’ordre néolibéraux, est dénoncée et combattue comme une forme de subversion, alors que les forces de mobilisation et la capacité d’organisation de la multitude permettent de problématiser de manière concrète les questions relatives à la souveraineté, au peuple, à la dignité, à l’unité, à l’autonomie et à la liberté.
Nous pouvons comprendre dès lors l’accession au pouvoir de leaders populaires – que l’on pourrait presque qualifier de plébéiens – comme Lula da Silva, Hugo Chavez ou Evo Morales. Ils ont en commun de traduire la promotion politique de catégories de la population historiquement délaissés dans leurs régions ou pays. Les cas de Bachelet au Chili, Cristina Kirchner en Argentine, Correa en Équateur, Tabaré en Uruguay, Lugo au Paraguay, pour ne prendre que ces exemples, sont tout aussi symptomatiques si l’on analyse le fonctionnement des élites au pouvoir dans leurs pays respectifs.
Pour cette raison, analyser la situation des mouvements par rapport aux changements de gouvernement demeure une tâche en suspens, bien qu’il soit aussi nécessaire d’interroger les changements introduits dans ces mouvements eux-mêmes à partir de nouvelles scènes politiques. Ce point mérite d’être souligné, parce que l’on tend à considérer les mouvements comme des formes données ou stables, en négligeant ce qui fait leur particularité en tant que mouvements : leur capacité d’organisation, de plasticité et de flexibilité, et, par conséquent, leur aptitude à rendre visibles et présents les corps et les voix, leur aptitude à mettre en œuvre leurs exigences.
4.
Penser l’Amérique du Sud par temps de crise de l’ordre néolibéral, c’est renouer avec une mémoire plus profonde, devenue invisible et subordonnée à travers des phases successives de progrès, de croissance, d’industrialisation, de compétitivité, de modernité et de nationalisme, selon des tonalités et des caractéristiques particulières d’un pays à l’autre. C’est peut-être le mouvement indigène qui a posé de la manière la plus juste le cœur du sujet continental, le courage sud-américain, qui a eu la force d’interpeller les manières de pratiquer la démocratie, la justice et la liberté des républiques et États-nations. On peut lire comme un signal l’approbation, le 13 septembre 2007, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, même si elle arrive en retard par rapport à l’ampleur du mouvement et demeure partielle dans sa capacité à mettre en œuvre ses propositions, parce que la reconnaissance accordée aux peuples indigènes est réduite à la prise en charge de quelques défis multiculturels et à l’introduction du pluralisme linguistique.
La proposition des peuples indigènes consiste à faire État, à construire un cadre institutionnel, une légalité et des formes d’autorité à partir des pratiques spécifiques des peuples. Penser, autrement dit, un État qui ne se contente pas de reconnaître et d’accorder des droits, mais un État imprégné et transversalisé, composé et orienté par les valeurs, manières de faire et pratiques indigènes. Pour la pensée politique légale et administrative, officielle et académique, c’est un véritable scandale : comment ces survivances historiques pourraient-elles fonctionner, aujourd’hui et dans le très long terme, avec la complexité et les spécialisations du monde contemporain ? En d’autres termes, les tenants du pouvoir sont très explicites quand ils se disent scandalisés, car pour eux la perception de l’Indigène n’a pas cessé de fonctionner dans une perspective coloniale. L’Indien, c’est précisément ce qu’il s’agit de dépasser, ce qui survit d’un passé lointain – la persistance, le retard, le sous-développement et la pauvreté. Les tenants du pouvoir ne sont absolument pas préparés à admettre que l’Indien constitue en fin de compte un contemporain, qu’il puisse avoir une autre vision et d’autres perspectives quant à la société, la vie et l’État.
Dans la situation coloniale, l’Indigène a été désigné et façonné selon des dispositifs ethniques qui permettaient de délimiter, et par conséquent de rendre invisible, l’existence d’autres modes d’organisation, d’autres manières d’être, des façons différentes d’exprimer, de parler et de dire. « Indien » est le nom dont on s’est servi pour désigner ce qui ne compte pas, ce qui est subordonné et « de trop » par rapport à l’ordre en vigueur et, en même temps, pour homogénéiser et confondre les cultures indigènes. L’Indien est devenu l’Amérique : comment rendre la productivité invisible sans se soucier des exigences sociales et de la redistribution minimale de la richesse ?
Par la manière dont il affirme sa dignité, l’Indigène est aujourd’hui le nom d’une pluralité de peuples et de nations qui compose le continent américain, et d’abord sud-américain. Parler de l’Indigène oblige à partir de la pluralité des cultures, des langues et des politiques, parce que ce sont autant de manières, multiples, d’organiser, de participer au commun et de le fabriquer, de gérer le vivant et d’affirmer la vie. Transformer l’État consiste à le rendre plus démocratique, en partant de la décolonisation urgente des pratiques institutionnelles et légales – un État qui s’accorde avec la société, un État plurinational.
La prise en compte de l’Indigène, en tant que projet décolonisateur, ne peut pas s’inscrire dans les dispositifs coloniaux, comme se plaisent à le croire le pouvoir traditionnel et les médias. Si tel était le cas, elle s’apparenterait à une simple inversion de l’échelle de valeurs, à une simple revanche ethnique sur les Blancs, qui aurait pour effet immédiat de faire de l’Indigène un pion interchangeable au service des élites – avec un colorant ethnique. Ce serait une nouvelle manière de rendre invisible et de réduire au silence la construction sociale et le pouvoir constituant des multitudes.
5.
Le tournant politique sud-américain et la force des mouvements sociaux et indigènes se trouvent justement dans la capacité à exiger la démocratie, et à la réaliser dans le cadre colonial que sont nos républiques. Pour ne prendre que l’exemple de la Bolivie, lorsque ont émergé les demandes de nationalisation des hydrocarbures et de convocation de l’Assemblée constituante – deux objectifs prioritaires aux yeux du gouvernement d’Evo Morales –, elles appelaient d’un côté une nouvelle forme d’action de l’État, un nouveau rôle de l’État vis-à-vis d’une ressource naturelle stratégique, et, de l’autre, une refondation du pays par le biais d’une Assemblée constituante. Les citoyens ont la possibilité, pour la première fois, de choisir leurs représentants et, par le biais d’une consultation, de donner ou de refuser leur approbation. Ils posent en somme la nécessité de changer l’État. Les deux tâches ne sont pas contradictoires et ne se confondent pas, elles correspondent à une perception différente de la nature et du champ d’action de l’État. Ce sont les deux faces d’une même pièce : d’abord la nécessité d’une insertion nouvelle sur le marché international, avec une capacité de contrôle sur l’excédent commercial, ensuite la capacité de transformer l’État pour modifier l’ordre existant sous ses aspects social, économique et culturel. Mais elles se rejoignent en ce qu’elles sont liées à la capacité de renforcer l’émergence régionale sud-américaine : la demande énergétique de la région, le compromis avec les processus démocratiques en marche, la solidarité entre les producteurs, les marchés et traités commerciaux, la création de mécanismes institutionnels communs.
Le cas de la Bolivie, que nous venons de décrire, n’est pas un modèle que l’on peut appliquer tel quel à l’Amérique du Sud dans son ensemble. Mais il est à prendre en considération pour parvenir à penser l’Amérique du Sud. Chaque processus en cours dans la région revêt un aspect et une temporalité propres et singuliers qui permettent de faire émerger du dialogue interrégional un projet commun possible pour la région, en synchronisant les agendas et en établissant des accords, et, surtout, en approfondissant la solidarité avec les mouvements « démocratisateurs » et les nouveaux acteurs de la politique régionale. Tous ne se présentent pas comme « indigènes » ou comme porteurs de « projets indigènes », même si la situation de marginalité, d’appauvrissement et de discrimination des indigènes les constitue en tant que « plèbe » du Continent. Ils sont les premiers à exiger la démocratisation de la société et la décolonisation de l’État, et à lutter dans ce sens. La crise permet « l’apparition pathétique » d’une situation coloniale qui traverse et relie les formes multiples de domination et les faces diverses de l’autoritarisme sud-américain, qui restaient jusqu’alors « souterraines et visqueuses ».
Penser l’Amérique du Sud, c’est penser l’Indigène – l’Indigène comme une boussole des changements, qui permet d’ouvrir de nouveaux fronts et de nouveaux défis politiques, un horizon possible pour constituer un bloc régional de peuples sud-américains à la recherche d’alternatives, une complémentarité et une solidarité qui nous permettent peut-être, face aux crises globales, d’apercevoir d’autres chemins de civilisation. Nous commençons à les parcourir.
Traduit de l’espagnol par Christophe Degoutin