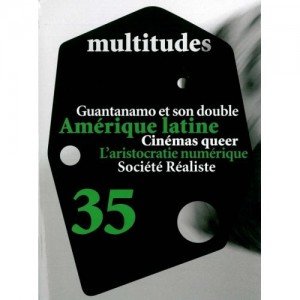« Tous les écrans avaient été détruits. Je me souviens que l’on cherchait les images partout. Je crois que nous errions. Il y avait de la poussière et des débris. Je pense que se souvenir était au centre de la question. Les bandes s’étaient évanouies, les écrans avaient implosé. On pouvait sentir cette étrange fumée, opaque, celle qui reste longtemps collée au nez, aux yeux. Comme de la neige. Ou de la brume. Les téléviseurs n’étaient plus alimentés. Les murs n’étaient plus réellement des murs. Les espaces communs étaient défaits. »
Ruins est la trace d’un long voyage à travers l’Europe de l’Ouest, dans différentes communautés queer autonomes. Les rencontres et les lieux ont été l’occasion de réaliser les cinq parties qui constituent ce projet artistique. Ni fiction ni documentaire, Ruins fouille les systèmes de production d’images pour mettre à jour des identités qui échappent à l’œil du système.
(Raphaël Vincent)
Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff : Pourrait-on commencer par la question de la signature de ton film Ruins (2004-2006, 23 minutes) : Ruinsproduction au départ, et maintenant Ruinsproduction & Raphaël Vincent ? Dans quelle mesure conçois-tu ce film comme « collectif » ? Qu’est-ce qui en a été élaboré collectivement ? Peux-tu nous parler de cet aller retour entre le projet initial et le film que tu/vous avez réalisé.
Raphaël Vincent : La décision initiale de ne pas faire apparaître de nom propre n’avait pas pour objectif de privilégier l’idée d’œuvre collective en opposition à celle d’œuvre personnelle. Il s’agissait plutôt plus d’une tentative d’échapper à ce que ce type de signature engage et désigne : la position de « l’Auteur ». La notion d’auteur renvoie inévitablement à celle du droit et de l’appartenance. Ruins est issu d’une période de vie collective dite « autonome ». J’ai personnellement filmé et monté les images, mais le processus même de cette production s’apparente plus à l’émergence de rapports interpersonnels entre mes amis, les gens avec qui je vivais, et non des acteurs, dans des lieux qui ont été nos lieux de vie, et non des décors. Il ne s’agit pas d’un film sur ces modes de vie mais d’un film issu de ces modes de vie. C’est dans ce sens que la position d’Auteur unique ne me parle pas. Par la suite, mon nom s’y est ajouté, car pour les réseaux dits « professionnels », l’absence de nom propre (et donc d’auteur) devient un vrai problème. L’utilisation d’un « sous-titre » facilite les choses. Ruins étant le premier film que je montre publiquement, ces questions sont loin d’être résolues. Je cherche encore d’autres chemins possibles et questionne encore le statut (et donc la signature) de mon travail.
K.Q. & I.O. : Tu travailles la forme du témoignage en rendant compte d’une vie commune passée et de « ces vies qui échappent à l’œil du système », comme tu le dis. Tu dis avoir opéré une transposition pour échapper à la reconstitution ou la captation documentaire que tu considères comme une forme d’objectivation des sujets filmés, quasi coloniale. Il s’agit d’un déplacement formel et méthodologique qui donne lieu à un autre cadre éthique de représentation. De quel ordre est cette transposition ? Est-ce un passage à la fiction ? Qu’est-ce qui, dans la fiction, te permettrait d’échapper à ce regard colonial ? Est-ce une composition commune avec tes personnages ? Plus largement, quel est le registre du film ? Pourrais-tu employer le terme de film d’artiste ? Quelle terminologie emploierais-tu ?
R.V. : Produire des images issues ou autour de minorités est pour moi problématique. Dans le début de l’histoire de la photographie, l’image a été un outil puissant de contrôle et de définition de « l’Autre », du différent, du malade, de l’anormal, de l’exotique. En 2004, j’ai commencé une série de vidéos dont les personnages ne sont pas des acteurs mais mes compagnons de voyage. Pendant six ans, j’ai voyagé à travers l’Europe de l’Ouest, participant activement aux réseaux alternatifs de politique queer, avec des enjeux comme la création d’espaces autogérés, l’organisation en collectifs de rencontres autour du questionnement sur les identités sexuelles, les constructions de genre et les moyens d’une possible résistance, etc. Pendant cette période, il était pour moi compliqué de sortir une caméra et de prendre des images. Je ne voulais pas produire du témoignage. Comment, dès lors, vivre mes pratiques politiques et les représenter dans le même temps, sans user ni abuser de moments d’existence et de ceux qui étaient mes amis ? Refusant la posture de l’exotisme, je ne voulais pas non plus produire des images sympathiques, qui auraient provoqué une adhésion immédiate et complète. Il fallait donc trouver un moyen de parler du caractère engagé de ces pratiques sans les réduire à un « style » de vie. Les « méthodes » que j’ai pu trouver étaient de ne surtout pas filmer le quotidien, mais d’effectuer des retours dans les lieux où l’on avait vécu. De proposer à mes amis des performances ou des actions (plus ou moins dirigées, selon les parties du film) écrites spécialement pour eux et en rapport à eux. Et surtout d’éviter tout didactisme, toute explication. Plutôt qu’à la fiction, il s’agit d’un passage à ce que j’appellerais de l’abstraction narrative. Ce n’est pas dans la fiction que j’essaie d’échapper aux rapports de pouvoir que la prise d’images engendre, qu’ils soient d’ordre « coloniaux », « classistes » ou autres… mais plus à travers la tentative de produire des images qui ne donnent pas à « montrer » (expliquer, justifier, définir…). Pour moi il s’agit de soustraire, de produire du déceptif. D’échapper au contrôle auquel la production d’images aboutit la plupart du temps. Les questions que je me pose, et qui sont importantes pour moi, sont celles de la place de celui qui filme. D’où parle-t-on ? C’est quoi ma position, d’où je viens et pour filmer quoi ? Dans le cas de Ruins et de mes autres productions, je ne suis jamais un outsider qui irait filmer un sujet. Ce sont la proximité, l’expérience personnelle et l’environnement proche qui guident ma façon de filmer, de faire des choix esthétiques. Mais, de ce fait, une autre question se pose : qui donne la parole ? Pour le moment, je définis mes travaux comme des films d’artiste, un peu par défaut. Je ne mène aucune recherche ni du côté du film politique de propagande ou de dénonciation, ni du côté d’une idée du documentaire réaliste. Je crois que suis plus proche des arts plastiques voire de la danse que du cinéma.
K.Q. & I.O. : Lorsque tu parles du film, on sent une nécessité très forte de filmer sur le terrain de quelque chose qu’il ne faudrait pas perdre, plutôt que sur un terrain directement politique. Quel est le potentiel politique de ce film, selon toi ? Plus largement, quels liens entretiens-tu entre cinéma et politique ?
R.V. : Je n’ai pas peur de « perdre quelque chose ». Je ne produis pas d’images pour laisser des traces (ou des témoignages) ; je ne cherche pas à rendre visible un quelconque « underground ». Tout mouvement n’a pas forcément besoin d’être « archivé ». L’acte politique se situe plus pour moi dans le fait de produire nos propres images, nos propres représentations – lisibles ou pas, d’ailleurs. Une fois encore, c’est une question de « place » : filme-t-on de l’intérieur ou filme-t-on un sujet extérieur à soi ? Il s’agit de s’approprier les espaces de représentation et de ne pas se satisfaire d’être représenté, visible et lisible.