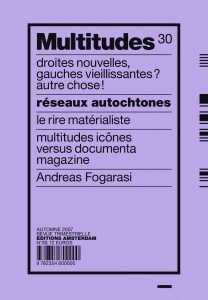Les populations indigènes sont celles qui possèdent une continuité historique dans le cadre de sociétés qui existaient avant la conquête et la colonisation européenne de leurs territoires (Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones). C’est l’acception des termes indigène et autochtone utilisés dans ce texte.
Le concept d’autochtonie reste encore très problématique dans le pays des droits de l’homme dont le fondement est une République laïque une et indivisible, dont la langue est le français et dont tous les citoyens n’ont qu’une et unique identité, l’identité française. La longue tradition assimilationniste de l’État français a toujours interdit toute revendication culturelle, de même qu’elle a toujours combattu toute velléité de revendication culturelle ou de séparation sur le sol national, notamment des populations basque, corse, ou bretonne. De même, tout mouvement de lutte pour le droit à l’autodétermination et à la souveraineté des peuples colonisés a été violemment réprimé, souvent par les armes et dans le sang. Il est intéressant de souligner que jamais le concept d’autochtonie n’a été évoqué dans les luttes nationales ni par l’État français, ni par les populations séparatistes elles-mêmes. L’autochtone, nouveau vocable correct pour l’indigène, ne vaut en effet que pour les populations hors territoire national et n’a de sens que par la colonisation européenne initiée au XVe siècle et actuellement encore en vigueur dans bien des régions du monde. Les décolonisations des pays d’Afrique et d’Asie ont fait oublier que la présence française en Nouvelle-Calédonie à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française n’est rien, sinon la continuité de la soumission par les armes au XVIIIe siècle de ces pays alors indépendants et le maintien d’une colonisation qui refuse de s’avouer. Ainsi la République une et indivisible a toujours été la mauvaise raison derrière laquelle se cache depuis toujours l’État français pour refuser aux peuples indigènes colonisés de se définir comme tels, faisant d’eux des Français souvent de seconde zone, certes, mais relevant de la même Constitution que les citoyens nationaux et par là dans l’incapacité à revendiquer leur différence, leur diversité culturelle. Cette question de la diversité culturelle est totalement et définitivement dominée dans la société française par la problématique de l’intégration des populations récemment immigrées sur le territoire national, ces populations étant en grande part issues des anciennes colonies. Dans ce contexte, les demandes de reconnaissance de leur diversité culturelle par ces populations sont immédiatement taxées de communautarisme du même temps que les revendications de droits relevant de l’autochtonie sont délibérément assimilées à une coupable xénophobie et un irrespectueux indépendantisme.
Malgré les nombreuses études effectuées dans les colonies du Pacifique Sud par de nombreux chercheurs nationaux et internationaux spécialisés en « logies » universitaires de toutes espèces, jamais le concept d’indigène ou d’autochtone n’a été évoqué, pas plus que n’ont été pris en considération les rapports de dépendance de domination de subordination qui tendent les relations entre autochtones et colonisateurs, affrontant souvent un « nous » occidental puissant et moderne à un « eux » communautaire chétif et traditionnalisant voire rétrogradant. En réalité le concept d’indigène, largement péjoré pendant la colonisation et tenu pour intellectuellement incorrect après les indépendances, a rapidement et durablement disparu des discours publics, empêchant ainsi la clarification de la situation et donnant naissance à une hypocrisie institutionnalisée par l’État et allègrement reprise par les divers gouvernements locaux. Ce concept de peuple indigène désormais autochtone n’a aucune existence dans l’espace métropolitain comme elle n’est quasi jamais revendiquée en Polynésie française, y compris par le parti indépendantiste, rendant durablement floue et obscure l’image que les peuples polynésiens[1] ont d’eux-mêmes.
En Polynésie française, l’Histoire depuis le contact est très peu enseignée et, quand elle l’est, elle est toujours présentée du côté du vainqueur, privant les principaux intéressés de la compréhension nécessaire à une saine mise à distance des événements qui continuent de se vivre comme douloureux, même si un consensus de mauvais aloi semble inviter à croire que cette tranche d’histoire entamée lors du contact, suivie d’une évangélisation frénétique et d’une colonisation mortifère pour se poursuivre aujourd’hui, a été intégrée et dépassée. Il n’en est rien et les Polynésiens dans leur majorité n’ont de leur histoire qu’une version écrite et dite par des Occidentaux, version qui souvent édulcore les guerres d’annexion et les exactions qui en ont découlé, transforme les peuples autochtones en peuples enfants, incapables de prendre leur destin en main. Pour mémoire, les conquêtes la colonisation et la domination européennes se sont traduites rapidement par le vol des terres et des ressources naturelles des peuples autochtones, en outre spoliés de leurs sciences, de leurs idées, de leurs arts et de leurs cultures. De même, les Polynésiens continuent aujourd’hui encore d’être réduits au mythe du bon sauvage décliné par Bougainville, Loti, Gauguin et tant d’autres écrivains peintres photographes venus d’ailleurs depuis le XVIIIe siècle. Cette histoire est rarement dite, d’un côté comme de l’autre, du moins n’est-elle pas dite audiblement. Sans doute n’aime-t-on pas parler une histoire violente officiellement présentée comme l’entrée en humanité des Polynésiens, car il faudrait alors reconsidérer la mémoire officielle angélique, du moins salvatrice protectrice civilisatrice, pour restituer l’Histoire telle qu’elle est. Humaine. Parler l’Histoire dans son humanité obligerait à accepter une Histoire de femmes et d’hommes dans leurs grandeurs dans leurs petitesses. Noirceurs et lumières, trahisons et fidélités, boues et espérances, violences et générosités, haines et compassions. Humaine. Parler l’Histoire du côté des Polynésiens obligerait à déconstruire plus de deux cents années d’un discours dominant, d’une pensée impérialiste, d’une occupation illégitime. Parler l’Histoire dans son entier obligerait à remettre en question toutes les théories qui ont encore cours aujourd’hui, qui voudraient nous faire accroire que la civilisation ne se décline qu’occidentale, que le progrès ne se conjugue que matériel, que l’avenir ne se compose que mondial.
Cette mal-connaissance, voire cette mé-connaissance, de l’histoire récente, alliée au discours péjorant d’un mythe-bonne-conscience désormais repris par les Polynésiens eux-mêmes, constitue le limon fertile d’un déséquilibre intellectuel, culturel, psychologique sur lequel germent des interprétations mythifiées, des mystifications culturelles, des distorsions identitaires que la classe politique, toutes tendances confondues, n’est pas la dernière à intégrer à son discours, dilatant ce faisant le pathétique mal-être qui obscurcit les intelligences polynésiennes.
Dans les années 1970, les peuples de Polynésie française avec leurs peuples cousins du Pacifique, comme nombre de peuples indigènes au travers du monde, ont entamé le lent chemin d’une revendication de dignité humaine tendu par la préservation des langues indigènes, la reconquête de la culture traditionnelle, ou du moins de ce qu’il en restait après le laminage évangélisateur et la destruction colonisatrice, la lutte pour la décolonisation et l’autodétermination des petits pays encore occupés par les puissances occidentales. Malgré le découpage arbitraire de l’Océanie opéré par les puissances européennes au gré de leurs conquêtes, malgré les barrières linguistique et culturelle dues aux colonisations, les peuples océaniens ont toujours su garder des liens culturels forts et de nombreux échanges ont sillonné le Pacifique, unissant Polynésiens, Mélanésiens et Micronésiens[2] dans leur quête d’identité et de liberté.
Après les décolonisations anglaise, américaine et hollandaise du Pacifique Sud, la nécessité de renouer les liens historiques effilochés par les présences occidentales s’est imposée. Ainsi la Commission du Pacifique Sud, fondée dès 1947 par l’Australie, les États-Unis d’Amérique, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, alors puissances d’occupation, s’est transformée peu à peu en Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, et compte désormais vingt-deux états et territoires insulaires du Pacifique ainsi que quatre des pays fondateurs encore en administration de colonies. C’est au sein de cette communauté que sont nés les Jeux du Pacifique Sud dès 1963, rassemblant les sportifs de la région, ainsi que le Festival des arts du Pacifique en 1972, marquant la volonté des pays de l’Océanie de réunir leurs peuples tous les quatre ans afin, ensemble, de lutter contre la disparition progressive des pratiques coutumières et traditionnelles, d’affirmer une identité océanienne forte[3] et en même temps pour chaque peuple d’asseoir son identité, pour lui-même tant que pour les autres, de promouvoir l’unité en encourageant la reconnaissance et le respect mutuels de la culture d’autrui. Le Festival, c’est encore un précieux outil de préservation des modes d’exécution et de production des savoir-faire qui sont le fondement de la diversité des expressions culturelles océaniennes. Il contribue pour beaucoup à l’évolution des identités océaniennes, qui y trouvent une scène où se mêlent expressions traditionnelles et contemporaines de la culture de tous les horizons du Pacifique. Les deux dernières éditions ont ainsi inclus dans les échanges culturels les arts plastiques modernes, le théâtre et la littérature, qui font désormais l’objet de débats et de tables rondes lors des festivals, au même titre que toutes les autres formes d’expression traditionnelles.
La Polynésie française est longtemps restée à l’écart de sa région, du fait de son isolement linguistique, francophone dans un océan anglophone, de son isolement géographique, mais aussi par une volonté politique délibérée de l’État français et des gouvernements territoriaux, tendant à la couper d’un environnement marqué par un engagement antinucléaire et anticolonial fort. Depuis une dizaine d’années, un formidable élan tend les peuples océaniens dans un désir de partage de connaissance de re-connaissance et un vaste mouvement d’expressions contemporaines anime l’Océanie, né d’une occidentalisation de plus en plus importante des pays insulaires. Un réseau d’échanges d’entraides et de solidarités s’est développé entre artistes océaniens par le biais de salons du livre, de festivals de films, de conférences et de publications, mais aussi via Internet et le courrier électronique qui permettent de réduire l’isolement des insulaires en les reliant par la Toile. Ce réseau porte la volonté des artistes d’adapter les techniques et savoir-faire occidentaux aux multiples identités autochtones océaniennes afin de préserver leur « exception culturelle » dans une mondialisation qui voudrait uniformiser l’humanité. L’essor de la littérature est particulièrement remarquable dans de nombreux pays océaniens, indépendants ou non, et la solidarité entre auteurs est d’autant plus intense que beaucoup d’écrivains sont engagés dans une recherche d’écriture porteuse d’océanité non seulement dans le contenu mais aussi dans la forme. Les réseaux d’échanges entre auteurs anglophones sont en place depuis longtemps, facilités par l’accession à l’indépendance de la majorité des pays anglophones et l’action de rayonnement régional des universités de Papouasie Nouvelle-Guinée et de Fidji. Les relations entre eux et les auteurs francophones jusqu’alors restées frileuses, notamment avec les auteurs de Polynésie française, qui abritait les expérimentations nucléaires françaises, se fortifient rapidement malgré, ou peut-être à cause de, la barrière linguistique existant par l’histoire coloniale de chacun, dans l’urgence de revendication d’une autochtonie océanienne longtemps considérée comme « honteuse ». Après presque deux siècles de silence, les Océaniens publient la parole écrite dans leur langue d’origine ou dans une langue occidentale, libérés de la mésestime d’eux-mêmes incrustée dès le début des dominations, libérés des incessantes mises en doute de leur capacité à maîtriser l’écriture parce que issus d’une tradition orale, libérés des diktats syntaxiques et grammaticaux d’une langue étrangère devenue leur. Cette réappropriation d’une parole écrite jusqu’alors aux mains à la plume à l’encre d’auteurs occidentaux se revendique océanienne pour mieux se dire polynésienne mélanésienne micronésienne, dans une aspiration à se dire différente mais part de l’humanité, à dire l’histoire du côté des autochtones non dans un désir de victimisation mais au contraire dans une créativité espérante, à dire l’autochtonie comme résistance à une pensée unique nécrosante. De la pensée de quelques mots au roman fleuve de neuf cents pages en passant par la poésie le théâtre les nouvelles les essais, la littérature océanienne ressemble aux multitudes d’îles piquetant le vaste océan, diverse, généreuse, créatrice.
En 2002, un groupe d’auteurs de Polynésie française, las de la sempiternelle question saturant l’air du pays, « La littérature polynésienne existe-t-elle ? » et désireux de se poser en acteurs de leur propre histoire, a fait le pari d’une revue littéraire bi-annuelle qui accueillerait tous les bouts de dits et d’écrits sans exception sans question sans classification. Revue qui accueille depuis quelques éditions déjà des écrits venus de toute l’Océanie, Micronésiens, Polynésiens, Mélanésiens, en langues autochtones, en anglais, en français. Revue pour traverser le Pacifique dans tous ses états tous ses horizons tous ses peuples, pour sillonner de nouveau l’Océanie dans toutes ses langues toutes ses cultures toutes ses identités. Cette traversée littéraire a natté plus serré les liens existants entre les auteurs du Pacifique qui par ailleurs échangent leurs expériences lors de salons du livre, en particulier le salon international du livre océanien en Nouvelle-Calédonie, dont l’ouverture sur le Pacifique est portée par son intitulé, ou se rencontrent dans les divers colloques et conférences organisés par les universités de la région. Parallèlement, cette volonté de surmonter la barrière linguistique est prise en compte par les éditeurs océaniens désireux d’offrir à leurs lecteurs un accès à la littérature océanienne dans son ensemble. Ainsi les éditions Au vent des îles, de Tahiti, ont créé l’an dernier une collection « Littératures du Pacifique » qui propose, outre les textes en français ou tahitien d’auteurs polynésiens et de Nouvelle-Calédonie, des traductions de textes d’auteurs de Nouvelle-Zélande et de Samoa, avec l’intention d’ouvrir la traduction à d’autres textes pacifiques. En Australie, les éditions Anu ont traduit l’intégralité des œuvres de Déwé Gorodé, auteure kanak. À Fidji, les éditions de l’université préparent Writing Pacific, une anthologie du Pacifique avec traduction en anglais d’auteurs polynésiens et de Nouvelle-Calédonie. L’université de Hawaï a publié l’an dernier Varua Tupu, une anthologie en anglais d’auteurs polynésiens. La barrière de la langue, mais surtout le coût des traductions, n’est plus un obstacle devant la demande des lecteurs océaniens de textes issus de l’autochtonie pacifique.
Les réseaux de solidarité entre peuples océaniens ont permis parallèlement aux échanges culturels d’engager une réflexion sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la culture face aux menaces généralisées que représentent le pillage et le piratage de leurs traditions culturelles spirituelles artistiques religieuses et scientifiques. Aujourd’hui plus que jamais en effet les savoirs des peuples autochtones toutes régions confondues suscitent l’intérêt gourmand de sociétés commerciales occidentales qui n’hésitent pas à exploiter leurs cultures et commercialiser leur art, à piller leurs connaissances médicinales et leurs savoir-faire en matière de biodiversité agricole et de gestion de l’environnement, sans en partager les profits. De nombreux peuples autochtones s’efforcent par ailleurs d’obtenir la restitution des restes de leurs ancêtres et des objets sacrés détenus dans les musées occidentaux. La protection des savoirs traditionnels des expressions culturelles et des biens immatériels se révèle aujourd’hui plus que jamais une urgente priorité et les États réunis au sein du Secrétariat général de la communauté du Pacifique ont, avec l’aide de l’ONU, engagé une réflexion qui a abouti à un document intitulé « Cadre juridique pour la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la culture », qu’il appartient à chaque État membre d’adapter à sa propre législation. Depuis la rédaction de ce document et son adoption par l’ensemble des représentants de la communauté du Pacifique, malgré une revendication culturelle trentenaire bruyante et de nombreuses tentatives de mobilisation de la société civile, les divers gouvernements de la Polynésie française et la classe politique dans son ensemble ont jusqu’ici fait preuve d’un désintérêt patent pour le sujet. La réflexion est désormais menée au travers de réseaux d’échanges et de solidarité tissés lors de rencontres et via Internet, avec l’espérance d’aboutir à des propositions concrètes qui pourraient être mises en œuvre dans le souci d’éviter le piratage et le pillage de patrimoines déjà mis à mal depuis la rencontre avec les premiers Européens. Il faut admettre que deux cents ans de christianisme et de domination ont érigé dans les esprits des Polynésiens des remparts psychologiques tellement solides que les peuples eux-mêmes continuent pour beaucoup de confondre période pré-européenne et paganisme ou sauvagerie voire cannibalisme, ce qui les empêche de ressentir profondément l’importance et les valeurs d’un patrimoine qu’ils savent de tête mais plus d’entrailles.
Le XXIe siècle semble être le temps pour les Océaniens de reprendre le voyage et de refaire les traversées entre les bouts de terre du vaste océan et de retisser les réseaux qui les ont nattés depuis l’immémoire qui les rattache à Hawai’i Sava’i, l’origine. Les peuples plus que les gouvernements sont les artisans solidaires de ces traversées, prémisses d’une océanité affirmée et d’une autochtonie assumée.
Tarafarero Motu Maeva, mai 2007.
Notes
[ 1] La Polynésie française a été constituée arbitrairement par l’État français lors de la colonisation, de cinq groupes d’îles indépendants les uns des autres, et désormais dénommés archipels. Le nom même de Polynésie française pose problème, puisque la Polynésie est un vaste ensemble d’îles géographiquement situées à l’intérieur d’un triangle dont le sommet nord-est Hawaï, le sommet sud-est Aotearoa et le sommet ouest Rapa Nui.
[ 2] L’Océanie est composée de la Polynésie, la Mélanésie et la Micronésie.
[ 3] Les extraits en italique sont tirés de la présentation du Secrétariat de la communauté du Pacifique Sud.