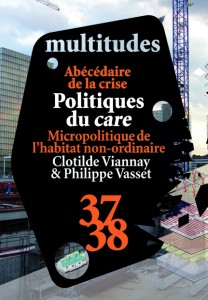« Loger » : donner un abri, trouver une place, identifier le lieu d’habitation.
« Se loger » : fait de trouver un logement c’est-à-dire de prendre place dans un ensemble d’autres positions déjà occupées. On dit d’un projectile qu’il est venu se loger dans une porte par exemple.
« Se loger en foyer » : trouver un feu, un lieu protecteur, mais aussi foyer d’infection, de contagion, de contestation, foyer révolutionnaire.
Quelque part en région parisienne au temps des circulaires Marcellin-Fontanet
Ayant été embauché sur un chantier, on m’a recommandé un foyer de travailleurs pour me loger. D’abord, il m’a fallu trouver l’emplacement et ce n’est pas rien. J’ai traversé des zones à urbaniser, des champs, des terrains vagues puis ces nouveaux quartiers populaires périphériques, et puis derrière des usines, une décharge et la voie rapide. Voilà le foyer : ADATARELLI, AFTAM, SONACOTRA, ou encore AMLI, c’est-à-dire association pour l’accompagnement, le mieux-être et le logement des immigrés, sic !. Peu importe le sigle pourvu qu’on ait le livret. Au milieu du vide, un bâtiment de quatre étages, un R + 4 « poteau-poutre » dans la terminologie des concepteurs, troué de fenêtres pour ne pas être borgne. Une porte d’entrée après un parking parsemé de Simca, Peugeot, Fiat et autres carcasses non reconnaissables. Deux hommes à l’entrée m’indiquent le bureau du directeur : l’homme qui monte la garde avec son chien au pied de son logement de fonction est le seul maître à bord de ce navire de chambres étroites. Il me fait passer une inspection rapide pour jauger le client, puis une fois dévisagé, fouillé au corps du regard, questionné sur l’alcool, les femmes, le bled et la politique, il me demande mon contrat d’embauche, papiers et titre de séjour. Je peux enfin remplir la fiche de police qu’il me tend. Je dois encore écouter ses oukases et le règlement intérieur. Pas de femme sauf quand c’est lui qui les fait venir. Pas de politique, pas de problèmes. Pas de linge qui traîne. Ne pas laisser couler la douche, accepter le montant et payer à la date du paiement de la redevance. Sinon, dehors. J’y suis presque. Il daigne attacher son chien et nous nous dirigeons vers la chambre, je crois reconnaître un gars aperçu sur le chantier dans le hall verdâtre. Nous passons devant le café dit maure avec son comptoir cuisine américaine et une affiche géante de plage des mers du Sud qui a dû avoir des teintes chaudes avant de verdir. Après un escalier, un couloir où les odeurs de repas, de sueurs et de grésil se mêlent. Quelques messages de sécurité bilingue Français/Arabe. Enfin le numéro 217. La peinture est écaillée par les coups de passe-partout assénés par le garde à chaque visite : quoi qu’il arrive, c’est correct tant qu’il frappe avant d’entrer, non ? Mes premières sensations sont le manque d’air et l’étroitesse de la fenêtre. Le directeur me dit que je la partage avec mon voisin de la chambre de gauche et qu’elle ne s’ouvre pas. L’œil était dans la chambre et regardait Abdelmalek. Chambre pour homme seul, chambre à deux ou trois lits, quelle différence ? C’est plus ou moins petit mais l’équipement reste le même. Un matelas roulé sur un lit bas et la couverture brune et rêche à motif géométrique sur le grillage du sommier, une chaise d’écolier, un tabouret, un placard branlant qui coupe et emplit à la fois la pièce miniature. Dessus, trône une valise laissée là sans doute. Un lavabo et une glace avec des autocollants « Panini » défraîchis tel un autel prolétaire. Sous l’évier, un seau et un reste de serpillière. Une ampoule nue pour une lumière crue. Bienvenu dans le temple de la reconstitution de la force de travail.
Une fois posé mon baluchon et mon sac plastifié, il me faut encore visiter la cuisine collective, où je croise le regard de quelques futurs voisins qui travaillent de nuit et attendent l’heure d’y retourner. L’un pèle des légumes. Un autre boit un café. Le cœur n’y est plus mais je dois aussi prendre possession de mon casier personnel dans le réfrigérateur collectif, le quatrième à droite en partant du haut au milieu d’une douzaine de petits coffres cadenassés. Je devrais me procurer un cadenas personnel. J’ai aussi droit à mon espace réservé sous la paillasse. Sur un bout de lino gras, une casserole cabossée et deux tasses ébréchées, les voisins me dépanneront pour le reste. Voilà on y est. C’est ainsi que je suis devenu résident d’un foyer de travailleur, pour dix jours, pour dix ans, pour toujours.
Survivre en foyer, ici ou ailleurs en province, au temps des premiers charters de Maliens
L’alarme sonne depuis près d’une heure. Les pompiers ne viendront pas. Des résidents en pyjamas sont agglutinés devant la vitre du bureau de l’assistant de gestion qui ne sortira pas de son bureau. Il vient de prendre ses fonctions. Les visages, collés aux carreaux façon Freaks, attendent une réaction du nouveau. L’hôpital psychiatrique voisin se déverse dans le foyer, avec lots de neuroleptiques et de traitements correcteurs, dit-on, mais sans personnel médical. Les ouvriers sont partis pour la plupart. Il est vrai qu’il est presque impossible de dormir. Des résidents hurlent, seuls ou à plusieurs, à un point tel que même les laps de temps où ils se taisent sont douloureux. On oscille en permanence entre la narcose et le délire collectifs. L’ambiance est tendue. Il s’est peut-être passé quelque chose depuis mon départ. Ou peut-être rien. Depuis mon licenciement économique de l’usine de plasturgie il y a trois ans, j’ai enchaîné les intérims : cariste, élagueur, vigile, dans le commerce, dans le nettoyage, ailleurs. Puis, après la fin de mes droits, j’ai décroché la lune, un poste de prestige : un contrat d’insertion. Je ramasse les papiers gras sur les berges du fleuve avec un petit crochet comme dans les jeux de fête foraine, mais sans la musique. Pour le manège, il faut s’adresser au foyer. Il est devenu une annexe d’asile et de cirque en même temps. Ces dernières années, de plus en plus de paumés, d’ex-nouveaux-toujours-très-pauvres, hommes et femmes, sont arrivés, envoyés par l’assistante sociale qui a trouvé dans les places vides de la résidence la solution miracle pour caser tous ceux qu’elle ne peut ou veut mettre ailleurs. Il y a là quelques papys blédards que l’on a installés au rez-de-chaussée. Du vert, du gris. Ce n’est pas encore un carré musulman mais ça y ressemble. D’anciens routards se sont fixés au premier étage et les bagarres sont réglées sur leur consommation d’alcool, un ordinaire de rosé de pays en cubi, jamais très frais. Ils ont soif surtout quand ils regardent les émissions de pêche à la mouche sur un gros poste de télévision qui occupe la moitié de la chambre. C’est quand l’émission se termine qu’ils se disputent. Au deuxième étage il y a nos amis les anciens de Sainte Marguerite. Et au troisième quelques gars d’une lointaine cité qui sont employés en CDD par une usine de scotch, l’adhésif. Ils n’y restent jamais bien longtemps malgré les bons soins de leur éducateur qui passe parfois. Avec moi, ce sont les derniers à travailler, mais tout le monde en a peur et les traite comme de la Caillera parce qu’ils fument des joints. De mauvais musulmans, disent les Chibs. Au dernier, je ne sais pas trop, je n’y monte jamais, c’est Twilight zone.
Revenant au foyer après avoir lâché ma pince à papier, j’apprends par le jeune handicapé rouquin qui partage sa vie avec un grand père kabyle le pourquoi de cette émeute en pyjama. Ce matin après mon départ, un des gars du premier étage a été découvert mort. Voilà la raison ! Ses voisins qui pourtant en connaissent un rayon question odeurs ont fini par se plaindre. Le type était mort depuis plusieurs jours. Cette fois la police s’est déplacée. Il leur a fallu casser la porte et franchir une muraille de détritus entreposés derrière le sommier placé verticalement. C’était un collectionneur. Ce mort est un peu comme un cadeau de bienvenu, pour le nouvel assistant de gestion, comme sa hiérarchie l’appelle. Il va falloir qu’il se dépêche de nettoyer la chambre pour pouvoir la relouer au plus vite. Sinon son contrôleur lui dira : Ça baisse, Coco ! Les personnels sous-traitant de la boîte de nettoyage industriel qui assurent l’entretien, un bien grand mot, il ne faut pas y compter. Le macchabée de plusieurs jours n’est pas prévu dans le contrat. L’assistante précédente est partie il y a un mois. Elle avait entendu un bruit sourd et mou devant son bureau et avait constaté qu’un résident du quatrième avait fait le saut de l’ange. Un saut dans le vide et il retrouve le béton. Une fois les pompiers décidés à enlever le corps, elle avait nettoyé le sol de la cour avec ses petits gants MAPA puis avait démissionné. Pas faite pour la gestion locative !
Vivre en foyer à l’ère du ministère de l’identité nationale
Du côté de Longwy, très anciennement bassin industriel, le foyer est là depuis toujours, sorte de trace archéologique de temps révolus. Tout comme moi. Je devrais pouvoir me souvenir de mon arrivée mais je m’embrouille maintenant avec les dates. Trop de chaînes d’assemblage, trop de chantiers, trop de foyers. Ma chambre est minuscule. Un lit nommé résidence. Mon voisin Kamel, bien plus vieux que moi, dit qu’il sera plus à son aise dans sa tombe. Ce vieux fou n’exagère pas. Il est devenu acariâtre, grommelant tout le jour et hochant violemment du bonnet à tout bout de champ. Il sort moins de son caveau ces derniers temps. Il baisse… Moi aussi d’ailleurs. Depuis ma retraite je passe de plus en plus de temps dans la cuisine dans laquelle je peux attraper quelques rayons de soleil, – j’ai toujours froid –, lorsqu’il daigne apparaître. Il n’y a pas que lui qui se fait rare. Nous les résidents ne voyons presque jamais de responsables du foyer. Ils font quelques rondes, c’est une habitude qui doit se transmettre de génération en génération, quelques permanences, drôle de mot pour dire absence, afin de traquer les impayés de redevance, des tournées d’inspection de chambres devenues boîtes aux lettres des vieux qui rentrent encore au pays. Il leur faut aussi envoyer les bien trop vieux à l’hôpital et les autres à la morgue. Même les fournitures hôtelières ne transitent plus par ici. Les draps, par exemple, vont directement chez les producteurs de mirabelles pour la cueillette. Il n’y a pas de petit profit. Nous gardons les nôtres, devenus fins comme des suaires.
C’est qu’on est tous des fantômes. Silencieux. Nos prières et nos plaintes sont intérieures. Si l’on observe bien, on en aperçoit quelques-uns en gandouras ou djellabas qui glissent à petits pas. Ce sont ceux qui peuvent encore marcher. Les plus téméraires se risquent parfois jusqu’au marché de la cité, cette fois en veste pied-de-poule et sac plastique à la main. Le grand jour. Ils achètent avec les yeux et se baissent en douceur pour glaner les invendus. Les moins pauvres, lorsqu’ils y voient encore, poussent jusqu’au bar PMU. La nostalgie sans doute et l’espoir de croiser quelques moins vieux qu’au Café social du quartier. Les plus âgés et les plus malades restent à demeure dans leur 4,5 m2. All inclusive ! « Hospitalisation à domicile » qu’ils appellent ça. Seuls les djinns les visitent. Voilà, Ali est au pays des Vermeils.
Ce matin je devine une certaine excitation. Vigor mortis ? Bal des Sonac’ ? Devant le mur des boîtes aux lettres, seul édifice rénové aux normes dans le foyer depuis sa construction, les collègues s’agitent. Certains lèvent même les bras. Je me joins à eux et récupère un pli officiel. Pour une fois les inspecteurs CNAV, qui suppriment le versement des pensions, n’y sont pour rien. Ce n’est pas non plus une annonce d’augmentation des tarifs par la direction régionale. C’est la maison mère. Alma Mater égale gros soucis : le foyer va être détruit. Ils veulent faire un centre d’accueil à la place. Raison sociale, raison raciale. Nous sommes expulsés et avons un mois pour déguerpir. Les résidents veulent se battre. Ils ne sont pas abattus. Plus, ceux qui peuvent encore bouger se sentent revigorés. De vrais warriors qui se souviennent enfin de leur passé militant, grève de loyer, grève à la mine, grève de la faim, de quand ils faisaient muter les juges et trembler le préfet. On va se battre. C’est sûr. Et on va perdre, c’est tout aussi certain. Vous verrez, c’est une question d’habitude.