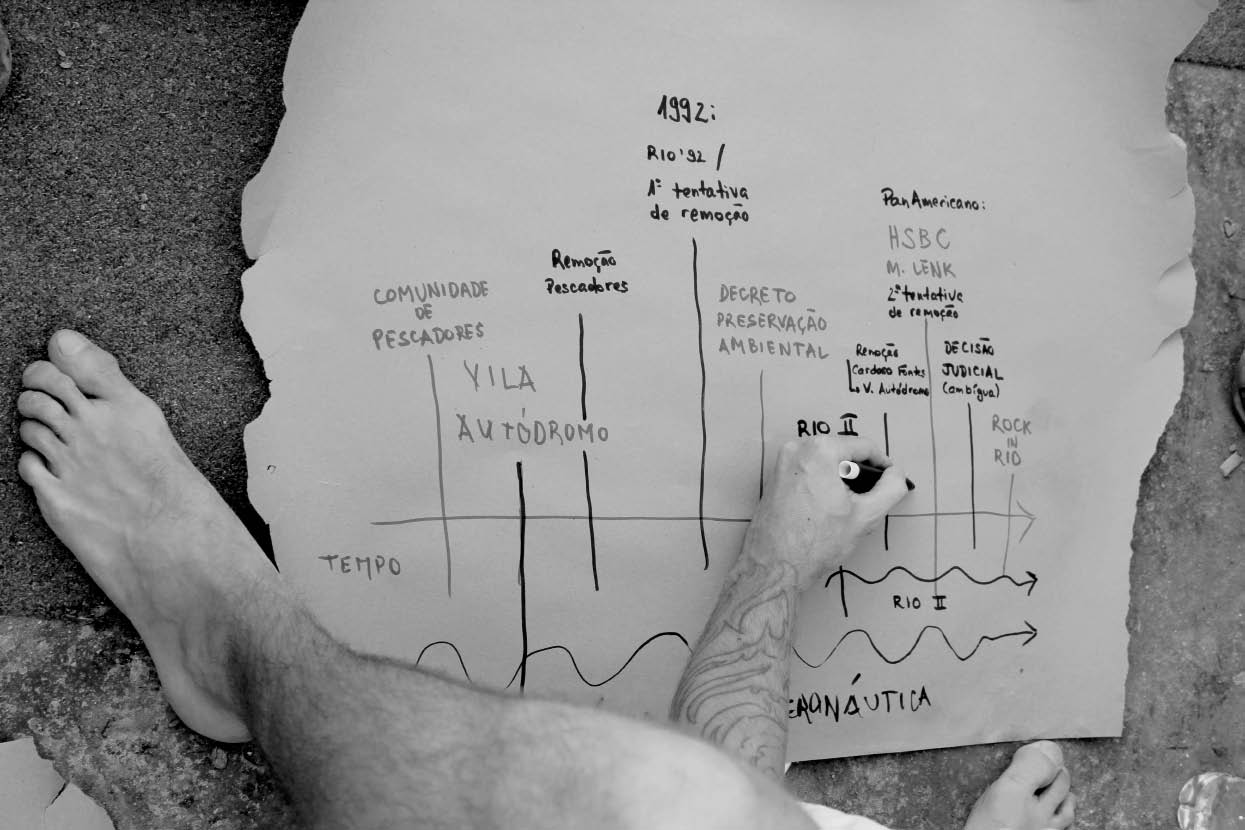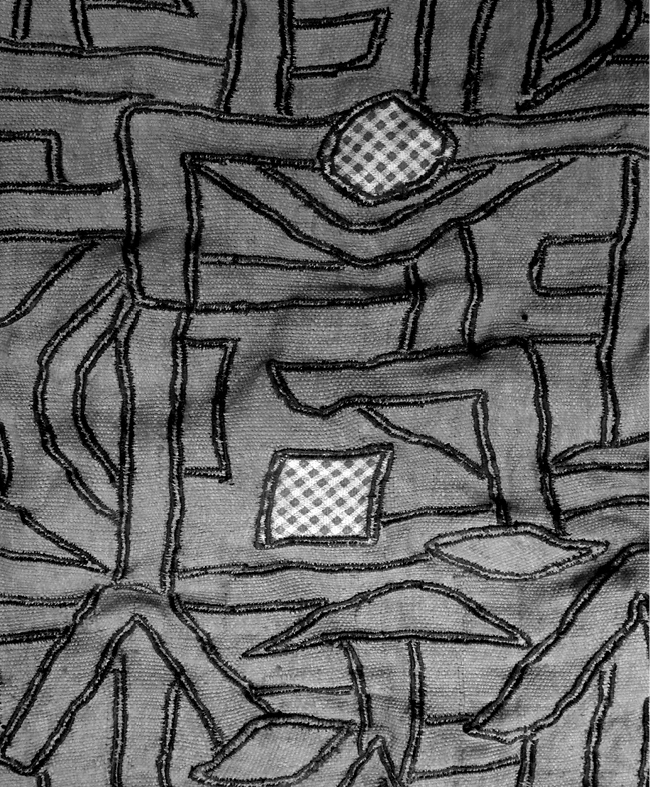Migrations, l’étoile noire de l’Europe
Migrations, l’étoile noire de l’Europe
Dans les années 1970-75, la tache sur la démocratie américaine avait été cette petite fille à demi-nue hurlant dans les flammes de napalm sur une route du Vietnam. En 2015, la tache sur le drapeau européen, c’est le corps de ce petit garçon de trois ans échoué sur la plage turque de Bodrum. Avec sa mère et son frère ils espéraient gagner l’île de Kos pour échapper à l’enfer syrien. Des années plus tard, ce sont ces hommes gelés dans la neige, à la frontière du Bélarus et de la Pologne que la Russie avait obligeamment convoyés.
Les dernières parutions
- Actualité
- À lire en ligne
- Actualité
- À lire en ligne
Navalny : Les assassins, par André Marlowicz
Nous reproduisons la réaction suivante de André Markowicz publiée sur son site facebook