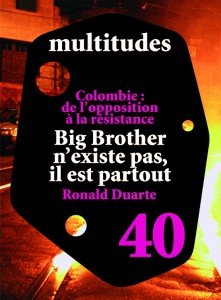La Minga est un concept quechua qui signifie « travail collectif en vue d’un objectif commun » tel que la construction de bâtiments pour la communauté, la réparation d’un chemin ou la récolte dans des terres communautaires ou une ferme familiale. La Minga était la base de l’organisation populaire de l’Amérique précolombienne. Sur un plan symbolique, la Minga dignifie ceux qui en prennent part. En Colombie, la Minga s’est projetée sur l’espace politique en tant que travail social d’organisation, de dénonciation et de réflexion sur les problématiques communes.
Depuis octobre 2008, les divers secteurs sociaux et les peuples qui composent la complexe scène sociale et politique colombienne, ont manifesté la volonté politique de construire de manière conjointe la Minga indigène, sociale et populaire. Il s’agit d’un processus de mobilisation sociale promu depuis les organisations indigènes qui est en train de profondément renouveler les méthodes et les grammaires des luttes sociales. La Minga s’est construite, en paraphrasant Fals Borda[1], de la périphérie vers le centre et du bas vers le haut. De la périphérie vers le centre, parce qu’elle a été poussée par le mouvement indigène d’une des régions les plus pauvres et dévastées au sud du pays, le Cauca, et parce qu’elle est devenue une condition nécessaire pour pouvoir penser le pays dans son ensemble depuis la mobilisation sociale. Du bas vers le haut, dans la mesure où elle se démarque des conceptions verticales de la division du travail politique et de l’avant-gardisme. Au contraire, la Minga est une invitation à faire partie d’un processus de transformation qui met l’accent sur les qualités de chaque apport des individus et des organisations. Feliciano Valencia, l’un des dirigeants de la Minga, dit ainsi : « nous ne représentons aucun espoir, nous posons juste un problème qui concerne tout le monde ».
Faire marcher la parole
Le 12 octobre 2008, les indigènes du Cauca sont sortis de leurs villages pour entreprendre une marche qui aurait dû les amener à Cali. Ces peuples grièvement menacés de disparaître n’ont pas cessé de subir les humiliations et le racisme. Leurs communautés sont soumises à la violence exercée par les acteurs armés du conflit colombien (légaux et illégaux). Les compagnies multinationales et les classes dominantes locales participent elles aussi (souvent en connivence avec les acteurs armés[2]) au saccage de leurs territoires et ressources.
Le but initial de la mobilisation indigène était de rendre visibles certaines des problématiques des peuples autochtones : l’inégale distribution des terres, les assassinats, les enlèvements, les déplacements forcés, les conséquences de l’éventuelle signature des traités de libre commerce (notamment avec les États-Unis et l’Europe) et toutes les autres menaces contre leur autonomie, les ressources naturelles, la biodiversité et la culture. Pendant leur parcours, alors qu’ils avaient un programme politique, mais une posture essentiellement revendicative, ils ont rencontré le Président Uribe qui n’a pas donné de réponse à leurs revendications. Entretemps, la police avait abattu trois représentants indigènes et d’autres avaient été arrêtés. Les communautés autochtones ont alors considéré qu’il fallait passer à un autre stade de la mobilisation, entreprenant une nouvelle marche, plus longue que celle initialement prévue, jusqu’à Bogota. Celle-ci a été l’occasion de convoquer les divers secteurs du pays à débattre d’un programme politique commun et d’une méthodologie des mobilisations.
Un million de personnes sont sortis pour accueillir l’arrivée de la marche à Bogota, ce qui a été interprété par certaines organisations comme la fin d’un cycle et le début d’un autre[3] : l’horizon de la mobilisation allait désormais dépendre de la capacité, pour chaque organisation, de s’approprier l’appel de la Minga afin de devenir Minga à son tour. Avant de rentrer dans le Cauca, Aída Quilcué, conseillère principale du Conseil Régional Indigène du Cauca (CRIC) signalait que la Minga s’était renforcée grâce à la participation de divers secteurs sociaux qui s’étaient accordés à poursuivre la construction d’un programme commun : « Aujourd’hui, 21 novembre 2008, une nouvelle voie de la Minga des Peuples s’ouvre à Bogota. D’ici le 12 octobre 2009, nous allons parcourir chaque coin et chaque cœur de la Colombie, en partageant le programme de cinq points. Nous allons tisser l’agenda et le programme possible et nécessaire pour ce pays. Le 12 octobre 2009, au plus tard, nous allons exposer le tissu de la Minga. À partir des Peuples, nous transformerons notre parole en plan d’action, afin de mettre cette parole en marche. Ce pays de propriétaires sans peuple, deviendra un territoire des peuples, sans propriétaires. La Minga a commencé »[4].
Lors des journées d’octobre 2009, des jeunes universitaires, des paysans, des organisations des quartiers populaires, des syndicats et d’autres organisations sociales se sont appropriées la Minga. Un grand nombre de rencontres, de débats, de mobilisations et d’actions ont eu lieu à Bogota, Cali, Medellin, Ibagué et d’autres centres urbains. La Minga n’a pas cessé de grandir.
Qu’est-ce que la Minga ?
D’une part, la Minga est un processus de mobilisation et d’articulation de différents secteurs (indigènes, paysans, afrodescendants, syndicalistes, étudiants, défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme), avec la volonté de transcender les communautés autochtones et d’embrasser les divers secteurs sociaux qui ont une implantation locale et font un travail de base. La Minga est une invitation à faire partie d’un processus qui se construit sur la base de la participation, se structurant dans des commissions et des comités de travail qui permettent de « mettre la parole en marche » de façon conjointe. D’autre part, la Minga constitue une façon de travailler et de construire collectivement pour un objectif commun qui n’est pas prédéfini et se construit progressivement.
Refaire la Colombie depuis les réalités historiques des régions et des peuples
Lors du tournant historique des années 1990, la mobilisation sociale a acquis un caractère régional où les notions de « territoire » et de « peuple » sont devenues fondamentales pour la construction du politique[5], redéfinissant la notion de classe qui avait marqué les revendications sectorielles et corporatistes des années 1970 et 80. La Minga est une alternative « raizal ». Cette notion largement reprise dans l’œuvre de Fals Borda, joue sur le mot raíz (racine) et revendique la substance nécessairement originaire d’une pensée et de pratiques émancipatoires propres.
L’État-Nation colombien a connu un développement incomplet. La bourgeoisie a copié un modèle européen visant à favoriser le contrôle politique et économique des territoires et des régions. Les mouvements pour l’émancipation construits au long du XXe siècle ont reproduit ce schéma, en imposant une vision eurocentrée et réductionniste du conflit entre les classes qui méconnaissait les réalités, les origines, la culture, les luttes, la pluralité des projections et des regards. En Colombie, l’expérience du Parti socialiste révolutionnaire dirigé entre autres par Maria Cano, Ignacio Torres Giraldo et Eduardo Mahecha a été délaissée[6]. Ce parti, cristallisation du mouvement ouvrier et populaire colombien de la fin des années 1920, envisageait les processus émancipatoires comme une réponse issue des réalités locales. Des revendications indigènes telles que celles défendues par Quintín Lame, leader du Cauca, y ont trouvé toute leur place. Les grammaires portées par la Minga reprennent ce regard particulier de l’action sociale organisée, du progrès, de la justice sociale, de la temporalité de la lutte… mais aussi de la division du travail politique et du rapport avec l’État et la démocratie. Cette réorientation de l’action s’imbrique, sur le plan culturel et intellectuel, avec une réapparition de l’intérêt pour l’histoire occultée des luttes qui ont mené à l’indépendance de la Colombie en 1810 et de celles qui en ont découlé. Ceci se traduit par une campagne, parallèle à la Minga, construite autour de l’idée selon laquelle les 200 ans d’indépendance n’ont pas été synonymes d’émancipation populaire.
Dans certains départements, comme le Cauca en particulier, la fragmentation des luttes s’était produite tout au long des années 1970, certains leaders indigènes ayant rejeté des consignes historiques au sein du mouvement paysan (« la terre pour celui qui la travaille ») et revendiqué leurs spécificités culturelles, politiques et territoriales[7]. Les luttes se réunifièrent dans les années 1990, à partir de la revendication de la diversité de chaque secteur social. On organise alors des commissions, des comités de négociation, on présente des cahiers de doléances, des propositions, on constitue des formes de gestion collectives. Entre 1996 et 1997, ce nouveau mouvement de la mobilisation régionale se cristallise pour donner lieu ensuite au Conseil paysan de 2003 et aux Rencontres populaires de 2004. À partir de ce moment, la capacité politique de la Minga se consolide pour transcender les revendications sectorielles vers un véritable débat politique.
Quatre points fondamentaux pour la construction d’un agenda commun
Dans le contexte du néolibéralisme triomphant des années 1990 et de l’intensification du conflit armé, l’État n’est plus le seul interlocuteur. Les luttes revendiquent la souveraineté et l’autonomie des dynamiques organisationnelles de base. La marche d’octobre 2008 constitue un point de rupture : la Minga renonce définitivement aux négociations avec l’État. C’est à l’intérieur de l’organisation et au niveau des régions qu’il faut d’abord résoudre les problèmes.
La Minga ne se conçoit pas elle-même en tant qu’un front revendicatif conjoncturel, mais comme une invitation à construire un processus collectif à partir de l’autonomie et de l’approfondissement des processus propres à chaque organisation, autour de quatre points programmatiques : 1)terre, territoire, souveraineté ; 2) droit à la vie ; 3)les accords non respectés ; 4) modèle économique et législation du saccage.
Terre, territoire et souveraineté
Le conflit colombien est ancré dans la longue histoire du saccage des terres et des ressources des populations autochtones. Ce cycle ne s’achève pas avec la période coloniale ; au contraire, on pourrait même dire qu’il s’intensifie après la fin de celle-ci. Les luttes indigènes des années 1970 sont parvenues à estomper cette voracité, réussissant à faire consigner un bon nombre de droits reconnaissant la spécificité culturelle et territoriale des indigènes, dans la Constitution de 1991. Néanmoins, cette reconnaissance n’a été que formelle. Henri Caballero, coordinateur du Laboratoire pour la paix du sud-ouest colombien, établissait un bilan de la situation dans le Cauca : « 82% des terres de notre département sont entre les mains des grands propriétaires terriens de l’élevage extensif, du café et de la canne à sucre. Les terres des paysans et des indigènes sont les moins fertiles, elles sont confinées dans les montagnes… Même si la constitution reconnaît que les indigènes devraient bénéficier de 217000 hectares supplémentaires, au rythme actuel il faudrait 150 ans pour leur restitution ».
Par ailleurs, la lutte pour la terre embrasse aussi une remise en valeur des relations qui se tissent dans le territoire. Celui-ci est l’espace où la culture s’enracine, où les processus sociaux se dynamisent. Bien sûr, cette conception engendre un affrontement politique : « Nous constatons deux visions. Notre vision, qui conçoit la terre comme l’origine et la possibilité de la vie, c’est pour cela que nous la défendons. Et l’autre vision, qui la conçoit comme une ressource à usage personnel et des multinationales. Dans cet ordre d’idées, nous faisons les propositions suivantes : premièrement, la consolidation de la résistance pacifique pour défendre et libérer la terre, les ressources naturelles et les êtres qui l’occupent. Deuxièmement, que cette responsabilité n’appartienne pas seulement aux Indiens, car le problème ne concerne pas que les Indiens. C’est pour cela qu’il faut consolider la Minga avec d’autres peuples et d’autres secteurs, afin de consolider un tissu global des résistances ».
Droit à la vie
La revendication du droit à la vie doit être comprise dans le contexte de la guerre et des atteintes systématiques aux droits fondamentaux de la part des acteurs du conflit armé. Cette situation est subie non seulement par les indigènes mais par tous les secteurs organisés et la population dans son ensemble. Par exemple, d’après le dernier Rapport annuel sur les violations des droits syndicaux de la CSI[8], 64% des assassinats de syndicalistes au monde, en 2009, ont eu lieu en Colombie. Les organisations de défense des droits de l’homme dénoncent cette situation depuis des années ainsi que la criminalisation systématique des organisations sociales par l’État.
La Minga a mis en place des formes de protection de la population civile telles que la Garde indigène. Bien que celle-ci se présente comme une réponse à la présence d’acteurs armés dans les territoires, il ne s’agit pas d’une structure militaire. Elle est composée d’hommes, de femmes et d’enfants qui, formés d’après les principes politiques et éthiques du mouvement, ne sont armés que de bâtons symbolisant la vigilance sur le territoire. Dès qu’un affrontement armé se produit, la Garde indigène doit veiller à l’intégrité de la population en la conduisant vers les espaces d’assemblée permanente où la parole s’exprime alors que les balles résonnent à l’extérieur. C’est une autre manière de lutter contre le déplacement forcé.
La revendication du droit à la vie place les individus dans un espace de projection temporelle long. Non seulement la vie est un produit du travail des générations précédentes, mais le travail de chacun doit préserver la vie des générations à venir. La sacralisation de la vie et sa connexion aux conditions matérielles de l’existence permet la généralisation d’une éthique orientée vers la responsabilité, qui confère un cadre pour l’action quotidienne. Alvaro Anacona, dirigeant du peuple Yanakona, explique ainsi leur lutte contre la privatisation des cours des fleuves et des sources d’eau : « l’eau n’appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Nous qui vivons dans ce territoire qui est sacré pour nous, nous avons le devoir de la défendre, pour éviter que ceux et celles qui viennent après nous périssent ».
Les accords non respectés
L’État n’a pas respecté les accords qu’il a souscrits avec les indigènes et les autres secteurs sociaux. De surcroît, les politiques néolibérales postérieures à la Constitution de 1991 ont invalidé bon nombre de droits qui y sont consignés. On comprend que les organisations faisant partie de la Minga, tels les syndicats, les organisations indigènes ou les organisations paysannes, aient alimenté un sentiment de méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics et soient persuadés que, sans une mobilisation sociale à même de soutenir et contrôler l’action de ces derniers, même les gouvernements théoriquement proches pratiqueront des politiques contraire aux aspirations, besoins et intérêts des populations. La Minga se construit donc dans la revendication d’une autonomie organisationnelle et dans la construction de cadres de décision propres, entre le niveau local et l’État.
Modèle économique et législation du saccage
La Minga convoque à une opposition contre les accords de libre-échange avec les pays du Nord. Une conceptualisation différente du progrès et du développement sous-tend cette opposition ainsi que l’exprime Feliciano Valencia : « Nous ne nous opposons point au développement, à condition qu’il n’agresse pas la « mère Terre », qu’il n’aille pas à l’encontre des ressources, de la vie… Nous considérons le développement depuis une logique autre, en vue de l’obtention d’un bien commun… On nous dit que pour le développement il est nécessaire d’attirer les investissements étrangers. Combien d’années se sont écoulées avec la même rhétorique et quels bénéfices sociaux ont amené les multinationales au pays ? La redistribution interne des richesses est mal faite… Allez voir nos chemins, ce sont des sentiers pour les bêtes par où nous devons sortir la nourriture pour les populations urbaines… Il n’y a pas d’écoles, ni de centres de santé, ni de médecins, ni de médicaments… Si leur progrès valait la peine, à quoi bon s’y opposer ? ».
L’avenir est dans le présent, non seulement comme représentation mais comme détermination du présent. Les contradictions du progrès technique et économique (sans progrès social et moral) rendent nécessaire un changement culturel et matériel à même de déconstruire, dans la mobilisation sociale, la notion même de « progressisme ».
La Minga,
un processus de construction permanente
« À quoi sommes-nous en train de nous confronter en tant que Minga ? Aux plans, aux programmes ou bien aux projets ? Aux principes de société qui gouvernent l’économie, la culture ? Quelles sont nos propositions politiques en tant qu’organisation ? De quelle façon ces propositions nous conduisent à un projet de société ? Comment sortir de nos conceptions sectorielles pour construire une vision du social…? » À travers ces questions aux différentes organisations, la commission politique de la Minga a organisé la première Minga de réflexion nationale [Minga de pensamiento] au mois d’août 2009. Cette rencontre a posé deux enjeux fondamentaux : identifier les propositions politiques essentielles de chaque organisation afin de mettre en valeur ce qu’elles ont en commun et de contribuer à la construction d’une vision d’ensemble, et organiser un agenda de mobilisations en consonance avec les agendas de chaque organisation. Ces Mingas de pensée ou espaces de délibération sont pratiqués dans plusieurs régions, dont en particulier le Cauca, sous la dénomination de tulpa. Les tulpas sont les trois pierres du foyer, un espace où l’on fait la cuisine, discute, réfléchit, construit collectivement. Dans l’espace de la cuisine, la pensée est orientée vers le devenir quotidien conçu pour l’action, la pensée est pratique. Se rassembler autour des « foyers » vise à souligner le caractère permanent de la construction de Minga, où l’on discute pour construire un devenir collectif.
La Minga dans l’horizon politique colombien
Le monde des luttes a été atomisé après la défaite du mouvement ouvrier comme projet de transformation sociale. À sa place, une fragmentation des mobilisations en ilots de résistance, où chaque groupe conduit sa révolution particulière. Depuis des années, ici et là, les acteurs de ces différents mouvements réclament la nécessité de retisser ces expériences pour construire un programme unifié ne serait-ce que revendicatif, sans y parvenir réellement. La difficulté intrinsèque de cette reconstruction, qui s’explique aussi en partie par la fragilité de chaque organisation et de chaque secteur social (acculés souvent à des positions défensives), donne des pistes sur le véritable exploit de l’émergence de la Minga. Qui plus est, dans un pays profondément polarisé par un conflit armé qui dure depuis des décennies et où les organisations sociales et populaires sont systématiquement criminalisées et combattues avec des moyens plus ou moins légaux.
La Minga s’explique par les conditions sociopolitiques du Cauca, mais elle n’est pas encore parvenue à expliquer à son tour le Cauca dans toute sa complexité. De la même manière, l’avenir de la Minga passe par sa capacité à devenir Minga Nationale, et à se démultiplier dans les différentes régions colombiennes. Les forces sociales qui composent la Minga sont aujourd’hui convaincues que la mobilisation ne saurait s’estomper. Un projet de taille, en phase avec la complexification graduelle de la société colombienne. Un projet fragile encore mais une opportunité pour pouvoir sortir enfin la Colombie du marasme et de la barbarie.