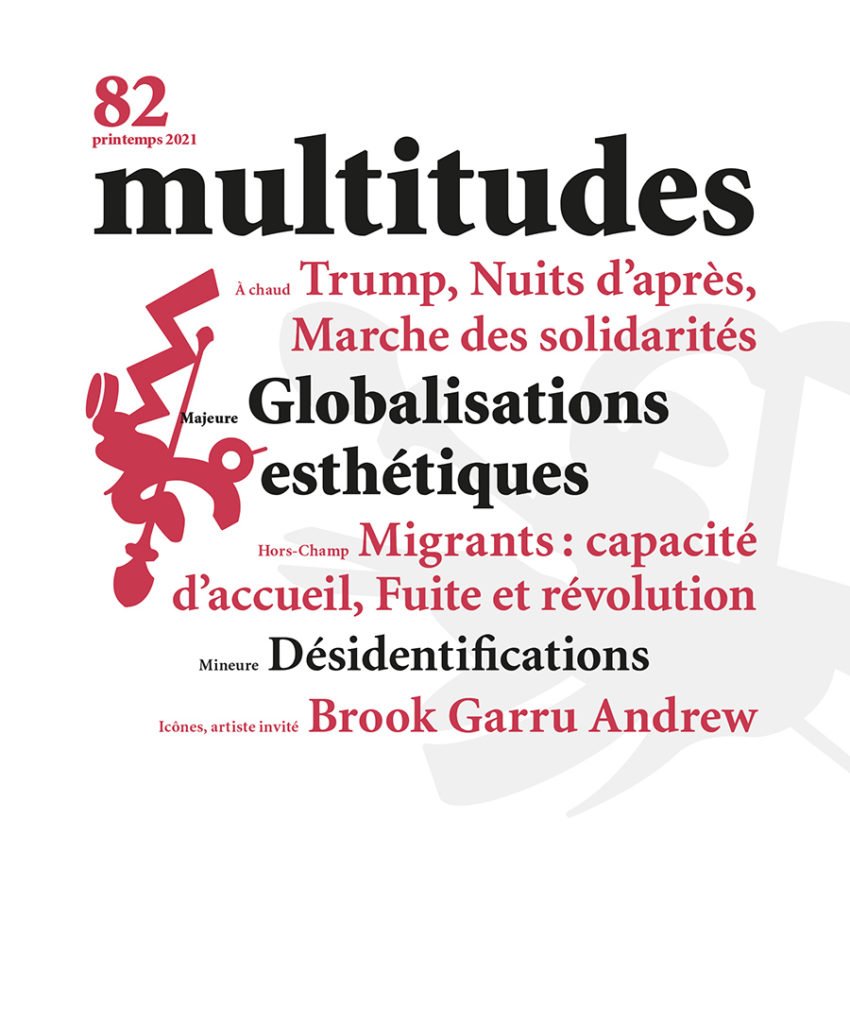Quelle est l’alternative ?
M. Krabs : Et juste quand tu penses que t’as trouvé l’El Dorado, ils t’attrapent par le caleçon, et ils te hissent à la surface, plus haut, encore plus haut, et plus haut, jusqu’à ce que tu sois à bout de souffle ! Et après y t’cuisinent, et y t’bouffent – ou pire !
Bob l’Éponge : (terrifié)
Qu’est-ce qui pourrait y avoir de pire ?
M. Krabs : (doucement) Les boutiques souvenirs.
« La pause », Bob l’Éponge carrée
Juste quand tu penses que t’as trouvé l’El Dorado, dit M. Krabs à ce bon vieux Bob l’éponge, tu te retrouves sur le menu, ou pire, dans la boutique souvenir. Tu atterris sur la table des produits dérivés d’une illusion à laquelle tu venais de dire adieu. Nous avons tous·tes l’habitude de voir nos rêves broyés, nos espoirs fracassés et nos illusions brisées, mais qu’est-ce qui vient après l’espoir ? Qu’arrive-t-il si, tout comme Bob l’éponge, nous ne croyons pas que le voyage au paradis finit inévitablement à la boutique souvenir ? Autrement dit, quelle est l’alternative à la résignation cynique d’une part et à l’optimisme naïf d’autre part ? Bob l’éponge voudrait savoir : quelle est l’alternative si l’on se refuse à travailler du matin au soir pour M. Krabs et à se laisser attraper dans les mailles du capitalisme marchand ? Ce livre1, un genre de « Kit de survie Bob l’Éponge », abandonne tout idéalisme et tout espoir, et cherche ses sagesses dans de nouvelles formes de relations spongieuses à la vie, à la culture, au savoir et au plaisir.
Alors, quelle est l’alternative ? Cette question toute simple annonce un projet politique. Elle requiert une grammaire de la possibilité (ici : le gérondif et la voix passive, entre autres grammaires déclaratives) et exprime un désir fondamental de vivre la vie autrement. Les universitaires, les activistes, les artistes et les personnages de dessin animé ont longtemps été en quête d’une vision alternative de la vie, de l’amour et du travail et des moyens de concrétiser cette vision. À travers l’usage de manifestes, d’un ensemble de tactiques politiques et de nouvelles technologies de représentations, les utopistes sont toujours à la recherche de manières différentes d’être au monde, d’être en relation les un·es aux autres et de désobéir aux prescriptions adressées au sujet-consommateur libéral. Ce livre utilise les savoirs populaires et la low theory – un terme adapté du travail de Stuart Hall – pour explorer les alternatives et pour chercher une échappatoire aux pièges habituels et aux impasses de la pensée binaire. La low theory essaye de repérer les entre-deux qui nous évitent d’être pris·es aux crochets de l’hégémonie et harponné·es par les séductions des boutiques souvenirs. Mais elle s’efforce aussi d’accepter la possibilité que les alternatives pourraient bien résider dans les eaux boueuses, contre-intuitives, incroyablement sombres et négatives de la critique et du rejet. Ainsi, le livre virevolte entre basse et haute culture, entre basse et haute théorie, entre culture populaire et savoir ésotérique, afin de passer au travers des divisions entre l’art et la vie, la pratique et la théorie, la pensée et l’action, pour entrer dans un royaume plus chaotique de savoir et de non-savoir.
Dans ce livre, je passe des films d’animation pour enfants à la performance d’avant-garde et à l’art queer pour penser des manières d’être et de savoir qui se tiennent au dehors des compréhensions conventionnelles du succès. Je soutiens que le succès, dans une société hétéronormative et capitaliste, se réduit trop facilement à la maturité reproductive et à son lien avec l’accumulation de capital. Depuis peu, les mesures habituelles du succès sont sous le coup de sérieuses pressions, avec l’effondrement des marchés financiers d’une part, et l’augmentation épique des taux de divorce d’autre part. La succession de plus en plus rapide des périodes fastes et des périodes de récession au tournant du XXIe siècle devrait au moins nous avoir appris que les modèles statiques du succès et de l’échec ne tiennent plus la route.
Plutôt que de défendre une réévaluation de ces modèles, l’art queer de ne pas réussir démantèle la logique du succès et de l’échec avec laquelle nous vivons actuellement. Dans certaines circonstances, échouer, rater, perdre, oublier, défaire, ne pas convenir, ne pas savoir, pourraient en réalité offrir des manières plus créatives, plus coopératives et plus surprenantes d’être au monde. Échouer, c’est une chose à laquelle les personnes queer ont toujours excellé ; pour les queers, l’échec peut être un style (pour citer Quentin Crisp) ou un mode de vie (pour citer Foucault), et peut contraster avec les scénarios sinistres du succès qui demandent d’essayer « encore et encore ». Si le succès requiert tant d’efforts, ne serait-il pas plus facile, sur le long terme, de s’efforcer de ne pas réussir ? Peut-être l’échec offre-t-il d’autres types de récompenses.
Indiscipliné·e
« L’illisibilité, donc, a été et reste une source fiable d’autonomie politique ».
James C. Scott, Seeing Like a State
Tout livre qui commence avec une citation de Bob l’Éponge et qui se nourrit des sagesses glanées dans Fantastique Maître Renard, Chicken Run, et Le Monde de Nemo (parmi d’autres manuels de survie sous forme animée) court le risque de ne pas être pris au sérieux. Et tel est bien mon but. C’est qu’en cherchant à être pris au sérieux, je manquerais peut-être la chance d’être frivole, immoral et impertinent. L’esprit de sérieux est précisément ce qui nous force à suivre les sentiers battus du savoir, à l’écart desquels je cherche au contraire à tracer quelques détours. Des termes comme « sérieux » et « rigueur » tendent à fonctionner comme des synonymes, à l’université comme dans d’autres contextes, de correction disciplinaire ; ils signalent une sorte de formation et d’apprentissage qui confirme ce qui est déjà su en fonction des méthodes de connaissance pré-approuvées, mais ils n’autorisent guère les visions intuitives et les envolées utopiques. Former, c’est toujours, d’une manière ou d’une autre, refuser la relation au savoir suggérée par Walter Benjamin dans Le Livre des passages : une invitation à la flânerie le long de rues inexplorées, une recherche explicite de la « mauvaise » direction. Au contraire, toute formation implique par principe de rester sur un territoire bien éclairé et de savoir exactement où l’on va avant même de faire ses bagages. Comme d’autres avant moi, je propose plutôt que le but soit de perdre son chemin, et pour tout dire : d’être prêt·e à perdre bien plus que son chemin. Perdre, pouvons-nous dire avec Elizabeth Bishop, est un art – un art « qu’il n’est pas trop difficile de maîtriser / même s’il est difficile d’avoir l’air d’y réussir2. »
Il est temps d’expérimenter avec les disciplines, car nous avons besoin de générer de nouvelles formes de savoirs à une époque où les champs qui se sont formés il y a plus d’un siècle pour répondre aux nouvelles économies de marché et au besoin d’expertises et de connaissances spécialisées telles que les a décrites Foucault, sont en train de perdre de leur pertinence et d’échouer à répondre tant aux projets concrets de développement des connaissances qu’aux intérêts des étudiant·es. À mesure que les grandes disciplines commencent à s’effondrer comme autant de banques qui auraient investi dans des actifs toxiques, il devient possible de se demander : tenons-nous réellement à consolider les frontières délabrées de nos disciplines, de nos intérêts partagés et de nos engagements intellectuels ; ou ne profiterions-nous pas de l’opportunité pour repenser du tout au tout le projet de l’apprentissage et de la pensée ? De la même manière que les tests standardisés utilisés dans les lycées aux États-Unis pour évaluer le progrès des élèves ont tendance à identifier… les personnes douées pour ce type de test (plutôt que, disons, les visionnaires), de même à l’université, les notes, les examens et les savoirs canoniques identifient les universitaires aptes à se conformer aux diktats de la discipline et à les maintenir.
[…] Un point de vue radical sur l’université et sa disciplinarité, qui prend pour point de départ à la fois l’effondrement des disciplines et le maillage des écarts entre les champs conventionnellement considérés comme séparés, nous est offert dans un manifeste publié par Fred Moten et Stefano Harney en 2004 dans Social Text : « L’université et les sous-commun*es. Sept thèses ». Leur article est une critique saisissante adressée aux intellectuel·les et à la critique, à l’universitaire de profession et aux « professionnel·les de la critique universitaire ». […] Moten et Harney nous invitent à « voler ce que l’on peut » à l’université, à « voler les lumières pour les autres3 » et à agir contre « ce que Foucault appelait la Conquête, cette guerre tacite qui fonde et, avec la force de la loi, constamment refonde la société4. » Et que veulent être les sous-commun*es de l’université ? Elles veulent constituer une force non-professionnelle de fugitives de la science, de savantes en fugue dotées d’un ensemble de pratiques intellectuelles qui ne seraient contraintes ni par les systèmes d’examen ni par les résultats aux tests. Le but de cette déprofesssionalisation n’est pas d’abolir quoi que ce soit ; Moten et Harney opposent la fugue de l’intellectuel·le à l’élimination ou à l’abolition de ceci, aussi bien qu’à la fondation ou à la refondation de cela : « Pas tant l’abolition des prisons que l’abolition d’une société où les prisons ont pu exister, où l’esclavage a pu exister, où le salariat a pu exister, et donc non pas l’abolition en tant qu’élimination de quoi que ce soit mais l’abolition comme fondation d’une nouvelle société5 ».
Non pas l’élimination de quoi que ce soit mais la fondation d’une nouvelle société. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas penser une société différente de celle qui a d’abord créé puis aboli l’esclavage ? Après tout, les mondes sociaux que nous habitons ne sont pas, comme de nombreuses penseuses nous l’ont rappelé, inévitables. Ils n’étaient pas nécessairement destinés à devenir ce qu’ils sont devenus. Qui plus est, dans le processus de production de cette réalité, beaucoup d’autres réalités, d’autres champs de connaissance et de manières d’exister ont été évacuées et, pour encore citer Foucault, « disqualifiées ». Quelques livres visionnaires, produits à la marge des savoirs disciplinaires, nous donnent une idée des chemins qui n’ont pas été pris. Par exemple, dans un livre qui lui-même a commencé comme un détour, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed 6, James C. Scott fait le détail des manières dont l’État moderne a écrasé les formes de connaissances locales, traditionnelles et indisciplinées afin de rationaliser et de simplifier des pratiques sociales, agricoles et politiques dont le profit est l’objectif premier. Au cours de ce processus, nous dit Scott, certaines manières de voir le monde se sont établies comme normales ou comme naturelles (alors même qu’elles sont les purs produits de la société qui les abrite), comme évidentes ou comme nécessaires (alors même qu’elles sont souvent totalement contre-intuitives). Seeing Like a State prévoyait d’être une étude de la « raison pour laquelle l’État est toujours apparu comme l’ennemi des “gens qui se déplacent” », mais s’est rapidement transformé en une étude de la manière dont l’État impose la lisibilité par des méthodes de standardisation et d’uniformisation. Dean Spade et d’autres universitaires queer ont utilisé le livre de Scott pour penser la manière dont l’identification de genre s’est progressivement imposée sur les papiers d’identité7. Pour ma part, je propose d’utiliser cette étude monumentale pour y prélever quelques-uns de ces savoirs locaux dont on a prétendu se débarrasser et qu’on a piétinés dans la course à la bureaucratisation et à la rationalisation d’un ordre économique qui privilégie le profit sur toutes les autres formes d’existence et d’action.
L’art queer de ne pas réussir
« Si tu ne réussis pas du premier coup, alors l’échec est peut-être ton style ».
Quentin Crisp, The Naked Civil Servant
« Les vagues successives de libération ont affaibli certains aspects de l’identité gay « historique » et, dans certains cas, l’ont même rejetée en bloc. L’association entre l’amour homosexuel et l’échec s’est longtemps trouvée au centre de cette identité – lien qui, historiquement, donnait à certain·es personnes queer un point de vue privilégié sur les faillites de l’amour et ses impossibilités (et sur les espoirs insensés qu’il génère). Pour ma part, je préfère revendiquer une telle association plutôt que de la désavouer, et je considère l’art de perdre comme un art particulièrement queer. »
Heather Love, Feeling Backwards : Loss and the Politics of Queer History
« L’échec queer… est davantage une question de fuite, et d’une certaine virtuosité dans la fuite. »
José E. Muñoz, Cruising Utopia : The There and Then of Queer Utopia
[…] On peut compter l’échec au nombre des outils oppositionnels que James C. Scott appelle les « armes des faibles8 ». Décrivant les résistances paysannes en Asie du Sud-Est, Scott identifie certaines activités qui peuvent à première vue ressembler à de l’indifférence ou à de la complaisance, mais qui se révèlent comme autant de « partitions cachées » d’actes de résistance à l’ordre dominant. De nombreuses théoricien·nes ont utilisé la lecture que Scott donne de la résistance pour décrire différents projets politiques et repenser les dynamiques du pouvoir. Certaines chercheuses, comme Saidiya Hartman dans Scenes of Subjection9, ont notamment utilisé le travail de Scott pour décrire les stratégies de résistance subtile face à l’esclavage, telles que le ralentissement du travail ou la simulation de l’incompétence. Le concept d’« arme des faibles » peut être utilisé pour concevoir comme une pratique d’enrayage de l’activité des dominant·es ce qui ressemble de prime abord à de l’inaction, de la passivité, voire à une absence de résistance. Nous pouvons aussi reconnaître dans l’échec une manière de refuser et de critiquer la complaisance avec les logiques dominantes du pouvoir et de la discipline. Pratiquer l’échec, c’est reconnaître que penser en termes d’alternative, c’est déjà faire le jeu des dominant·es. C’est, à la place, proposer de tirer avantage du fait que le pouvoir n’arrive jamais à être total ni cohérent partout où il s’applique. C’est inviter à tirer profit des imprévisibilités et des indéterminations de l’idéologie.
Les études queer nous offrent une méthode pour imaginer, non pas le fantasme d’un ailleurs, mais des alternatives existantes aux systèmes hégémoniques. […] José Muñoz a magistralement rendu compte de cette manière queer de ne pas réussir en expliquant la connexion entre les queers et l’échec d’une part en termes de « rejet utopique du pragmatisme » et d’autre part en termes d’un refus tout aussi utopique des normes sociales10. […] Le reste de ce chapitre se présente comme une archive de l’échec, en dialogue avec l’« histoire cachée du pessimisme » de Sandage11 et l’« utopie queer » de Muñoz, où s’explore sous la forme de notes et d’anecdotes, de théories et d’exemples, ce qui se passe quand l’échec est lié de manière productive à la conscience raciale, à la lutte anticoloniale, à la variabilité de genre et à différentes formulations des temporalités du succès.
À la quatrième place : l’art de perdre
Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques donnent en spectacle leurs hauts et leurs bas et l’alternance de victoires et d’échecs qui s’y jouent. Toutefois, la couverture implacablement patriotique des Jeux dans bien des pays, mais particulièrement en Amérique du Nord, en donne une image tronquée : tandis que les athlètes américain·es échouent plus souvent qu’ils ne réussissent, le public américain des Jeux n’a guère l’occasion d’assister à leurs échecs ; nous sommes abreuvé·es d’images de Yankees triomphants à la piscine ou sur la piste de course. On nous livre l’histoire des vainqueurs du matin au soir, tous les jours, si bien que tous les quatre ans, les téléspectateur·ices américain·es ratent le théâtre plus vaste des Jeux qui émerge de l’imprévisibilité, de la tragédie, des défaites à un cheveu et, oui, du joyeux bordel indigne de l’échec.
Dans un projet photographique associé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Tracey Moffatt a saisi des images profondément émouvantes d’athlètes arrivé·es quatrièmes. Dans le catalogue de l’exposition, Moffatt explique avoir entendu la rumeur selon laquelle elle avait été recommandée pour être l’une des photographes officielles des Jeux cette année-là, et elle commente : « je me suis mise à imaginer que si j’avais vraiment été la “photographe officielle” des JO de Sydney en 2000, j’aurais pris les images en suivant mon propre biais – j’aurais photographié les perdant·es. » Elle s’imaginait que tandis que l’attention de tout le monde aurait été orientée par les media mainstream vers le spectacle des victoires triomphales, elle se serait concentrée sur « les images des athlètes brillant·es qui n’auraient pas réussi ». C’est finalement à la quatrième place qu’elle a décidé de dédier son archive des perdant·es, parce qu’il lui semblait que finir quatrième était plus triste que de finir dernière12. L’athlète qui arrive quatrième est celle qui a tout juste perdu, tout juste manqué la médaille, à peine trouvé une (non)place au seuil des annales de l’histoire. Moffatt remarque : « Quatrième, ça veut dire que tu es presque bonne. Tu n’es pas la pire (ce qui, perversement, aurait eu son propre glamour), mais presque. Presque une star ! » La quatrième place, c’est l’anti-glamour de l’échec. Comme le dit Moffatt, on n’en tire même pas le plaisir pervers d’être tellement mauvais qu’on en est presque bon. Non, celui qui arrive quatrième occupe une position tout à fait unique : au-delà de la gloire mais avant l’infamie.
Moffatt s’est efforcée de saisir dans ses photographies ce moment décisif où l’athlète se rend compte qu’il ou elle est arrivée quatrième : « La plupart du temps, l’expression est hagarde. C’est un regard fixe, qui traverse un visage humain. C’est un masque terrible, beau, lucide, qui dit “oh merde !” » Elle photographie les nageuses encore dans la piscine, leurs larmes amères mélangées à l’eau chlorée. Son appareil déniche des coureurs épuisés, rompus et frustrés, des boxeuses à terre, des joueurs qui ramassent leur équipement après l’événement. Toute la série est une vaste documentation du désespoir de la déception, de la défaite dramatique et de la cruauté de la compétition. Ces images nous rappellent que gagner est un événement multivalent : pour que quelqu’un·e gagne, quelqu’un·e d’autre doit ne pas réussir. L’acte de perdre a donc sa propre logique, sa propre complexité, sa propre esthétique mais aussi, tout bien considéré, sa propre beauté. Moffatt essaye de capturer la texture de l’expérience de l’échec, l’ailleurs du succès et l’absurdité statistique qui détermine qui gagne aujourd’hui à une fraction de seconde près ou à un centimètre près, et qui se fondra demain dans l’anonymat. […]
Les enfants et l’échec
Les films mainstream destinés aux enfants produisent, presque accidentellement, quantité de perversions des récits dominants de l’appartenance, des relations et du développement. Ces perversions sont souvent liées aux imaginaires politiques du succès et de l’échec. Plutôt que d’être surpris·es par la présence de personnages et de récits ouvertement queer dans les films pour enfants mainstream, plutôt que d’être surpris·es par la présence fréquente des thèmes de l’échec et de la déception, nous devrions reconnaître dans les dessins animés pour enfants un genre qui, parce qu’il doit attirer l’attention de sujets désirants immatures, est parfois bien forcé de le faire en recourant à une large palette de relations et de corporéités perverses. Plutôt que de protester contre la présence de personnages queer dans ces films, comme une journaliste du Village Voice le faisait à propos de Shrek 2, nous devrions les employer à troubler les mythologies sucrées et idéalisantes de l’enfance, de la sexualité et de l’innocence, et en profiter pour imaginer de nouvelles versions des récits du passage à l’âge adulte, de l’apprentissage et du développement qui ne dépendraient pas de la logique de la filiation ou du succès.
Les comédies pour adolescent·es et les dessins animés pour enfants mainstream foisonnent d’imaginaires de l’autre et de la différence, de corporéités alternatives, de filiations collectives et de désirs excentriques. Dans un certain nombre de ces « contes de fées queers », les histoires d’amour font place à des histoires d’amitié, l’individuation fait place à la collectivité, et la réussite du couplage hétérosexuel est mise à mal, déplacée et remise en cause par d’étranges contacts, des contacts queer : les princes se transforment en grenouilles plutôt que l’inverse, les ogres refusent de devenir beaux et les héros préfèrent fréquemment la vie collective à la vie de couple. Presque tous ces films privilégient des modèles de développement non-linéaires et non-oedipiens ainsi que des histoires oubliées et souvent troubles. La répétition est préférée à la séquentialité ; le temps du conte de fées (« il y a fort, fort longtemps… ») et l’espace mythique (« dans un royaume fort, fort lointain… ») constituent l’arrière-plan fantastique d’une invention de modes de vie « adolescents » ou « infantiles » qui sont souvent, aussi, manifestement queer. Alors que des films pour enfants comme Babe, Chicken Run, Le Monde de Nemo et Shrek sont souvent décrits comme des gourmandises pour enfants que les adultes peuvent apprécier, ils seraient sans doute mieux décrits comme des films conçus avec la conscience aiguë du caractère dénué de toute sentimentalité, de toute moralité et de toute téléologie des désirs narratifs enfantins. Ce sont les spectateu·rices adultes qui ont besoin de sentiments, de progrès, de conclusions ; les enfants, comme le reconnaissent ces films, s’en fichent éperdument. Et pour illustrer mon argument concernant ces contes de fées queer, comme autant de manières de mettre en scène à la fois les temporalités non-linéaires et de nouveaux imaginaires radicaux de communauté et d’association, je voudrais relever l’abondance de personnages explicitement queers dans ces films et souligner quelques-uns des thèmes politiques communs qui les habitent.
Les contes de fées queer sont souvent organisés autour de héros ou d’héroïnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont différents, et dont la différence est jugée comme offensante par la communauté à la marge de laquelle ils se trouvent rejetés : Shrek est un ogre forcé de vivre à l’écart d’un village ogrophobe ; Babe est un cochon orphelin qui pense être un chien de berger ; Nemo est un poisson orphelin de mère avec une nageoire difforme. Chacun de ces héros « déficients » doit se battre ou se mesurer avec son opposé, qui représente la richesse, la bonne santé, le succès et la perfection. Alors qu’ils pourraient aisément conduire à une leçon de morale bien rangée sur la nécessité d’apprendre à s’accepter soi-même, chacun de ces récits de la différence associe en réalité la lutte individuelle de celui qui est rejeté à la lutte plus large des dépossédé·es. Dans Shrek, par exemple, l’ogre devient un combattant de la liberté pour les réfugié·es du conte de fées que Lord Farquaad (fuckwad, « l’idiot nuisible », c’est-à-dire : Bush) a évincé de ses terres ; dans Chicken Run, les poules s’unissent pour renverser un couple diabolique de fermiers, les Tweedy, et s’échappent de l’exploitation pour sauver leurs peaux ; dans Babe, les moutons se soulèvent pour résister à un chien de berger autoritariste ; et dans Le Monde de Nemo, Nemo se retrouve à la tête d’une rébellion de créatures marines contre les pêcheurs.
Chacun de ces films révèle l’articulation entre la queerness d’un côté, et l’ajointement du personnel et du politique de l’autre : la monstruosité dans Shrek, la déficience dans Le Monde de Nemo, et la dysphorie d’espèce dans Babe figurent les effets pernicieux de l’exclusion, de l’abjection et de l’exil qui se produisent au nom de la famille, de la domesticité et de la nation. La beauté de ces films tient à ce qu’ils ne craignent pas l’échec, ils ne privilégient pas le succès et ils ne donnent pas l’image des enfants comme des pré-adultes ou comme des adultes en devenir, mais comme des êtres anarchiques aux logiques temporelles étranges et incohérentes. […]
Ginger la poule, Dory le poisson et Babe le cochon sont comme ces athlètes qui finissent quatrièmes : elles nous rappellent qu’on peut être puissante en se trompant, en perdant, en échouant, et que tous nos échecs combinés pourraient bien suffire, si nous les pratiquons avec suffisamment d’insistance, pour renverser les vainqueur·es. Laissons le succès et ses prouesses à la droite républicaine, aux managers du monde, aux stars de la téléréalité, aux couples mariés et aux conductrices de 4×4. L’idée de pratiquer l’échec nous conduira peut-être à découvrir notre geek intérieur, nous appellera peut-être à réussir un tout petit peu moins bien qu’on ne le pourrait, à ne pas être à la hauteur, à être distraites, à faire des détours, à trouver une limite, à perdre notre chemin, à oublier, à nous garder de la tentation de la maestria et, avec Walter Benjamin, à reconnaître que « l’empathie avec le vainqueur bénéficie inévitablement aux maîtres du moment13. » Les perdantes d’aujourd’hui sont les petites-filles de toutes celles qui ont perdu avant elles. L’échec aime la compagnie.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Morgan Labar & Romain/Emma-Rose Bigé,
avec l’aide délurée de Lyne Salvi, Nicolas Jourdan, Élodie Rougeaux, Florian Bondy, Marguerite Maréchal & Velvet Aubry,
et quelques autres non-identifié·es
1 Cet article est composé à partir de la traduction de deux passages de l’introduction et du chapitre 3 de The Queer Art of Failure, Duke University Press, 2011.
2 Elizabeth Bishop, Poems, Prose and Letters. New York: Library of America, 2008, p. 166-167.
3 Moten, Fred, and Stefano Harney. « The university and the undercommons: Seven theses. » Social Text, vol. 22.2 (2004), p. 112 et Multitudes no 79.
4 Ibid., p. 113.
5 Ibid.
6 Scott, James C., L’œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Ruchet, Paris, La Découverte, 2021.
7 cf. Spade, Dean. « Documenting gender. » Hastings LJ, vol. 59 (2007).
8 Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press, 2008.
9 Hartman, Saidiya V. Scenes of subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America. Oxford University Press, 1997.
10 Muñoz, José Esteban. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: NYU Press, 2010; traduction française par Alice Wambergue, à paraître : Cruiser l’utopie : l’après et ailleurs de l’advenir queer, Paris: Brook éditions, 2021.
11 Sandage, Scott A. Born Losers. Harvard University Press, 2009.
12 Fourth, le nom de la série, renvoie également pour Moffatt au « quatrième monde » de la culture aborigène : une histoire d’art perdu et effacé, l’histoire d’un peuple détruit par le succès des colons blancs.
13 Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire » (1940), Œuvres, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, 2000, vol. 3, p. 432-433.