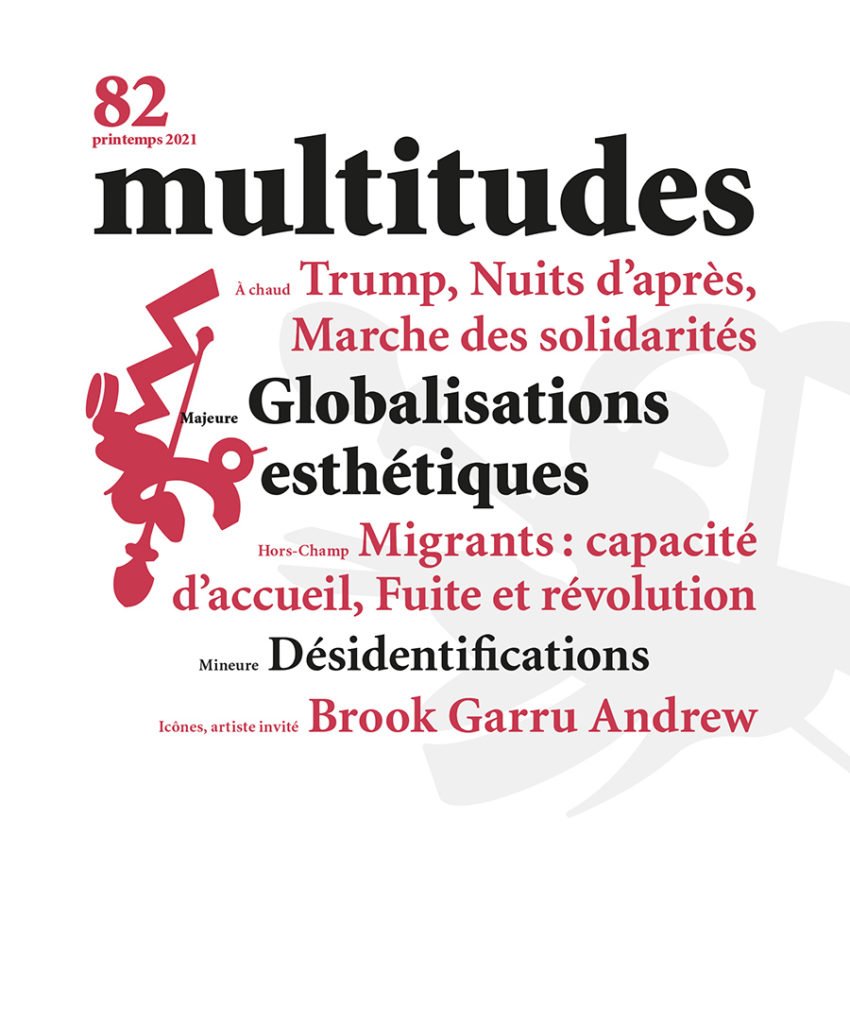En 2014, Facebook proposait 52 identifications de genre ou d’orientation sexuelle à qui voulait s’y inscrire1. Les conclusions qu’on peut en tirer sont pour le moins ambiguës. D’un côté, on ne peut que célébrer la prolifération tentaculaire de tant de noms pour se dire, et la manière dont cette multiplication complique singulièrement l’idée qu’on pourrait se faire de la binarité des genres (homme/femme) et des orientations (homosexuelles/hétérosexuelles). De l’autre, on peut s’interroger sur la continuité entre les catégories proposées aux usagères de Facebook et celles que la médecine du XIXe siècle invente pour pathologiser les orientations non-hétérosexuelles, c’est-à-dire, non-vouées à l’utéro-reproduction de la nation à un moment, celui du premier capitalisme industriel, où les enjeux populationnistes deviennent le socle des biopolitiques européennes. De fait, comme dans toute inscription à un registre, la vertu des identités qui se proposent (sur Facebook comme ailleurs) est d’abord policière : elle permet d’exercer un certain contrôle en fonction duquel les individus policés sont susceptibles d’être regroupés et ciblés par différents appareils de capture allant des dispositifs de surveillances psychopathologiques aux marketings publicitaires.
Classification
Publiée en 1889, la Psychopathia Sexualis de Richard von Krafft-Ebbing signait les débuts de cette sexologie policière en recensant une multitude d’investissements érotiques où les Lesbiennes, les Déféminisées (les butchs ?), les Homosexuels et les Coquets (les trans* MtoF ?) côtoient les Nécrophiles, les Cannibales et les Tortionnaires d’animaux. D’où vient cette passion contemporaine pour la catégorisation de toutes les spécificités des formes corporelles, des permutations de genres et de la multiplicité des désirs ?
Dans Trans*, le théoricien queer Jack Halberstam situe le projet de classification exhaustive des sexualités humaines dans la ligne de la botanique coloniale du XVIIe siècle, et de sa passion pour nommer la prolifération désordonnée d’êtres inconnus. Comme les botanistes arrivant dans le « Nouveau » Monde se retrouvent dépourvus, dans leurs langues vernaculaires européennes, pour nommer les espèces de plantes qu’ils rencontrent et se tournent vers le latin pour penser cette « nouvelle » nature sauvage (plutôt que de se tourner vers les autochtones, supposé·es inaptes au langage ou à la rationalité scientifique), de même, les sexologues se sont mis·es à ordonner le Continent des Paraphilies (et Autres Formes Déviantes de l’Amour) que l’impératif utéro-reproducteur imposé aux États-nations par le productivisme de la Révolution industrielle venait de mettre au jour2.
Remarquablement absente des 52 dénominations proposées par Facebook, l’hétérosexualité est l’angle mort de ces multiples identités : ne sont requises de s’identifier que celleux qui n’obéissent pas à la cishétérosexualité obligatoire et au système binaire des genres. Autrement dit, tel est le paradoxe : l’identité (de genre, d’orientation sexuelle, mais aussi, de race, d’ethnicité, de nation), c’est toujours celle des autres – et c’est sans doute pourquoi celleux qui sont du côté du « même » (les nostalgiques de « l’avant » ou de la pureté raciale) se lamentent sans cesse sur leurs « identités malheureuses ».
Du point de vue de celleux qui sont considérées comme autres et sommées de s’identifier au registre policier, une stratégie courante, à la fin du XXe siècle, a consisté à se réapproprier positivement cette identification obligatoire et à la retourner en étendard. Telle est la logique des identity politics : revendiquer la catégorie générée par et pour la domination (femmes, sorcières, pédés, gouines, queers, noir·es, brun·nes, crip…) afin d’organiser la lutte autour de l’expérience spécifique de l’oppression et des cultures qui ont émergé pour lui faire barrage. Tel est aussi leur piège : en suivant les cartographies patriarco-coloniales d’identités qui n’ont jamais existé que dans l’esprit de celleux qui voulaient les éradiquer, « les politiques identitaires, loin de démanteler les régimes d’oppression raciale, sexuelle ou de genre, ont fini par renaturaliser et même intensifier les différences3. »
Au cours de ma vie (trente-trois ans), on m’a considérée et parfois j’en suis venue à me considérer comme petite fille (je cachais mon pénis à l’échographie), petit garçon, homme, hétéro, homo, bi, poly, mec cis pro-féministe, homme gay, pédé, en manque de vagin, monsieur, mademoiselle, madame, lesbienne, personne non-binaire, personne trans. Chacune de ces dénominations appartient ou flirte avec un régime discursif pathogénique organisé autour d’une question reproductive à laquelle j’ai pourtant décidé de ne pas prendre part. Comment s’en sortir ?
Désidentification
La proposition, pour cette Mineure, est d’aller chercher aux différentes stratégies élaborées dans le champ des études queer pour penser depuis et avec une des alternatives opposées au système genre/genre : la désidentification. Face à un système policier qui demande à chacune, y compris au sein des militances LGBTQI+, de s’identifier avant de parler, la désidentification invite à refuser la lisibilité, à embrasser la dés/orientation sexuelle, à revendiquer l’oblique. Le mot vient de l’historien de l’art cubain émigré aux États-Unis José Esteban Muñoz, qui l’utilise pour désigner ces artistes queers noir·es et latinx qui ont développé des techniques pour ne pas répondre à l’injonction institutionnelle à produire un art « ethnique » ou estampillé « queer ». Mais on peut en généraliser l’idée à tous les actes, à toutes les pratiques, à toutes les manières d’exister par lesquelles, face à la question de l’Inquisiteur : homosexuelle ou hétérosexuelle ? homme ou femme ? La seule réponse qui s’impose est : Non.
De fait, Muñoz empruntait déjà le concept de désidentification à Teresa de Lauretis, qui elle-même l’employait (dans un trafic de signifiants coutumiers des études féministes et des études en genre) pour décrire le slogan de Monique Wittig selon lequel « la lesbienne n’est pas une femme », c’est-à-dire que l’homosexualité féminine pouvait être conçue comme une position politique de rejet de l’assignation à un genre et aux rôles associés. Teresa de Lauretis définit cette attitude comme une pratique excentrique de la subjectivité, caractérisée par un double déplacement : « d’abord, le déplacement psychique de l’énergie érotique sur une figure qui excède les catégories de sexe et de genre, figure que Wittig appelle “la lesbienne” ; ensuite, l’auto-déplacement ou la désidentification du sujet vis-à-vis des attentes culturelles et des pratiques sociales liées aux catégories de genre et de sexe4. »
Fred Moten et Stefano Harney, dans Les sous-commun*es, appellent cela le « droit premier », c’est-à-dire le droit de refuser ce qui nous a été refusé, et notamment le droit de refuser les droits (au mariage, à l’adoption, à la propriété) qui nous ont été refusés, car ils sont souvent des moyens pour « spéculer sur certaines manières d’être ensemble et demander aux gens de les traduire afin, en dernière instance, de les mettre au service du capital5. » Cela ne veut pas dire que, devant le choix imposé entre se positionner pour ou contre le mariage gay, il faudrait le refuser sous prétexte que l’identification des « homosexuel·les » est une technique policière. Comme dit à nouveau Jack Halberstam, « si on ne te laisse le choix qu’entre « pour » ou « contre » [le mariage gay], il est sûrement mieux avisé de te prononcer pour6. » Mais à côté de ce (faux) choix, il faut aussi lutter pour le droit à ne pas être identifiées comme homosexuelles ou hétérosexuelles, hommes ou femmes, sous prétexte que de telles identifications devraient nous permettre d’accéder à certains droits7.
Les différent·es auteur·ices traduit·es à l’occasion de cette Mineure (l’historien de l’art José Esteban Muñoz, la physicienne quantique Karen Barad, les théoricien·nes queer Sara Ahmed et Jack Halberstam) se sont fait une spécialité de relever ce qui, dans les pratiques et les modes d’existence queer, met en jeu des stratégies de désidentification. Il ne s’agit en aucun cas de la romantiser (ce n’est pas toujours un choix que d’être « lue » dans l’espace social comme illisible ou étrange) ni de l’héroïser (nous n’avons pas besoin d’héroïnes, mais de luttes collectives). Il s’agit plutôt d’y voir, a maxima, un cas particulier de ce que James C. Scott a appelé, dans La domination et les arts de la résistance, des « armes des faibles8 », c’est-à-dire, tout un ensemble de stratégies à peine visibles mises en place par certaines sociétés et par certaines personnes pour échapper à la main-mise de l’État : oralité (des traditions), illisibilité (des comportements), fugitivité (des habitats), inefficacité (du travail), lenteur (à la réponse), auto-sabotage, désorientation, désintérêt. La désidentification fait partie de ces manières d’être en appositionalité par rapport à l’hétéropatriarcat : pas tellement contre, mais plutôt obliquement, de biais, autant que possible, si c’est seulement possible, en tous cas pour quelques instants qu’il s’agit d’apprendre à mieux voir et à mieux sentir.
Dissidences
Chacune à leur manière, les autrices traduites dans cette Mineure nous proposent de pratiquer des sciences humaines « indisciplinées », c’est-à-dire des manières de porter notre attention à des « mauvais objets », comme les dessins animés pour enfants, de Bob l’Éponge au Monde de Nemo dont les sagesses émaillent L’art queer de ne pas réussir de Jack Halberstam, mais aussi des manières d’être attentives, comme la physicienne quantique Karen Barad, à comment certains phénomènes physiques nous apprennent à déjouer les notions normatives et binaires que nous pouvons projeter sur les êtres autres qu’humains. L’intérêt de ces chercheur·euses se porte ainsi sur des formes mineures, marginales de percevoir et d’habiter le monde, qui nous enseignent à désorienter les lignes et les trajectoires hégémoniques. Elles ne le font pas par esthétisme, mais par conviction politique, pour réfléchir à ce qui dans l’expérience queer ouvre sur de nouvelles alliances où les identifié·es du système policier-politique identitaire peuvent se rejoindre dans le besoin et la pratique commune de désobéissance à l’injonction dont la seule commande est finalement le Narcissisme individualiste et sa formule identitaire : Moi=Moi. Certaines personnes non-binaires, en langue anglaise, utilisent le pronom pluriel they pour se désigner sans passer par les genres féminin ou masculin, ni par leur agglutination (comme dans le français iel). Ce they est un pronom de la multitude qui fait aussi alternative au Je majuscule (I) : une manière de signaler un refus du moi-unique pour s’ouvrir aux légions qui nous habitent. De la même manière, la désidentification ouvre, chez nos auteur·ices, sur des aventures toujours collectives, où l’échec apparent à rentrer dans les cadres, l’oblique, l’étrange, ménage des manières non-planifiées d’être ensemble.
De ce point de vue, ce qui est frappant, c’est la manière dont nos autrices étudient leurs questions : non pas tellement comme des objets que comme des occasions pour (s’)apprendre à raconter les histoires de modes d’existence alternatifs, des occasions pour changer le genre (littéraire) des récits par lesquels on se raconte9. La figure de Nemo (du film pour enfants Le monde de Nemo) décrite par Halberstam est un bon exemple de cette opération : petit poisson crip (une de ses nageoires est atrophiée) au papa veuf et queer (il s’agit d’un poisson clown, et comme dans la vraie vie, si la femelle meurt, le mâle joue le rôle de mère), Nemo est un étrange héros qui passe son temps à demander de l’aide. Sa faiblesse et son manque de conformité lui donne ainsi une force particulière : la capacité à créer des alliances révolutionnaires (le film se conclut sur une grande échappée des poissons hors du zoo/aquarium menée par Nemo et sa drôle de « famille » décomposée/recomposée). En ce sens, Nemo donne une bonne image de la dialectique de la dissidence : les êtres construits/jugés comme dissidents (les poissons à nageoire atrophiée, comme Nemo ; mais aussi les êtres socialement inacceptables, comme sa compagne de route Dory, figure dont on s’attend à ce qu’elle devienne une mère de substitution, mais qui, atteinte de troubles de la mémoire, d’instant en instant, ne cesse d’oublier où elle se trouve, et oblige donc Nemo à inventer une parenté/amitié décalée par rapport à ce que les schémas habituels de la famille nucléaire nous inviteraient à penser), c’est-à-dire les êtres jugés comme nulle part à leur place, introduisent une brèche dans le monde qui, si suffisamment de gens s’y engouffrent, finit par créer un alter-monde.
Il faut une certaine générosité, et une certaine insistance, et une certaine désorientation dissidente du regard pour lire cette histoire dans Le Monde de Nemo, et pour faire de Nemo un poisson-clown dissident capable de créer un mouvement collectif révolutionnaire. Appelons cette obstination à lire des actes de résistance à l’hégémonie dans les plus petites dissonances par rapport au système sexe/genre une pratique dissidente de la théorie : des genres d’enquêtes, des genres de disciplines elles-mêmes rendues dissidentes par les savoirs-situés de leurs autrices, et voyons dans les méthodes mises en place par nos théoricien·nes autant de manières de s’exercer à détourner les histoires de leurs cours hétéro-obligatoires.
Queer
Un concept rassemble nos auteur·ices, celui de queer qui sert d’étiquette universitaire à désigner, dans les études anglo-saxonnes, leurs domaines de spécialité. Un point d’histoire lexicale s’impose à son propos, qui nous permettra de préciser les enjeux de cette Mineure.
On peut commencer par rappeler que depuis le début du XXe siècle, à l’oreille anglo-saxonne, le mot queer a principalement la valeur d’une insulte employée pour désigner les sexualités jugées déviantes. Il est en ce sens un équivalent de mots français tels que « pédé » ou « gouine », mais sans distinction de genre ou de sexualité. Au début des années 1980, la poétesse et militante lesbienne chicana Gloria Anzaldúa est l’une des premières à retourner positivement l’insulte en revendication, en associant le queer à la figure de la mestiza, et à tous·tes les créatures hybrides qui vivent « sur la frontière » et troublent la partition coloniale des genres et des États-nations. Un de ses essais-poèmes autobiographiques, « La Prieta », paru dans une collection d’« écrits de femmes radicales de couleur », se termine ainsi par un appel à l’alliance : « Nous sommes les groupes queer, celleux qui ne sont à leur place nulle part, ni dans le monde dominant, ni dans nos propres cultures10. » La mestiza queer d’Anzaldúa situe le queer à l’intersection des enjeux de race, de classe et de genre en considérant comment celleux qui répondent mal aux critères d’identification courent régulièrement le risque d’être mis·es aux arrêts : « Les prohibé·es, les défendu·es et les interdit·es, voilà les habitant·es de la frontière. Los atravesados y ont leur résidence : les yeux-bridés, les pervers·es, les queer, les fauteurs de trouble, les bâtard·es, les mulatos, les sang-mêlé, les morts-vivants ; en un mot, tous·tes celleux qui débordent, qui dépassent ou qui traversent les confins du “normal”. Qu’iels aient leurs papiers ou pas, qu’iels soient Chicano·as, Indien·nes ou Noir·es, les gringos du sud-ouest des États-Unis voient dans celleux qui vivent aux frontières des intrus·es, des étranger·es. N’entrez pas : les intrus·es seront violé·es, mutilé·es, étranglé·es, gazé·es, tué·es11. » Comme les désidentifié·es de José Esteban Muñoz, les monstres métisqueer d’Anzaldúa sont celleux qui résistent aux schèmes patriarco-coloniaux de l’identification policière et qui parfois y risquent leur vie.
Suivant la brèche ouverte par ces revendications féministes décoloniales, le mot queer commence à être investi positivement par des groupes militants états-uniens tels que Queer Nation ou les Lesbian Avengers qui naissent dans le sillage du féminisme lesbien (la « menace mauve » qui hantait les rangs du féminisme hétéro) et des réponses anarchistes aux nécropolitiques de la pandémie de sida12. Le mot passe alors du statut d’adjectif à celui de substantif (pour désigner « les » queer), voire de verbe (pour désigner l’opération de queeriser, de détourner, de faire dévier). C’est ce que dit un slogan célèbre de Queer Nation : Not GAY as in HAPPY, but QUEER as in FUCK YOU 13! Le concept s’est rapidement diffusé dans le champ universitaire états-unien, où il sert à désigner des « études queer » dès les années 1990, et il apparaît également dans d’autres pays et dans d’autres langues où divers·es auteurices, activistes et théoricien·nes (comme, en France, Paul B. Preciado, Sam Bourcier ou encore Guillaume Dustand) ont repris le mot et le diffusent sans traduction (ce qui bien sûr est une manière de traduire), y voyant l’occasion d’un cri de ralliement autour d’une « identité Non-Identitaire, Non-directive, Non-excluante14 ;::?! ».
Dans ces divers usages, on retrouve un effet lexical lié au statut étrange du mot queer : celui d’être « un adjectif sans nom à modifier, un adjectif déguisé comme un nom15 », c’est-à-dire la modalisation d’une chose qui n’est elle-même jamais nommée. C’est ce que dit David Halperin, l’auteur d’une « hagiographie gay » de Michel Foucault, lorsqu’il affirme que « le queer ne se réfère à rien de particulier. C’est une identité sans essence. Queer, en ce sens, démarque non pas une positivité, mais une position vis-à-vis du normatif – position qui ne se restreint pas aux lesbiennes et aux gays, mais qui est en fait disponible pour toute personne qui se sentirait marginalisée en raison de ses positionnements sexuels16. » Autrement dit, queer est moins une orientation sexuelle qu’une pratique de désorientation à l’égard du genre et de la sexualité. C’est en ce sens précisément qu’on pourrait traduire le mot queer par désidentifié·e, déviant·e ou dissident·e du système sexe/genre : non pas pour pointer des populations ou des identités, mais au contraire pour suggérer l’existence d’une multiplicité de stratégies de déviance ou de détournement à partir desquels des formes politiques et des formes de vie se déploient. C’est ainsi qu’on peut comprendre la manière dont Paul B. Preciado se définit comme « dissident du système genre-genre » (une traduction, par la pratique plutôt que par l’identité, de l’identification queer) : « Je ne suis pas un homme je ne suis pas une femme je ne suis pas hétérosexuel je ne suis pas homosexuel je ne suis pas bisexuel. Je suis un dissident du système genre-genre. Je suis la multiplicité du cosmos enfermée dans un régime politique et une épistémologique binaire, et je crie devant vous17. »
Non moins attachés à défaire l’épistémologie binaire dans laquelle la multiplicité du cosmos tend à être enfermée, les textes qui suivent nous donnent des instruments pour renommer les pratiques fugitives qui refusent les dogmes du genre et les alliances queer qu’elles sont susceptibles de générer.
1 Sam Bourcier, « Le dictionnaire des 52 nuances de genre de Facebook », Slate.fr, 17 février 2014. Aujourd’hui en 2021, on a le choix entre « Femme », « Homme » et « Personnalisé », où l’on peut alors choisir son pronom : « Elle », « Lui », « Neutre » et décrire son « Genre (facultatif) » dans un champ à entrée libre.
2 Jack Halberstam, Trans*. A Quick A Quirky Account of Gender Variability. University of California Press, 2017. cf. aussi en français la récente étude de Clovis Maillet, Les genres fluides. De Jeanne d’Arc aux Saintes trans, Paris, Arkhè, 2020.
3 Paul B. Preciado, « Inexistants », Libération, 31 janvier 2020. Cela n’étant pas dit pour condamner par principe les personnes qui, pour des raisons personnelles ou politiques, éprouvent le besoin de s’identifier, mais pour pointer les dangers dialectiques que chacune d’entre nous encourrons à continuer de faire circuler les catégories de l’oppression.
4 Teresa de Lauretis, « When lesbians were not women » (2001), repris dans Figures of Resistance. Essays in Feminist Theory, Urbana et Chicago, University of Illinois Press, 2007, p. 73.
5 Fred Moten et Stefano Harney, The Undercommons. Fugitive Planning and Black Study, Minor Compositions, 2013, p. 124.
6 Jack Halberstam, « The Wild Beyond » in Fred Moten et Stefano Harney, ibid., p. 8.
7 Pour une analyse de la pression homonormative, c’est-à-dire de la normalisation des cultures queer par intégration à la culture néolibérale et au modèle du couple hétérosexuel, cf. Lisa Duggan, The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy, Boston, Beacon Press, 2003. Prolongeant ces travaux pionniers, on peut aussi lire la remarquable étude d’un cas de récupération de l’identité homosexuelle par le nationalisme états-unien à la suite des attentats du 11 septembre 2001 proposée dans le livre de Jasbir K. Puar, Homonationalisme : politiques queer après le 11 septembre, traduit de l’anglais (États-Unis) par Judy Minx et Maxime Cervulle, Paris, Amsterdam, 2012.
8 James C. Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Ruchet, Paris, Amsterdam, 2008.
9 Dans le même sens, l’activiste et universitaire transféministe Sandy Stone appelait à considérer les trans* « non plus comme une classe ou un “troisième genre” (third gender) problématiques, mais plutôt comme un style (genre) d’écriture ou d’existence – un ensemble de textes incarnés dont les potentiels de perturbation productive de sexualités structurées et de spectres de désirs reste à explorer. » (« L’Empire contre-attaque : un manifeste posttranssexuel » (1987), traduit de l’anglais (États-Unis) par Kira Ribeiro, Comment s’en sortir ?, no 2, automne 2015.)
10 Gloria Anzaldúa, « La Prieta », in Cherríe Morraga et Gloria Anzaldúa (dir.), This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color, New York (NY), Kitchen Table Press, 1981, p. 233.
11 Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco (CA), Aunt Lutte Books, 1987, p. 3.
12 Fray Baroque et Tegan Eanelli (dir.), Vers la plus queer des insurrections. Bashback!, une anthologie (2011), traduit de l’anglais (États-Unis) par Diabolo Nigmon et Decibel Espanto, Paris, Libertalia, 2016.
13 Queer Nation, Queer Read This!, New York, 1990; traduction française disponible sur https://remuernotremerde.poivron.org/uploads/2020/01/queer_nation_manifesto_ppp.pdf
14 Guillaume Dustan, « Queer », e.m@le, no 66, 1999, cité dans Isabelle Alfonsi, Pour une esthétique de l’émancipation : construire les lignées d’un art queer, Paris, B42, 2019 et disponible sur http://treize.site/index.php/2020/cinq-films-de-guillaume-dustan
15 Mel Y. Chen, Animacies. Biopolitics, Racial Mattering and Queer Affect, Duke University Press, 2012, p. 69.
16 David M. Halperin, Saint Foucault, traduit de l’anglais (États-Unis) par Didier Éribon, Paris, EPEL, 2000, p. 75-76. Traduction modifiée.
17 Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus. Chroniques de la traversée, Paris, Grasset, 2019, quatrième de couverture.