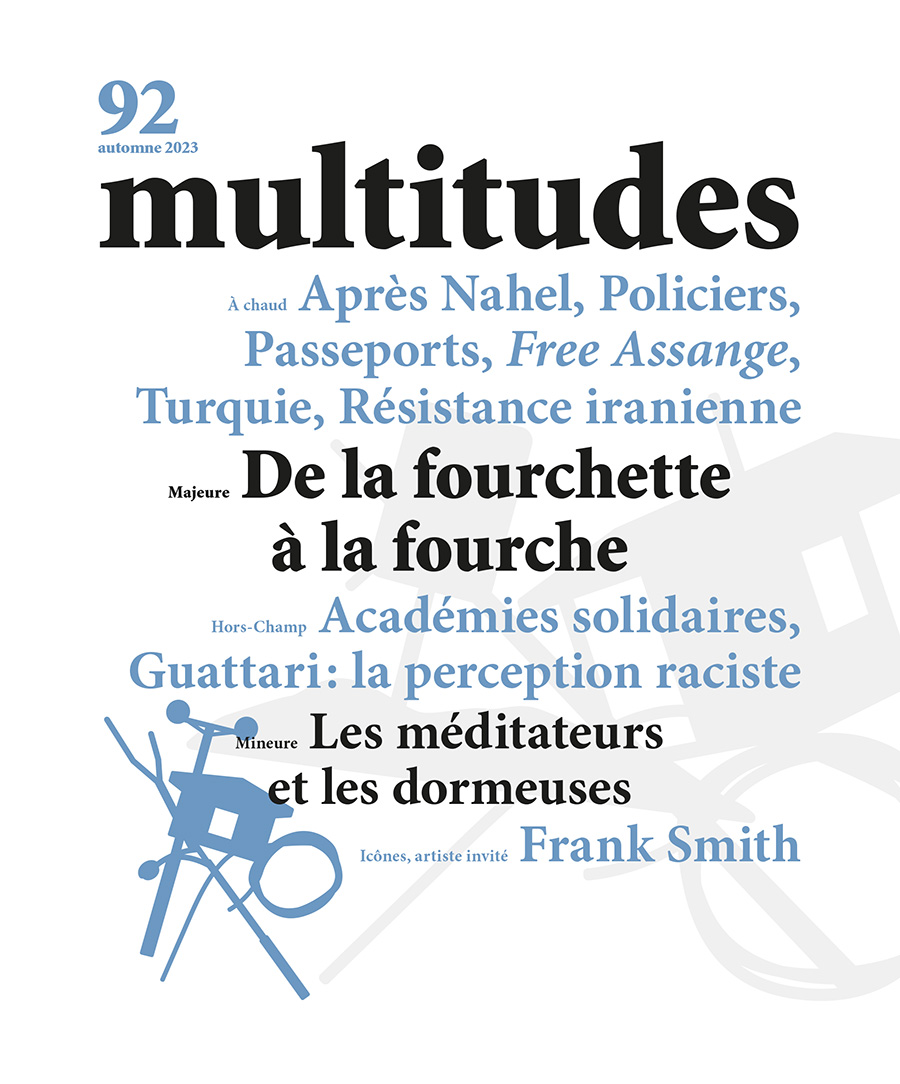La puissance des céréales
Spéculations, famines, guerres
Tous les empires dans l’histoire ont pu faire ce constat : la puissance n’est pas seulement une question d’armement, mais aussi de contrôle des céréales. Elles ont constitué, jusqu’à l’essor de la consommation de viande, le carburant du travail humain. Cet article permet une charnière bienvenue entre histoire et actualité (« pénurie » et déstabilisation des marchés mondiaux des céréales avec la guerre d’Ukraine). Il retrace l’histoire longue des marchés des céréales dans le monde, les successions des politiques visant leur contrôle (stockage, contrôle des prix, blocage des approvisionnements) ou donnant libre cours à la spéculation, les effets de ces cycles sur les famines et les guerres. Ce qui spécifie le « nouveau capitalisme agraire » contemporain depuis les années 1980, c’est la spéculation totalement dérégulée sur les céréales : marchés virtuels, futures, accaparement des terres, contrôle du vivant et monopoles des semences, entrée de nouveaux acteurs comme banques, fonds de pension, hedge funds. L’auteur propose en conclusion quelques options politiques pour lutter contre cette hégémonie.
The Power of Cereals
Speculation, Famines, Wars
Every empire in history has recognised that power is not just a question of armaments, but also of control over cereals. Until the rise of meat consumption, grain was the fuel of human labour. This article provides a welcome link between history and current events (the “shortage” and destabilisation of world grain markets with the war in Ukraine). It traces the long history of world grain markets, the succession of policies aimed at controlling them (storage, price controls, blocking supplies) or at giving free rein to speculation, and the effects of these cycles on famines and wars. The “new agrarian capitalism” that has emerged since the 1980s is characterised by totally deregulated speculation in cereals: virtual markets, futures, land grabbing, control of living organisms and seed monopolies, with the entry of new players such as banks, pension funds and hedge funds. In conclusion, the author proposes some political options for combating this hegemony.
Disponible sur le site de notre partenaire CAIRN