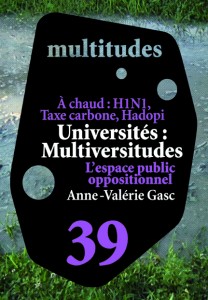« Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse. Je vous le dis : vous portez encore en vous un chaos. Malheur ! Les temps sont proches où l’homme ne mettra plus d’étoile au monde. Malheur ! Les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici !
Je vous montre le dernier homme. »
F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.
Enfant-pharaon d’une Égypte post-humaine à venir, dormant dans son sarcophage d’oxygène, momie aux lambeaux de peau morte comme des bandelettes d’homme invisible ou comme des mues de reptile, Narcisse fétichiste au gant blanc et au déhanché auto-érotique de vierge pubère, petit voyou aux yeux de faon, amoureux aux yeux fauves, fée clochette et loup-garou hurlant à la lune, androïde au pas robotique qui soudain prend vie, squelette décharné qui vainc l’attraction terrestre dans le miracle de la danse, famélique corps christique d’une grand-messe carnavalesque, idole sacrificielle devenue homme infâme, monstre et martyr, enfant-lune solitaire, enfant-bulle, enfant-roi, enfant.
La force infantile éternelle d’une vie n’est pas de savoir rester jeune, de retomber en enfance, ni surtout de courir après une enfance perdue ou volée, mais de devenir enfant. Michael Jackson n’a pas joué à être enfant, pas plus qu’il n’a voulu être blanc. Il est tellement facile de grouper des symptômes sous un nom tout fait qui « colle » (« Peter Pan »), d’invoquer la violence paternelle pour expliquer le fantasme de l’enfance perdue, d’invoquer la fuite du père humiliateur pour expliquer la névrose chirurgicale et le blanchiment de peau, en oubliant ainsi ce que ces symptômes comportent en même temps de liberté créatrice et de singularité. Narcissisme, anorexie, infantilisme, fétichisme, les pathologies ne sont pas que des fixations névrotiques, mais les signes distinctifs d’une santé bizarre, qui tourne ses poisons, se fortifie de ce qui la blesse, s’aiguise en apprenant à aimer ses souffrances. Les interprétations rétrospectives les plus morbides ne lâchent leur proie que quand, ayant réduit toute force de vie aux angoisses d’une petite affaire œdipienne, elles croient avoir tué en elle l’enfance éternelle. La gravité dont certains mots ou regards d’enfant sont empreints est adulte comme seul un enfant peut l’être. Réciproquement, Michael Jackson devient enfant comme seul un adulte peut le faire. Son chant inouï a une rage mêlée de sanglots, oscille entre la gravité adulte de l’enfant et la mièvrerie infantile de l’adulte.
De même, il devient blanc, non pas seulement ni même essentiellement par honte d’être Noir ou d’être le fils d’un ogre à qui il ne veut pas ressembler en vieillissant, mais d’une étrange et inquiétante manière qui ne peut appartenir qu’à un Noir, et en trouvant un point de surfusion entre les couleurs. Au moins autant qu’il soumet le rythme vivant de l’âme noire à la pulsation métronomique mécanique de l’Amérique blanche, il saisit la danse et la sexualité au point nègre d’indiscernabilité où elles se fondent l’une à l’autre. Étrange et froide sexualité d’automate détraqué. Le pelvis lascif d’Elvis est tout à coup pris de saccades spasmodiques, électrisé par une danse rituelle de possession qui semble une surchauffe de robot aux séquences enchaînées aléatoires. Chaque pas est pesé, anticipé, répété mille fois, calculé, programmé. Il pleure en coulisses quand il croit avoir raté sur scène un mouvement pour un dixième de seconde. De même, les halètements, les cris, les soupirs, les tics et les crispations qui entrecoupent le flux mélodique de sa voix sont maîtrisés, tenus comme la corde dans la tension de l’arc. Mais la belle apparence apollinienne de Michael Jackson est perpétuellement tremblée, toujours sur le point de se déchirer sous un coup de griffe. Michael Jackson ne devient pas blanc sans qu’en même temps la blancheur elle-même soit prise de chair de poule et s’ensauvage en Michael Jackson. Sa dépigmentation est en même temps une sorte de devenir-albinos de la négritude plutôt qu’un renoncement ou un reniement honteux.
De manière générale, son mode d’être est le morphing, comme il le conscientise lui-même techniquement dans le vidéo-clip du tube Black or white. Il danse en cercle avec les tribus africaines, les Peaux-Rouges, les Chinois, les Hindous, les cosaques russes. On peut l’accuser d’avoir vendu l’âme révoltée de la musique noire à la réaction blanche qui l’aseptise en se l’appropriant, d’être un suppôt du capitalisme mondialisé qui dévore les cultures dans l’abstraction, on peut ne pas se sentir appartenir à la pseudo-humanité atomisée qui le pleure. L’homme blanc a toujours été le véritable cannibale. Mais la critique méprisante suppose souvent à son tour la position normative d’une humanité de droit naturel et sûre de son identité, de son bon goût comme de son bon sens, qui ne sait pas se sentir troublée par la monstruosité, vitale aussi bien qu’esthétique.
Michael Jackson n’est certes pas le moins du monde révolutionnaire, mais sa vie est néanmoins, depuis son enfance, une lutte intense et perpétuelle avec le pouvoir tentaculaire qui l’enlace, pour utiliser et détourner ses forces sans jamais les renverser. Il n’a pu survivre à cette pieuvre qu’en mourant sans cesse à lui-même, déchirant plusieurs fois la chrysalide de son corps. Michael Jackson est une créature du devenir, exacerbant toutes les ambiguïtés de la mutation échevelée qu’il incarne : devenir-enfant, devenir-femme, devenir-animal, devenir-molécule d’oxygène, air pur exaltant dont il s’enivre, jusqu’à une évanescence, à un devenir-imperceptible qui est comme l’envers secret de son excès de visibilité. Disparaître par magie comme un courant d’air sous les draps de Billie Jean, fuyant la police et les photographes qui le pourchassent, partir comme un fantôme dont les pas de velours allument les pavés d’une rue déserte. Michael Jackson n’est pas une personne, mais un faisceau de devenirs qui se chevauchent et se fondent les uns aux autres dans un brouillard de gouttes. Plutôt que d’en faire une histoire ou un pitoyable roman familial, la sympathie qu’il inspire conduit à dresser la carte météo changeante de ses devenirs. Quelles sont les singularités pré-personnelles émises sous le nom de Michael Jackson ? Les images stylisées de lui-même (pochettes de disques, vidéo-clips, etc.) ne sont pas que des affiches publicitaires, mais esquissent une iconographie processuelle, en phase avec sa musique et avec toute sa vie.
Devenir enfant, ce n’est pas un fantasme. C’est arracher à son milieu des morceaux de placenta, les constituer en matière à expérimentation. Lors de son accident sur le tournage de la publicité pour Pepsi, après avoir été transformé en flamme dansante et tournoyante, la première chose que Michael Jackson réclame sur son brancard est son fameux gant à paillettes, comme s’il en avait besoin pour traverser la foule et l’épreuve du feu. Le gant est un pouvoir. La main y devient sorcière, se libère de l’organisme pour se laisser aller à des mouvements stochastiques. Il libère une puissance de vie qui était prisonnière en nous. Les enfants le savent : leurs masques, leurs déguisements ont une vertu talismanique. La force des jeux de mimicry n’est pas d’abord symbolique, mais réelle, matérielle. Avant de représenter des personnes ou des personnages complets, les accessoires de déguisement, « objets transitionnels » partiels, valent par leurs propriétés texturales et affectives. La soie, le velours, ce sont des affects impersonnels : ça glisse sous les doigts. Le brillant des diamants incrustés est un affect, comme l’éclat et le tranchant d’une lame de couteau. Le fétichisme de Michael Jackson exprime ainsi un devenir-enfant, où le gant blanc et les chaussettes blanches libèrent magiquement la main et les pieds pour une danse où les parties du corps entrent et se composent dans de nouveaux rapports non organiques, sous lesquels il ne s’appartient plus à lui-même en personne. Quand il chante Billie Jean, ses pieds glissent tous seuls. Devenir enfant, c’est ainsi machiner son corps avec les suppléments prothétiques qui le dépossèdent de sa souveraine subjectivité. Mais le devenir-enfant de Michael Jackson est ambigu, car l’enfance est toujours menacée de s’éteindre dans la tristesse de l’imaginaire. La dérisoire forteresse Disney que Michael Jackson se construit à mesure qu’il se croit vieillir, l’enfance rêvée, de carton-pâte et de dessin-animé, étouffe la force vitale du devenir-enfant. L’enfance artificielle de Walt Disney est l’enfance fantasmée par l’adulte, chargée de ses angoisses et de ses frustrations narcissiques, l’enfance ressaisie par les forces réactives qui la plient à leur désir, œdipianisée, entièrement façonnée par l’Œdipe auquel elle croit échapper, tel Gros Nez croyant fuir son Père Ogre. Le devenir-enfant ne peut ainsi se maintenir vivant que quand il parvient à se conjuguer à d’autres flux moléculaires, à se marier avec d’autres devenirs auxquels il emprunte leurs forces autant qu’il leur prête la sienne, devenir-femme, devenir-animal.
Devenir femme, c’est extraire la jeune fille en fleur de son propre corps, de son genre, de sa sexualité, en volatiliser les particules à l’air libre. La Jeune Fille est processuelle, héraclitéenne, fleuve jamais le même, adolescente, petite fille, mec, femme-enfant, sainte intouchable, garce jouisseuse ou vierge de glace selon les heures et les volte-face de chaque instant. Michael Jackson trace sa diagonale entre les sexes, chevauche sa ligne sinueuse de transsexuation comme un balai de sorcière. Androgyne viril, voyou transgenre, criminel de velours, éromène gracile à la lèvre duveteuse, dirty Diana, l’enfant des rues n’en finit pas de muer et d’éclore sous les écailles de sa peau. Mais sous les yeux de biche de l’enfant et de la jeune fille, les yeux jaunes de la bête. Bambi, l’animal œdipianisé, dissimule les instincts sauvages de la panthère noire. La danse de rue donne forme à cette agressivité dont la fauve fierté n’a pas été domestiquée par l’Œdipe. On a raillé l’esthétisme masturbatoire de cette danse folle de son corps, aux caresses suggestives, mais sous ce narcissisme secondaire d’adolescent au miroir, on sent battre l’Éros autotélique triomphant de la Vie même. L’enfant et la jeune fille tournent dans le devenir, virent à la lune. Au fond, nous ne nous sommes jamais remis du choc provoqué par le vidéo-clip de Thriller, depuis lequel Michael Jackson a gardé pour nous la duplicité et l’inquiétante étrangeté de son personnage monstrueux. La transformation du loup-garou de la séquence introductive est le prototype du devenir-animal. Thriller a su utiliser et cristalliser les potentialités de l’image télévisuelle, produisant de l’événement à distance, de l’émotion collective virtuelle, sans communauté. Par une mise en abyme jubilatoire qui rend un hommage parodique au film d’horreur, le vidéo-clip dédouble Michael Jackson, à la fois acteur et spectateur de lui-même, le multiplie dans une série de transformations. Michael Jackson fait danser les morts-vivants. La danse est la puissance de vie par excellence, où les forces du chaos prennent corps, marchant au pas brisé de celui qu’elles travaillent intérieurement et qui les discipline dans un style nouveau. Zélateur du style, Michael Jackson invente en danse une langue qui parle sans rien dire, par bribes et fulgurances.
Pourquoi écrire maintenant sur Michael Jackson, alors que notre actualité est déjà saturée du bruit le plus assourdissant et le plus vulgaire ? Résister au présent, c’est apprendre à distinguer entre ses différentes virtualités déjà réelles sans être actuelles, lutter contre les virtualités négatives qui germinent en lui, aimer les virtualités affirmatives qu’il enveloppe. Michael Jackson est le symbole et le bouc-émissaire de toutes les hantises et les ambiguïtés de notre temps : exhibitionnisme et angoisse du vide, sexualité agressive refoulée et normativité, voyeurisme et cruauté, adoration et persécution destructrice de l’idole. Il est « Bambi Frankenstein », comme dit Jean-Hubert Gailliot, ou le « mutant solitaire » qui, par son exacerbation caricaturale de la folie de l’époque, dit une vérité sur notre monde. « Enfant-prothèse » comme dit Baudrillard, visage-emblème du transhumanisme en lequel s’exténue notre nihilisme, il incarne jusqu’à sa mort accidentelle par anesthésie notre fantasme prométhéen de négation de la nature humaine. En concert, il semble donner son corps en sacrifice rituel aux masses sous hypnose : « ceci est mon corps ». La pitoyable cérémonie de veillée funèbre retransmise à la télévision suggère qu’il serait mort pour nous, en rémission de nos péchés, annonçant on ne sait quel Salut post-humain. Il meurt pour que cette humanité meure, pour sauver la Terre. Roi bouffon de mardi-gras, Christ de polichinelle sacrifié pour rire comme on brûle Sa Majesté Carnaval sur son bûcher, on lui fabrique un rôle qui satisfasse notre avidité de culte.
De toute évidence, Michael Jackson ange réconciliateur de races n’est que l’alibi du capitalisme cannibale. Mais quelque chose cloche malgré le système : en haut de sa statue de la Liberté impérialiste, le visage osseux et dysharmonique du messie est celui du plus hideux des hommes, à la fois plein de l’orgueil démesuré de la créature-Dieu et pris d’un malaise vertigineux face à lui-même. Il sait encore assez se mépriser lui-même pour ne pas se satisfaire de ce qu’il est et se transformer, se laissant traverser par les forces du chaos pour enfanter des étoiles filantes de danse flamboyante. Il précède le dernier homme, contre lequel il lutte encore, dont il retarde l’avènement.
Plutôt qu’un avatar suicidaire du Christ, Michael Jackson est Mikaeel, ange d’Allah. Sa « conversion » tardive à l’Islam, partiellement censurée ou raillée par les médias, est pourtant un signe prophétique. On pressent déjà les levées de bouclier des apôtres républicains bien-pensants face aux accointances personnelles des Jackson avec Nation of Islam et, symétriquement, le rejet violent de cet hérétique américanisé par les islamistes « radicaux », djihadistes. Il est pourtant drôle de voir apparaître un tel simulacre d’Islam à l’heure de toutes les intolérances. Le masque noir chirurgical de Michael Jackson devient burqa. L’hygiénisme médical rejoint le rigorisme religieux, les idéaux ascétiques s’esthétisent. Il est certain que la burqa a coïncidé au mouvement le plus intime de Michael Jackson : devenir imperceptible, défaire son visage, devenir femme voilée, devenir fantôme anonyme, disparaître. Mais, en toute inconscience, cette conversion singulière est en même temps virtuellement porteuse d’un avenir universel : subvertir l’Islam pour une spiritualité du style, une esthétique de l’existence, porter le devenir-femme dans les « instincts virils » de l’Islam lui-même. L’aristocratie spirituelle à venir aura des lèvres de velours sous sa burqa.
À l’opposé de ces virtualités lointaines, sa mort a relancé la fièvre hystérique d’une industrie culturelle qui l’avait sacré roi pour capter le rayonnement de sa transcendance dans l’immanence de son réseau commercial et idéologique, en multipliant et en redistribuant les flux de capitaux dans toutes les veines du marché. L’image, l’aura, le mythe Jackson ont servi à la machine de caution de sainteté pour instituer son schème de fonctionnement et sa cadence frénétique. Chaque nouveau vidéo-clip depuis Thriller a été savamment fabriqué comme un événement, et chacune de ses apparitions comme une grâce messianique. La nouvelle poussée de fièvre est aujourd’hui mêlée de la mauvaise conscience pleurnicheuse d’un système qui s’est pris à son propre jeu, en voulant diaboliser et martyriser le dieu qu’il s’était fabriqué, dans une sorte de simulacre américanisé de sacrifice christique et de culpabilité. Mais en même temps, sous le cynisme nécrophile et coprophage d’un pouvoir qui se nourrit des déchets de son dieu mort, malgré les forces réactives qui s’emparent de cette mort pour faire de l’argent ou leur petit mea culpa hypocrite, on ne peut s’empêcher de sentir le pathétique d’une industrie à l’agonie qui se reprend à rêver de sa gloire passée, quand en réalité le disque meurt aujourd’hui avec Michael Jackson qui en a été le promoteur mondial, quand la nouvelle ère technologique et le nouveau dispositif de pouvoir gestionnaire qui s’installe peu à peu avec elle ne nous promettent encore aucune grâce et tendent plutôt à remplacer la mythologie par la consommation la plus vulgaire. Dans l’Égypte-fantôme universelle de Wacko Jacko, la transcendance pharaonique s’est résorbée dans l’immanence d’une Anarchie couronnée, où seule la multitude est reine : zig et zig et zag, des squelettes dansent un pas de lune en faisant claquer leur os. Sans chair, sans cartilage, sans nez, le squelette plastiné est de nerfs et de muscles. Toute la musculature affective écorchée vive se donne à la perfection de cette danse impossible, absurde, mime abstrait de clown blanc, rite narcissique qui ne célèbre rien, rien que le vide au-dessus duquel il nous suspend pour un instant de grâce funambulique. L’œuvre de Michael Jackson est d’avoir donné une innocence au spectacle carnavalesque de notre temps, une intensité d’existence à notre
inexistence même.