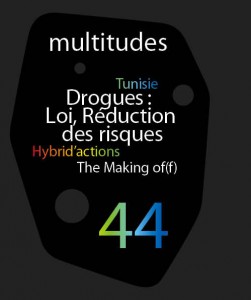Ce qui échappe à la pensée est l’objet d’étude du philosophe, ce qui échappe à la forme matérielle est ce que l’artiste recherche avant tout, ce qui échappe au mouvement est ce que le danseur essaye de mettre en acte, ce qui échappe au son du quotidien est la visée ultime du compositeur en musique…[1] L’œuvre échappe au réel et prend forme par un processus d’hybridation avec le virtuel, l’imaginaire, le possible : « ce qui échappe » est l’essence même de la création. Il est en effet indéniable qu’à l’intérieur de ce qu’on nomme « art contemporain » (terme ambigu, j’y reviendrai) se dessine une tendance visant à dépasser le réel, à faire de la création une recherche de l’insaisissable, au risque de brouiller les définitions terminologiques classiques et de constituer un nouveau régime d’expérience.
L’art se fabrique désormais grâce à une méthode d’épuisement : les formes établies sont reconverties, martyrisées, maltraitées, nivelées à un résidu d’existence où la survivance même de l’art semble en danger. Épuisé dans ses possibilités propres, l’art s’est vu menacé depuis longtemps. Les avant-gardes artistiques, avec Dada, le surréalisme et le constructivisme ont déclaré une guerre ouverte à l’art par son extension aux domaines mouvants de la vie, de la politique, de la dérision. Mais, à bien regarder, l’épuisement est la forme même de la création depuis toujours : Vermeer qui peint des scènes de la vie quotidienne, Velázquez dévoilant la présence du peintre dans un tableau, Léonard de Vinci inventant une nouvelle forme de clair obscur par la simple juxtaposition de couches de couleur, étaient déjà en train de distordre le sens de l’art par l’immanence de leur pratique. Pas d’art sans de controverse avec l’art, c’est là que gît le paradoxe de la liberté.
Échappée, épuisement, dépassement, brouillage, confusion, illimitation, voilà différentes manières de nommer le processus d’hybridation qui est au cœur des pratiques artistiques contemporaines. Mais, soyons attentif, cette tendance n’est pas entièrement destructive, puisqu’elle ne mène pas à l’annulation totale de l’art, mais au contraire à sa ressuscitation. Pour reprendre les termes d’Allan Kaprow, l’art se « con-fond » avec le non-art, ou la vie, dans une tentative d’estompage[2] qui évite tout rapport d’identité ; brouiller les limites, estomper les différences ne permet pas de parler d’une réelle « identité », ou d’une « identification » entre l’art et ce qui n’est pas de l’art, mais uniquement un rapport d’« indiscernabilité » ou d’hybridation. Contre l’identité, l’hybridation conçoit une con-fusion et non pas une fusion totale, une perturbation entre deux choses et non pas l’annulation réciproque de leurs différences. Ouvert désormais aux règles démocratiques de la vie courante, et de l’espace social, l’art sollicite la participation du spectateur, se détourne de l’activité productive de l’artiste, choisit des formes d’intervention anonymes et recourt souvent à des techniques hybrides, cela au risque même de ne plus être reconnu en tant qu’art.
La perturbation du contemporain
L’époque de l’art pour l’art est terminée. L’art se voue à des pratiques limitrophes, ayant un sens et une vérité qui sont externes à ses disciplines. Cette tendance contemporaine est à l’origine du flottement, voire de l’incompréhension, autour de la définition de « art contemporain ». Qu’est-ce qu’il y a de « contemporain » dans l’art d’aujourd’hui, si les pratiques qui le constituent sont souvent en réaction au passé ? Peut-on se limiter à donner une définition temporelle de l’art ? Car l’art, comme tout autre événement historique, pose le problème classique de la relation entre diachronie et synchronie (on ne pense pas de la même façon un événement pendant qu’on le vit et quand on le juge rétrospectivement). Ainsi, plutôt que de se restreindre à des critères de démarcation temporelle, l’art contemporain semble en réalité définir une tendance, une sorte de disposition intrinsèque à son propre dépassement, disposition héritée de l’idée d’avant-garde, que le terme « art contemporain » est venu remplacer. Prenant le relais de l’époque moderne, l’art contemporain vise à en dépasser certains critères : la dépersonnalisation de l’artiste, l’implication du spectateur, la déformation des objets, le détachement du régime représentationnel des images, etc. En raison de ce dépassement critique, il est tout à fait logique que l’art contemporain puisse aussi être nommé « art postmoderne ».
L’art contemporain désigne, d’un côté, un ensemble d’objets et de pratiques qui ne ressemblent plus à de l’art. De l’autre côté, il apparaît aussi comme un ensemble de significations accessibles uniquement par des spécialistes et des théoriciens. Par ces deux aspects, a priori opposés (démocratisation et élitisme de l’art), on peut saisir toute l’ambiguïté de cette terminologie : si un certain savoir théorique et un certain recul historique sont nécessaires pour comprendre les trajectoires de l’art récent, ce n’est pas pour pouvoir définir ce que l’art est mais plutôt ce qu’il n’est plus.
Cette hybridation de l’art avec le non-art vient se conjuguer au phénomène de l’interdisciplinarité. Désormais, il n’est plus besoin d’être peintre, plasticien, danseur ou sculpteur pour être reconnu comme artiste. Certes, il reste que la plupart des praticiens ont souvent reçu une formation artistique, mais les techniques sont désormais devenues hybrides, et l’interdisciplinarité semble même fonctionner comme une nouvelle discipline. Depuis la technique des collages et des assemblages jusqu’aux formes récentes des installations et des performances, l’art contemporain ne semble tenir qu’au dépassement des démarcations entre les techniques. Dick Higgins nomme cette opération « intermedia[3] » afin de souligner les traversées allant d’un médium artistique à un autre ; Arthur Danto parle, lui, d’un « no man’s land[4] » de l’art, d’un territoire où aucune règle ne peut plus être respectée ; et Thierry de Duve défend le critère du « n’importe quoi[5] ».
Ce dérèglement est particulièrement remarqué pour l’art indiscipliné de la performance, qu’Arthur Danto associe à « l’art de la perturbation[6] ». En choisissant ce terme, le philosophe américain désigne des pratiques artistiques qui se sont « développées tels des bidonvilles à la périphérie de ce qui était habituellement considéré comme les limites de l’art[7] ». Des pratiques hybrides, donc. Pour Danto, la « performance » occupe une place privilégiée à l’intérieur de ce type de pratiques, « puisqu’elle est à cheval sur la peinture et le théâtre[8] ». Le désir de la performance consisterait, selon Danto, à dépasser les limites de l’art en provoquant du « désordre[9] ». Toutefois, considérer les échanges et les rapports entre l’art et la vie en termes de perturbation – comme le fait Danto – réduit l’hybridation à une perturbation, voire à une menace. Cela signifie aussi considérer l’art comme un domaine supérieur qui serait bousculé et déréglé par des entités inférieures, et soumettre l’art au régime de l’interprétation et de l’image. Ceci se comprend aisément si l’on souligne les raisons pour lesquelles Danto choisit le terme « perturbation ». Celui-ci aurait, d’une part, une valeur négative (selon lui, « les arts regroupés sous ce nom comportent une certaine menace, voire promettent un certain danger »), et d’autre part, il ferait « allusion à sa rime naturelle » avec le terme masturbation :
Ce terme [perturbation] est bien sûr censé faire allusion à sa rime naturelle en français, puisque la masturbation est une activité à cheval sur une frontière similaire, en ce que certaines images et imaginations y sont suivies d’effets externes – de simples images chargées érotiquement culminent dans des orgasmes réels et mènent à une réduction de tension effective. En un sens, c’est là le modèle de ce que l’art de la perturbation cherche à accomplir, à savoir produire un spasme existentiel par une intervention des images dans la vie[10].
On voit ici clairement ce qui échappe à Danto : ce qu’il appelle les « arts de la perturbation », ne sont pas – comme la masturbation d’ailleurs – des pratiques purement imagées ou imaginaires, mais des activités proprement gestuelles, des activités où le corps est impliqué avec son organicité et sa puissance physique. Ce qui échappe à Danto c’est le geste. Les changements réels produits par ces pratiques, comme les orgasmes auxquels Danto les compare, ne sont pas le résultat de la simple création d’images, mais l’aboutissement d’une implication corporelle qui est, elle aussi, réelle, voire simplement due à des réactions mécaniques du corps. Je reviendrai sur l’importance du corps comme limite d’une pensée purement représentationnelle et interprétative. Pour le moment, retenons ceci : soumettre les arts de la perturbation (ou de la performance) au régime de l’image signifie ne les voir qu’à travers le prisme du système des beaux-arts en rétablissant donc cette même distance interprétative que ces pratiques visent précisément à dépasser. Le point de vue de Danto est clairement conservateur. Il est vrai que, d’un point de vue épistémologique, de nombreuses pratiques « artistiques » ne ressemblent plus à de l’art. Mais cela n’est vrai que du point de vue de l’art, que si l’on prend cette ouverture de manière négative, à savoir comme une attaque à l’ordre établi.
Indiscernabilité et hybridation
Danto pose explicitement la question de l’indiscernabilité[11] que l’on peut aisément rapprocher de celle de l’hybridation, puisque ces notions se basent, toutes deux, sur la nature double d’une relation. Le point de départ est la question de la « différence esthétique » telle que l’étudie Nelson Goodman[12], et à propos de laquelle Danto remarque la chose suivante :
Goodman, curieusement, rejette une des conditions de la question, à savoir la relation d’indiscernabilité. Il semble être d’avis qu’elle ne saurait être que momentanée et que tôt ou tard des différences se feront jour. (…) Goodman [soutient] qu’on ne saurait jamais prouver qu’une différence perceptuelle est par principe impossible : des objets qui nous paraissent indiscernables aujourd’hui pourront demain se révéler si différents l’un de l’autre que rétrospectivement on se demandera avec étonnement comment on a pu les confondre. Et pour donner plus de poids à sa position, il souligne notre extrême acuité visuelle et auditive qui nous rend capables de percevoir des différences très nettes à partir de variations minimes[13].
Le problème que rappelle Danto est celui de la « contrefaçon[14] », problème que Goodman pose et cherche à résoudre non pas uniquement en fonction de l’amélioration de « l’acuité visuelle » – comme la remarque de Danto le laisse croire – mais aussi par l’intervention d’une « information » qui indique qu’on est bien face à deux choses distinctes, et que l’une est la copie parfaite de l’autre[15]. Cette information est ce qui permet, selon Goodman, de comprendre la portée symbolique des œuvres d’art : il s’agit là de sa célèbre théorie basée sur les concepts de dénotation et de symbolisation. Selon cette théorie, Goodman trouve une différence esthétique entre l’œuvre d’art et l’objet ordinaire une fois que ce dernier est extrait de sa fonction pratique. Que ce soit même partiellement ou temporellement, c’est à ce moment qu’il devient une œuvre d’art, il est dénoté en tant qu’œuvre puisqu’il ne fonctionne plus en tant qu’objet, il passe du stade réel au stade symbolique.
La théorie de la différence esthétique s’affiche comme un antidote à la pathologie de l’hybridation : par l’introduction d’une notion savante, on est à l’abri du risque d’une confusion. Les qualités esthétiques sont décrites par Goodman comme des « symptômes[16] » que le récepteur de l’œuvre, comme un médecin, doit savoir repérer. La symbolisation permet à Goodman d’échapper à deux réponses insatisfaisantes : celle qui associe la valeur de l’œuvre au contexte physique d’exposition et celle qui l’associe à l’intention de l’artiste. Ni le musée ni l’artiste n’ont l’autorité de déterminer le statut artistique d’un objet. Goodman défend la théorie d’un fonctionnalisme esthétique : l’art est ce qui suspend et trouble les fonctions de l’ordinaire. L’art est ce qui dys-fonctionne. C’est peut-être aussi en raison de cet aspect que Danto prend ses distances avec Goodman, en radicalisant toutefois les traits conceptuels du système esthétique de ce dernier : ce sont l’interprétation et le savoir théorique qui seuls peuvent garantir la valeur artistique d’un objet.
L’interprétation, loin d’être, selon Danto, un critère de jugement de goût est un facteur intrinsèque à l’objet qu’elle interprète, bien davantage, elle a un pouvoir de transformation, mieux de transfiguration vis-à-vis de l’objet en question. L’interprétation devient un critère valable pour établir une différence de nature entre l’art et le non-art. En critiquant à la fois la symbolisation de Goodman – selon lequel la différence esthétique serait « psychophysique plutôt que d’ontologie[17] » – et la théorie institutionnelle de Dickie[18], Danto affirme :
Apprendre qu’un objet est une œuvre d’art, c’est savoir qu’il faut être attentif à des qualités qui font défaut à sa réplique non transfigurée et que donc il provoquera des réactions esthétiques différentes. Et ceci n’est pas une question institutionnelle, mais ontologique. Il s’agit en effet de deux types d’identités totalement différentes[19].
Alors que Goodman avait cherché à évacuer précisément la question ontologique, voilà que Danto la récupère puisqu’il affirme que l’interprétation transforme, ou transfigure le réel et place l’interprétation au niveau d’un changement de nature de la chose interprétée. Sur ce point, l’héritage hégélien, dont Danto se réclame par ailleurs[20], est évident. Sans une autorité subjective qui les interprète, les qualités esthétiques n’existeraient pas ; l’interprétation de Danto a la même fonction que le « baptême de l’esprit » et Danto concorderait avec Hegel quand ce dernier affirme :
« N’est vraiment réel que ce qui est en soi et pour soi, c’est-à-dire la substance de la nature et de l’esprit (…). Bien sûr, l’essentialité apparaît aussi dans le monde extérieur et intérieur ordinaire mais sous la forme de chaos d’accidents, atrophiée par la forme immédiate du sensible et par l’arbitraire des circonstances passagères, des événements, des caractères[21]. »
La solution de Danto au rapport d’hybridation tient dans une distinction subjective supposée avoir comme effet un changement de nature de la chose interprétée, cette distinction est nommée « aboutness » (que l’on traduit selon un usage établi par « l’à-propos-de[22] »). « Les objets réels, comme classe, ne sont pas “à propos de quelque chose”, ils sont dépourvus d’à-propos-de, pour la simple raison qu’ils sont des objets[23] ». Une œuvre d’art, à la différence d’un objet ordinaire, sera « à-propos-de » autre chose qu’elle-même, en l’occurrence l’œuvre d’art en général ; seulement grâce à l’aboutness, l’œuvre « possède un contenu, un sujet ou une signification[24] ». L’aboutness établit une relation non-mimétique entre les œuvres d’art conventionnelles (un tableau de Rembrandt ou une symphonie de Beethoven) et les œuvres propres à la transfiguration du banal (un ready-made duchampien ou les boîtes Brillo de Warhol). Ces dernières ne ressemblent pas aux œuvres conventionnelles, tout en partageant avec celles-ci une fonction que Goodman nommerait « symbolique ». L’hybridation est dévoilée donc par un système de référence.
Le corps comme limite
Mais jusqu’où va l’hybridation ? Si l’on peut accepter l’idée selon laquelle l’interprétation ajoute une valeur supplémentaire au non-art, celle de l’art et de sa reconnaissance symbolique – comme le veut la théorie de Goodman –, il est beaucoup moins facile de soutenir que cette valeur implique un changement de nature dans la chose interprétée – comme le veut la théorie de Danto. La valeur reste un aspect mesurable par des critères de jugement, tandis que la nature dépasse le domaine de la simple interprétation. Ainsi, l’on pourrait affirmer, sans contradictions majeures, qu’un urinoir signé « R. Mutt », intitulé Fontaine, daté de 1917, appartenant à la série de copies reproduites à partir du ready-made original désormais perdu, a plus de valeur qu’un autre urinoir qui ne possède pas ces éléments ajoutés. En revanche, l’on serait en contradiction si l’on affirmait, comme le fait Danto, qu’entre la copie de Fontaine et un autre urinoir il y a une différence de nature. Même en acceptant l’idée selon laquelle, dans l’urinoir dit « artistique » l’on aurait découvert des qualités supplémentaires que cet urinoir partagerait avec toute œuvre d’art (« l’être-à-propos-de », en l’occurrence), il serait bien difficile de démontrer que ces qualités produisent une quelconque transfiguration ontologique. Il semble plus justifié de soutenir la thèse selon laquelle l’urinoir Fontaine demeure un urinoir, tout en acquérant une valeur esthétique supplémentaire. Danto cherche à tout prix à garder le régime d’autonomie et de hiérarchie imposé par la théorie conventionnelle de l’art, alors que le principe d’hybridation cherche justement à effacer cette autonomie hiérarchisante à la faveur d’un rapport d’indiscernabilité.
Ainsi, les exemples pris par Danto, tout en touchant au domaine du non-art, sont toujours des objets qui ont déjà été reconnus par le monde de l’art comme « artistiques » (l’objet dada, l’objet pop et le ready-made), et donc des objets qui ont déjà basculé dans l’identification symbolique de l’art. La transfiguration n’est rien d’autre que la constatation de leur légitimité institutionnelle. Aucune suspension anarchique de la valeur de l’œuvre n’est ici prise en compte, non plus que l’éventuelle illégitimité de son auteur. Mais Danto se confronte à un cas limite qui bouscule sa théorie de la différence esthétique : le geste du corps.
Les gestes de celui qui interprète le rôle d’une femme sont à propos des femmes, alors que la mimésis efféminée du travesti ne possède aucun caractère sémantique. La mimésis devient incarnation lorsqu’elle représente le comportement de quelqu’un d’autre. Plus généralement, l’imitation devient une possibilité artistique à partir du moment où elle ne se borne plus à ressembler à quelque chose, comme le fait une image en miroir, mais est à propos de ce à quoi elle ressemble, comme c’est le cas lorsqu’on interprète une personne[25].
Parce que le travesti cherche à vivre en tant que femme au lieu de représenter le personnage d’une femme, comme le ferait un acteur sur scène, il n’est pas, pour Danto, en train d’accomplir un geste artistique, ce dernier nécessitant la distance propre à l’aboutness, par laquelle le signifié est clairement indiqué. Quand l’hybridation est poussée à son aboutissement logique, elle sortirait du domaine de l’art. Il n’y aurait donc d’art que par le processus classique de la représentation : l’interprétation de l’acteur entame l’identification du spectateur lequel, par le fait de sortir de son statut ordinaire, lui fait atteindre un état exceptionnel. Il y aurait donc des gestes qui représentent (ceux qui sont « à-propos-de ») et des gestes qui font (comme la mimésis du travesti).
Dans le faire réel du geste, dans la performance, dans la vie tout entière, dans l’incarnation non-mimétique, aucune technique concrètement déterminable, aucun lieu géographique symboliquement chargé de sens, aucune virtuosité extraordinaire ne jouent le rôle de garde-fou contre le danger de la confusion, contre le régime de la doublure et de l’hybride. Le geste interroge l’art dans un état minime, c’est-à-dire en absence de tout aspect corollaire facilement reconnaissable comme art. Le geste balaye le régime esthétique du langage (la sémantique) pour incarner (et non pas représenter) autrui. Le geste n’est donc plus « à-propos-de », mais il incorpore directement son altérité. C’est pour cette raison que les arts du corps sont hautement hybrides : ils incarnent la différence en leur sein. Etre soi-même, tout en étant autrui, tel serait le défi d’une esthétique de l’hybride.