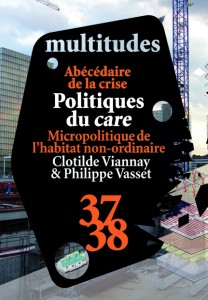[…
Téléchargement illégal
Ces dernières années, le téléchargement illégal de fichiers numériques sur Internet – films, musiques, jeux et logiciels payants – est sûrement la pratique la plus subversive surgie dans le champ culturel. L’accès à la culture, sa propriété matérielle et symbolique et ses possibilités d’échanges sont questionnés. Un rapport inédit entre masses, culture, industrie, émancipation et démocratie, apparaît dans le piratage-partage. Nouveauté de cette dynamique culturelle : elle émerge du côté des spectateurs et non pas de celui des créateurs, elle réinvente l’appropriation culturelle et développe donc un paradigme de l’émancipation, «téléchargement illégal » et « crise du capitalisme » sont étroitement liés. Car, la pratique du « piratage » par une partie de la population mondiale, connectée à Internet, anticipe et dépasse des formes de propriétés et d’échanges qui montrent aujourd’hui leurs limites.
Peer2Peer, BitTorent et autres formes de téléchargement de fichiers sur Internet s’appuient sur une logique de partage. À partir d’une interface informatique, on cherche un film ou de la musique convertis en fichiers numériques. Une fois le fichier trouvé, un protocole d’échange permet de le télécharger (download) sur le disque dur d’autres utilisateurs. Plus un fichier identique est présent chez de nombreux utilisateurs, plus il sera aisé alors de l’acquérir. Le fichier acquis, on se met en principe soi-même à le fournir à d’autres utilisateurs (upload). Pour imaginer comment un premier fichier est piraté puis téléchargeable, tous les scénarii sont possibles. Ceux et celles qui placent le fichier originel sur la toile sont à proprement parler des pirates. Les autres, en le téléchargeant et le partageant, deviennent à leur tour des pirates selon la loi. Ici, il n’existe donc pas de piratage sans partage. L’enjeu de cette nouvelle pratique est alors de taille.
Pourquoi et comment dénoncer le « partage » dans des législations criminalisantes ? La contradiction entre le discours publicitaire du « connecting people » de l’industrie du spectacle et les médias de masse, et la mise en pratique effective mais criminalisée de cet ensemble connecté, devient alors flagrante. Il s’agit, au contraire, de culpabiliser et dénoncer ceux et celles qui téléchargent « comme des voleurs » ; les spots anti-pirates présents en introduction des DVD loués en vidéoclubs l’illustrent bien. L’objectif est alors d’insister sur la dimension immorale de la pratique, tout en éludant ses vertus partageuses pour mieux la criminaliser. L’acharnement législatif contre le piratage-partage oblige à questionner la potentialité de ces pratiques et expériences. Pourtant, la démocratisation de la culture est aujourd’hui un principe bien ancré dans l’espace public et, en même temps, le fruit d’une histoire ambiguë. C’est l’idée, selon les termes de Malraux, travaillée par les expériences culturelles du Front Populaire, incarnée dans le système républicain et impérial des beaux-arts, marquée par la Révolution française et héritée de la vieille idée kantienne de rendre accessible à un plus grand nombre le plus grand nombre d’œuvres d’art. C’est alors au rôle de l’État d’assurer cette diffusion, et d’organiser la séparation entre ce qui est œuvre et ce qui ne l’est pas. Tout cela éclate face au piratage-partage où s’installe un rapport inédit entre émetteurs et récepteurs culturels : c’est le pouvoir du n’importe qui, de l’anonyme, qui s’exerce et pas seulement celui de la République des savants. C’est ainsi une activation forte de l’idée démocratique, telle que pensée par Rancière par exemple dans La haine de la démocratie et Le spectateur émancipé. Le téléchargement illégal crée alors les pistes d’une réflexion autour de la démocratie culturelle qui dépasserait le principe de démocratisation de la culture. Notons, enfin, que le piratage-partage n’est pas toujours pensé par ses acteurs comme une pratique subversive, à l’exception notable des campagnes du site The Pirate Bay et du Piratpartiet suédois. Dans ces pratiques, une invention de la politique liée à la fibre sensible des individus, renvoie à la question des subjectivités contrariant le pouvoir – pensé lui comme un ensemble d’abstractions réelles.
La question des industries culturelles posées par Adorno et Horkheimer dans Dialektik der Auflklärung, (1944) est alors réactualisée. Ce sont les œuvres issues de ces industries qui sont le plus facilement piratables. Par le jeu de la diffusion médiatique, elles mettent en place des opérations promotionnelles de grandes envergures. En parallèle de quoi, elles donnent aussi l’occasion, malgré elles, d’être largement piratées. Par exemple, les films les plus attendus et les plus secrets, comme Star Wars, se retrouvent sur la toile, avant même d’être projetés sur les écrans de cinéma. L’attente et l’hystérie consuméristes qui cherchent à être créées chez le spectateur/consommateur se retrouvent subverties et cette dimension répressive de l’industrie culturelle/spectaculaire est anéantie par le piratage-partage. La répression du piratage-partage de biens culturels se dote de l’arsenal HADOPI ; alors que la propriété intellectuelle est déjà protégée, le piratage est d’ores et déjà devenu une pratique criminelle. On voit ici comment l’État se retrouve contraint à légiférer. Il ne se présente pas comme un garant universel et impartial de la citoyenneté, mais comme un ensemble d’institutions et de principes attaqués par des pratiques déviantes ou rebelles. Le pouvoir montre le visage désenchanté de celui qui acculé doit réagir face à l’inventivité des individus connectés : un visage de la réaction. La sanction négative et pénale prévue est l’exclusion d’un marché. Société de l’information et échange marchand sont rendus indissociables. La répression du téléchargement illégal doit être celle du plus grand nombre.
Enfin, le discours énonçant que cette criminalisation protègerait les créateurs, en pénalisant et éduquant (le principe de riposte graduée) doit être déconstruit. C’est plutôt la longue chaîne de leurs ayant droits qui est défendue. Nombres d’artistes – musiciens en particulier – ont déjà compris le nouveau rapport qui se joue entre eux et leurs auditoires. Du côté des pirates-partageux, l’ambiance est vivifiante. Le phénomène dépasse le refus d’acheter des biens culturels et déborde le vol thésaurisant, car ce que permet cette forme de piratage, c’est le partage. Plus d’utilisateurs accumuleront des fichiers partagés, plus le fond partageable sera élargi. Ce processus d’accumulation culturelle contrarie l’accumulation de capital – qui montre aujourd’hui clairement ses limites dans la crise économique. Dans cette pratique, nous observons aussi une communauté esthétique se construire grâce à la mobilisation des publics eux-mêmes, sans impulsion venant des artistes, sans principe fondateur ni barrière entre cultures légitimes et illégitimes. Sans non plus utiliser des moyens tolérés et reconnus par et dans l’espace public bourgeois. Ainsi, les réseaux d’échanges mettent en pratique une forme de potlatch numérique, mais qui n’implique ni destruction, ni désappropriation de la part de ceux qui donnent (upload) et reçoivent (download). Une éthique pirate s’invente, créant de nouvelles formes de reconnaissance des créateurs, assoiffée de partage, d’échange, de mise en commun par et pour les publics. Il suffit de saisir HADOPI dans un moteur de recherche Internet pour constater la richesse du débat.
Dans l’action de télécharger, les processus et rapports liés à la production sont contestés et s’imbriquent à la crise du capitalisme. De nouvelles formes d’échanges se mettent en place. Les réseaux de solidarités se réactivent et se réinventent. La relation intime entre spectateurs et créateurs est bouleversée, le piratage-partage en est une forme de dépassement. Ce qu’elle montre est aussi classique qu’inédit aujourd’hui : inventer c’est partager et partager c’est inventer.
[…
Socialiser les pertes
Vivons-nous vraiment une crise du capitalisme ou son business as usual ? Le montant inouï des sommes impliquées, les milliers de milliards d’euros volatilisés dans les coffres des banques, refinancés par les États du jour au lendemain, évaporés le surlendemain, avec les hauts le cœur et les vertiges que cela ne manque pas de causer, tout cela ressemble non seulement à une crise, mais – comme le disent et l’espèrent certains – à la crise, à « la mère des crises », celle qui nous débarrassera une fois pour toutes du monstre capitaliste.
Les esprits raisonnables peuvent opposer à cela que c’est le plus vieux truc dans la panoplie du capital que de socialiser les pertes après avoir privatisé les profits (et après avoir prudemment planqué son argent en Suisse). Que des petits porteurs se fassent flouer dans leurs rêves de petits profits, que même de grosses fortunes se fassent escroquer par un imposteur de haut vol, que les États soient appelés à la rescousse, au nom de l’intérêt général, pour éponger les dettes et colmater les brèches qui ont nourri le festin des plus riches – voilà bien le business as usual du capitalisme tel qu’il se renouvelle périodiquement depuis maintenant plusieurs siècles. Il faudrait être singulièrement naïf pour ne pas voir ce que ses théoriciens répètent depuis des décennies, à savoir que la crise est son business as usual, sa façon de se développer (par trials and errors), de se reconfigurer sans cesse, de se condenser et de se redéployer (par diastoles et systoles). Rien de nouveau sous le soleil, diront les cyniques.
Allons plus loin. Peut-on se souvenir d’une seule année, au cours des trois dernières décennies, où nos pays (riches) ne se soient pas dits et sentis « en crise » ? Le discours de la crise est permanent depuis les années 1970, même lorsque le PIB croissait à un rythme qui aurait pu justifier une suspension de l’état de siège économique. Le business as usual du capitalisme (récent ?) ne repose donc pas seulement sur une alternance de déploiements conquérants (durant lesquels sont privatisés les profits) et de rétrécissements périodiques (au cours desquels sont socialisées les pertes) ; il repose aussi sur un sentiment de crise permanente qui garde tout le monde sous pression constante – afin de prévenir toute forme de redéploiement basé sur une logique autre que celle de la reproduction du capital.
Loin de peindre le capitalisme en phase terminale, on pourrait donc lui trouver au contraire les signes d’une vitalité étonnante, tant il est parvenu à mobiliser rapidement des ressources inouïes, grâce à une coordination planétaire, pour venir au secours du système bancaire qui lui sert de poumon d’oxygène. N’est-ce pas un gage de triomphe que de voir non seulement les USA, l’Europe occidentale, le Canada, le Japon et l’Australie, mais aussi bien le Brésil, l’Inde, la Chine et la Russie trembler de peur devant ses hoquets (au lieu de danser de joie et de verser de l’huile sur son bûcher) et signer des déclarations communes pour s’assurer de sa pérennité ? Qui l’aurait imaginé il y a seulement 20 ans ?
Quoiqu’en disent les cyniques, il y a toujours quelque chose de nouveau sous le soleil. Le défi est de repérer quoi. L’hypothèse du capitalisme cognitif a pour fonction de nous aider dans ce travail (tâtonnant) de repérage. Elle nous incite à hasarder l’intuition suivante : la socialisation des pertes est le symptôme du socialisme du capital.
Une partie de la thèse n’est guère nouvelle : à chaque fois que « la société » (sous la forme instituée de l’État) intervient massivement pour sauver le capitalisme de ses dérives suicidaires, de nouveaux pans de l’activité productive sont intégrés sous la coupe d’un contrôle social explicite. Le processus de déploiement évoqué plus haut de façon unilatérale s’avère donc double : d’une part, certes, le pouvoir d’État aide le capitalisme à se redéployer à plus vaste échelle en rachetant (à prix fort) ses fourvoiements calamiteux ; d’autre part, le capitalisme se trouve ainsi en position de poursuivre son travail d’exploration sur des dimensions d’activité que l’État pourra venir coloniser lors de la prochaine « crise ». L’enjeu des conflits exacerbés qui se déroulent durant un moment de crise est donc d’imposer autant de contrôle social que possible sur les captations opérées par le capital. Le moment de socialisation des pertes apparaît de ce point de vue comme un moment de conquête socialisante des nouveaux horizons productifs défrichés par l’expansion (éminemment hasardeuse) opérée par la logique du capital.
Mais ce que l’hypothèse du capitalisme cognitif nous permet d’entrevoir est encore différent de cela. Dire que la socialisation des pertes est le symptôme du socialisme du capital, c’est suggérer que la socialisation est antérieure au contrôle social, opéré après coup, par l’État. Même si cela a toujours été partiellement le cas, cela devient de plus en plus patent au fur et à mesure que la production repose de plus en plus directement sur la production de services et de biens immatériels. Ce qui produit la richesse (et non seulement ce qui la réglemente ou se l’approprie) apparaît de plus en plus clairement comme relevant de relations sociales inhérentes à la vie sociale elle-même : savoir parler, argumenter, convaincre, communiquer, apprendre, plaire, résister aux chocs émotionnels, compatir, assister, soigner, conforter, résoudre des problèmes, organiser, inventer, créer – tout cela participe de compétences multiples que ne peuvent produire ni une école, ni une université, ni une famille, ni une paroisse, ni un hôpital, ni un journal, ni un site Internet, mais qui se construisent au fil de l’ensemble des interactions que chaque individu entretient avec les autres à l’intérieur de et à travers ces différentes institutions. En parlant de « capital humain », l’économisme régnant tend certes à réduire ces compétences multiples, impalpables et transindividuelles à celles d’entre elles qui peuvent se mesurer individuellement et s’échanger contre des revenus financiers. Mais en reconnaissant le rôle central que joue ce « capital humain » dans nos modes de production actuels, il sanctionne du même coup la nature immédiatement sociale du capital.
Un tel « socialisme du capital » ne constitue toutefois nullement le dernier mot d’une politique qui se voudrait « de gauche ». Sa mise à jour permet au contraire de clarifier une triple distinction au sein des différents courants qui se réclament encore de « la gauche ».
Un premier groupe, qu’on qualifiera de socialistes libéraux, regroupant la plupart de ceux qui, depuis les années Mitterrand, ont occupé des positions de pouvoir dans les différents gouvernements, essaie de gérer au mieux la production sociale de l’humain au sein des régimes capitalistes de captation et de reproduction de richesses (régimes qui sont, on l’a vu, en constante évolution). Ce courant tend à reconnaître que c’est le « capital humain » qui est décisif dans les modes de production actuels, mais il n’en tire de conséquences que dans le cadre des présupposés de la théorie économique orthodoxe dominante, qui constitue « l’idéologie spontanée » du régime capitaliste (individualisation, productivisme, consumérisme, fétichisme du PIB, etc.).
Un deuxième groupe, qu’on qualifiera de socialistes étatiques, ne peuvent concevoir d’alternative au régime de captation capitaliste qu’à travers une extension du contrôle social opéré par l’État (lequel est généralement conçu dans sa dimension nationale). On trouverait dans ce groupe le gros des forces qui se sont mobilisées pour rejeter une constitution européenne accusée d’être « libérale », c’est-à-dire d’affaiblir les pouvoirs de l’État (national). La socialisation des pertes appelée par la « crise » actuelle leur donne l’opportunité de promouvoir leur cause, dans la mesure où nous vivons un moment de colonisation par le pouvoir étatique des zones productives défrichées par les errances du capitalisme. La complémentarité entre les explorations opérées par le capital et les conquêtes récupérées par l’État suggère de relativiser le rôle d’« opposition » que prétend jouer ce courant de la gauche : les dynamiques de déploiement de l’État et du capital ont été si intimement liées entre elles au cours du xxe siècle que leur « lutte » frontale peut apparaître aussi bien comme une danse commune, certes mouvementée, mais finalement assez harmonieuse. En bornant sa réflexion au cadre étroit fourni par l’opposition État-Marché, ce courant de « la gauche » s’inscrit dans une dynamique qui s’avère souvent être terriblement conservatrice, surtout lorsque les modalités d’action de l’État (national, « républicain ») se trouvent remises en question.
Un troisième groupe, qu’on qualifiera d’autonomistes, tente d’échapper au double carcan que constituent, d’une part, les présupposés économistes sur lesquels reposent les conceptions et les captations capitalistiques de la productivité sociale et, d’autre part, le recours obligé à l’État pour contrer les dérives du « Marché ». En décalage avec ces deux attitudes qui restent toutes deux largement prisonnières de cadres obsolètes, il s’agit de repérer aussi précisément que possible ce qu’il y a de nouveau sous le soleil de la socialisation immédiate de la production de richesses. La tâche, difficile et forcément tâtonnante, consiste à reconnaître (et imaginer) les nouvelles possibilités politiques offertes par l’autonomisation d’une force de travail qui participe de plus en plus directement d’une intelligence collective, qui se laisse de plus en plus problématiquement capter par la logique individualisante et réifiante du régime capitaliste, et qui se soumet de moins en moins volontiers à des formes de contrôle étatique qui limitent inutilement sa liberté d’invention et d’association. Bien au-delà du socialisme du capital, ce courant aspire à tout ce qui peut promouvoir l’autonomisation de la vie sensible et intelligente.
[…