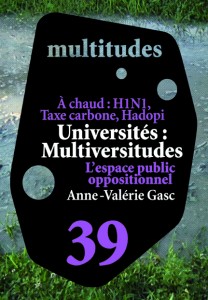Une houle d’espoir dans l’université italienne moribonde
En Italie au début de l’année scolaire 2008/09 a commencé un ample mouvement social qui est descendu dans les rues et a commencé à bloquer facs et écoles. Un mouvement fort, large et déterminé, après plusieurs années de tranquillité relative sur le front des mobilisations dans l’éducation et la recherche[1]. L’opposition sociale aux projets de destruction de l’Éducation Nationale commence au mois d’octobre 2008, dans les universités, mais aussi dans les écoles primaires et secondaires avec la participation d’enseignants, de chercheurs, d’étudiant(e)s, de précaires et de parents d’élèves. Le mouvement se diffuse partout en Italie et se développe en particulier dans les universités, qui deviennent des points de référence pour alimenter et continuer les mobilisations.
Le nom Onda Anomala (Vague anomale) apparaît pour rendre compte de la vitesse de développement et de la force du mouvement (la vague) ainsi que pour l’imprévisibilité de ses comportements en dehors des logiques des partis et des organisations politiques classiques (la dimension anomale du mouvement). Ce mouvement a impliqué des gens venus de toute l’Italie, en particulier beaucoup de participants qui n’avaient aucune expérience antérieure de mobilisation. Le point de vue proposé ici n’est pas celui d’un participant à cette mobilisation, mais une vision (à demi) extérieure de quelqu’un qui a participé aux dernières tentatives de mobilisations contre la précarité de la recherche et la destruction de l’Université. Engagement et distance, donc, se mélangent dans ce texte pour proposer des récits et quelques tentatives de réflexion sur cette vague anomale.
Une vague européenne
de réformes normalisées
Au cours des années 1990, une stratégie européenne commune a été mise en place pour la réforme du système universitaire et l’harmonisation des cursus et des évaluations. En Italie, il y a désormais plus de dix ans que le processus de « réforme » visant à essayer d’aligner le système éducatif sur les transformations du capitalisme a commencé. Un des impératifs institutionnels les plus insistants a été de créer les conditions pour produire « plus de licenciés en moins de temps ». En revenant au pouvoir, le gouvernement Berlusconi a poursuivi son projet de réforme et de destruction de l’éducation nationale, déjà commencé pendant la dernière législature par la loi Moratti, ancien ministre de l’éducation. Ce programme de réforme est assez peu différent, par son inspiration et par sa dangerosité pour les étudiants, de la dernière réforme du gouvernement de centre-gauche (la réforme Berlinguer de 1997). Le projet gouvernemental de transformation de l’université a donc une longue histoire, avec une vision partagée par les coalitions de gauche et de droite. L’appel à « l’autonomie » présumée des universités cache en réalité la volonté de réduire l’investissement public dans la recherche et de l’ouvrir aux intérêts et partners privés.
Ce processus de transformation de l’université, poursuivi au nom d’une harmonisation européenne et afin d’obtenir des « taux de réussite » plus hauts, s’est développé dans au moins trois différentes directions : a) une réforme de l’organisation de la didactique et du parcours de formation, avec une fragmentation des cursus en modules très courts, avec l’introduction d’une licence de premier niveau et d’un second niveau de spécialisation ; b) la transformation du système d’évaluation à travers l’introduction du CFU (crédit d’unité de formation) ; c) la progressive autonomisation des facs et la prolifération des offres de formation. Cette réforme s’accompagne, bien entendu, de décrets financiers visant à réduire les frais et les financements publics de l’éducation et de la recherche.
Au-delà du monde universitaire, cette réforme concerne toutefois tous les niveaux de l’éducation depuis l’école primaire jusqu’à la fac. Entre autres dispositions, cette réforme prévoit pour les écoles primaires et secondaires : a) le retour à l’enseignant unique pour les écoles primaires (alors qu’ils sont aujourd’hui plusieurs pour la même classe) ; b) l’introduction de l’obligation de l’uniforme scolaire ; c) la création de classes séparées entre Italiens et étrangers dans le primaire, officiellement afin d’améliorer l’insertion des enfants qui ne parlent pas l’italien ; d) la réintroduction de la note de conduite pour le passage dans la classe suivante. Ici aussi, ces dispositions sont accompagnées d’une réduction à tous les niveaux des financements pour l’éducation.
Une question centrale concerne la réduction des effectifs et l’absence de solutions relatives à un système qui favorise un régime de précarisation extrême, surtout pour les chercheurs universitaires. Rien n’est prévu pour intégrer les milliers de précaires qui, depuis des années, travaillent dans ces classes du primaire et du secondaire. La question est très similaire dans le contexte des universités où des milliers de docteurs et de chercheurs précaires, faisant partie intégrante des équipes de recherche, n’ont aucune garantie de revenu ni de statut pour leur avenir professionnel.
La question du financement touche aussi très lourdement l’université parce que l’aspect néolibéral de la loi a comme objectif de les pousser à devenir des fondations privées, mises en compétition pour toucher l’argent de partners privés. L’objectif est de créer un dispositif centré autour d’écoles « d’excellence » qui pourront attirer la plus grande part de l’argent disponible (public et privé évidemment), avec comme conséquence un appauvrissement de la plupart des autres universités.
On le voit, « l’harmonisation européenne », ou du moins l’alignement politique des gouvernements nationaux sur une même idéologie néolibérale, conduit à des programmes de réformes par là-haut qui présentent des similitudes frappantes entre les cas de l’Italie et de la France. C’est donc plutôt du côté des réactions et des résistances contre ces réformes gouvernementales qu’il convient d’aller chercher l’originalité de la situation italienne.
Une vague anomale de résistance : transversalité et autoformation
Le slogan « Nous ne payerons pas votre crise ! » a très rapidement conquis l’imaginaire collectif. Il exprime aussi bien la volonté des étudiants et des précaires de ne pas accepter la réforme destructrice de leur futur, que la réaction des gens aux conséquences de la crise du capitalisme qui fait la Une de tous les mass médias. Les premières mobilisations sont arrivées pendant les jours les plus chauds de la chute des bourses internationales en octobre 2008. Ce cri est devenu une forme de résistance qui, bien au-delà du système éducatif, a vite concerné tout le monde : il a donné, dès le début, une dimension transversale au mouvement, qui a identifié comme ses cibles non seulement les ministères mais aussi les sièges du Medef italien (Confindustria) et la bourse de Milan. Le slogan « Nous ne payerons pas votre crise ! » est devenu une forme de prise de parole collective pour tous les gens qui subissent une précarisation existentielle et une incertitude croissante envers l’avenir.
Cette transversalité du mouvement, on a pu l’observer à travers la participation aux mobilisations de tous les protagonistes de l’éducation nationale (enseignants, étudiants, chercheurs, parents d’élèves avec leurs enfants, chercheurs précaires, professeurs d’université, personnels des écoles) mais aussi et surtout à travers les branchements qui ont pu se constituer entre ces protagonistes et un consensus social considérablement plus large. Bloquer la rue Tiburtina de Rome en arrivant non seulement à ne pas être frappé par les automobilistes, mais en parvenant à susciter leur solidarité et à recueillir leurs applaudissements, voilà qui a tenu du miracle ! Dans les manifestations, pendant les actions et dans les sondages des medias, l’étendue du consensus qui a émergé dans la société en faveur de ce mouvement a peu de précédents dans l’histoire italienne récente. Pancartes aux fenêtres, paroles de passants et discussions entre amis ont généralement accompagné les actions d’une large résonance qui s’est manifestée par la phrase « Ils ont raison ! ». En Italie, voilà qui constitue déjà une anomalie majeure !
Un autre slogan qui a émergé du mouvement est « Je n’ai pas peur ! », prononcé tout suite après la déclaration de Berlusconi d’utiliser les CRS pour expulser les occupants des écoles et des facs. Ce slogan a été repris aussi après les violentes provocations des groupes de fafs armés dans les manifestations[2]. Il s’agissait donc d’un cri de résistance, lancé simultanément au gouvernement, à la police et aux fafs. Mais ce slogan a surtout représenté une forme d’opposition et un désir d’alternative au discours sécuritaire qui est mobilisé en Italie par tous les partis comme tactique de gouvernement (depuis les lois hyper-répressives de la droite jusqu’aux « maires shérifs » de la gauche).
À travers de tels slogans, un large mouvement a pu se coaguler en conjoignant la volonté de ne pas payer la crise et celle de ne pas avoir peur. Cette coagulation a entraîné en même temps un programme de lutte et une déclaration de refus radical du modèle économique imposé (à partir de l’éducation nationale) ainsi que des formes culturelles (racisme) et répressives (policières) qui lui servent de corollaires.
Le mouvement a commencé à se définir comme vague anomale afin de souligner expressément son irreprésentabilité, sa transversalité et son imprévisibilité. Cette vague, me semble-t-il, a été plus émotionnelle qu’organisationnelle, plus improvisée que structurée. En rapport à cette revendication d’anomalie, il me paraît fondamental que l’affirmation d’une solidarité ait été liée au statut précaire comme condition commune aux différents sujets qui participaient au mouvement. Cette précarité concerne autant les conditions présentes que les perspectives futures de la vie des gens. Le mouvement a connu une forte continuité entre octobre et décembre 2008. Un des moments les plus intenses a été la journée de manifestation du 14 novembre et les deux jours d’assemblées plénières à l’Université occupée de Rome. De ces assemblées sont sorties des propositions sur la continuité des luttes, ainsi que des différences de points de vue entre les divers collectifs organisés et les diverses réalités mobilisées.
Une des ses priorités a clairement été de réaliser des actions de blocage et d’occupation d’universités et de lycées, avec une caractéristique fondamentale liée à la visibilité publique des mobilisations. Un des points critiques a été le choix entre un blocage total des activités d’enseignement et la construction d’un enseignement alternatif à côté des cours « normaux ». En plusieurs villes, le mouvement a choisi de ne pas bloquer les cours pour éviter de trop fortes tensions avec les autres étudiants. Cette stratégie est à double tranchant, puisqu’elle privilège des formes de visibilité et de consensus plutôt que la radicalité de conflits capables de déboucher sur la construction d’alternatives réelles.
Cette construction d’alternatives – à travers les initiatives d’autoformation – a toutefois connu des expériences encourageantes. Dans la plupart des villes, le mouvement a organisé une série des séances et de cours autogérés en plein air. Des dizaines des professeurs (entre eux Dario Fo et Margherita Hack) ont donné des conférences publiques, aussi bien sur questions académiques que sur les motivations du mouvement. Ces séances en plein air ont été réalisées par des professeurs, par des chercheurs précaires ou des groupes d’étudiants.
Une partie des collectifs universitaires était profondément convaincue de la priorité et de la nécessité d’une « autoréforme » (d’une réforme autogérée) de l’université, à partir de ces initiatives d’autoformation organisées par les étudiant(e)s et précaires eux-mêmes. Ces initiatives ont joué un rôle très important dans le développement et l’impact du mouvement : elles se sont appuyées sur des structures organisées depuis déjà plusieurs années et pratiquées par différents collectifs d’universitaires et de chercheurs. Elles se sont avérées constituer des moments très formateurs, ainsi que des occasions très favorables à l’expérimentation de nouvelles formes de diffusion et de circulation des savoirs critiques et « non académiques ». Ces initiatives d’autoformation ont fourni des moyens pour activer la population des universités (dans une dimension transversale entre étudiants, chercheurs et professeurs). Elles ont permis de diffuser des outils théoriques et de partager différentes expériences du conflit, par exemple pendant des rencontres avec des militants grecs ou français.
Les défis du branchement
Malgré ses mérites indéniables et sa puissance de rayonnement intellectuel, la pratique de l’autoformation a toutefois eu pour effet de contribuer à concentrer le mouvement sur l’espace contesté mais limité de l’éducation et de l’université. Une des limites qu’a rencontrée la vague anomale tient en effet à certains choix qui ont conduit à affaiblir les liens transversaux qui commençaient à se constituer bien au-delà des campus universitaires. Même si ces choix ont souvent été opérés pour sauvegarder l’influence et la force du mouvement chez les étudiants, ils ont recentré l’action sur les mécanismes de l’université au lieu de nourrir la force de contagion d’une mobilisation qui était potentiellement très présente dans les rues, et qui avait réunie autour d’elle de larges couches de précaires, bien au-delà des seuls secteurs de la recherche et de l’éducation.
Les aspects les plus encourageants de la vague anomale ont en effet tenu aux branchements qui ont pu se mettre en place entre différents espaces habituellement séparés. Le mouvement italien s’est ainsi déployé à une échelle européenne, grâce à la mobilisation, à la mise en réseau et la circulation dans les différents pays d’Europe d’activistes qui ont des intérêts communs à la sauvegarde de l’université publique (à commencer par les participants aux projets d’échanges européens). Dans beaucoup de villes européennes (Paris, Madrid, Grenade, Bruxelles, Berlin entre autres), des collectifs se sont (re)trouvés, ont organisé des rencontres et des manifestations face aux ambassades, ont suscité des branchements avec les luttes et les réalités locales. Cette forme particulière d’activation transnationale est particulièrement intéressante parce qu’elle souligne les potentialités de création d’un large réseau d’étudiant(e)s et de chercheurs qui peut imaginer des formes européenne de mobilisations et d’oppositions à un projet européen de destruction de l’université (le « Processus de Bologne[3] »).
Au titre de cette dimension internationale du mouvement, il est également intéressant de relever que les formes de lutte adoptées par la vague anomale ont été profondément influencées par le modèle français fourni par la lutte contre le CPE. « Manif sauvage » fait désormais partie du lexique de l’activiste italien, de même que de sa boîte à outils militante : on part en manif, on évite les flics et on essaie de bloquer la ville ! Les rythmes et l’intensité de la mobilisation ont aussi souvent été calquées sur la lutte contre le CPE : pendant des semaines, il y a eu des manifs tous les jours, avec une détermination très forte.
Mais c’est toutefois surtout à l’intérieur de l’espace urbain que ces branchements ont cherché à s’esquisser. La visibilité du mouvement passe naturellement à travers des formes de mobilisation comme les cortèges, les manifestations ou les sit-in. Une des pratiques les plus intéressantes a été le blocage de la ville : les manifestants ont bloqué la circulation des voitures dans les centres-villes et celle du trafic ferroviaire dans les gares. Cette pratique du blocage, dès lors qu’elle sort de l’espace de l’école et de l’université contient la possibilité d’engager le dialogue et d’impliquer dans le mouvement des couches beaucoup plus larges de la population.
À ces efforts de branchements du mouvement au-delà des campus universitaires italiens s’est associé un effort pour maintenir l’autonomie – l’anomalité – de la mobilisation par rapport aux forces politiques traditionnelles qui faisaient pression pour le réduire aux formes conventionnelles de l’engagement. Un des aspects principaux de la vague anomale a en effet été l’extériorité des partis politiques à la mobilisation : la défaite historique et culturelle des partis de gauche est restée très présente à l’esprit d’un mouvement qui n’a voulu ni de leurs représentants et ni de leurs instrumentalisations[4]. Les organisations étudiantes officielles de la gauche n’ont pas non plus obtenu de crédibilité suffisante pour participer aux rencontres avec la ministre de l’éducation. Le rapport avec une partie des syndicats (la Cgil et les syndicats de base) a relevé parfois d’une alliance fonctionnelle, mais le mouvement a constamment essayé de ne pas être en position subalterne : le jour de grève des syndicats est simplement devenu un jour de mobilisation générale. Les syndicats ont suivi un mouvement qui poussait sur un terrain de lutte beaucoup plus avancé et radical que celui qui les avait habitués à la concertation négociée avec le gouvernement.
La vague anomale a également essayé d’occuper l’espace médiatique, avec des actions symboliques comme l’invasion de la Fête du cinéma de Rome. Au cours de telles actions, il a fallu affronter plus d’une fois la répression policière. Les matraques de Berlusconi ont frappé les étudiants à Rome, Milan et Bologne, mais elles n’ont pas réussi à arrêter la force du mouvement de la vague anomale. Celle-ci s’est certes calmée après la grève générale du 12 décembre[5]. Il n’y plus eu de grande action coordonnée à l’échelle nationale, mais on a toutefois vu plusieurs mobilisations locales et ciblées prendre forme sur des questions spécifiques (augmentations des taxes universitaires, réductions des opportunités et services proposés aux étudiants et chercheurs, etc.). Un certain degré de mobilisation (virtuelle) reste toutefois latent dans les facs, et le ministre Gelmini ne participe plus depuis octobre à aucune conférence ou inauguration dans les universités, par peur de la contestation. On peut par ailleurs s’attendre à ce que la mobilisation reprenne dans les prochains mois, quand certaines conséquences de la réforme commenceront à toucher directement les chercheurs dans les facs ou les parents d’élèves.
Même si le mouvement ne fait plus la Une des médias, il n’est pas mort, simplement en reflux temporaire. Plus qu’une « vague », l’Onda anomale mérite d’apparaître comme une houle, comme un mouvement profond qui s’avance, qui recule, pour s’avancer à nouveau, mais qui charrie à chaque fois des forces nouvelles et potentiellement imprévisibles.