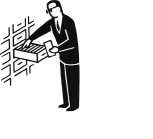avec la collaboration de Jean‑Claude Bonne
Le sujet traité dans notre livre d’exploration – l’art contemporain – est si manifestement dans l’air du temps qu’il oblige à préciser le propos dans une manière de déclaration d’intention à même de restituer (et de resituer) le caractère d’expérimentation (et d’expérience de pensée) de ce qui est tenté ici.
Loin d’un art contemporain de l’air du temps devenu le décor-laboratoire des creative (et toujours cultural) industries, notre projet vise moins à produire une philosophie de l’art contemporain qu’à se tenir dans l’entre-deux de l’Art et de la Philosophie en vue d’y introduire une oscillation, un battement supplémentaires entre une philosophie contemporaine de l’art contemporain et un art contemporain de la philosophie contemporaine. Le contemporain ainsi doublement visé et divisé en lui-même n’est pas affaire de condition philosophique (que pourrait bien vouloir dire un art contemporain mis sous condition de la philosophie contemporaine ?) mais de problème, aiguisé par la problématisation réciproque des deux entrées mises en chiasme pour bousculer leurs catégories aussi bien que les partages disciplinaires enregistrés ou affiliés. Car le problème est décidément celui du « contemporain » dont la notion commune écarte, de son peu défendable a priori/a posteriori, toute temporalité critique « différentielle » de et dans l’art ou la philosophie. Il faut oser que le concept du contemporain ne vaut que par la construction politico-spéculative (un monstre assurément !) qui en détermine la dramatisation, et le plan de déphasage avec l’air du temps qu’il trace à partir d’une zone de fracture introduite dans « l’homogénéité inerte du temps linéaire ».
On peut en inférer trois conséquences dont les effets peuvent et doivent être en droit distingués en art/philosophie, mais en fait conjugués au performatif présent d’un « art » du contemporain.
Première conséquence, la plus immédiate : le contemporain doit être distingué des données immédiates de la représentation la plus présentiste du présent. Il ne fait sens qu’à nous engager dans l’opération d’une critique de l’identité du présent (l’état de choses) et d’un rapport clinique aux altérités porteuses d’une événementialité nouvelle (virtualité), dont les signes sont étouffés sous la forme historique de la présence (et de l’omniprésence de l’actualité). Une manière d’urgence et d’absolu de la pensée s’y affirme sous la figure de l’« intempestif » qui, sans réduire sa part d’anachronisme, relativise les différences de formes d’expression et de régimes de temporalisation dans une expérimentation politique du présent dont la mise en œuvre relève de l’hétérogenèse de la pensée aux prises avec les devenirs qui conditionnent son surgissement.
Cette première effectuation du contemporain se noue dans la pragmatique d’une pensée en acte, à la fois transcatégorielle et transdisciplinaire. « Chaque élément créé sur un plan fait appel à d’autres éléments hétérogènes, qui restent à créer sur les autres plans » tout en communiquant sur un même plan de consistance ontologique toujours singulièrement saisi et modulé pour construire un réel à venir à partir des points de création et de potentialité du présent. Cette transformation de rapports qui pose et investit la pensée comme milieu de l’art et de la philosophie, mais en excès sur leurs formes constituées (un art transcatégoriel, une philosophie transdisciplinaire en intersection avec toutes les sciences), nous l’avons une première fois tentée à en-tête de La Pensée-Matisse et dans la perspective encore en gestation d’une archéologie de l’art contemporain. Il s’agissait alors de penser à nouveaux frais la radicalité de la rupture que Matisse, dans la longue durée d’un demi-siècle, ose dans la peinture et avec la Forme-Art définie par le « pictural » auquel il substitue le décoratif en faisant fonds sur une pensée vitaliste d’esprit bergsonien à développement constructiviste (d’où la mise au travail, moins générative que transformationnelle, de la philosophie deleuzienne).
Troisième et dernière conséquence. Le motif du contemporain, ainsi stratégiquement réinterprété, se trouve déterminé en rapport à un temps qui est celui de la mise en devenir de la modernité. Il demande à être analysé dans une double perspective, généalogique et archéologique. Généalogique : le contemporain s’instruit et se pense depuis les années 1960 et la crise totale de tous les modèles de détermination, crise contemporaine de l’ouverture de nouveaux champs de possibilités et de virtualités porteurs de cette mutation sociale à l’échelle du monde qui s’est traduite en « dé-définition » de la politique comme sphère séparée de la vie, renvoyant en dernière instance à la politique professionnelle qui avait mis les avant-gardes au rouet entre l’art comme politique et l’art politique. Cette contemporanéité peut se résumer d’une formule : « 68 a eu lieu », et ce lieu est biopolitique par les questions micropolitiques de subjectivation qu’il met en avant. On pourra observer ici que la « dé-définition de l’art » (pour reprendre l’expression fameuse d’Harold Rosenberg) – et sa prime motivation en « art et vie confondus » – est à son tour contemporaine de la dé-définition de la philosophie telle qu’un Deleuze en pose le principe en cette année 1968 : « Le temps approche où il ne sera guère plus possible d’écrire un livre de philosophie comme on en a fait depuis si longtemps… ». Nous intéresse particulièrement la façon dont il en fixe les modalités : « … La recherche de nouveaux moyens d’expression philosophiques fut inaugurée par Nietzsche, et doit être aujourd’hui poursuivie en rapport avec le renouvellement de certains autres arts… », pour mieux y faire résonner un attendu au look/L.H.O.O.Q. très Duchamp : « Il faudrait que le compte rendu en histoire de la philosophie agisse comme un véritable double, et comporte la modification maxima propre au double. (On imagine un Hegel philosophiquement barbu, un Marx philosophiquement glabre au même titre qu’une Joconde moustachue). » En deçà du sens proprement deleuzien d’une Différence et répétition de la philosophie, ce collage incite à passer au plan archéologique pour réécrire la modernité d’un siècle qui commence avec la « crise des fondements » scientifiques et se poursuit dans une critique de la représentation s’attaquant à tous les dispositifs formels et catégoriels qui ont pu porter ses régimes spécifiques d’identité objective et/ou subjective.
Que l’on retrouve ici Duchamp, qui abuse de cette crise pour faire lien de sa « physique amusante » (à ambition quadridimensionnelle) en 3 Stoppages-étalon signifiant un changement radical de paradigme de l’Idée de l’art, montre assez que l’art comme expérience, par lui élevé au rang d’un protocole (pseudo-) expérimental, n’est pas moins impliqué que la philosophie dans la découverte et l’exploration de toutes les forces qui agissent sous la représentation de l’identique. Mais n’est-ce pas alors aussi, comme l’avait encore affirmé Deleuze, que l’art – et l’art contemporain (Deleuze « cite » le Pop art) – peut, même, indiquer un « chemin » à la philosophie jusque dans la mise en question de son identité formelle (la Forme-Art) distribuée en genres (la Forme-Peinture…) et par la multiplication de ces œuvres par nature problématiques qui se rangent mal sous la catégorie post-romantique, c’est-à-dire esthétique, d’une « pensée-artiste » ? En sorte que la formule archéologique du contemporain pourrait s’énoncer : « le xxe siècle a eu lieu ». Et nous embarquer – par-delà Deleuze-Deleuze – dans un dehors qui est aussi celui de la philosophie-philosophie en pointant ce que « à la lettre, les philosophes n’ont jamais fait, même quand ils parlaient de politique, même quand ils parlaient de promenade ou d’air pur » : « brancher la pensée directement et immédiatement sur le dehors ». Alors Deleuze pris sous l’Effet-Guattari, qui écrit ces lignes marquées par une « pensée nomade » au coin réaffûté du penseur de l’intempestif (Nietzsche), et qui, s’avançant jusqu’à la pointe extrême de sa pensée (avec Guattari), peut même énoncer que « le modèle du peintre, c’est la marchandise ». Ce qui ne va pas sans compliquer l’idée d’un branchement direct et immédiat sur le dehors… Annoncer que c’est aussi dans cette complication que s’aventure ce livre.
C’est dans la perspective d’une archéologie de l’art contemporain que le travail s’est engagé dans ce qui apparaissait comme un singulier mais nécessaire déplacement de la vision du « siècle des avant-gardes ». S’il s’agissait d’investir la crise de l’idée d’image ouverte par l’art moderne en montrant que celle-ci allait produire tous ses effets par ce qui se démontre dans la phénoménale dis-continuité de l’art contemporain, cette dernière nous apparaissait dépendre de la rupture que Matisse et Duchamp opèrent, à front renversé, avec la phénoménologie picturale de l’image esthétique, d’une locution à double détente qui tente de ressaisir le point de départ commun de leur trajectoire dans le siècle. En produisant cette rupture, dont nous nous sommes attachés à mesurer la radicalité ontologique et à préciser les modalités asymétriques, Matisse et Duchamp détermineraient ensemble moins les deux paradigmes fondateurs de l’art contemporain que sa mise en tension, non au niveau (généalogique) des pratiques à travers lesquelles il s’est constitué, mais au plan (archéologique) des modes de construction de son auto-problématisation dans le champ de forces ainsi créé. Ce qui pourra se développer aussi bien en auto-problématisation du constructivisme expérimental propre à l’art contemporain, qui trouverait avec ces deux pôles ses limites les plus idéellement intérieures entre :
– un vitalisme constructiviste (c’est-à-dire processuel et relationnel au sens matisséen d’un constructivisme décoratif) portant la peinture hors d’elle-même, mettant en scène la défenestration de la Forme-Peinture pour excéder le monde contemplatif du tableau et prendre possession de l’environnement qu’elle affecte et déconditionne d’une façon qui est déjà en excès sur toute site specificity (« elsewhere as well as anywhere else », comme l’avance à regret Dominique Fourcade en pointant la logique impulsée par les gouaches découpées) ;
– et un constructivisme du signifiant commençant par réduire la Forme-Art aux jeux de langage sur l’art afin de subvertir son régime esthétique en le coupant des arts dits plastiques par un renversement readymade de la perspective bergsonienne du se-faisant dont s’empare un signifiant littéralisé autant que phalliquement déchaîné contre la dialectique du visible et de l’invisible qui informe le désir d’image maintenant exposé à la devanture (des grands magasins).
Mettre en avant la place unique de Duchamp dans la pensée contemporaine nous a conduit à produire une Pensée-Duchamp en envers du champ matisséen convoquant aussi bien Lacan que Badiou dans l’hétérogenèse que nous en avons tenté. Mais la véritable réinvention de Duchamp à laquelle donnent lieu les années 1960 confirme à son tour l’écueil d’une projection « continuiste » de/dans l’art contemporain, tout en imprimant un tour de plus à l’avertissement foucaldien selon lequel ce sont « des pratiques qui forment systématiquement les objets dont ils parlent ». Il est en effet loin d’être indifférent que ce reformatage (de Duchamp) participe de la déconstruction du champ artistique en des termes politiques exacerbés par l’institutionnalisation des avant-gardes historiques, y compris dans la configuration la plus ready-made de cette extrême modernité ; institutionnalisation qui pourra également devenir le facteur déterminant d’une critique « institutionnelle » (avant la lettre) du « mythe Duchamp » et d’une relève de la lignée matisséenne (toute l’importance du travail de Daniel Buren tient peut-être au fait qu’il conjugue cette double modalité). Qu’il y aille d’un radical après-Matisse surgi d’un inévitable après-Duchamp devant être pensé en termes non pas « conceptuels » mais post-conceptuels (le post- s’articule autour de la fonction constituante de la critique de l’art conceptuel) est confirmé par la reprise la plus expérimentale qui soit de la question de l’architecture comme signifiant social. Elle va déterminer à la fois l’ontologie spatiale de l’art contemporain et la réouverture ontologique de l’art comme question transcatégorielle à effet post- ou trans-media (avec Hélio Oiticica et surtout Gordon Matta-Clark pour la question du site/non-site). Tout se passant comme si l’exposition problématisante du « site » dans la négociation du passage (le plus risqué) de la plénitude vivante de l’expérience esthétique (Art as experience, selon l’intitulé-phare du livre de John Dewey) à l’art comme expérimentation extra- ou non-esthétique déterminait l’orientation contemporaine de l’art du côté de la critique et de la clinique de l’organisation sémiomatérielle du temps présent.
Mais il faut dire enfin quel est le trait majeur de cette discontinuité qui se déploie en synthèse disjonctive de l’art contemporain. Nous l’avons regroupé sous l’idée de régime ou d’agencement diagrammatique pour le distinguer du régime esthétique de l’art et de l’analyse formelle qui sous-tend sa par trop générique indétermination constitutive : c’est chez Jacques Rancière ce moment historico-transcendantal de révolution totale propre à ces « nouvelles formes de visibilité et d’intelligibilité » qui ne définissent jamais aucun contenu spécifique pour étendre à l’infini le domaine de leur condition de possibilité. Or ce nom de « diagrammatique », tel que nous l’impliquons dans un défaire l’image du régime esthétique de l’art, nous reconnaissons volontiers que nous l’avons utilisé comme un mot de passe. C’est aussi que le diagramme engage l’usage qu’on en fait (« pas de problème de sens, mais seulement d’usage ») pour qu’on puisse passer des conditions de possibilité (des formes) aux conditions de réalité (des forces) ; et que l’on puisse avancer dans l’exploration d’un art-pensée contemporain dont nous percevons tous qu’il n’est pas plus celui d’hier que celui d’un « bel aujourd’hui » collectionnant tout ce qui s’y passe.
Sur ce point, il faut rappeler que la logique de la position esthétique si profondément redéfinie par Rancière dans un postkantisme ayant recouvré (pace Schiller) son horizon métapolitique pour faire vaciller les partages les mieux établis du sensible et de l’intelligible se déploie « depuis la fin du xviiie siècle ». Rupture fondatrice avec l’ordre représentatif et hiérarchique des arts, l’esthétique est l’affaire d’une reconfiguration ouverte de l’expérience découpant le singulier de l’art dont on pourra faire, en amont de l’épuration greenbergienne, « contre-histoire » de sa modernité artistique en la replongeant dans la longue durée des jeux de l’autonomie et d’une hétéronomie « synchrone avec toutes les vibrations de la vie universelle » – sans, donc, que la question du contemporain et de l’art contemporain n’émerge jamais comme problème. Mais n’en va-t-il pas de même du côté symétriquement inverse de l’« inesthétique » d’Alain Badiou ? Après avoir repris à ce titre ce que l’on pourrait aussi bien tenir pour l’inclination romantico-moderniste la plus consistante de l’esthétique philosophique (« décrire les effets strictement intraphilosophiques produits par l’existence indépendante de quelques œuvres d’art »), Badiou pose le constat de la saturation de tous les schèmes empruntés par les arts du xxe siècle en des synthèses diverses – sans en avoir (dit-il) inventé aucun de nouveau (didactisme platonicien, classicisme aristotélicien et romantisme leur préexistent). Ne reste plus que « la recherche désespérée et instable d’un schème médiateur […] didactico-romantique » qui ne pouvait survivre à la disparition des avant-gardes que sous l’espèce contemporaine dégradée d’un « formalisme romantique ». La relève « affirmationniste » qu’en propose Badiou s’invente alors sur mesure l’ensemble-cible d’un art contemporain faisant l’objet de « maximes » (c’est-à-dire de prescriptions) en forme de réquisition où le solennel le dispute à la parodie du genre « Manifeste ». Mais au lieu de l’exercice du nouveau schéma d’affirmation (inesthétique) des vérités d’un art irréductible à la philosophie en sa pensée singulière immanente à la réalité des œuvres, on assiste au nouage le plus attendu du platonisme au modernisme – soit la vérité dernière de sa philosophie – réglant une généalogie réaffirmative du « grand xxe siècle » dont le propre – valant pour propre de l’art – aurait été de soustraire la « forme » au romantisme de l’expressivité dans un « vouloir artistique » qu’il faut savoir « restituer […] à sa rigueur incorporelle ». Ainsi mis au service du dogme moderniste de l’autonomie de l’art et de ses genres, le platonisme de l’Idée sera fondé à condamner les tentations du « motif multimédiatique d’un art multisensoriel » tout en récupérant en guise de situation contemporaine d’un « réel sans image » la « transformation du sensible en événement de l’Idée » par une « soustraction matérielle » qualifiée de « purification », qui synchronise et formalise au présent des abstractions de l’art l’idéation hégélienne des arts selon leur puissance de dématérialisation. « Jusqu’au moment où plus rien de réel n’est tenu, faute d’évidence [sensible], faute d’impureté ». Mais on prendra garde à toute résonance trop forte avec le thème de la fin de l’art, car l’inesthétique s’affirme bien plutôt ici comme l’envers le plus tordu d’une esthétique hégélienne rappelée à son ancrage dans la « forme sensible de l’Idée » pour mieux accuser sa continuité paradoxale avec la conception deleuzienne de l’art ramenée à l’incarnation de l’infini dans le fini.
Car c’est par rapport à celle-ci que, sous couvert d’explication avec Hegel, Badiou lance in fine ses pointes les plus acérées dans l’art contemporain en indiquant en creux pourquoi Deleuze ne pouvait, en vérité, s’approcher de cette zone à hauts risques. Le plus mordant tient à la critique de la sacralisation romantique de l’œuvre, et de l’artiste comme agent de la descente de l’infini dans la finitude de l’œuvre (en écho à certains passages de Qu’est-ce que la philosophie ?). Cette critique, Badiou la mène (dans Le Siècle) au nom d’une « conception intégralement laïcisée de l’infini » procédant directement du fini et de la finitude agissante dans le procès mis en œuvre selon des modalités événementielles supposées épouser les ruptures majeures de l’art moderne-contemporain (de la critique de l’œuvre-tableau au ready-made et à l’art minimal). La logique de cette position se laisse résumer, chez lui, sous la notion de « formalisation expérimentale ». Elle cherche à saisir la forme comme l’indice matériel de la formalisation couplée au réel de l’acte d’une Idée prenant ainsi sur elle l’ouverture infinie de la visibilité de la puissance du fini. Alors, l’infini n’est plus capturé dans la forme, il transite par la forme finie qui, prise dans l’animation de son acte, est l’infini dont l’art est capable dans la multiplicité de ses formalisations. On comprend mieux que le philosophe puisse « remarquer » que « le siècle [artistique] est en discussion avec Hegel » puisqu’on a ainsi renversé la « forme sensible de l’Idée » en Idée de la forme comme acte de formalisation du sensible en événement de l’Idée. La forme n’est plus classiquement « mise en forme d’une matière, de l’apparence organique de l’œuvre, de son évidence comme totalité » ; elle se conforme à l’acte de dématérialisation du sensible qui formalise l’Idée comme cet « infini qualitatif » affirmant ce que Hegel appelle encore la « qualité pure du fini lui-même », et qui est comme son fond « subjectif » extrait de la valeur brute de la répétition quantitative (des produits ou des œuvres).
On ne saurait nier qu’il y a là, contre l’intention de départ mais en puissance, et en puissance des formes qu’elle formalise, une philosophie inesthétique de l’art contemporain qui ne demande qu’à déployer ses effets d’intelligibilité les plus anti-phénoménologiques dans la séquence ouverte par Duchamp, avant de retourner son axiomatique contre cette (supposée) esthétique romantique deleuzienne si peu contemporaine pour avoir prolongé d’une douteuse seconde vie « inorganique » la mise en tension de la forme finie par la visitation de l’infini. L’ontologie (badiousienne) de l’art pousse ainsi la forme en ses derniers retranchements contemporains et dans l’art contemporain du côté d’une « formalisation expérimentale » dont le « diagramme » (ou la diagrammatisation expérimentale) est la rigoureuse alternative au niveau même de « ce que l’acte artistique autorise de pensée nouvelle » en commençant par excéder dans un devenir multiplicateur des forces les jeux d’évanouissement de la forme dans l’acte. Une pensée nouvelle, une pensée contemporaine de l’art comme capture des forces… qui obligent, sauf à se payer de mots, à « affirmer » la quantité (un « infini quantitatif ») et la relation (le processus et les opérations de mise en relation plutôt que l’acte par quoi se modernise le platonisme du même). En effet, si toute force est relation de forces et n’a pas d’autre être que le rapport (de forces : immanence), la construction (toujours singulière) d’un diagramme des forces agit transversalement aux points qu’il connecte en mobilisant des « points relativement libres ou déliés, points de créativité, de mutation, de résistance » dans une « distribution de singularités » redéfinissant la force en tant qu’affect : c’est chaque force qui a le pouvoir d’affecter d’autres forces (avec lesquelles elle est en rapport) et d’être affecté par d’autres encore. À l’encontre des deux procédures de « vérité » maintenues distinctes dans l’art et la politique par Badiou, c’est toute une conception micropolitique du « réel » qui s’avance à destination de l’art dans ce phrasé deleuzien dont il nous faut brièvement expliquer le montage et le contexte.
Le travail avec Guattari aura aiguillé, avant les développements les plus importants dans Mille plateaux, la première reprise du terme de « diagramme », par le seul Deleuze, dans un article consacré en 1975 à Surveiller et punir, à partir d’un hapax employé par Foucault pour qualifier le Panopticon comme « le diagramme d’un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale ». Mais la « forme idéale » est biffée par Deleuze pour lui substituer le principe d’une « machine abstraite […] coextensi[ve] à tout le champ social » qui ne scelle pas la différence de nature entre « micro » et « macro » sans se voir vite infligée d’une double direction ou de deux états opposés du diagramme : le « diagramme du pouvoir » réglé par un principe d’intégration des forces qui est un plan d’organisation lié à l’État (en tant que régulateur molaire des « micro-données » du diagramme) ; et le « diagramme des lignes de fuites […] lié à une machine de guerre » animant le « champ d’immanence collectif ». C’est en fonction de cette double instanciation que Deleuze oppose aux dispositifs de pouvoir foucaldiens sa propre conception d’« agencement de désir » élaborée avec Guattari. Elle affirme le primat du désir (toujours agencé : un constructivisme désirant) et des lignes de fuite sur le pouvoir dont les dispositifs, aussi abstraits soient-ils, sont toujours de reterritorialisation à l’horizon d’un capitalisme qui ne cesse de recoder et d’axiomatiser ce qu’il déterritorialise de première main.
Appelée par cette révolution copernicienne en désir/pouvoir, la fonction micropolitique de déterritorialisation expérimentale dont l’art va devenir le laboratoire en reconduisant les « Idées » aux rapports de forces les plus matériels se confirme par l’argumentation développée par Deleuze : « si les dispositifs de pouvoir sont en quelque sorte constituants, il ne peut y avoir contre eux que des phénomènes de “résistance” ». Au lieu de quoi on affirmera l’existence de phénomènes de création passant par une pensée devenue machine de guerre de déterritorialisation absolue, positive, et se définissant par un diagrammatisme dont Deleuze anticipait le régime dans son article sur Foucault : « le diagramme ne fonctionne jamais pour représenter un monde objectivé ; au contraire il organise un nouveau type de réalité. […] Le diagramme n’est pas une science, il est toujours affaire de politique […] défaisant les réalités et les significations précédentes, constituant autant de points d’émergence ou de créationnisme, de conjonctions inattendues, de continuums improbables ». « Il double l’histoire avec un devenir », conclut Deleuze, par la carte des forces, ou intensités (une carte intensive), qu’il pilote. Le diagramme y est soumis à une déterritorialisation qui le détache de son usage scientifique commun pour participer d’un « art » de la cartographie du présent indissociable d’une distribution d’affects subjectivant l’ensemble du procès en le qualifiant comme « désirant ». Si le principe d’une pensée diagrammatique s’extrait ainsi de la compréhension « schématisante » du diagramme en prolongeant son usage foucaldien jusqu’à en renverser la logique, encore faut-il que sa déterritorialisation s’inscrive au lieu même de l’exercice du diagramme qui confond, per se, jusque dans son étymologie en dessin-écriture, espace de visibilité et champ de lisibilité, sans se limiter au formalisme expérimental d’une coadaptation abstraite entre forme d’expression et forme du contenu. La « solution » deleuzo-guattarienne pourra apparaître à son tour désespérément formelle et vaguement tautologique :
« C’est donc le contenu le plus déterritorialisé et l’expression la plus déterritorialisée que le diagramme retient, pour les conjuguer. Et le maximum de déterritorialisation vient tantôt d’un trait de contenu, tantôt d’un trait d’expression, qui sera dit “déterritorialisant” par rapport à l’autre, mais justement parce qu’il le diagrammatise, en l’emportant avec soi, en l’élevant à sa propre puissance. »
Il y va pourtant des virtualités réelles d’un « diagramme révolutionnaire d’où découlent à la fois un nouveau faire et un nouveau dire » dans des conditions qui, pour atteindre à « des matières non formées, non organisées, et [à] des fonctions non formalisées, non finalisées », et relever en conséquence de l’élément informel des forces qui baigne le visible et l’énonçable, pourront produire « l’exposition des rapports de forces qui constituent le pouvoir ». Car ce sont sur ces rapports de forces qui se jouent entre le contenu et l’expression que se détermine « la stabilisation des rapports de déterritorialisation » du point de vue de leur formalisation (tendant à une reterritorialisation axiomatisante) et des formations de pouvoir (stratification) ou, tout au contraire, le montage d’une machine de déterritorialisation intensive qui se porte sur les flux de signes en les engageant dans des procès de conjonction diagrammatique en prise sur les flux matériels de toute nature dans lesquels ils travaillent toujours plus. Mais ici et là, « avant l’être, il y a la politique », qui ne vient pas après : « diagramme » est aussi le nom et le processus conduisant à cet énoncé qui met en situation de mise à l’être les pratiques génératrices d’hétérogénéité et de complexité.
« Les signes travaillent à même les flux matériels » : c’est le lemme guattarien qui a lancé le constructivisme du désir, corrélatif de la déterritorialisation ontologico-politique du signe et de l’image, dans la machination du diagramme et sa fonction d’embrayeur sur une dimension de créativité processuelle qui se reconnaît de moins en moins dans les formalités esthétique/inesthétique de l’art. Mais cette formule phare de Guattari signe aussi la remise en jeu du contemporain et de l’art comme expérimentation dans la trajectoire d’une pensée – celle de Deleuze. Si elle ne se pensait que forcée par l’intrusion problématique d’un « signe » qui la dépouille de la représentation jusque dans la révolution copernicienne du sujet et de l’objet, la signesthésie guattarienne commande au passage d’une pensée-artiste qui investit la révolution de l’abstraction en peinture comme modèle d’une « pensée sans image » faisant monter le « sans fond » des forces au niveau des formes (une animation vitaliste de l’abstraction) à une pensée micropolitique de l’abstraction se déterminant réellement (une « abstraction-réelle ») dans le décodage et la déterritorialisation généralisés des flux matériels et des signes caractéristiques du champ d’immanence capitaliste, avec la coextension du champ social au désir qui le définit et le dé-définit dans un art devenu « mineur ». En sorte que s’orienter au présent dans la pensée, c’est se redéfinir entre capitalisme et schizophrénie – pour reprendre l’intitulé unique de la pensée deleuzo-guattarienne et le lieu d’émergence de leur pensée diagrammatique. Ne partage-t-elle pas avec la « schizophrénie », ou le processus schizophrène, l’expérimentation des flux décodés et déterritorialisés qu’elle rend à la production désirante, à la limite de toute production sociale ?
On peut avancer maintenant, très vite, que l’on ne touche pas ici à l’implication diagrammatique de la pensée deleuzo-guattarienne (ou guattaro-deleuzienne) en son plan d’insistance le plus politiquement aiguisé sans que le « diagramme », dépassant la lettre et l’intention de ses géniaux machinistes, ne puisse s’expliquer et se compliquer singulièrement en glissant dans le « et » reliant capitalisme et schizophrénie (identité de nature, différence de régime) la possibilité constituante d’une ontologie de l’art contemporain en tant qu’art-cartographie de notre présent. (De là, aussi, qu’il puisse se caler sur le capitalisme de laboratoire des creative industries.) L’accès en sera commandé par le sens opératoire toujours singulier du diagramme, mis en variation dans différents types de montage. Que ceux-ci n’aient peut-être en commun que d’affirmer dans une perspective contemporaine ainsi reconfigurée l’art comme machine abstraite-réelle forçant l’infini à procéder directement du fini confirme l’identité-altérité problématique (non théorématique) d’un « diagramme » qui, depuis Peirce, n’engage la réalité du possible qu’en s’élevant aux virtualités d’une expérience de pensée mais qui doit aussi produire l’actualité de son fonctionnement direct dans une matière-flux (aussi déterritorialisée et sémiotisée soit-elle). Aussi les diagrammes pourront-ils avoir des noms propres d’artistes, mais qui désigneront des opérations et des effets plutôt que « des personnes et des sujets ». Ce qui, en guise de méthode de « remontage » du contemporain, détermine toute une pragmatique des effets diagrammatiques et de leurs repérages. Pragmatique qui engage à son tour la réalité de la politique d’expérimentation mise en jeu par ces forces-signes qui s’attaquent aux « strates » pour en faire fuir quelque chose d’imprévisible et y faire passer la forme-art.
C’est aussi le « principe » d’un art participant d’une condition post-conceptuelle qui dévie de l’interprétation globalement macropolitique de tout l’art contemporain et du modèle de politisation archiviste de l’art conceptuel (ledit Global Conceptualism) auquel elle a donné lieu. Pour le lecteur de Multitudes, cela recommencera dans le Panthéon de la république occupé par la multitudo dissoluta du Leviathan Toth sur lequel ouvre Défaire l’image. Panthéon dont on nous accordera que son âge est à peu près celui de l’« esthétique ».