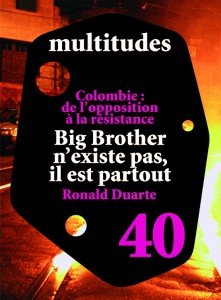Santa Teresa est un ancien quartier bourgeois situé au-dessus des collines de Rio de Janeiro dont les flancs ont été occupés par des « favelas ». Ses demeures décadentes sont très appréciées par les artistes et les intellectuels, jeunes ou précaires. Ronald Duarte y habite et décide de « montrer » le monstre carioca, c’est-à-dire la violence qui fait irruption dans la ville à tout moment du quotidien apparemment paisible d’un peuple qui se dit « cordial ». Difficile de le montrer quand les médias monopolisent les discours et stigmatisent les jeunes métis qui ont choisi le trafic de drogues (et, par conséquent, le port de grosses armes à feu) comme forme de vie. Santa Teresa est loin d’être le seul quartier à se trouver souvent sous les « fogos cruzados », c’est-à-dire, sous les échanges de coups de feu entre trafiquants de drogues, ou entre police et trafiquants. Il ne s’agit pas pour Ronald Duarte de se faire l’écho du discours médiatique qui décide où est le « Bien » et le « Mal », il ne s’agit pas non plus de faire l’apologie de la violence mais de la « montrer » pour éviter qu’elle ne devienne un sujet tabou. Il fait alors appel à sa pratique de la religion afro-brésilienne. Le candomblé est polythéiste et, du coup, non manichéen. Ses divinités sont 12 orixás qui, comme les hommes et les femmes, ont beaucoup de qualités et de défauts. Ni Dieu ni Diable, Exu – orixá de la terre, de la puissance, du sexe, du mouvement et de la communication – est ambivalent, c’est-à-dire que le sens de ses actions doit être construit par la communauté. En 2001, tel Exu qui lance du sang sur la terre avec l’aide de ses guerriers, Ronald appelle ses amis et innonde les rues de Rio avec de l’eau pigmentée de rouge lancée par une citerne d’eau[1]. O Q Rola Você V[2] (2001) ouvre ainsi la guerre des débats médiatiques et artistiques sur la guerre à Rio. L’action, enregistrée en vidéo, lance la série « Guerra é guerra »[3].
Il est 3 heures du matin du matin à Santa Teresa et c’est ensuite Xangô – l’orixá de la guerre dont les éléments sont le fer et le feu – qu’invoque Fogos Cruzados (2002). Ronald rassemble artistes et gens du quartier, et met le feu aux 1500 mètres de rails du tramway. Un vieux dicton dit « quem brinca com fogo pode-se queimar »[4]. À Rio, on ne joue pas avec le feu, c’est-à-dire, avec la police tout à fait biopolitique[5] qui décide sans hésiter qui tuer ou ne pas tuer selon sa couleur de peau. Par précaution, des T-shirts où l’on pouvait lire « Ronald » avaient été imprimés et distribués aux participants du rituel, de sorte que lorsque la police est arrivée et a demandé qui était « Ronald », elle s’est trouvé face à une légion. C’est donc la multitude réunie autour de ces rails brûlants qui doit non pas « juger » mais décider quel sens donner à la violence de ces jeunes qui vivent dans les favelas cariocas bourrés d’armes et de coke. « A Sangue Frio »[6] (2003) met en scène leur destin : des blocs de glace d’environ un mètre vendus dans le commerce ont été enroulés avec les couvertures caractéristiques dont les jeunes abandonnés se servent pour dormir dehors, tachés de colorant rouge et éparpillés dans les rues du centre-ville sous les regards indifférents. Le thème et l’inquiétude de la violence restent aussi présents dans une autre performance, « Traçantes » (2003), qui simule sur le corps de l’artiste la trajectoire lumineuse des balles traçantes : nombreuses sont les victimes de « balas perdidas », ces balles perdues qui, contrairement à leur dénomination, trouent bien des corps.
Les références afro-religieuses continuent dans « Pisando em Ovos » (2005), intervention urbaine d’une vingtaine d’artistes coordonnés par Ronald avec plus de 3000 œufs sur l’Esplanada des Ministères à Brasília. « Marcher sur des œufs » fait appel à la prudence pour ne pas reproduire les accusations et dénonciations médiatiques de corruption du gouvernement et donner d’autres sens aux événements. La possibilité du passage de la politique de la représentation à une radicalisation de la démocratie est ainsi présentée par un « ebó » aux Orixás pour redonner de nouvelles énergies à Brasilia. De la capitale fédérale planifiée, symbole même de la modernité brésilienne, nous nous dirigeons maintenant vers la démesurée banlieue de Rio de Janeiro. Réalisée avec Aderbal de Ashogum, « Treme Terra »[7] (2006) est une construction de sculptures sonores avec 50 « atabaques »[8] de 8 terreiros – centres « spirituels » du Candomblé, mais dont l’étymologie indique bien le lien à la terre – de la Baixada Fluminense.
Si Exu est la référence de la série sur la guerre, c’est à Oxalá que Ronald rend hommage dans « Nimbo Oxalá », sculpture éphémère de liens durables ou non, réalisée dans plusieurs villes du Brésil et du monde. Les participants réunis en cercle, vendredi à midi, tout de blanc vêtus et extincteurs à la main, forment un immense nuage au son des tambours. Ici, il n’y a pas de recherche du paradis perdu ou de la naïveté primitive dans un mythe de la création qui pourrait séduire des touristes malades de civilisation. Tel Oxalá, Ronald ouvre des possibles à la création artistique et à la transformation sociale avec son engagement dans le collectif artistique Imaginário Periférico, dans le magazine d’art et de politique Global/Brasil et dans le réseau Universidade Nômade qui milite pour la démocratisation de l’accès à l’université brésilienne. Malgré la présence des éléments de la nature, le travail de Ronald est profondément lié aux luttes des métropoles et se développe dans un contexte d’une riche production d’images et de sons provenant des « favelas » et des banlieues – grafitti, musique, photo, cinéma et audiovisuel en général. Cette production d’une part est immédiatement intégrée dans l’économie formelle emballée sous l’étiquette « estética da periferia » et, par ailleurs, nourrit aussi un circuit alternatif de vendeurs de rue pourchassés eux aussi par les forces de l’ordre. « Funk da Coroa » (2007) confirme cet agencement de la religion avec les mouvements sociaux urbains. Alors qu’après des siècles d’interdiction, la samba gagne le statut d’art et la capoeira celui de sport, le « funk » de Rio est à son tour combattu par les médias et la police sous prétexte d’apologie de la violence du narco-trafic ou d’exaltation de la sexualité. Au Musée Impérial de Petrópolis[9], Ronald remplace le paysage bucolique déployé par les grandes fenêtres de la Salle de Musique par des photos du Morro da Coroa, une des « favelas » les plus violentes de Rio, et branche un funk « proibidão »[10]. Le musée l’interdit.
Finalement, tous les circuits ouverts par ces agencements – communication verticale entre la terre et le ciel ou entre l’événement et l’éternel, mais surtout connexion horizontale entre toutes les singularités d’une communauté éphémère et fugitive – se présentent comme des résistances à la régulation biopolitique des circulations matérielles et symboliques. Ces résistances ne devraient pas, de par leurs apparences exotiques, être placées du côté des « pré-médias », mais plutôt envisagées comme phénomènes de l’ ère « post-médias »[11] et aussi, dans la mesure où le capitalisme contemporain, dit cognitif, cherche ses modèles du côté de l’art[12], de l’ère « post-art-contemporain » . Plus que les origines africaines, c’est un devenir brésilien[13], mortel et vital à la fois, que le « travail »[14] de Ronald Duarte – artiste et comunicateur-connecteur, exprime et par lequel il imprime de nouveaux sens à des formes de vie qui, souvent présentées comme violentes, redeviennent puissantes. Laroyê Exú ![15]