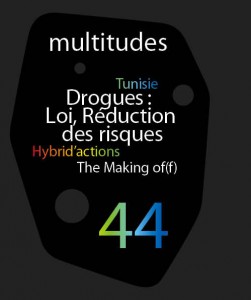Par sa pratique photographique, depuis près de vingt ans, Bruno Serralongue décrypte l’événement en constituant des séries sur les conférences de presse, les manifestations, les sommets mondiaux, les grèves… À travers ses photographies et ses expositions, l’artiste cherche à révéler les normes de la représentation qui contribuent à façonner les subjectivités. Sa proposition visuelle offre alors au spectateur la possibilité de repenser ce qui lui est donné à voir. À la fin des années 1990, il a ainsi réalisé deux séries assez singulières au regard du reste de son œuvre, en s’immergeant dans les rédactions de deux journaux quotidiens. Ces séries, sur lesquelles nous nous sommes entretenus, sont issues d’une démarche qui renverse les codes habituels de l’artiste. Car, en prenant intentionnellement la place du journaliste, Serralongue questionne les frontières de la représentation du réel. Faisant de sa dernière exposition, Feu de camp[1], un « moment de direct », le photographe cherche à renouveler la pratique en opérant un subtil glissement de l’art à l’événement.
Victor Secretan : Ton discours critique sur les événements et l’information est-il issu de ce passé de photo-journaliste qui t’est attribué ?
Bruno Serralongue : Je me suis toujours intéressé aux photographies et à l’information qui transitent par les journaux et j’ai effectivement travaillé à deux reprises comme photographe pour la presse, mais c’était à chaque fois dans le cadre de projets artistiques. La première fois, c’était en 1997 à Corse-Matin pour une commande du FRAC Corse (Fond Régional d’Art Contemporain) puis j’ai réitéré cette démarche en 1999 au sein du quotidien national Jornal Do Brasil. À chaque fois l’idée était de reprendre les codes visuels, ainsi que les protocoles de travail des photographes associés aux rédactions, pour produire des images publiables et publiées. Il n’y avait rien qui signalait ma présence en tant que présence étrangère car mon nom était crédité comme les autres photographes sous les images.
Le premier temps du travail était la production de photographies dans un champ particulier. Dans un second temps, il s’agissait d’extraire les vingt photographies publiées dans les pages de Corse-Matin. Ce sont celles-ci, sous forme de tirages noir et blanc, qui appartiennent au FRAC Corse. Les recadrages effectués par la presse ont été conservés. La publication était comme un filtre qui donnait le droit aux images d’exister.
V. S. : Durant ce mois à Corse-Matin comment as-tu évolué au sein du journal ?
B. S. : Je jouais le jeu totalement. Le matin, je participais à la conférence des rédacteurs où l’on se voyait attribuer les sujets et après, seul ou avec un journaliste papier, j’allais faire des photos. Pour Jornal do Brasil, j’avais un chauffeur pour des raisons logistiques. À chaque fois, j’étais dans les conditions exactes dans lesquelles les autres photographes travaillaient, je n’étais pas assisté, j’étais autonome, de plain-pied dans la fabrication d’une image telle qu’elle peut être dans les codes journalistiques. D’ailleurs, j’ai travaillé au 24 x 36, qui est le format traditionnel de la presse.
V. S. : Cette confrontation au processus de production d’images journalistiques n’a pas empêché la publication de tes photographies dans ces deux quotidiens. Pourquoi et sur quelles bases tes images étaient sélectionnées pour publication ?
B. S. : Un double choix présidait à la publication des photographies : la qualité informative de l’image mais aussi celle de l’article.
C’est vrai qu’il y a des images que je faisais de trop loin, mais, comme parfois j’étais le seul photographe à avoir couvert un sujet et que l’article devait à tout prix être publié avec photo, (car dans la presse régionale la photo fait vendre, une personne qui se reconnaît achète le journal) elles sont parues, même si, un décalage esthétique flagrant pouvait se voir avec celles produites habituellement. La question de la distance est essentielle dans la photographie de reportage en général. Être au plus près du sujet c’est encore et toujours, pense-t-on, être au plus près de la vérité. C’est sur cette croyance que j’ai axé mon projet.
Cette série Corse-Matin a autorisé quelques personnes à penser que j’étais photographe de presse avant de basculer dans le champ de l’art contemporain, ce qui n’est pas du tout le cas ! Comme je l’ai dit précédemment, les informations circulant dans les médias sont à l’origine de mon travail.
V. S. : Dans un article[2], paru dans Multitudes no 23, Alexandre et Daniel Costanzo propose une lecture de ton point de vue qui, selon eux, réside dans « l’écart » que tu creuses « entre ce que l’on voit et ce que l’on nous donne à voir ». Dans ces deux séries Corse-Matin et Jornal do Brasil, ta confrontation aux normes de la représentation est différente de celle du reste de ton œuvre. Qu’as-tu trouvé à travers cette démarche hybride, d’ailleurs unique au regard du reste de ton œuvre ?
B. S. : Déjà, il faut garder à l’esprit qu’un quotidien, comme son nom l’indique, est publié tous les jours. Il faut comprendre cette temporalité cyclique. La course contre la montre, faire remonter les informations sous forme de textes et de photos avant l’heure du bouclage, tout cela est central dans la fabrication d’un journal. Après c’est trop tard, et il n’est pas sûr que l’information soit reprise le lendemain, elle est souvent tout simplement jetée parce que le monde tourne… Et ça recommence tous les jours presque à l’identique. Ce ne sont jamais les mêmes articles, les mêmes photos, mais il y a une routine, un moule, un cadre préexistant qui borne et norme le produit fini.
Une usine fabrique en permanence les mêmes objets à flux tendu. C’est la même chose pour la presse. Il faut donner en permanence à « la machine » des photos et des textes. Il y a très peu de possibilité de reprises. C’est aussi ce qui m’intéressait. C’est presque du direct. Autant un livre ou le travail artistique peut être fait de reprises, de repentirs, autant là, même si ce n’est pas à proprement parlé du direct, ça reste une production en rapport avec l’immédiateté, une fois qu’il y a eu le « top » pour l’impression, c’est fini.
Dans la continuité de cette réflexion, j’ai entamé un travail qui consiste à réaliser une collection des rubriques de rectificatifs et de précisions que les journaux sont obligés de publier quand on leur signale une erreur. Comme les faits-divers de Nice-matin, je découpe les rubriques et je les classe simplement. On accorde une grande confiance aux journaux papier, mais le nombre d’erreurs publiées est impressionnant. Certes, elles sont parfois anecdotiques, Madame untelle au lieu de Monsieur untel, mais permettent de questionner la confiance que l’on accorde aux journaux.
V. S. : Pourquoi ces images n’étaient pas présentées dans ta dernière exposition Feu de camp ?
B. S. : Je m’étais posé la question puisque bien évidemment ces deux séries auraient fait un bon contrepoint à ce qui était présenté. Chronologiquement elles se situent au début de mon travail (1997 et 1999) mais j’avais déjà enclenché ce grand cycle de séries sur les événements qui se passent dans le monde puisque la première série Encuentro, Chiapas a été faite au Mexique en août 1996. Ces deux séries Corse-Matin et Jornal Do Brasil découlent de cette réflexion sur l’information et sur une profession, le photojournalisme. C’est plutôt le travail antérieur qui a fait naître ce désir d’inverser le rapport aux images, non plus d’être extérieur à l’information (lecteur) mais d’être professionnel, de travailler de l’intérieur.
Pour l’exposition Feu de camp au Jeu de Paume, l’information était abordée depuis la place du lecteur de journaux (pour reprendre le titre de l’article de Carles Guerra[3] publié dans le catalogue). La dialectique, la tension, ne se situait pas entre le dehors et le dedans, entre l’amateur et le professionnel, entre deux modes d’accès à l’information : le hasard et l’anticipation du professionnel, mais dans les choix d’accrochage.
V. S. : La scénographie de l’exposition était, en effet, fondamentale pour saisir ton questionnement par rapport à l’événement. Finalement le réel semblait être accroché aux murs de la salle et la mise en scène s’exercer dans nos quotidiens.
B. S. : L’exposition du Jeu de Paume s’est montée à partir de deux intentions, ne pas construire de cimaises et ne pas organiser de parcours chronologique. Retrouver l’espace originel pour donner tout à voir d’un seul coup. Sans pour autant privilégier le chaos, j’aimais l’idée qu’en se plaçant au centre de la salle, le spectateur ait accès à toute l’exposition. Je me suis dit qu’il serait intéressant de regrouper les photographies par thèmes et non plus par séries. Montrer les séries les unes après les autres aurait mis en avant les événements propres à chacune. Là, je crois que j’ai voulu mettre en avant l’exposition comme un événement, (« direct »), comme un moment de direct. Pour cela, il fallait que les images coexistent les unes avec les autres, quitte à brouiller, à rendre moins lisible, les sujets. Parce que je crois que c’est comme cela que nous regardons les images aujourd’hui, non plus dans la linéarité, la succession mais dans la confrontation.