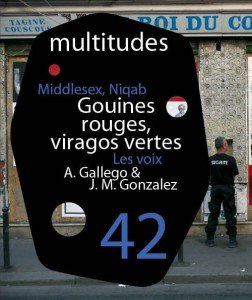Chaque société se crée son propre noyau de problématiques, auquel elle confère un rôle central et c’est autour de ce noyau que s’élaborent des questions et des réflexions récurrentes, ainsi que des appareillages conceptuels sophistiqués qui ont à la fois pour but de réduire les dilemmes et d’élargir les questionnements. Les priorités établies s’étendent d’ailleurs aux formes et aux moyens par lesquels ces questions sont posées et réitérées. Cet essai cherchera à cerner l’un de ces noyaux, dans une approche évidemment partielle et aux objectifs modestes et circonscrits. Il s’agit d’une géographie imaginative qui a modelé au Brésil une catégorie d’espace, le sertão, comme l’une des principales façons de dire et de définir la nation, et qui a choisi le cinéma comme moyen d’expression approprié. La perspective sera ici celle de comprendre comment Le Dieu noir et le Diable blond de Glauber Rocha, récit d’une importance sans pareille dans la filmographie nationale, a construit le sertão, quelles images et figures y sont utilisées et comment ce sertão définit et projette le Brésil.
Espace, trope, sertão
Dans l’un de ses textes les plus exaltants Michel de Certeau nous rappelle que dans l’Athènes contemporaine les transports collectifs sont appelés metaphorai : les grecs utilisent des métaphores pour se déplacer – dénomination qui dénote l’intime relation existant entre espace et récit. La locomotion, le déplacement dans l’espace, est métaphorique, puisque la métaphore est justement la manifestation des façons de devenir autre, de se transfigurer. Les récits acquièrent ainsi valeur de syntaxes spatiales : ils sont des pratiques de l’espace. Ce raisonnement nous indique que la géographie imaginative qui invente le Brésil n’est pas isolée des récits et que chercher à la comprendre nous conduit inévitablement à la rencontre des formes du récit lui-même. Comprendre la nation et ses configurations spatiales, c’est donc aussi, si nous suivons De Certeau, analyser les stratégies textuelles utilisées pour raconter ses histoires et appréhender les tropes qui constituent les récits.
Trope signifie « tour », « forme », « manière ». L’anglais turn et le français tour ont longtemps été utilisés comme synonyme de trope. Ce lien indique une proximité entre les dimensions et les variations spatiales et la construction des récits, en reliant directement le style et l’espace, le lieu et la façon de raconter. L’analyse tropologique nous permet, selon Hayden White, d’approcher les stratégies textuelles caractéristiques des discours, puisque la connaissance des tropes permet au chercheur d’identifier des « formes structurelles profondes » de l’imagination historique.
La littérature et le cinéma sont devenus des moyens d’expression privilégiés dans le processus d’établissement des fondements symboliques impliqués dans la formation de la nation. Durant une longue période au Brésil, les meilleures expressions de la pensée brésilienne ont pris une forme fictionnelle. La recherche et la réflexion sur le Brésil ont commencé à travers la littérature et le cinéma, et c’est seulement avec l’institutionnalisation des sciences sociales que les rôles de romancier, de cinéaste et de sociologue ont pu se différencier, donnant lieu à la division du travail intellectuel que nous connaissons aujourd’hui. Écrivains et cinéastes comprenaient l’exercice de leur profession comme une mission, au cours de laquelle l’art ne se réalisait pleinement que par la présence d’une couleur locale et d’une prise de position face aux dilemmes de la nation. Dans leur recherche d’un représentant de l’idéal brésilien, la littérature et le cinéma ont mobilisé une notion spatiale spécifique – devenue prédominante dans la géographie imaginative du pays – qui devait porter en soi le symbole de l’identité nationale : le sertão.
Le dictionnaire Aurélio définit le sertão comme : « 1. Région de campagne, éloignée des villages ou des terres cultivées. 2. Terrain couvert de végétation, loin du littoral. 3. Province faiblement peuplée. 4. Zone provinciale faiblement peuplée du Brésil, en particulier celle de la région semi-aride de sa partie nord-occidentale, plus sèche que la caatinga, où l’élevage du bétail prime sur l’agriculture et où perdurent des traditions et coutumes anciennes. » Le sertanejo est l’habitant du sertão, qui, toujours selon ce dictionnaire, évoque les adjectifs suivants : « rustique », « agreste », « rude ». Les expressions « campagne, lointain, loin du littoral, faiblement peuplé, tradition et coutumes anciennes, rustique et rude » dénoncent le lieu d’où parle l’énonciateur, puisque le regard est toujours celui du « civilisé », du « littoral », du « moderne ». Ce procédé met à jour la distance impliquée dans l’acte même de repérage des signifiés. Le champ sémantique est porteur de valeur et signale un manque, un défaut constitutif du sertão et du sertanejo face au littoral civilisé.
Toutefois, plusieurs récits ont repris ces termes et désignations en inversant leurs valeurs : plus que des termes issus de la civilisation, ils en faisaient en réalité des formes positives, affirmant la différence face aux regards civilisateurs. C’est ainsi que le sertão, dans cet essai, doit être compris comme un terme qui met en lumière ces regards croisés et qui parle des liens entre « civilisés » et « non-civilisés », racontant par là même l’occupation territoriale du Brésil. Ces récits nous disent surtout quelque chose à propos de l’irréductibilité des Autres au sein de la nation, exprimant par là leurs différences.
Le terme sertão se trouvait déjà présent au XVIe siècle dans les récits de certains voyageurs. C’est néanmoins seulement dans la période comprise entre 1870 et 1940 qu’il devient une catégorie centrale dans les récits qui évoquent le Brésil. En ce qui concerne plus spécifiquement le cinéma, la thématique du sertão est apparue en 1908, avec Nhô Anastacio chegou de viagem, de Julio Ferrez, le premier film de fiction brésilien. Dans certains récits, le sertão est devenu le signe d’une nation inachevée : la recherche d’une homogénéisation territoriale s’est heurtée à la nécessité de combler les vides, impératif qui devenait la condition de l’unité nationale. Cet impératif souligne le besoin d’une représentation horizontale de l’espace – qui doit être comprise comme une évolution vers l’homogénéisation et l’unification du territoire national. Le sertão se présentait, dans cette perspective, comme le signe d’une fracture spatiale, et matérialisait la division de la nation. Son existence supposait une temporalité disjointe et justifiait, dans la conception de ces inventeurs du Brésil, une entreprise pédagogique de civilisation par les récits.
Renvoyant à des images de vide, de désert, le sertão se montrait soit comme un obstacle à l’homogénéisation territoriale et à l’élimination des temporalités disjointes, soit comme le garant même de l’identité nationale. De toutes les façons, même si l’on reconnaissait le sertão comme représentant le cœur de la « brasilianité » – ce qui, suivant ce raisonnement, en demeurait l’essence, car resté intouché par les souffles européens ou nord-américains –, il devait sa pérennité à une imagination civilisatrice, soucieuse de l’altérité au sein de la nation.
C’est de cette tentative de raconter la nation à travers la notion d’espace, en se saisissant du sertão pour parler du Brésil, que surgit l’un des films les plus importants de la cinématographie brésilienne, Le Dieu noir et le Diable blond de Glauber Rocha. Ce film se distingue parmi l’importante filmographie qui aborde les relations entre le sertão et la nation, et peut être considéré comme celui qui a le mieux exploré la géographie imaginative de la nation, à plusieurs titres : par le degré d’influence qu’il a exercé sur les cinéastes au Brésil ; par son importance dans le champ de la fiction brésilienne, puisque ce film a été considéré par de nombreux penseurs comme le « point fort du cinéma national » ; et, pour l’analyse que je développe ici, par la singularité de sa narration, c’est-à-dire par sa configuration tropologique. Cette singularité surgit d’une configuration spécifique de relations entre espace et récit, géographie imaginative et trope. D’où l’importance et l’aspect central de l’allégorie dans Le Dieu noir et le Diable blond, puisque l’allégorie, comprise comme métaphore continue, renvoie à la fois aux dimensions de mouvement et de glissement : confondant mouvement, espace et temps, elle devient une notion privilégiée pour comprendre le film de Glauber.
La nation et ses Autres
La différenciation du Brésil par rapport aux Autres a été soulignée par divers intellectuels, devenant même une question récurrente parmi ceux qui débattaient de la nation. Qu’ils se soient affirmés face à la tradition occidentale, ou qu’ils se soient accommodés de la présence gênante des autres au sein de la nation, tous voyaient l’écart se creuser entre les diverses façons dont on définissait le Brésil et dont on abordait l’irréductible présence d’autres au sein de la nation, écart qui allait à l’encontre des idéaux d’homogénéité de la « communauté imaginée ». La relation complexe entre la tradition dite occidentale et les données locales a ainsi engendré une abondante littérature et de vifs débats au cours de l’histoire brésilienne. L’incertitude au sujet des particularités de la « brasilianité » a hanté les intellectuels, qu’ils soient romanciers, poètes, essayistes ou cinéastes, faisant éclore une profusion de thèmes, qui vont des Indiens aux favelas et aux formes particulières d’urbanisation, en passant par le cangaço ou la pampa.
Le film de Glauber Rocha incorpore et transforme l’héritage du cinéma occidental et de la tradition cinématographique en général. Il s’agit de libérer le langage cinématographique de l’imitation des formes classiques du cinéma international, en particulier européen et nord-américain. Glauber réinvente les traditions littéraires ou cinématographiques, en cherchant à les transformer. En observant les citations contenues dans le film, on peut détecter des influences et la tentative de les dépasser. D’un point de vue cinématographique, on identifie Rosselini, Kurosawa, Eisenstein, Visconti ; en matière de théâtre, les tragiques grecs et Brecht ; en littérature James Joyce, Euclides da Cunha, José Lins do Rego, et fondamentalement Guimarães Rosa. Le mouvement de Glauber est double. Les expériences doivent être traduites, dans un processus complexe de déplacement et de reconfiguration. Et c’est précisément par ce processus de traduction – qui n’est jamais parfait – qu’il aboutit à un cinéma impur. Il s’agit bien ici d’un cinéma hybride.
Glauber utilisera les influences reçues d’Eisenstein, Renoir, Resnais, John Ford, Visconti ou Godard, mais en les inversant. Tout comme Guimarães Rosa, qui a cherché à faire usage de l’influence de James Joyce – entre autres nombreux auteurs – pour rendre compte et réinventer le parler du sertão, Glauber se prévaut de l’influence internationale pour créer un langage spécifique pour son cinéma. Le récit absorbe, mais transforme, imite, mais trahit. Le mouvement esquissé par Glauber ressemble donc à la réinvention de la langue par Guimarães Rosa, ce qui indique déjà l’intime relation entre les deux œuvres. Si, comme le remarque Willi Bolle[1], Diadorim réécrit Hautes Terres de Euclides da Cunha, Le Dieu noir achève la relecture d’une relecture, couche sur couche, construisant le sertão dans un tissu intertextuel – tissu qui déstabilise le langage, faisant place à une nouvelle manière de raconter.
Ceci est visible dans un extrait du film très commenté par les critiques. Il s’agit de la citation de la fameuse scène de l’escalier d’Odessa du Cuirassé Potemkine d’Eisenstein. Glauber en fait une nouvelle lecture, car si le montage du Cuirassé est rationnel, équilibré, évolutif et mathématique, celui du Dieu Noir est désordonné, discontinu, anarchique. Un glissement est à l’œuvre dans cette traduction, qui s’éloigne, tout en le citant, de cela même qu’elle évoque. Dans ce petit extrait, nous pouvons observer comment une exposition évolutive d’images se heurte à un langage fragmenté, dilacéré.
L’attitude de Glauber, qui cherche à éviter un langage trop proche de la tradition du cinéma occidental, est due en grande partie à sa tentative de s’écarter d’une perspective qui observe le sertanejo sous le prisme de la ville, c’est-à-dire d’un regard civilisé et civilisateur porté sur un Autre inconnu. Cette tentative de donner à voir l’autre sans le dompter, sans l’enfermer dans des cadres préconçus par un regard extérieur, participe également à la déstabilisation du langage mentionnée plus haut et permet d’aborder le sertão « du dedans ». La comparaison de O Cangaceiro de Lima Barreto et du Dieu noir pourra éclairer mieux ce que signifie cette déstabilisation qui permet de dire le sertão « du dedans ».
Les deux œuvres traitent du sertão et du cangaço. O Cangaceiro cherche à conférer à son objet un haut degré de vraisemblance, dans le but de montrer le sertanejo « véritable ». Le film se structure selon une composition qui s’en tient à un découpage classique ; les thèmes nationaux sont ainsi exaltés par un langage tributaire des modèles européen et nord-américain. Il existe dans O Cangaceiro une distance qui sépare le narrateur de son objet. Le narrateur « organise tout en fonction d’un regard unique, centralisateur, qui dispose les figures avec beaucoup de soin au moment de les faire poser devant l’objectif », nous dit Ismail Xavier[2]. La distance recherchée dans l’acte même de description place le sertanejo comme un Autre, en le séparant d’un Je civilisé. Le sertanejo est défini comme primitif et installé dans le passé, et il appartient au narrateur de le traiter comme objet d’étude à domestiquer. O Cangaceiro propose ainsi des racines à la nationalité, en soulignant que ces racines doivent être apprivoisées, civilisées. Le sertão représente le Brésil jusqu’à présent et doit être apprivoisé par la civilisation ; l’un des « deux Brésils » doit céder la place au Brésil civilisé. Enfin, les procédés narratifs imposent une irrémédiable distance entre ces deux Brésils.
Le Dieu noir cherche, au contraire, à supprimer cette distance qui caractérise O Cangaceiro, et ce par divers procédés narratifs : le narrateur centralisateur est éliminé, et l’utilisation de musique, du cordel[3] et des voix du peuple (celle de l’aveugle Julio, par exemple), conduit à une polyphonie qui décentralise la narration. Il y a enfin une exploitation intensive de la diversité des voix et de la variété des types de discours. Bien qu’essayant de leur rendre hommage, le film de Lima Barreto observe le sertanejo et le sertão avec une distance qui nous est révélée par le récit lui-même. Celui de Glauber cherche à éliminer cette distance, en accentuant surtout le caractère intertextuel du récit, en mêlant les « desenredos » (dénouements) et les « interteixos » (intertextes) – procédé permettant d’esquiver la réduction ethnocentrique qui considère le sertanejo et le sertão comme des figures de la pensée irrationnelle.
Les caractéristiques du Dieu Noir exposées jusqu’ici nous amènent à conclure que Glauber a conçu son film à l’épicentre des contradictions qui existent dans l’affirmation du Brésil face à un autre extérieur et face à la présence d’autres au sein de la nation, mais aussi dans la présence d’une pluralité de voix et de sujets historiques face à la volonté unitaire et aux agissements d’un État National qui planifie la diversité interne. Si Le Dieu noir doit être compris dans cette relation tendue avec les autres internes et externes – dans le contexte d’une nation qui, en même temps qu’elle produit la structure asymétrique de son altérité interne, définit la nature de ses relations avec les autres externes – et si Glauber cherche, simultanément, à dire le sertão de l’intérieur et à construire un cinéma national, il faut également prêter attention aux autres histoires que son film nous raconte à travers des allégories.
Allégories dans Le Dieu noir et le Diable blond
Glauber évoque des moments importants de l’histoire du Brésil, mais il procède tout au long du film de manière à s’écarter d’un certain réalisme factuel qui fut présent dans la filmographie brésilienne. Il soustrait les situations et les personnages à leur concrétude immédiate ; il recherche, par le biais du cordel, une structure simultanément réelle et fantastique – il élimine, en fait, la distinction entre réel et fantastique : il dramatise l’action en lui ôtant son caractère quotidien.
Les séquences du film expriment une intime connexion entre l’abstraction et la réflexion, en élaborant, par cette façon de narrer, une synthèse des dramatisations d’événements importants dans l’histoire du Brésil. Les faits et les êtres appartenant à l’histoire sont réinventés, les actions sont mises en scène, le comportement des personnages dépasse les attitudes quotidiennes, et la musique et les danses achèvent d’écarter le film des modèles conventionnels. La structure prime donc par la recherche incessante et jamais aboutie d’une déconstruction de tout lien direct et immédiat avec tout fait historique spécifique.
La structure narrative semble affirmer que le factuel n’est pas de première importance. C’est alors le langage qui accentue la dramatisation des scènes, produisant un effet d’irréalité. L’histoire se déroule sans chronologie, comme le montre la scène où Antonio das Mortes tue les fidèles et surgit à plusieurs endroits en même temps ; dans une autre scène encore, Corisco crie et saute sur les côtés dans des postures invraisemblables. Une autre séquence exemplaire est celle de la pénitence de Manuel qui porte, à genoux, une pierre sur le chemin de Monte Santo. La caméra suit chaque mouvement, mais nous offre aussi à voir des images de l’escalier. Le résultat est double : nous pouvons voir l’importance de la performance de Manuel et la caméra qui capte un tel effort produit l’intensité de la situation.
Le montage du film se refuse à montrer une succession de gestes continus et rationnellement situés, comme nous le rappelle Ismail Xavier[4]. Glauber préfère le procédé de la condensation. Il part d’une réalité multiple, dont il extrait le matériel nécessaire à son texte, dans le dessein d’établir des images à la fois précises et générales, abstraites et spécifiques. Lorsque nous voyons surgir, par exemple, les personnages d’Antonio das Mortes, Santo Sebastião, Corisco ou Manuel, ce qui apparaît à l’écran dépasse la singularité des figures historiques, car celles-ci condensent les personnages de divers mouvements socioculturels brésiliens. On observe ainsi que Corisco représente à la fois un personnage historique et tous les cangaceiros, outre la référence immédiate et significative à Lampião lui-même. Il s’agit donc de métaphores historiques : des allégories du Brésil.
Le Dieu noir évoque la guerre de Canudos, Juazeiro et le Padre Cicero, Virgulino Lampião, Corisco, Caldeirão, Sebastião et le Sébastianisme. À travers des déplacements de la réalité empirique et concrète, des métaphores et des images allégoriques traversent constamment le film pour raconter une certaine histoire du Brésil. Antônio das Mortes nous renvoie au Colonel José Rufino, meurtrier de Lampião, et représente, en même temps, tous les tueurs de cangaceiros. Corisco, possédé par l’esprit de Lampião, parle alternativement avec ses propres mots et avec ceux de Lampião. Le lien, qui semble d’abord métonymique (Corisco présenté comme figure historico-concrète) est en fait métaphorique : il représente les qualités des cangaceiros du sertão. La mort de Corisco et de Lampião, les événements de Pedra Bonita et de Canudos, la figure elle-même du tueur de cangaceiros Antonio das Mortes, condensent les situations et les personnages. Le massacre des fidèles dans les escaliers de Monte Santo est une métaphore du massacre de Canudos ; le sacrifice d’un enfant, entrepris par Santo Sebastião et Manuel, renvoie aux événements de Pedra Bonita – et ainsi de suite.
Par un processus de dramatisation de certains moments historiques brésiliens, le film réinvente la réalité, façonnant le temps, l’espace, les biographies et la géographie en des configurations imaginaires toujours nouvelles, offrant différents regards sur les personnages et les événements. Le film, en racontant une histoire du Brésil, ne se contente pas de donner à voir le réel, ou d’identifier des « personnages historiques » ; il préfère les recréer par allégorie.
Dilacération
Les allégories dans l’œuvre de Glauber nous présentent des images d’une nation dilacérée. Il s’agit d’un récit qui nous raconte d’autres histoires, dans lesquelles le sertão est évoqué pour dire la nation à partir de ses marges et de ses dissidences. Si la définition d’une identité brésilienne est recherchée, l’effet attendu est cependant le produit d’une différenciation, par le biais d’allégories qui inventent le Brésil en affirmant ses marges – les cangaceiros, jagunços[5], et sertanejos démunis – pour raconter une autre histoire, en dépit du projet hégémonique de la nation. Le Brésil surgit alors comme « multiplicité complexe, originale, polyvoque »[6].
Le sertão de Glauber est le lieu de conflits aux temporalités diverses et superposées, lieu aussi de confrontation des cultures. Dans cet espace, l’idée de nation comme temporalité unique et participant d’un processus unidirectionnel et civilisateur perd son sens. C’est alors qu’émerge le sertão comme espace alternatif qui interroge la naturalisation : a) du territoire, puisque la mer et le sertão se confondent et que ce dernier est à la fois partout et nulle part ; b) de la langue, puisque d’une part on réinvente ici un langage où se mêlent les expressions populaires et châtiées et, puisque, d’autre part, la tradition cinématographique internationale est relue, traduite en un langage qui tend vers celui des récits mythiques ; c) du temps, puisque des temporalités différentes sont juxtaposées. Le Dieu noir met ainsi en question la naturalité même de la nation.
La complexité apportée par la construction allégorique implique cependant des risques, puisque raconter une autre histoire signifie choisir, souligner, délimiter, dans un processus d’édification qu’on ne maîtrise jamais entièrement. Et ce qui reste, le fruit d’un récit comprimé de toutes parts – comprimé par une tradition cinématographique qu’il faut traduire et par des expressions populaires et châtiées qui résistent à la traduction – fait que raconter une autre histoire crée toujours une autre histoire. La conception d’un cinéaste totalement conscient des processus de fabrication de son art, qui parfois dépeint le sertão sous des couleurs marxistes, ou distille une idéologie du développement, faisant coïncider la mer et la révolution, ou celle-ci avec la révolution socialiste, cette conception oblitère justement les risques et l’imprévisibilité des constructions allégoriques.
Au contraire des allégories pédagogiques et prévisibles, ces autres histoires issues d’un récit comprimé, fruit de la relation tendue entre les autres internes et externes, nous présentent un sertão dilacéré, parsemé de personnages précaires, à l’abandon, ambigus et en constante traversée. C’est à partir de cela, par exemple, qu’Ismail Xavier constate en conclusion de son étude combien l’allégorie pédagogique (il utilise le mot « didactique ») « se voit envahie par l’allégorie au sens moderne, figure de la dilacération[7]».
Les allégories chez Glauber sont centrées sur la nation dilacérée. La dilacération se manifeste dans le langage cinématographique, dans une façon dilacérée de raconter, dans la violence même des images, que les scènes de l’escalier expriment si bien, dans les histoires dilacérées de personnages démunis, dans la violence et l’ambiguïté des personnages en traversée, dans les mésententes et les conflits qui parcourent tout le film. Les allégories expriment alors des disjonctions et rompent avec l’idée d’une temporalité unique, dans la mesure où elles inscrivent d’autres moments dans l’histoire de la nation, signalant la violence qu’implique l’idée même d’un temps synchrone, au sein duquel le sertão devrait être soit maîtrisé par la civilisation, soit pétrifié en un archaïsme idéalisé et dépassé. Le processus de l’allégorie suggère ainsi d’autres temps, qui glissent et produisent une identification collective performative, qui s’écarte des tentatives de construction d’une identité nationale transcendante et unique. Les tropes signalent et soulignent les différences et les fractures : en un intense dialogue avec diverses traditions – littéraires ou cinématographiques, populaires ou académiques – ces tropes dilacèrent tout point de vue qui essentialiserait et homogénéiserait la nation.