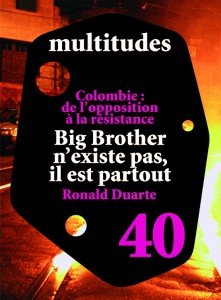Sociogenèse du mal-être cinématographique
Le cinéma français est en état de siège. L’industrie du numérique et la volonté d’imposer sa révolution technique, l’État et la politique de démantèlement de l’ACC (l’Action Culturelle Cinématographique), les internautes et le « piratage » massifié, les municipalités et la tentation de tirer un profit électoral des salles « municipalisées », les opérateurs de télécommunications et leur positionnement sur le marché… Les assaillants se bousculent, multipliant d’autant les facteurs d’inquiétude au sein du secteur cinématographique.
Prises isolément, ces offensives répondent à des logiques spécifiques (technologique, politique, culturelle, industrielle). Mais dès lors qu’on les envisage dans leur globalité, elles révèlent un mouvement de fond : la judiciarisation et la financiarisation des enjeux cinématographiques. Car c’est un fait : le temps, les rythmes, les modalités et la place du cinéma dans la société ont changé. La période n’est plus aux rivalités entre sectes cinéphiliques, ni aux envolées lyriques des prêcheurs de ciné-clubs. La forme primordiale de discussion n’est plus le débat, mais la délibération ; l’espace cinématographique-clé est moins la salle que la commission.
Les manifestations de cette évolution abondent : la mobilisation de la profession contre le téléchargement illégal, la guerre des images entre Orange et Canal+, la passe d’armes juridique initiée par UGC/MK2 contre les salles subventionnées ; les 90 saisines annuelles du Médiateur du cinéma[1] ; les innombrables avis rendus par les Commissions d’équipement commercial ; les procédures initiées dans le cadre du Conseil de la concurrence ; la nature des 12 propositions avancées par le Club des 13 pour remédier aux dysfonctionnements du cinéma français ; les demandes incessantes adressées au législateur pour étoffer l’arsenal de lois en vigueur ; le « scandale » des marges arrières engrangées par les « gros » exploitants, les polémiques suscitées par le système de la carte illimitée et de l’adhérent garanti, les politiques publiques axées sur une dimension strictement programmatique et tarifaire, la levée de bouclier des professionnels de la culture contre la réduction des budgets des DRAC (directions régionales des affaires culturelles). Les nostalgiques du Quartier Latin doivent se faire une raison : à l’heure de fêter les cinquante ans des premiers pas de Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et François Truffaut, la « Nouvelle Vague » est moins artistique que judiciaire ; non plus esthétique mais financière.
Comprendre cette dynamique d’involution – la réduction du cinéma à une affaire de droit(s) – nécessite de revenir sur la conjonction de facteurs dont elle procède : la constitution de l’image-capital en ressource économique, politique et culturelle décisive au sein du « capitalisme communicationnel », les conflits d’intérêts qui en découlent et le processus sociologique qui sous-tend l’ensemble de ce processus
L’avènement de l’image-capital
Cette dynamique prend forme dans les années 1970. Dans le sillage du mouvement de « libéralisation » sociale, économique et culturelle post-68, les futurs emblèmes du capitalisme culturel et cinématographique émergent. UGC, MK2, CGR Cinémas, Ciné Alpes font leur apparition, tandis que les frères Seydoux posent les jalons du futur empire Europalaces (regroupant Pathé et Gaumont). L’élan entrepreneurial de l’époque fait croire à un secteur florissant. Mais l’illusion n’a qu’un temps, celui de la montée en puissance du petit écran. Entamée dès les années 1950, cette dernière s’accélère brutalement sous l’effet de la privatisation de la télévision. La création de Canal+ (1984), de la Cinq (1986), et de M6 (1987), précipitent l’effondrement de la fréquentation, pierre angulaire du système de financement du cinéma français[2].
À cette problématique économique globale est opposée une solution politique transversale : le Médiateur du cinéma (1982), l’Agence de développement régionale cinématographique (1983), la Fondation européenne pour les métiers de l’image et du son (1986), le toilettage complet des aides diligentées par le CNC, la « municipalisation » de centaines de salles de « proximité », l’injection d’argent public dans le tissu associatif. Cette refonte globale stimule le renouvellement des talents, là même où le raz-de-marée télévisuel causait des ravages irréversibles sur les terres de Fritz Lang et de Roberto Rossellini. Parallèlement, elle assure la pérennité d’une vie culturelle et sociale autour du cinéma, tout en intégrant les chaînes de télévision à l’ensemble de la mécanique cinématographique.
À terme, l’obligation imposée aux chaînes de consacrer une partie de leur budget au cinéma (de 3,2 % pour les chaînes hertziennes à 20 % pour Canal+) permet, d’une part, la mise en production de grands spectacles fédérateurs (Germinal et Les Visiteurs en 1993, Astérix en 1998, Le pacte des loups en 2001[3]), et, d’autre part, le dégagement d’un apport financier providentiel pour des projets plus singuliers, véritables « têtes de proue » de l’exception culturelle hexagonale à l’étranger. Rois et reine (Arnaud Desplechin, 2004), Les témoins (André Téchiné, 2007), La graine et le mulet (Abdelatif Kéchiche, 2007), cofinancés par France 2 Cinéma ; Indigènes (Rachid Bouchareb, 2006), Le premier venu (Jacques Doillon, 2008) ou Julia (Erik Zonka, 2008) coproduits par France 3 Cinéma ; Tirésias (Bertrand Bonello, 2003), La blessure (Nicolas Klotz, 2005) et Flandres (Bruno Dumont, 2006) financés par Arte Cinéma en sont des exemples récents.
À ce sursaut télévisuel de la production s’est ajoutée une restructuration d’ensemble du parc de salles. Au prix d’un renouvellement constant de l’offre technique (son THX, équipement numérique), commerciale (perfectionnement des systèmes d’abonnement, création de la carte illimitée, apparition de multiplexes conçus comme des lieux de consommation cinématographique intensive, insérés au sein d’un espace commercial plus vaste) et culturelle (transformation des cinémas en « lieux de vie » via l’implantation de services de restauration, librairie ou salle de jeux vidéo selon le référent choisi, multiplication des expositions temporaires et des espaces détentes), la sortie « ciné » a retrouvé, dès le milieu des années 1990, l’attractivité que le succès de la formule TV-canapé avait contribué à éclipser.
Cette embellie des courbes de fréquentation n’a que peu d’incidence sur les engagements publics opérés dans le secteur cinématographique. Bien au contraire, le cinéma apparaît à bon nombre d’édiles comme un moyen efficace et peu onéreux – comparé aux gouffres à subventions que sont les théâtres, les musées, les bibliothèques, l’opéra –, d’impulser une dynamique culturelle au sein de leur circonscription et, accessoirement, de s’attirer les bonnes grâces de leurs concitoyens.
Plus généralement, cette reviviscence cinématographique peut être considérée comme la conséquence de l’affirmation capitalistique des « industries de programmes » (Bernard Stiegler) ; phénomène expliquant que le cinéma demeure un secteur économique crucial en dépit de sa forte incertitude financière et de sa faible rentabilité en relation aux sommes engagées. En effet, la multiplication des supports de diffusion (télévision, consoles de jeux, téléphonie mobile, ordinateurs) a entraîné une hausse significative des investissements, des rythmes et du volume de la production filmique. En cela, le productivisme des images, à l’origine de l’embouteillage hebdomadaire de films dans les salles (onze nouvelles sorties en moyenne chaque semaine), est l’expression française d’une tendance industrielle amorcée aux États-Unis et aux Japon dès la décennie 1980 : la prise de contrôle du « software » par le « hardware », des programmes par leurs canaux de diffusion. Les associations de Canal+ à SFR au sein de TF1 production à Bouygues Télécom, de Studio 37 à Orange illustrent ce processus d’absorption de l’industrie cinématographique par le « capitalisme communicationnel ».
Plaintes et complaintes du cinéma français
Sur le plan comptable, le bilan de cette dynamique s’avère largement positif. Car il profite d’un maillage territorial unique, d’un niveau de fréquentation retrouvé (entre 180 et 190 millions d’entrées chaque année, soit un niveau équivalent à celui de l’année précédant la création de Canal+), d’une offre de films pléthorique (de 500 à 600 sorties annuelles dont la moitié concernent des films français), d’une part de marché flatteuse pour les films français (45%), et d’ investissements globaux inégalés. Pourtant, la période est au conflit plus ou moins larvé. Paradoxe ? Apparent seulement, le système étant victime de son propre succès. C’est tout du moins ce que semblent démontrer les tensions recensées au sein du secteur de l’exploitation et de la production.
Providentielle dans un contexte de crise, l’intervention publique apparaît illégitime à l’heure du redéploiement généralisé. En effet, les lourds investissements mis en jeu dans les stratégies de groupes ne s’accommodent guère de pratiques concurrentielles jugées « déloyales » en raison de l’origine publique de certains financements. Pour quelques-uns, les phénomènes de saturation observables en centres-villes et proches périphéries, les coûts imposés par l’équipement numérique, les efforts de modernisation du parc de salles, nécessitent que la logique centripète des politiques publiques cesse d’entraver la dynamique centrifuge du marché ; au risque de menacer un tissu associatif dynamique mais captif des aides publiques.
En ce qui concerne la production, la démultiplication des partenaires financiers, résultante de l’intensification de la concurrence audiovisuelle, a fragilisé les conditions de travail de la majorité des acteurs du secteur. Marin Karmitz, fondateur du groupe MK2, rappelle ainsi que « le saupoudrage généralisé, au CNC et ailleurs, rend très difficile la construction de structures moyennes. Face à cela, les seules structures qui ont une vraie cohérence sont celles qui ont des moyens – celles des chaînes de télévision et des grands groupes. Il y a quelques producteurs moyens qui essaient de tenir le choc et une pléiade de tout petits qui ont à peine de quoi vivre. Cela les empêche d’investir sur des scénarios et les rend complètement dépendants de tous les pouvoirs. Tous ces indépendants sont plus que dépendants vis-à-vis des chaînes TV et de l’État. »
Phénomène d’autant plus préjudiciable qu’à l’autre bout de la chaîne de production, la puissance financière ne garantit pas non plus la qualité de la production. À titre d’exemple, Manuel Alduy (directeur « Cinéma » de Canal+) remarque qu’au moment de la concurrence la plus acharnée entre la chaîne cryptée et TPS (précédant la fusion des deux groupes en 2006), « deux effets étaient préjudiciables au cinéma. Chacun avait peur de perdre le film, donc on signait les projets le plus vite possible. Résultat, on lisait pas ou peu, sans faire de remarques. L’autre dimension est que la concurrence a créé une bulle spéculative sur certains films. Pas ceux de Robert Guédiguian, Marina de Van ou Arnaud Desplechin – et ce n’est pas non plus ces films-là que les groupes de télécommunication vont mettre en vitrine demain. Par contre la concurrence entre Canal+ et TPS a donné les Bronzés 3. »
Dans ces conditions, il est logique que se multiplient les demandes visant à améliorer la régulation du secteur, tant du côté des acteurs privés que des instances publiques, des structures indépendantes que des groupes, des cinéastes que des représentants associatifs.
Du « tout politique » au « tous artistes »
Mais limiter l’analyse de l’économisme et du judiciarisme ambiants à des considérations purement économiques serait quelque peu caricatural. En effet, les conflits d’intérêts et les mécontentements divers suscités au sein du cinéma français ont pour toile de fond un processus sociopolitique plus large, particulièrement manifeste chez les anciens frondeurs de Mai 68. Fauchée en plein vol du post-modernisme, cette génération, née entre les années 30 et 50, s’est retrouvée idéologiquement orpheline aux lendemains des années 1970. Particulièrement investie dans l’activité cinématographique, une minorité d’entre ses membres a joué contre vents et marées la carte du cinéma (r)engagé (à l’image du réseau de cinémas Utopia). Mais dans la majorité des cas, l’espoir du grand soir fut sacrifié sur l’autel du petit et du grand commerce. Signe d’un effondrement moral ? D’une ignoble trahison à la cause ciné-révolutionnaire ? Plus sûrement, ce changement de cap traduit un changement d’époque, parfaitement incarné par la trajectoire de Marin Karmitz.
Impliqué au premier chef dans les luttes de Mai, les premiers pas du réalisateur emblématique de Coup pour coup (1972) répondaient à une logique essentiellement militante : « Coup pour coup procédait de l’idée de changer le monde par le cinéma ; c’était le cinéma pris dans un système culturel global. Mais à l’époque se mettait en place un système où la censure ne venait plus de l’État mais des points de vente. Je me suis donc doté d’une relative liberté en louant une salle au Quartier Latin… Puis j’ai trouvé un local à Bastille, où j’ai fait une librairie et un lieu de réflexion. On y passait tout un tas de films qui sinon n’auraient pas pu voir le jour en France ; des films que je distribuais également et qui avaient une forte dimension politique. Ces films appelaient un commentaire, une discussion, un décryptage de l’image. Il fallait constamment les remettre dans une parole critique, explicative et vivante ; les inscrire dans la réalité. Puis la réalité politique a changé. Les gens n’ont plus eu envie de cette parole-là. Ils ne sont plus venus aux discussions… » (Marin Karmitz). Aux détours du récit de vie, une rupture majeure se fait jour, à l’égard de laquelle la parenthèse « militante » 1968-75, authentique âge d’or du « cinéma politique », représente une période charnière.
Jusqu’alors, l’individuation, entendue comme processus d’autonomisation des individus, opérait dans un cadre de socialisation stable, via des groupes sociaux structurés et cohérents. Le parti, le syndicat, le ciné-club, entre autres, tous fortement imprégnés des idéaux socialistes, ravivaient en permanence le sentiment d’appartenance au groupe (conscience sociale), la nécessité d’agir en son sein (conscience politique) et l’aspiration à un avenir clairement identifiable (conscience historique). Au sein de ce cadre d’expérience et de sociabilité, l’activité cinématographique, tant du côté des créateurs que des spectateurs, obéissait à une logique dite « politique ». Or, la délitescence des principaux vecteurs de croyances et de socialisation qu’étaient le parti, le syndicat, le ciné-club, provoqua un repli sur la sphère individuelle, par ailleurs maintes fois énoncée[4].
Or, il est remarquable que ce « reflux individualiste » ait pour pendant un mouvement symétrique d’investissement du champ artistique. Aujourd’hui, près de 25 % des jeunes de moins de 25 ans revendiquent d’y faire carrière. Le cinéma et l’espoir d’une reconnaissance internationale suscitent nombre de vocations, tendance dont témoignent la floraison de lieux de formation à l’image (la Fémis, les écoles privées, les départements Cinéma sur les campus universitaires), la dilatation de l’espace physique et éditorial consacré au « septième art » (revues, magazines, livres, forums et sites spécialisés sur la toile) et la masse d’acteurs, réalisateurs, producteurs, néophytes tentant chaque année d’acquérir une visibilité sur le marché.
Cet engouement cinématographique quelque peu frénétique découle directement du passage d’une individuation collective (l’autonomisation de soi et d’un groupe à travers soi, les deux dynamiques se nourrissant l’une l’autre) à une individuation égotiste (l’autonomisation de soi sans qu’elle soit inscrite dans une perspective collective et historique). En effet, sous ce nouveau régime, auquel l’idéologie néolibérale conféra opportunément une structure symbolique, les actions et interactions sont limitées, souvent au grand dam des protagonistes, à la réalisation de soi, par soi et pour soi. Raison pour laquelle l’attachement indéfectible des aspirants cinéastes aux valeurs d’intégrité, d’authenticité et de singularité va de pair avec une forme de standardisation esthétique et thématique (l’égotisme du cinéma d’auteur français dont les thèmes fétiches sont le rejet de la famille, les affres du couple et l’auto-analyse).
Cinépathie
Mais comment expliquer qu’au moment même où de plus en plus d’individus accèdent au statut d’artistes-cinéastes, les suppliques budgétaires et juridiques se multiplient ? Pour quelle raison la démocratisation de l’expression artistique nourrit-elle un sentiment d’anomie ? Pourquoi l’avènement du « capitalisme communicationnel » débouche-t-il sur un défaut structurel de communication ? Emmanuel Kant ne présentait-il pas, dans sa troisième critique, l’expression artistique comme le modèle d’une communication achevée, en ceci qu’elle offre aux êtres humains l’opportunité d’être perçu et compris en tant que « sujet » à part entière ?
Ce paradoxe se comprend, en partie au moins, à partir du processus d’individuation égotiste. En effet, l’avènement de la « réalisation de soi » comme principe normatif dominant réduit les chances de chacun de se « réaliser » dans les faits. Car, là où l’individuation collective produisait du groupe, la radicalisation du processus d’autonomisation ne permet plus à l’artiste de s’inscrire et d’être inscrit au sein d’un cadre commun. Ses relations sociales et ses créations ne sont plus agrégatives et génératrices d’un collectif, mais dissociatives et individualisantes, empêchant ipso facto une pleine réalisation. Les nouvelles règles d’un libéralisme exacerbé entraînent une autonomisation individuelle au sein même des métiers artistiques, en dépit des valeurs humanistes souvent affichées.
Or les différents acteurs du secteur sont de plus en plus contraints par les conditions même de la production et de la diffusion à s’envisager et à se positionner en tant que concurrents, ponctuellement associés, au sein d’un même marché. L’invisibilité et la brutalité des relations qui en découlent font que les prétendants « artistes » de tout acabit (qu’ils soient acteurs, réalisateurs, critiques) vivent leur activité sur le mode du conflit, de la souffrance et de la plainte. Les transformations sociologiques de ces trente dernières années ont ainsi généré une nouvelle pathologie : la cinépathie. Les appels croissants à l’édiction et à l’application de règles cinématographiques peuvent être considérés comme l’expression symptomatique de ce mal-être, le domaine juridique apparaissant de facto comme le dernier lieu commun d’un secteur en proie à l’atomisation sociale et au consumérisme culturel.
On pourrait objecter que, dans une période de forte segmentation médiatique, sociologique, culturelle, économique, le cinéma constitue l’un des derniers creusets culturels efficients. Thèse à laquelle le succès historique de Bienvenue chez les Ch’tis apporte un indéniable crédit, et dont Alain Sussfeld, directeur général du groupe UGC, se fait le relais : « Le cinéma est aujourd’hui un lien social plus grand qu’il y a quinze ans. La télévision était fédératrice jusqu’au milieu des années 1990. Aujourd’hui le passage d’une réception collective à une réception individuelle fait que le lien social est assuré par le cinéma. Le cinéma peut continuer à créer des éléments de références communes parce que, dans un environnement de consommation éclaté, il reste pour partie une consommation collective. » Le cinéma devrait donc faire société au lieu de la diviser – à plus forte raison au sein des agents minoritaires qui dynamisent sa corporation.