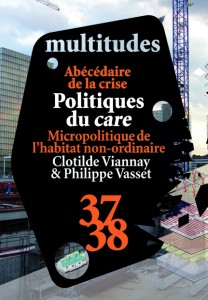Dans les pays industriels, la croissance des formes d’habitat « non-ordinaires » en mobile-homes, hôtels, foyers, collectifs autogérés, cabanes ou squat est un des phénomènes les plus souterrains de ces dernières années[1]. Pourtant, ces formes d’habitat, dites marginales, doivent être pensées au sein des mutations d’ensemble de la société post-fordiste, de la même façon que les bidonvilles des années soixante étaient pleinement inclus dans la socio-économie politique des migrations et du fordisme.
Division du travail et mutations de l’habitat
L’habitat mobile ou précaire ne relève donc pas seulement de la grande pauvreté et de l’exclusion, il est aussi lié à la renaissance du travail mobile dans le capitalisme cognitif. Cet arrière-monde de la mutation du capitalisme est à mettre en relations avec deux phénomènes. D’une part, la méfiance historique de l’État à l’égard des mobiles (répression des tziganes, de tous les « forains » et sans papiers) peut entrer en contradiction avec ces mutations. D’autant plus qu’une part d’autonomie et de défense d’un « habitat choisi» existe par ailleurs chez certains acteurs fuyant le salariat, l’ordre urbain ou l’ordre des genres. On propose ici de relier l’habitat « non-ordinaire » avec la segmentation salariale : l’habitat mobile est une conséquence de processus de segmentation, simultanément fonctionnels et politiques, son retour peut ainsi s’expliquer par l’intermittence temporelle et spatiale du travail.
Il concerne entre autres des travailleurs « en déplacement » ou travaillant de façon intermittente sur des sites distants les uns des autres. Dans l’économie de connaissance, il faut un dispositif pour échanger des informations spéciales, non codées, et encore plus pour innover. Le recours aux NTIC ne rend pas caduques les actions situées dans un même cadre matériel. L’interaction de face à face rend nécessaire des proximités temporaires. Un des traits « géographiques » de cette réorganisation, que Pierre Veltz a nommée « économie d’archipel », est la recherche d’économies d’échelle sur plusieurs sites et non dans un seul[2]. Mêmes les « districts » ont tendance à s’organiser en réseau avec une production des biens d’équipements spécifiques qui n’est plus seulement locale ou régionale. Ces redéploiements dans l’inter-cluster nécessitent des déplacements de personnes, et pas seulement des cadres comme dans la période fordiste. Ce travail mobile se développe dans de nouveaux segments (informatique, tertiaire, machines spéciales, maintenance industrielle) disloqués, au sens de déplacés et réorganisés, par le capitalisme cognitif[3]. La réforme des entreprises de réseau, qui aboutit à la séparation entre les opérateurs et constructeurs, participe aussi de ce phénomène : elle a re-mobilisé une partie des tâches d’aménagement et de maintenance des infrastructures, autrefois effectuée par des salariés permanents et à postes fixes. Ces changements suscitent l’apparition d’un groupe de salariés, pas forcément précaires, et de travailleurs indépendants, en intermittence spatiale. Cette segmentation renvoie en partie à une nouvelle division cognitive du travail. L’externalisation de certaines tâches, notamment de maintenance, ou la réallocation spatiale de certains salariés, plutôt que le recours au travail précaire « sur place », permet de maintenir un apprentissage. Le travailleur circulant devient le spécialiste de tâches dispersées dans la réorganisation de la production, et donc en charge d’un méta-savoir ambulant aidant à coordonner l’ensemble, à l’échelle nationale et internationale. Cette organisation participe d’un développement de la production modulaire à l’échelle mondiale, la Division Internationale des Processus Productifs (DIPP), une des motivations non-salariales des délocalisations[4]. Or, la DIPP génère des coûts de coordination pour maintenir l’interdépendance des différentes parties du processus, coûts que l’on peut réduire via la circulation de personnels. On peut aussi envoyer temporairement des salariés sur d’autres sites pour éviter les licenciements. Mais cette segmentation n’est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi politique (au sens de Marglin) quand elle recouvre une main d’œuvre « étrangère » (non-communautaire en Europe), à qui l’on n’accorde que des permis de travail inférieurs à un an. Les déplacements pendulaires de ces personnes obéissent à une division politique de la main d’œuvre.
On peut prendre le cas d’une entreprise produisant des équipements pour l’industrie gazière. Le responsable considère son activité comme un métier de service d’assemblage de préfabriqués industriels (échangeurs, éléments pré-montés, séparateurs), d’équipements modulaires pour l’industrie du pétrole et du gaz. L’intermittence spatiale est la règle puisqu’il s’agit de chantiers situés sur une zone d’exploitation ou des zones de transit, comme les quais d’embarquement des machines. Il s’agit bien de sous-traitance pour des entreprises de réseau. Le responsable de l’entreprise pense que la tendance ira en s’accentuant. La firme a une politique de logement simple pour ces salariés : elle cherche un hôtel ou un gîte, voire un camping, négocie les prix. Ces salariés en déplacement seront donc inclus dans la catégorie « tourisme d’affaire » de la région. Mais, sur les lieux du chantier, on trouvera plusieurs camping-cars utilisés par des salariés très qualifiés pour lesquels l’itinérance fait partie du métier. Pour eux, le véhicule habitable est un moyen de rester sur place n’importe où et de garder une certaine indépendance.
Via l’habitat, ces salariés cognitifs en croisent d’autres, saisonniers et personnes étrangères ayant des permis de travail temporaires pour des chantiers déterminés ou travailleurs sans-papiers. On a donc, dans l’habitat « non-ordinaire », un mode du travail « mobilisé » ; phénomène qu’on peut comparer sous cet angle aux migrations intérieures chinoises qui concerneraient 130 millions de personnes. C’est un point de connexion avec le capitalisme industriel redéployé dans les pays émergents. Le « squat artistique » pourrait présenter un autre pôle : celui du travailleur indépendant produisant plus ou moins volontairement une externalité cognitive urbaine. Travailleur indépendant qu’on retrouve aussi dans le renouveau du commerce de foires, comme soutien à l’économie de variétés. On va aussi retrouver ces modes d’habitat avec le Shuttle Trade, terme utilisé par l’OCDE pour désigner le colportage international. Les pratiques redécouvertes par Tarrius entrent donc dans les préoccupations de l’administration mondiale[5]. Pour désigner les personnes concernées, on utilise le terme « touriste », bien sûr. Des difficultés méthodologiques, pour trouver les données relatives à ces commerces, sont contournées en entrant dans les statistiques du tourisme, car celles du commerce formel ignorent une grande partie de ce trafic. C’est bien dans le tourisme que se cache toute une économie de la mobilité qui n’a pas grand-chose à voir avec les vacances. Or le touriste, toujours dans les définitions des organisations internationales, c’est la personne en déplacement loin de son domicile, en habitat « non-ordinaire », sans titre de séjour permanent ou en transit. Les habitants non-ordinaires rejoignent cette définition administrative d’une « multitude ». Les « flux touristiques » tendent à être le nom générique au XXIe siècle des « populations flottantes » du XIXe, qui étaient définies par leur mode d’habitat.
Ces mêmes populations flottantes étaient perçues, au début du XXe siècle, comme rétives à l’intégration à l’entreprise. Ce qui faisait d’elles non seulement des « étrangères » au sens politique (découlant d’une équivalence implicite qui fait de tous les étrangers des nomades et de tous les nomades des étrangers, repérées par Wagniart, mais également des groupes supposés hostiles au Fordisme[6]. La conséquence auto-réalisatrice de cette perception est la mise à l’écart de ces groupes, dans la statistique et via toute une série de mesures, dont, en France, la loi de 1912 instaurant un régime d’exception pour les forains et nomades. Avec le succès des normes fordistes, la coupure institutionnelle passe ensuite par la distinction salariés/chômeurs. Les travailleurs mobiles deviennent alors invisibles quand ils sont intégrés à l’entreprise (cas des marins, des salariés permanents des entreprises de maintenance industrielle, etc.) ou marginalisés quand ils restent isolés (forains, mariniers etc.)[7]. Une conséquence de cette construction est que la renaissance d’un monde de l’intermittence spatiale se fait à l’abri d’une intrusion statistique. Si cette invisibilité statistique découle de choix institutionnels antérieurs, elle provient aussi des stratégies individuelles. Comme il est dangereux d’être perçu par l’administration comme un SDF, les personnes en habitat mobile (caravanes, camping-cars, voire péniches) vont déclarer une adresse de complaisance pour ne pas se faire repérer, ou tout simplement pour continuer à travailler (dans les agences d’intérim, on exige une adresse pour monter les dossiers, même si elle peut être fictive). En conséquence, les statistiques disponibles sont fortement au-dessous de la réalité. On est donc face à des mouvements non-mesurables, parce que refoulés et en partie clandestins, mais aussi divers et singuliers, relevant du concept de multitude. Ce que retraduit l’expression administrative « non-ordinaire », c’est-à-dire aussi inclassable, flou, hors comptes. Cependant, cette invisibilité entretient la fragmentation car il est de fait difficile de repérer la construction d’un collectif autour de l’intermittence spatiale engendrée par les recompositions du travail, de la production et de la distribution.
La catégorie « touriste » qui tend à recouvrir toutes ces situations ne crée pas une mobilisation politique des personnes. De la même manière que la convention faisant de tous les SDF des étrangers, à la fin du XIX e siècle, ne déboucha pas sur une constitution politique des groupes ainsi agrégés. Si le monde du travail mobile ne se laisse pas résumer en une seule formule, il constitue pourtant un réseau.Via ces « itinérants », des connexions entre des territoires comme entre des personnes s’opèrent, même de façon minoritaires ou lacunaires. Il y a une connaissance des territoires et des mondes de production qui s’élaborent dans ce réseau. On peut, à l’inverse, repérer une tendance des « autorités » à essayer d’empêcher ou de retarder ces rapprochements. Des « travelers » liés à la musique « techno » ont plusieurs fois réclamé en vain le droit de séjourner sur les « aires d’accueil (ou de relégation) » réservées aux titulaires du livret forain ou nomade. Même si l’accès aux campings est souvent interdit à ces derniers. Cependant, il y a des pratiques individuelles remettant en cause ces distinctions via des alliances entre personnes permettant l’usage des campings par des forains ou des aires d’accueil pour gens du voyage à des ouvriers itinérants. Or, la perspective d’une jonction entre ces groupes fait craindre des « débordements », c’est-à-dire une remise en cause des conventions reléguant ces groupes dans des enclaves distinctes.
Habitat non-ordinaire et fragmentation de la ville
S’il s’agit d’une construction socio-économique participant de la réorganisation de la production, elle s’explique aussi par des dynamiques spatiales urbaines. Notamment par l’existence d’effets frontières engendrés par les infrastructures de transport. D’où le rôle des ponts et autres échangeurs, qui disloquent les anciens espaces productifs pour les relier à de nouveaux. Ces équipements enclavent d’autres espaces, dont certains occupés temporairement par des travailleurs intermittents. Ainsi le tunnel sous la Manche, reliant directement Paris et Londres, fait circuler directement des cadres mobiles qui doivent néanmoins croiser, sans les voir, des « sans-papiers » à la jonction de Sangatte, sur la gare de triage. L’externalité inter-métropole, inter-centres, produite par l’effet tunnel, a comme contrepartie le fractionnement local et la création d’interstices occupés par des habitats « non-ordinaires ». Si la formation de quartiers connectés aux gares TGV, rassemblant les « élites circulantes » européennes a été, dès les années quatre-vingt, l’une des premières manifestations urbaines des changements post-fordistes[8], elle n’est pas la seule. On peut analyser le lien entre ces changements et l’occupation de ces espaces de l’entre-deux, de l’interlude, que sont les friches délaissées par des fluctuations de la production ou des marchés immobiliers. Ils sont, via ces occupations temporaires, eux aussi terrains des jeux de la production, pris dans celui de l’échange, et en retour ils déséquilibrent et rééquilibrent les autres composantes de la ville productive[9]. Les usages « non-ordinaires » de ces lacunes, déterminées et circonstancielles, indiquent ce qui n’est pas pensé et formulé dans le discours des marchés ou des plans urbains.
« L’habitat non-ordinaire » peut ainsi s’entendre comme hors marché normal[10]. C’est-à-dire comme un logement hors normes qui n’est pas, ou pas encore, dans la nomenclature officielle. Mais il ne faut pas non plus identifier ce type d’habitat avec une fuite hors des transactions marchandes. Même dans des formations urbaines de type « favelas » brésiliennes, on trouve un marché immobilier, alors que les droits de propriété ne sont pas complets puisque la propriété du sol n’est pas reconnue aux habitants. Si des penseurs historiques de la ville, comme Hector Horeau ou les désurbanistes russes, ont pu donner un rôle à l’habitat mobile, démontable, portatif, c’était en effet dans un schéma rationnel d’ensemble, dans le cadre d’une planification –même s’il s’agissait pour Horeau de permettre l’usage de terrains que leurs propriétaires « gelaient » ou pour les Soviétiques dans le cadre d’une redéfinition soviétique des droits de propriété. Maintenant il faut penser cela dans le cadre néo-libéral où la planification « moderne » a reculé au profit des enclaves et des projets limités, dans des adaptations au coup par coup. Le développement récent de cités universitaires en conteneur que l’on peut déplacer en suivant les évolutions de la ville est une première réponse institutionnelle. Le logement en conteneur intéresse aussi des firmes privées pour loger des salariés et notamment les entreprises de réseau. Les villes portuaires peuvent fournir un exemple intéressant, par l’importance des friches de l’époque industrielle et des interstices entre la ville et le port[11]. Elles sont concernées, pour certaines depuis longtemps (Naples), en raison de leur fractionnement micro-politique et physique, qui crée des frontières intérieures et des terrains aux statuts ambigus, propices à des occupations informelles. Elles le sont aussi en tant que places de transit des flux migratoires qui renvoient à l’intermittence comme rythme fondamental des villes portuaires. Mais ces caractéristiques, comme les conteneurs, se répandent partout[12]. De plus, l’habitat non-ordinaire remplit des fonctions spéciales, pas seulement d’entrée pour des migrants précaires ou pour loger des travailleurs de passage. Il se situe souvent sur des zones frontières entre espaces à usages alternatifs. Via l’habitat non-ordinaire, on peut « coloniser » une zone tampon, entre des mondes distincts, et de ce fait atténuer des coupures. C’est le cas du fameux « container city » à Londres, organisé par Urban Space Management, une firme spécialisée dans les usages intérimaires de l’espace qui a développé une enclave entre Docklands et Canning Town au bord d’un affluent de la Tamise. Ce n’est pas seulement le réinvestissement d’une friche, promue au rang d’incubateur, mais une remise en cause de la séparation fonctionnelle, puisqu’on y trouve habitat et lieu de travail. On peut observer une réflexion sur ce type d’architecture dans plusieurs villes portuaires européennes, pour accompagner les processus de requalification des territoires en friches. Loin de n’être qu’un obstacle à la régénération, l’habitat provisoire peut ainsi être une amorce spontanée à la requalification de certaines friches. Il peut en outre offrir une solution de transition, utile en cours de réorganisation urbaine. Enfin il est un indicateur de mouvements de population et d’activités économiques.
Au-delà du conteneur, on peut remarquer que les firmes présentes sur le marché du logement temporaire, pour des chantiers de requalification urbaine par exemple, ont en général une activité logistique connexe. Il s’agit d’une part de l’extension de la logistique à la sphère de l’habitat et d’autre part d’une redéfinition de la division du travail entre firmes, dans laquelle la production de la ville concerne aussi d’autres secteurs que les acteurs traditionnels, comme ce sera sans doute le cas aussi pour les projets de villes « vertes » et autres quartiers labélisés « développement durable ». On peut donc en déduire qu’on est à l’aube de nouveaux changements dans les découpages du système productif. Ainsi à la lisière des villes, comme parfois en leurs centres, la ségrégation peut prendre d’autres formes que celles de vastes zones homogènes, pour emprunter celles de petites enclaves plus ou moins connectées à des voies rapides et constituant un archipel, ou une couronne, d’habitat ségrégué. D’un point de vue global, le processus est le même que celui menant aux lotissements pavillonnaires fermés à destination des multiples groupes composant la « classe moyenne », ou aux quartiers des élites circulantes, ou encore aux enclaves touristiques.
On peut, en outre, comprendre l’habitat non-ordinaire comme un mode de bi-résidentialité. Une des conséquences de l’étalement urbain dans les zones pavillonnaires est la difficulté pour les salariés nichés dans ces quartiers de déménager suite à une perte d’emploi et cela explique l’acceptation des trajets et d’une intermittence spatiale, parce que la base de vie est immobile. On peut paradoxalement devenir nomade pour échapper aux pièges des lotissements déconnectés. Ces situations renforcent l’absence de fiabilité des statistiques, car un salarié, pourtant en déplacement constant, sera considéré comme résident permanent de son lotissement. Les phénomènes sont communicants. L’habitat non-ordinaire peut-être une réponse temporaire à l’éloignement domicile-travail, que la hausse brève mais sensible du prix des carburants l’été dernier a pu rendre insoutenable pour certains ménages. Si beaucoup de salariés semblent subir l’espace et les coûts de transport, cela ne doit pas amener à conclure à l’absence d’inventivité et de ruses (au sens de De Certeau) des personnes vivant dans le péri-urbain.
Peut-être faudrait-il reconsidérer les pratiques des jeunes errants, « travelers » roulant de festivals en festivals ou routards évangélistes, comme annonciatrices de l’inventivité des zones péri-urbaines. En effet, une composante notable de ces jeunes est d’être originaires des zones péri-urbaines, et non pas des « quartiers sensibles » de barres et de tours. Dans ces zones pavillonnaires, les jeunes en souffrance ou en rupture sont isolés, et ils partent car il n’y a pas de possibilités de former une bande sur place. Ce peut être une préfiguration d’autres rassemblements.
Luttes et équipements du pouvoir
Les luttes dans ce cadre sont moins salariales, en raison de l’individualisation des rémunérations, et tendront à se focaliser sur la production de l’espace. Pour ces acteurs, les conditions du travail sont directement liées aux conditions de vie. D’où des conflits dispersés sur « l’habitat choisi », à l’occasion des tentatives municipales pour reprendre le contrôle des terrains de campings, ou villages de vacances détournés de leurs usages touristiques « normaux ». Les zones rurales sont tout autant concernées comme en témoignent les « chartes anti-cabanisation » qui ont pour but d’éliminer des néo-ruraux alternatifs et de permettre une gentrification des parcs naturels. Une association comme Halem, Habitants en Logements Éphémères et Mobile-homes, essaie de faire se rencontrer ces contestations et d’engager des luttes pour un habitat « autonome » des contrôles sociaux. Les politiques publiques face à ce phénomène sont prises entre plusieurs contradictions et les conséquences urbaines seront plus profondes que ce que les gestionnaires pensent. À l’heure où les projets de relance face à la crise vont passer par une nouvelle production d’infrastructures, il faut reprendre la critique de ces équipements.
En effet, loin de produire du « commun », ils participent d’une fragmentation des espaces. L’habitat non-ordinaire se loge alors dans les interstices de ces équipements. Il peut être élément dans un « dispositif » global de contrôle des populations migrantes jusqu’à leur insertion. Mais il demeure aussi comme élément hors normes, à la fois comme reste et comme support de nouvelles subjectivités, que les équipements du pouvoir cherchent à éradiquer ou à déplacer constamment, faute de penser l’envers du nouvel ordre productif.
De fait, si l’habitat non-ordinaire (dont l’habitat mobile) a crû durant la décennie quatre-vingt-dix, c’est d’abord de façon invisible. Une fois qu’il passe un seuil local de visibilité, le problème est détecté par les pouvoirs publics, la réaction est souvent négative, on a vu ainsi la fermeture de campings abritant majoritairement des salariés, les chartes anti-cabanisation, la lutte contre les squats. Les destructions brutales de campements de Roms ou de travailleurs temporaires, effectuées par les autorités ou par des milices « spontanées », s’inscrivent dans ce contexte. Dans ces conditions, ce type d’habitat stagne ou se camoufle. Mais la conjoncture présente pourrait le faire exploser dans le sillage de la crise des sub-primes. On peut alors envisager un cycle, ou une fluctuation de l’habitat non-ordinaire. Mais au-delà des vicissitudes du marché du logement « ordinaire », il constitue des équipements collectifs de fait, aux statuts et à la gouvernance variés, de l’hôtel au camping, à l’aire d’accueil pour tsiganes participant à l’économie résidentielle mais relégués, à celle pour retraités en camping-cars à proximité des lieux touristiques. Ce sont des équipements collectifs publics ou privés pour le logement de travailleurs employés sur ces équipements collectifs nomades que sont les chantiers, voire les usines post-modernes déterritorialisées. Terminons par une citation extraite d’un livre fétiche des années soixante-dix à propos des ateliers nationaux post-1848[13] : « Voilà une dimension bien peu connue des politiques de construction de ce qu’on appelait à l’époque « l’équipement national » (les grandes infrastructures) ou de construction urbaine : occuper, fixer la main d’œuvre, à côté des ateliers nationaux, des casernes, des prisons et des fabriques. Une dimension secrète de l’équipement collectif : le chantier de travaux publics comme équipement collectif nomade, territorialisation mobile des flux de travailleurs déracinés ou en chômage. On passe sans transition d’une énergie révolutionnaire mise en réserve dans les ateliers nationaux, à une énergie productive de valeurs d’usage et de plus-value, employée dans l’économie. Chantier de barricades ou chantier de grands travaux, l’Etat doit choisir. »
Après avoir rejeté hors de l’usine fordiste nombre de personnes, redevenues mobiles et flexibles, après plus de cinquante ans de territorialisation, il est peu probable que l’économie actuelle puisse se passer de ces équipements accompagnant une remobilisation même minoritaire. D’autres « équipements du pouvoir » sont en cours d’élaboration dans la nouvelle donne biopolitique : hôtels pour salariés intermittents, aires d’accueil, « villages d’insertion » pour Roms, etc… La complexité de la situation est d’autant plus grande que l’on est en présence de normes explicites sur les nomades, les travailleurs immigrés et d’autres implicites sur le genre, les nouveaux intermittents, les touristes, etc. Le résultat de ces évolutions est donc en partie imprévisible et dépend notamment des pratiques et luttes de l’intermittence spatiale qui interdiront de revenir à des modèles de ville-machines, fussent-elles post-fordistes. La créativité des villes se joue aussi dans ces nouveaux usages.
Notes
[ 1] Claire Levy-Vroelant, « Les Avatars de la ville passagère », Annales de la recherche urbaine n° 94, 2002.
[ 2] Pierre Veltz, Mondialisation Villes et Territoires. L’économie d’archipel, Paris,PUF, 1996.
[ 3] Yann Moulier-Boutang, Le Capitalisme Cognitif. La nouvelle grande transformation, Paris, Éditions Amsterdam/Multitudes, 2007.
[ 4] P. Moati et E.M. Mouhoud, « Les nouvelles logiques de décomposition internationale des processus productifs », Revue d’économie politique, n° 5, 2005.
[ 5] André Tarrius, La Mondialisation par le bas. Les nouveaux nomades de l’économie souterraine, Paris, Balland, 2002.
[ 6] Jean-François Wagniart, Le vagabond à la fin du XIXesiècle, Paris, Belin, 1999.
[ 7] Arnaud Le Marchand, « Recenser les travailleurs de passage : catégorie socio-économique et exclusion », Cahiers de sociologie économique et culturelle, 2009.
[ 8] André Tarrius, Anthropologie du Mouvement , Caen, Paradigme, 1989.
[ 9] Thierry Baudouin, Ville productive et mobilisation des territoires , Paris, L’Harmattan, 2006.
[ 10] Arnaud Le Marchand, « Travail mobile et habitat non ordinaire dans les villes portuaires », Le logement précaire en Europe, Claire Levy-Vroelant, Douglas Robertson et Jim Smyth, Paris, L’Harmattan, 2007.
[ 11] Michèle Collin, « Nouvelles urbanités des friches », Multitudes, n°6, 2001.
[ 12] Peter Sloterdijk, Le Palais de Cristal. À l’intérieur du capitalisme planétaire, Paris, Hachette, 2008.
[ 13] François Fourquet et Lion Murard, Les Equipements du Pouvoir, Recherches 10/18, 1978.