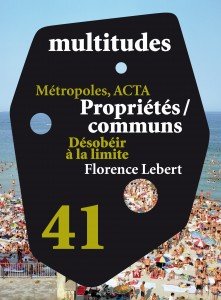Les autochtones comme acteurs politiques
La reconnaissance de l’importance des peuples autochtones par la Communauté internationale s’est construite en plusieurs étapes durant les 40 dernières années, culminant par l’adoption de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones. Cette Déclaration, bien que juridiquement non contraignante, possède une valeur symbolique aussi grande que la Déclaration des Droits de l’Homme et une valeur politique non négligeable dans le cadre d’une construction internationale du monde dont les États nations sont jusqu’à présent les piliers principaux. La dynamique qui conduisit à la reconnaissance des populations autochtones comme « peuples » cède aujourd’hui la place à une réflexion plurielle sur la manière d’induire à l’échelle du globe un changement de pratiques dans l’ordre de la gouvernance comme dans les régimes d’exploitation des ressources. Trois faits sont à souligner pour comprendre le renouvellement des perspectives qui invitent initialement à reconnaître les communautés autochtones comme victimes des politiques d’assimilation pour admettre ultérieurement leur capacité à promouvoir leur propre développement ; ce que l’actuelle présidente de l’Instance permanente dénomme « un développement auto-déterminé » (self-determined development).
L’identification du sujet collectif « autochtone » comme digne de considération spécifique – et non plus comme une collection d’individus identifiés comme « sauvages »…, à transformer éduquer / civiliser, pour les intégrer dans la communauté nationale – est le fruit, à partir des années 60 et dans la foulée des décolonisations, d’une mobilisation qui s’est appuyée sur les secteurs sociaux et politiques occidentaux favorables à la construction du droit international des droits de l’homme[1]. Elle est concomitante, dans les années 70 et 80, d’une prise de conscience de l’intégration planétaire des systèmes économiques et politiques, la planète devenant le « village global » annoncé par McLuhan[2]. La question des frontières a commencé à être l’objet d’une vraie réflexion en liaison avec les transformations de l’État nation, laquelle s’est poursuivie jusqu’à nos jours par une redéfinition des frontières disciplinaires et la construction d’objets de recherche pluri ou interdisciplinaires.
Ne pouvant décrire ici l’ensemble du dispositif international relatif aux peuples autochtones, nous ne signalerons que les éléments éclairant la question traitée ici, en indiquant leur position dans une généalogie ou grammaire institutionnelle[3]. Le premier Groupe de Travail sur les Populations Autochtones (GTPA, 1982-2004), rattaché à la sous-commission des droits de l’homme pour la protection des minorités, s’est efforcé d’instruire les questions autochtones sur la base de témoignages et de rapports d’études pour avancer sur la voie du règlement juridique et politique. Ses membres ont contribué à l’élaboration des normes internationales susceptibles de protéger les cultures autochtones. Ils ont permis d’avancer sur la compréhension de quelques concepts clés comme, par exemple, l’idée d’une souveraineté permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles[4]. L’Instance qui prit, en 2001, la suite du GTPA pour permettre aux délégués autochtones du monde entier d’exposer leurs points de vue et de faire des recommandations aux agences onusiennes comme aux États, est l’une des pièces maîtresses du dispositif de dialogue international qui conduisit, en 2005, à l’adoption d’une nouvelle Décennie et, en 2007, à celle de la Déclaration. Elle contient des dispositions claires sur la question des « Terres, Territoires et Ressources naturelles », en complément de dispositions visant la reconnaissance des formes d’organisations sociales, économiques, politiques, judiciaires et de gouvernance autochtones. Les autochtones s’appuient sur les articles de cette DDPA dont ils demandent l’application par les États pour revitaliser des systèmes sociaux, économiques et culturels qu’ils conçoivent autant comme des éléments de protection de leurs identités dans le sens d’une autonomie qu’ils pourraient retrouver.
Le programme d’action de la Seconde Décennie pour les Populations Autochtones (2005-2014), adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies après qu’aient été successivement adoptés un « Jour» (le 9 août), une « Année » (1993) et une première Décennie (1995-2004), s’est donné comme objectif d’établir « un partenariat dans l’action et la dignité », entre les États membres, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et de la société civile, et les peuples autochtones.
Ce sont ces perspectives ouvertes par l’institutionnalisation des questions autochtones et par la construction d’un partenariat international qui ont conduit les experts et les délégués autochtones à prendre position, en 2006, sur le vaste programme international dit « des Objectifs de Développement du Millénaire ». Programme dont la définition les avait tenus à l’écart au moment où les huit objectifs étaient négociés (2000) alors même que les communautés autochtones, en tant qu’ensembles considérés généralement comme « plus pauvres » et « moins développés » que tous les autres, sont visées par les mesures que les États envisagent de prendre et sur lesquelles ils font des rapports périodiques. Le dialogue entre les autochtones, les États et les agences onusiennes, qui débuta sur ce point lors de la 5e session de l’IPQA, se conclut sur la nécessité de reconsidérer les définitions de la pauvreté et les modalités pour la réduire en milieu autochtone, de repenser les enjeux de l’éducation pour les adapter aux réalités autochtones, de prendre en compte le rôle des femmes autochtones ou encore de revenir sur la conception occidentale de la santé.
À cette occasion, la notion de « développement avec identité et culture » a été introduite pour que les projets nationaux et internationaux, notamment les grands programmes d’aménagement des infrastructures routières et énergétiques et de « mise en valeur des territoires » soient plus respectueux des identités et des cultures des populations visées. L’enjeu n’est pas seulement d’éviter les effets directs et connexes de ces grands projets comme, par exemple, le déplacement forcé des populations ou l’invasion de leurs territoires par des fronts pionniers. Il vise à « repenser le développement » dans un sens qui met en question les prémisses et le discours du développement à l’occidental.
Penser la place des autochtones dans le monde
Tribune des autochtones, et matrice de leurs futurs développements institutionnels, le GTPA fut aussi le lieu qui posa les premiers jalons d’une réflexion globale sur la « mondialisation et les peuples autochtones »[5]. Les contributions des délégués autochtones au rapport de l’expert dévoilaient, en 2005, ce que j’ai dénommé les « deux faces de la mondialisation »[6]. L’une, évaluée comme positive, conduit les peuples autochtones à s’insérer dans une logique d’échanges planétaires – cette intensification des relations sociales caractérisant la globalisation pour A. Giddens[7]. La participation des délégations autochtones aux débats des Nations Unies les plonge dans un creuset intellectuel et politique extraordinairement fécond, d’où ils ressortent non seulement plus riches des expériences partagées mais aussi très actifs dans la construction des réseaux et autres formes d’organisation qui leur permettent de se préparer mieux aux débats des sessions suivantes et de devenir des interlocuteurs crédibles des organisations internationales, gouvernementales et intergouvernementales dont ils captent les ressources financières pour monter des projets locaux. Tout cela a été dynamisé par le développement des nouvelles technologies d’information et de communication et par un processus consistant à déplacer l’organisation des séminaires experts dans les régions à présence autochtone, ce qui permet de visiter les communautés qui n’ont pas les moyens de se rendre à Genève ou à New York et de prendre connaissance des situations dans lesquelles elles se trouvent. Cette dynamique eut pour effet, durant les quatre dernières décennies, de permettre la construction d’une représentation internationale de peuples qui auraient, autrement, toujours été isolés par des logiques d’exclusion, parfaitement compatibles avec des logiques d’exploitation. Quelque soit la critique que l’on peut faire à une notion de représentation autochtone qui emprunte d’autres canaux de légitimation que ceux reconnus par la démocratie occidentale, c’est ainsi que les délégués autochtones prennent conscience de la similarité des situations des peuples marginalisés par le développement des États et des sociétés dominantes (voir aussi le rapport de J. Martinez Cobo sur les discriminations spécifiques à l’encontre les peuples autochtones, 1986). Ce que les contempteurs de l’autochtonie politique ne prennent pas en juste considération, préférant identifier les tendances ouvertes par le Forum des Nations Unies comme une perspective régressive, si ce n’est réactionnaire[8].
C’est à partir des réflexions de ce forum international et de l’intérêt qu’ont progressivement marqué les anthropologues de terrain qu’a commencé à être forgé le concept de « colonialisme interne » – B. Glowczewski parlant également de « réfugiés de l’intérieur » – pour rendre compte de la manière dont nombre de groupes sociaux, de communautés, ou de populations – lesquelles se reconnaissent aujourd’hui dans la catégorie politique et relationnelle de « peuples autochtones » – ont été oubliés des politiques de décolonisation et restent toujours pris dans des logiques de négation de leur souveraineté caractéristique du moment colonial[9]. Il reste à décoloniser les mentalités pour ne plus identifier les sociétés autochtones comme « manquant de tout » ou comme « des ensembles à civiliser ». On commence à peine à reconnaître que les sociétés en question sont riches de savoirs, de connaissances, de relations humaines et d’éléments non comptabilisables sous forme monétaire. C’est d’ailleurs l’enjeu des négociations que les représentants autochtones mènent aujourd’hui à l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour lutter contre l’appropriation de divers produits par des entreprises pharmaceutiques, cosmétiques, ou autres, et pour protéger de la marchandisation les éléments qu’ils estiment leur être propres (savoirs traditionnels, folklore, dessins, peintures, danses, flore, etc), dont ils acceptent qu’ils fassent partie du patrimoine de l’humanité.
L’autre face de la mondialisation, plus négative au sens où elle dévoile l’extrême fragilité des mondes autochtones, tient à l’inégalité des forces en présence, en raison de la montée en puissance des acteurs économiques, notamment des firmes transnationales dont certaines sont plus puissantes que les États en développement. Les témoignages et les quelques analyses qui se préoccupent de la question montrent que la pression du marché pour la conquête des ressources et les modalités de la globalisation économique pèsent sur la capacité des sociétés autochtones à se reproduire. Les compagnies extractives (minerais, bois rare, hydroélectricité) et l’incorporation dans le grand marché (qui conduit à remplacer des cultures vivrières par des plantations de rente, type palme à huile, soja, ou maïs pour les agro-carburants) affectent les équilibres sociaux et politiques, mais aussi écologiques et culturels des sociétés autochtones. Celles-ci étant caractérisées par des statuts démographiques minoritaires, par un moindre accès aux services d’éducation et de santé, et par la dépossession des moyens de contrôle économiques et politiques, elles n’ont guère de possibilité de s’opposer à la distribution des concessions d’exploitation des ressources naturelles. Ce que les États font sans les consulter et, la plupart du temps, sans leur consentement, y compris lorsque cela affecte la possibilité de chasser, de collecter ou de pratiquer des rituels sur sites sacrés et que cela risque de conduire les autochtones à grossir les flots des désœuvrés urbains en voie de désocialisation.
La mondialisation économique se traduit sur la scène onusienne, peuplée de juristes, d’administrateurs et d’experts, par une critique du développement à l’occidental et la dénonciation du néo-libéralisme comme cadre idéologique dépossédant les États des moyens de la régulation nécessaire à la protection des secteurs sociaux les plus faibles. On observe des formes de convergence sur cette scène. Ainsi les délégations autochtones, les secteurs universitaires qui les soutiennent et certains États, comme la Bolivie ou le Venezuela, pointent les menaces que représente l’avancée des fronts de colonisation pour la survie des modes de vie « traditionnels ». Ils dénoncent l’impact négatif des industries extractives, la multiplication des obstacles au nomadisme pastoral, l’insécurité des régimes fonciers pour les territoires et l’identité culturelle des peuples autochtones. Ils évoquent les conflits qui les opposent ici à des entreprises hydroélectriques, là à des compagnies pétrolières, extractrices d’uranium ou encore aux grands consortia agroalimentaires. Ils montrent les incohérences des politiques publiques et relient les problèmes du changement climatique qui perturbent leurs économies de subsistance au type de développement économique des pays qui les englobent. Cela les conduit à proposer des solutions alternatives, s’appuyant sur les compétences autochtones en tant que « gardiens de la terre », un rôle qu’ils assument d’autant plus volontiers que le monde occidental, à leurs yeux, s’est éloigné des perspectives d’un développement qui serait favorable à l’ensemble des êtres peuplant la planète. Ils demandent ainsi à être reconnus dans ce rôle de guide spirituel, autant pour les connaissances qu’ils estiment posséder que pour leur capacité à anticiper les symptômes d’un mal développement dont le délabrement de leurs sociétés sont la conséquence.
Face aux principes occidentaux qui, à l’encontre d’une idéologie autochtone centrée sur le développement local et le respect des équilibres naturels, valorisent la circulation des hommes, des idées et des capitaux, les délégués autochtones prennent position sur une série de questions économiques. De la migration économique qui représente l’horizon de leur jeunesse à la migration écologique que le réchauffement climatique induit dans les écosystèmes qu’ils occupent, en passant par le contentieux de la propriété intellectuelle et de la marchandisation des savoirs, et l’exploitation de leur force de travail, aucune dimension sociale de l’économie mondiale ne leur est étrangère. Dans ce contexte, la crise économique et financière qui introduit de nouvelles tensions au niveau global est perçue par de nombreux acteurs internationaux comme l’occasion de repenser les modes de développement, ce que les représentants des peuples autochtones s’efforcent de formuler depuis plusieurs années[10].
Adaptations autochtones à la crise économique et financière globale
Si la plateforme internationale de dialogue avec les autochtones ne s’étend pas encore aux sphères de l’économie et de la finance, la situation économique du monde et la crise qu’il traverse ont été abordées lors de la dernière session de l’Instance permanente. À cette occasion, la Présidente en exercice, V. Tauli-Corpuz (Igorot des Philippines) directrice de la Fondation Tebtebba (nom Kankaney-ey-Igorot pour Indigenous Peoples International Center for Policy Research and Education) et membre actif du Indigenous Forum on Globalisation (IFG), a présenté les éléments d’un rapport très structuré sur l’impact de la crise sur les peuples autochtones. Auparavant, elle avait donné la parole à deux « experts » de profils très distincts. Le premier avait été nourri aux mamelles d’une science économique qui se veut objective et pleine de certitudes. Le second avait bu le lait des Anciens dont il exprimait la sagesse in persona. Nous présenterons brièvement ces trois communications.
L’exposé de M. Jomo Sundaram, un distingué économiste malaisien de l’ONU, montra à partir de graphiques très explicites la gravité de la crise économique globale et ce qui la différenciait des crises précédentes. Selon lui, cette crise avait été prévue par le système des Nations Unies, son impact concerne principalement les marchés financiers, y compris dans les pays en développement, alors que l’on assiste à une inversion des flux de capitaux qui auraient pu leur être utile. Montrant qu’à la fin des années 70, les pays en développement connaissaient une croissance rapide, tandis que les pays développés subissaient une forte inflation, il observe que la situation actuelle est fort différente, les destins des deux parties du monde étant liés entre eux, en partie à cause de la mondialisation. Les pays en développement subissent une baisse des exportations, alors que les flux d’aide sont en baisse et peu fiables quant à leur stabilité. Les projections de l’Organisation internationale du Travail (OIT) prévoient une hausse du chômage de 50 millions de personnes, et de plus de 200 millions les personnes qui sont en sous-emploi, ce qui signifie que les dépenses sociales des États devraient aller en augmentant. Or les politiques d’autorégulation impulsées par les pays développés n’ont pas contribué à améliorer le sort des populations et la diminution des ressources financières opère aux dépens d’un accroissement des dépenses de santé. L’instabilité qui s’ensuit représente une vraie menace géopolitique, les États se montrant peu enclins à coordonner leurs efforts. Concernant les peuples autochtones, le prochain défi pour ceux-ci est le combat pour les ressources naturelles, a-t-il estimé.
La seconde communication fut introduite par un prêtre maya, Niklas Lucas Ticum, porteur d’un « message de la Communauté Maya du Guatemala à l’Instance Permanente ». De courtes séquences filmées introduisirent des paroles maya, portées par quelques individus, hommes et femmes, âgés et plus jeunes, sur le changement climatique, son impact sur les communautés qui vivent en rapport étroit avec la nature, et l’importance de la sagesse des anciens Mayas. Nous n’entrerons pas ici dans l’examen savant du temps maya (un cycle dure 13 ba’qtun, soit 5215 ans), ni de l’exacte datation, le présentateur au Forum faisant état de l’entrée dans le 13e ba’qtun, tandis que certains estiment que le 13e ba’qtun se terminera le 21 décembre 2012, scellant ainsi la fin d’un monde. Le fait de présenter au siège des Nations Unies une prédiction maya, augurant d’un meilleur monde à venir après une période de réchauffement climatique, visait à mettre en évidence la sagesse des Anciens et à « valider » le caractère quasi scientifique de leurs savoirs astronomiques et astrologiques. L’enjeu était de montrer l’urgence de retrouver le modèle indigène et d’inclure « l’expérience millénaire des autochtones dans les perspectives globales de lutte contre la crise financière, économique et écologique afin de construire un rapport plus harmonieux avec la Terre-mère et ainsi garantir le futur de l’humanité ».
La troisième communication réalisée par la Présidente de l’Instance Permanente, une autochtone bien insérée dans les réseaux onusiens et académiques, témoigne de la possibilité de concilier approche scientifique et approche indigène de la question. En quelques diapositives, elle identifia la nature de la crise : la libéralisation des marchés des capitaux, la rupture entre politiques économiques et objectifs sociaux, la croissance des inégalités, le changement des relations entre l’État et le Marché, la dérégulation du marché du travail, le pouvoir croissant des firmes transnationales et des institutions financières. Considérant que les effets de cette crise pèsent plus précisément sur les pays qui se sont le plus ouverts à la globalisation, elle pointa les impacts déjà connus sur les peuples autochtones ; pauvreté croissante, risque de perdre maisons et territoires, destruction des modes de vie traditionnels, insécurité économique et alimentaire, augmentation des activités extractives (mines et forêts) au détriment des activités de subsistance, moindre accès aux soins de santé et sociaux. Elle mit en évidence les conséquences qu’auront pour les Peuples autochtones un certain nombre d’options de lutte contre la crise telles : le choix d’augmenter les dépenses d’infrastructures, opéré par la Banque mondiale et par d’autres fonds de développement étatique ; la moindre importance accordée aux mécanismes de sauvegarde de la protection sociale ; ou encore le laxisme entourant les études d’impact environnemental. Cela la conduit à proposer d’impulser une vraie réflexion sur un développement respectueux des droits humains et à exiger la mise en œuvre de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones dont l’épine dorsale est définie par le droit à l’autodétermination (expression tendant à remplacer celle de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes). Il s’agit pour elle de stimuler l’intégration des peuples autochtones dans la recherche de réponses à la crise, en relation avec les solutions envisagées pour réduire la crise due au changement climatique et s’y adapter.
En d’autres termes, les peuples autochtones disposant des modèles leur ayant permis de survivre jusqu’à présent, ils seraient capables de surmonter la crise qui les affectent autant sur les territoires qu’ils occupent que dans les lieux où leurs membres ont migré, s’ils retrouvaient une souveraineté qu’ils n’ont jamais concédé (même lorsqu’ils ont signé des traités comme les Amérindiens du Canada le firent avec la puissance anglaise, de « nation à nation »).
En guise de conclusion
Nous signalons le problème des contradictions entre droits des autochtones, droit au développement et projet de développement national. Comme il ressort de la documentation rassemblée depuis une trentaine d’années par les Groupes de travail et l’Instance des Nations Unies et archivée par le DoCip (Centre de Documentation, de Recherche et d’Information des Peuples Autochtones), les communautés autochtones sont souvent affectées négativement par les projets de développement nationaux. On citera ici l’exemple tout récent de la lutte que les Amérindiens d’Amazonie péruvienne ont mené pendant plus de 2 mois, en avril-juin 2009, pour protéger leurs territoires et modes d’existence, face à un gouvernement soucieux d’accélérer l’exploitation de la forêt. La volonté de mettre la législation péruvienne en phase avec le Traité de Libre Echange commercial avec l’Amérique du Nord conduisit le gouvernement du Président Alan Garcia à mettre en péril l’intégrité de la forêt amazonienne et les droits autochtones récemment reconnus. Alors que le gouvernement célébrait devant les Nations Unies son engagement ferme aux côtés des autochtones – le Pérou ayant assumé la présidence du Groupe de travail sur le projet de Déclaration durant une douzaine d’années, ce qui le conduisit à adopter sans réserve la DDPA –, ladite priorité économique de la nation dans une logique néo-libérale et l’existence d’intérêts plus puissants que ceux des Amérindiens, prirent le pas en 2008. Cela se traduisit par la rédaction de décrets contredisant la souveraineté des autochtones sur les terres collectives reconnues, avec la possibilité de déclasser ces zones et mettant un terme à un processus de titularisation des terres indiennes pourtant toujours nécessaire. L’enjeu inavoué est de laisser place à un autre maillage du territoire : celui des concessions sur lesquelles opérer la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, ou d’autres formes de « valorisation » des ressources naturelles. Cela poussa l’État, le 5 juin, à l’exercice d’une rare violence à l’égard des communautés engagées dans la lutte. Bilan : une vingtaine de policiers tués, une cinquantaine d’Indiens massacrés, un gouvernement discrédité et finalement conduit à retirer les décrets incriminés.