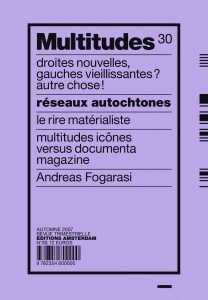Expérience et singularité
À l’origine de ce texte, il y a un étonnement devant une singularité, celle de mon inscription corporelle dans les relations humaines, en particulier lors de spectacles. Cet étonnement a commencé à prendre la forme d’une réflexion plus élaborée à l’occasion d’une expérience personnelle marquante, lors d’un spectacle de théâtre / danse contemporain auquel j’ai assisté à Bruxelles en février 2005 (La Chambre d’Isabella, de Jan Lauwers et Needcompany[2]) et qui m’a mis dans un état de délabrement physique et mental intense. Après le choc du spectacle, j’ai compris en parlant avec les personnes qui m’accompagnaient que ce qui m’avait mis dans cet état était notamment le clivage entre le rire du public et mon malaise face à ce qui était mis en scène. À partir de ce moment, j’ai voulu comprendre plus consciemment mon rapport corporel aux spectacles. Il s’agira donc dans ce texte de revenir sur diverses expériences personnelles pour en dégager une réflexion sur une éthique du rire en public.
Dans cette voie, une première étape est de prendre conscience des limites d’une approche universalisante du corps. Malgré les avancées conceptuelles majeures que l’approche phénoménologique, en particulier celle de Merleau-Ponty[3], ont permis de mettre en place à ce sujet, elles ne donnent que peu d’outils directement utilisables pour comprendre en quoi les réactions du corps dépendent de la trajectoire sociale de l’individu, de son histoire personnelle en tant qu’elle se passe dans une culture déterminée ou dominée par une culture majoritaire. En effet, mes tentatives pour arriver à élaborer une analyse de la spécificité de mon inscription corporelle n’ont commencé à prendre sens qu’en rattachant mes observations à des expériences similaires issues de la « culture populaire ». De plus en plus, je ne peux m’empêcher de faire des liens entre mon origine sociale, ou plutôt ma trajectoire sociale[4], et ma façon de penser, de sentir, d’agir. Cela m’amène à la conviction que l’approche phénoménologique doit faire la place ou tout au moins s’accompagner d’une approche anthropologique[5], subculturelle[6] ou mineure du corps. Cette constatation m’a progressivement mis sur la voie de l’étude de Mikhaïl Bakhtine sur Rabelais[7] qui est essentielle pour comprendre la spécificité du rapport au corps du monde populaire, et du rire comme conception populaire du monde en particulier. Mais c’est dans une autre étude de cet auteur[8], écrite dans les années vingt, que j’ai trouvé les éléments qui me manquaient pour établir les bases d’une éthique de l’acte singulier dont le rire est l’une des formes.
La souffrance du spectateur
Comment expliquer ma réaction viscérale lors de la représentation de La Chambre d’Isabella[10] ? Je pense qu’elle a débuté lors d’une scène où Arthur, le père d’Isabella, tombé en déchéance après la mort de sa femme, exécute sous l’emprise de la boisson un monologue, face au public, où il exprime maladroitement tout son mal-être. Pour rendre sa prestation particulièrement réaliste, l’acteur Benoît Gob utilise sa connaissance apparemment vécue de près de colères de soûlards issus des milieux populaires, en prenant l’accent facilement reconnaissable de ma ville natale. Pour la majorité des spectateurs, issus pour la plupart d’un milieu socio-culturel assez élevé et vivant dans la capitale, la représentation d’une telle « tranche de vie » ne pouvait que susciter la moquerie, la pitié ou, au mieux, la sympathie envers un « brave type ». Le contexte général de la mise en scène, faisant penser par certains aspects à la forme populaire du cirque, et l’attitude des autres acteurs sur scène, dansant et chantant ou simplement présents en souriant[11], me donnait l’impression qu’on ne laissait la place qu’à la première de ces possibilités. À mon sens, le metteur en scène, Jan Lauwers, dont la présence sur scène en costume blanc accentuait le rôle de Monsieur Loyal, était là comme narrateur, imposant aux spectateurs une passivité morale[12] difficilement compatible avec une éthique telle que Spinoza pourrait la définir. Ma résistance envers cette passivité est sans doute ce qui a déclenché ma crispation. Comme le formule très bien Anne Longuet Marx : « C’est la raison pour laquelle on peut tant souffrir au théâtre si la proposition d’espace est obscène, parce qu’on est impliqué dans cet espace. Le spectateur fait partie du dispositif, c’est donc insupportable de se commettre avec des choses avec lesquelles on n’est pas d’accord[13]. » Comme un texte construit son lecteur implicite, un spectacle construit aussi son spectateur implicite, mais, contrairement à la lecture solitaire du texte, la représentation du spectacle, qu’il s’agisse de théâtre, de danse ou de cinéma, suppose un public, présent ensemble. Cela nécessite une grande précaution dans la construction du spectateur implicite pour éviter qu’il engendre une cristallisation ou une polarisation trop forte des réactions des spectateurs réels[14].
Ma souffrance n’aurait pas atteint une telle intensité si les rires du public n’avaient continué à ponctuer régulièrement le spectacle alors que d’autres scènes, dont certaines auraient pu créer un malaise dans d’autres circonstances, suscitaient la même « mise à distance humoristique de la souffrance »[15], notamment par leur juxtaposition avec d’autres scènes ou figures au contenu plus léger. Il me paraissait clair que cette distanciation était utilisée par certains spectateurs comme un mécanisme de défense face à une situation désagréable ou même intolérable. Mais il me semblait que la mise en scène elle-même abusait de ce mécanisme au point de le convoquer en permanence. Ainsi, si le spectacle qui nous était proposé ce soir-là avait heureusement bien d’autres qualités, je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il prenait le risque, en généralisant le recours à la distanciation, sans égard à la diversité des réactions possibles des spectateurs, d’anesthésier leur sensibilité. Un public qui rit face à un spectacle se protège peut-être de celui-ci mais alors le spectacle rate une de ses fonctions importantes. Le spectateur ne s’entraîne plus à exercer sa sensibilité par l’exposition à la maladie peu dangereuse que représente le spectacle[16]. Dès lors, il ne sera pas immunisé contre le véritable danger présent dans la réalité car il n’aura pas été vacciné par le spectacle. Mais l’exposition à la souffrance ne devrait-elle pas faire partie de l’éducation du spectateur ? En tout cas, bien qu’involontairement peut-être, cette expérience aura finalement contribué à la mienne.
Dans la scène suivante, des objets ethnologiques et archéologiques[17] sont présentés un à un par les acteurs dans un crescendo qui se termine en hurlements. Isabella conclut par cette remarque : « Pourquoi Arthur m’a-t-il donné cette chambre ? Tous ces objets, les uns autant que les autres, étaient exceptionnels. Certains m’inspiraient de l’angoisse et je pendais toujours le faucon momifié dans un sac étanche à la balustrade de mon balcon, avec l’un des sept crucifix, pour qu’aucun rayon maléfique ne pénètre ma tête pendant mon sommeil. Et voyez, aucun pigeon ne venait chier sur mon balcon[18]. » On pourrait penser qu’il s’agit là d’un rabaissement[19] conforme à l’esprit grotesque de Rabelais. Mais, ces objets ayant déjà été profanés par la colonisation, je ne voyais pas le besoin de leur faire subir un tel sort dans ce contexte. Pour moi, les hurlements rendaient impossible toute tentative de redonner un nouveau sens à ces objets.
En fait, bien que ces deux scènes aient en commun d’effectuer directement ou indirectement un rabaissement carnavalesque, elles visent non pas le détenteur d’un pouvoir, comme dans le carnaval traditionnel, mais des personnes ou objets issus de mondes dominés, populaires ou coloniaux. Plutôt qu’une transvaluation liée au principe populaire de l’ambivalence[20], elles génèrent un sentiment uniquement négatif. C’est ce même principe ambivalent du rabaissement carnavalesque décrit par Bakhtine à propos de Rabelais qu’Artaud remarque dans une scène du film Monkey Business des Marx Brothers, « qui met le braiement d’un veau au même rang intellectuel et lui attribue la même qualité de douleur lucide qu’au cri d’une femme qui a peur »[21]. Cette ambivalence contraste avec le traitement de Lauwers où, à plusieurs reprises, les gestes et les cris des acteurs deviennent bestiaux et ridicules, sans que cela débouche sur un renouveau sur un autre plan.
Le corps ambivalent
Pour mieux saisir l’importance de cette notion d’ambivalence, il faut comprendre que la conception grotesque du corps chez Rabelais repose sur une façon spécifique au monde populaire de concevoir les rapports de l’homme et du monde, caractérisée par l’absence de négation[22], de séparation et de permanence[23]. Cette conception trouve son fondement philosophique dans la conception de l’homme comme microcosme. Cette notion, déjà présente en germe dans la tradition médicale hippocratique de l’Antiquité, connaît à la Renaissance un déploiement très large. En effet, à la Renaissance, facilitées par la circulation de livres imprimés et souvent traduits en langue vulgaire, de plus en plus d’hérésies[24] émergent sous la forme d’une « magie naturelle »[25, où les notions de microcosme et de sympathie entre tous les phénomènes donnent à l’homme une nouvelle place dans le cosmos : « l’homme peut réunir en lui le supérieur et l’inférieur, le lointain et le proche, peut pénétrer tous les mystères celés dans les profondeurs de la terre »[26]. Selon Bakhtine, dans cette conception du monde, « le corps humain y devenait le principe à l’aide duquel et autour duquel s’effectuait la destruction du tableau hiérarchique du monde existant au Moyen Âge et se créait un tableau nouveau »[27].
La spécificité de Rabelais est qu’il a saisi l’importance, au moment où le livre imprimé se répand grâce à la possibilité nouvelle de la reproductibilité technique de l’écriture, de transmettre tout un savoir populaire traditionnel, d’essence orale, irréductible à la théologie chrétienne[28]. Dans son œuvre, Rabelais réussit comme nul autre à inscrire la malléabilité de l’oral dans l’écrit en inventant, plus qu’un style, presque une langue qui lui est propre. Son écriture est la traduction en acte de la conception populaire du monde mais, bien sûr, vue par un lettré humaniste et médecin : « Pour lui, le corps est la forme la plus parfaite de l’organisation de la matière, partant, la clé donnant accès à toute la matière. (…) dans le corps humain, la matière devient créatrice, productrice, appelée à vaincre tout le cosmos, à organiser toute la matière cosmique ; dans l’homme, la matière prend un caractère historique[29]. » Cela va lui permettre de faire une critique de l’idéologie scolastique en utilisant les formes traditionnelles du comique populaire qui se prêtent parfaitement à ce nouveau but et lui permettent d’échapper (en partie) à la répression que lui vaudrait une attaque directe. Néanmoins, pour Rabelais, le fait de rire de la religion ne doit pas être interprété comme une prise de position athée avant la lettre. Si l’Église est une cible privilégiée, c’est parce que sa rigidité et son sérieux se prêtent à la relativisation par le comique populaire. Ainsi, selon Bakhtine, la véritable originalité de Rabelais tient à ce qu’il ne prenait pas plus au sérieux les hérésies que la doctrine scolastique officielle.
La conception, propre à la Renaissance[30], de la nature et de l’homme en tant que réciprocité du microcosme et du macrocosme, suppose de rester en empathie avec la cible de la moquerie. En effet, « dans la conception grotesque du corps, est né et a pris forme un nouveau sentiment historique, concret et réaliste, qui n’est pas l’idée abstraite des temps futurs, mais la sensation vivante qu’a chaque être humain de faire partie du peuple immortel, créateur de l’histoire »[31] Cette conception co(s)mique du monde implique que la critique de l’autre sous la forme de la satire puisse se retourner en autodérision, en auto-ironie. Même lorsque le rire populaire vise les tenants du pouvoir, la moquerie prend la forme d’un rabaissement carnavalesque, temporaire et ambivalent. De cette manière, l’irrévérence envers la hiérarchie (visant le rôle social), qui traduit un sentiment très vif de constituer un groupe à part[32], va de pair avec le respect pour la personne humaine. Dans le monde populaire, lorsque l’on rit de l’autre, on rit toujours également de cet aspect de l’autre présent chez soi-même, alors qu’au contraire, « le sérieux et la peur unilatéraux sont les sentiments d’une partie qui se sent coupée du tout »[33].
Vers une éthique de l’acte singulier
Nous vivons dans une société où le conditionnement réciproque des spectateurs et des spectacles tend à une reproduction industrielle du rire. Ce rire réducteur ramène chaque expérience à une même pauvreté émotionnelle que Bernard Stiegler nomme misère symbolique, où « les individus sont privés de leur capacité d’attachement esthétique à des singularités, à des objets singuliers »[35]. Ce qui engendre ce phénomène, ce n’est pourtant pas la reproductibilité de l’œuvre d’art en soi, qui permet sa diffusion au plus grand nombre et qui donc augmente les possibilités de partage d’émotions[36], mais seulement la reproductibilité de la réaction esthétique qu’elle suscite. Par exemple, au théâtre comme au cinéma, on subit de plus en plus cette expérience agaçante où des spectateurs rient parce qu’ils reconnaissent avant tout le comique sous l’acteur, même si l’action n’est pas drôle en soi, voire tragique[37]. Le véritable danger est la normalisation de la sensibilité esthétique et éthique des spectateurs.
11 Celui-ci va de pair avec la perte de la capacité à transmettre oralement les expériences, que diagnostiquait déjà Walter Benjamin dans les années trente[38] [38] Les textes principaux sont « Expérience et pauvreté »…
suite. En effet, il est impossible d’atteindre la singularité en tant que telle. Celle-ci n’est accessible qu’indirectement, par le partage d’une émotion et, plus précisément, par une expression indirecte libre[39] [39] Cette notion est centrale dans l’œuvre de Pier Paolo…
suite qui fait intervenir une interaction entre subjectivités et nécessite le recours à un intercesseur, narrateur ou acteur, duquel dépend fortement la responsabilité éthique du récit ou du spectacle : « Comme c’est dans une autre langue que l’on trouve parfois le mot juste pour exprimer une pensée, un concept, c’est à travers la personnalité de l’interprète qu’on a des chances d’entrapercevoir ce à quoi nous voulons toucher[40]. »
Un jour, ma femme m’a lu une histoire destinée à notre futur enfant, qui n’était alors qu’un projet. L’intensité de mon émotion croissait en fonction des relations que j’effectuais entre les points de vue de l’enfant possible que j’imaginais et du père potentiel qu’il impliquait. Mais je fus finalement touché par l’amour que ma femme me faisait sentir par son acte, accordant ainsi une place tout à fait singulière dans le monde à un nouvel être. Bakhtine a développé une éthique de l’acte singulier qui se prête tout à fait à la compréhension de cet événement qui marquait pour moi le passage de la possibilité d’avoir un enfant à sa réalisation singulière : « seul l’acte responsable surmonte tout caractère hypothétique, car en effet l’acte responsable est réalisation — déjà inévitable, irrémédiable et irrévocable — d’une décision ; l’acte est un bilan dernier, une conclusion générale définitive ; l’acte concentre, corrèle et résout dans un contexte un, singulier, et dernier aussi bien le sens que le fait, l’universel que l’individuel, le réel que l’idéal, car tout entre dans la composition de sa motivation responsable ; l’acte constitue une sortie de l’intérieur de la simple possibilité, qui débouche dans la singularité, une fois et pour toujours »[41]. Cet acte, ma femme n’aurait pas pu l’accomplir sans le support matériel et corporel de sa voix et de son intonation : « le mot vivant, le mot plein ne connaît pas d’objet qui soit totalement donné : par le simple fait que j’aie commencé à en parler, j’ai déjà adopté une certaine attitude envers lui, non pas une attitude indifférente, mais une attitude intéressée-opérante. Et c’est pourquoi le mot ne désigne pas seulement l’objet comme une certaine entité disponible, mais, par son intonation (un mot prononcé réellement ne peut être dépourvu d’intonation : son intonation découle du fait même de sa prononciation), exprime aussi mon attitude évaluative par rapport à cet objet, le désirable et le non désirable en lui et, ce faisant, le met en mouvement vers ce qui est son donné-à-accomplir, en fait une composante d’un événement vivant[42]. » Ainsi la « magie naturelle » a pu s’opérer pour continuer l’œuvre interminable de la vie.
Bakhtine conçoit tout énoncé comme un acte dont le contenu est reproductible mais dont l’énonciation par un sujet constitue un événement nouveau, non reproductible : « Lorsque, dans les langues, se font entendre les jargons, les styles, les voix, tout cela cesse d’être un moyen potentiel d’expression pour devenir une expression actualisée, réalisée ; la voix les a pénétrés, en a pris possession. Il leur incombe de jouer un rôle unique et non reproductible dans l’échange verbal (créateur)[43]. » De même, il conçoit tout acte humain comme un texte potentiel qui témoigne d’une singularité[44]. Par cette philosophie de l’acte comme expression, à sa manière, il fait sienne la conception de l’homme comme microcosme amenant à comprendre la relation de l’homme et de la nature comme un dialogue intériorisé, immanent : « on ne saurait comprendre l’acte hors du signe virtuel (reconstruit par nous-mêmes) qui l’exprime. (…) Nous ne questionnons pas la nature et elle ne nous répond pas. Nous posons les questions à nous-mêmes, et nous-mêmes, d’une certaine façon, nous organisons notre observation ou nos expériences en vue d’obtenir une réponse. Lorsqu’on étudie l’homme, on cherche et on trouve le signe partout, et il faut essayer d’en comprendre la signification »[45]. Ainsi, il nous invite à écouter derrière chaque mot et chaque acte la polyphonie des voix qui peuvent exprimer leur point de vue à partir de leur position singulière dans le monde.
La chambre de Jeanne
Ma grand-mère a à peu près l’âge d’Isabella. Comme elle, elle vit seule dans une pièce. Mais plutôt que d’une caméra reliée au cerveau et d’objets coloniaux, elle est entourée de photos et de bibelots qui lui rappellent ses souvenirs d’enfance et les personnes qui l’ont entourée durant sa vie. Elle n’est pas aveugle mais elle a besoin de ces objets et images matérielles pour garder un lien avec la réalité entre les visites de ses proches. En dehors de ces moments d’échange, tout se mélange lentement dans sa tête. À chaque nouveau récit d’une anecdote de sa vie quotidienne, un élément s’est ajouté, effacé ou modifié. Pourtant, il manque une photo dans cet ensemble, celle de mon père, son fils. Il est décédé il y a une dizaine d’années d’une tumeur au cerveau. Quand les médecins n’ont plus rien pu faire pour lui, elle l’a accompagné jusqu’à la fin, comme elle l’avait fait auparavant pour mon arrière-grand-mère et mon grand-père. Depuis, elle a dû continuer à vivre, seule, et, pour tenir le coup, l’oublier. Car, pour elle qui a perdu ses proches l’un après l’autre, qu’un fils parte avant sa mère, et surtout de cette manière si brutale et si éloignée de l’homme qu’il avait été, ce n’était pas pensable[47]. Pour remplir ce vide immense dans sa vie, elle a trouvé une solution ingénieuse : je suis devenu son fils. Et le reste du monde n’a qu’à se plier à ce fait primordial qui n’est finalement pas plus absurde que le mystère de la Trinité : si quelqu’un remet ce fait en cause, en suggérant une incohérence, elle invente une astuce ou elle part dans un rire embarrassé, mais sans jamais pouvoir accéder à cette partie de sa vie maintenant séparée d’elle-même. Néanmoins, dans ce contexte difficile, elle garde intacte sa capacité à saisir les êtres dans leur singularité, ce qu’elle manifeste à sa manière par un rire suivi d’une expression stéréotypée du style « On n’a jamais que le bien qu’on se fait » ou « Tant qu’on peut encore rire[48]… » La preuve en est cet ultime instant d’éternité partagé avant de se séparer : la répétition du même geste, effectué par ma femme pour remettre son chapeau, à chacune de nos visites, lorsque nous prenons congé d’elle, provoque le même rire spontané. Pour elle, la surprise est toujours renouvelée, la joie initiale est à nouveau vécue, la singularité du geste la touche à chaque fois. De cette manière, elle approche l’éternité car « qui a un Corps possédant un très grand nombre d’aptitudes, la plus grande partie de son Âme est éternelle »[49].
Pour moi, la forme supérieure du partage est l’indirect libre. L’indirect libre correspond à un point de vue à la fois éternel, universel et inscrit dans le temps et la singularité. Le rire indirect libre est l’affirmation joyeuse d’un instant d’éternité partagé. C’est le rire des amoureux lorsqu’ils sont touchés par la singularité de l’autre car « c’est peut-être ça aussi, tomber amoureux, être troublé par le mouvement dans un être, sa manière singulière d’être vivant »[50].
Notes
[ 1] Antonio Negri, « Nécessité et liberté chez Spinoza : quelques alternatives », in Multitudes, n°2, mai 2000, p. 172.
[ 2] Le texte est édité dans Jan Lauwers, La Chambre d’Isabella, suivi de Le Bazar du Homard, Actes Sud, 2006. Un dossier de presse et une vidéo peuvent être consultés sur www.needcompany.org
[ 3] Bien qu’il reconnaisse l’importance de l’histoire personnelle dans la formation des structures du comportement et de la perception, Merleau-Ponty insiste à diverses reprises sur leur ancrage dans l’unité de la culture humaine : « par-delà les distances de l’espace et du temps, il y a une unité du style humain qui rassemble les gestes de tous les peintres en une seule tentative, en une seule histoire cumulative, et leur production en un seul art ou en une seule culture » (La Prose du monde, Gallimard, 1969, p. 114-115). Si la reconnaissance de cette unité me semble légitime, Merleau-Ponty n’accorde pas suffisamment d’attention à mon goût aux mécanismes sociaux, liant sans intermédiaires l’universalité de l’homme et la singularité du regard de l’artiste. Bien que ne cherchant pas à mettre en évidence sa filiation avec la phénoménologie de Husserl ou de Merleau-Ponty, l’œuvre de Bourdieu constitue une tentative pour remédier à cette difficulté, notamment à travers la notion d’habitus, déjà présente chez ces derniers, mais que Bourdieu va utiliser comme analyseur du monde social décliné en différents champs, comme le montre François Héran dans son article « La seconde nature de l’habitus : tradition philosophique et sens commun dans le langage sociologique » (Revue française de sociologie, XXVIII, 1987, p. 385-416).
[ 4] Sans entrer dans les détails, je ne peux pas dire que j’ai été élevé dans une « culture populaire », dans le sens d’un milieu socio-culturel particulièrement défavorisé, mais la plus grande partie de ma famille n’a eu qu’une éducation de base, alors que j’ai été depuis mon plus jeune âge un intellectuel autodidacte, le seul à accéder par la suite à l’université. Mis à part les aspect spécifiques au lieu et à l’époque, les conflits intérieurs que peuvent entraîner cette situation sont parfaitement décrits dans l’autobiographie de Richard Hoggart, 33 Newport Street : autobiographie d’un intellectuel issu des classes populaires anglaises (Gallimard, 1991). Néanmoins, être différent n’est pas une situation si difficile à vivre lorsqu’on a la chance de vivre entouré par des personnes qui savent « accepter chez les autres ce que l’on ne comprend pas en eux » (Richard Sennett, Respect : de la dignité de l’homme dans un monde d’inégalité, Albin Michel, 2003, p. 297).
[ 5] Jean-Marc Leveratto, Introduction à l’anthropologie du spectacle, La Dispute / SNEDIT, 2006.
[ 6] Paul Sweetman, « Stop Making Sense ? The Problem of the Body in Youth / Sub / Counter-Culture » in Sarah Cunningham-Burley et Kathryn Backett-Milburn (dirs.), Exploring the Body, Palgrave, 2001, p. 183-200.
[ 7] Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Gallimard, 1970.
[ 8] Mikhaïl Bakhtine, Pour une philosophie de l’acte, L’Âge d’homme, 2003.
[ 9] Patrick Bonté, in Patrick Bonté, Nicole Mossoux, Anne Longuet Marx, L’Actuel et le Singulier : entretiens sur le théâtre et la danse, Lansman, 2006, p. 30.
[ 10] « La chambre d’Isabella est le portrait d’une femme forte, passionnée, qui tente de survivre dans le siècle le plus rapide et le plus turbulent. (…) Au moment où elle raconte son histoire, elle a presque quatre-vingt-dix ans, elle est aveugle et vit isolée dans une chambre à Paris. Elle participe à une expérience scientifique au cours de laquelle une caméra projette des images directement dans son cerveau. » (Jan Lauwers, La Chambre d’Isabella, suivi de Le Bazar du Homard, Actes Sud, 2006, p. 7).
[ 11] « Nous avons opté pour une présence très fugace du chant et de la musique. La musique semble présente “par la bande”, mais en fait, elle domine tout. Les émotions sont déterminées par ce que l’on entend. Je veux que tout le monde chante en direction du public en souriant autant que possible. Moi-même, je me trouve sur scène pour relativiser tout cela encore davantage. Je m’assieds tout simplement près d’eux, je chante un peu avec eux, je donne quelques explications au public. Aussi détendu que possible. Aucune sacralité. J’aimerais que le rituel du théâtre, ça devienne cela : des gens qui se rassemblent pour chanter. » (Jan Lauwers, extrait du dossier de presse).
[ 12] « La passivité n’existant pas réellement en soi, elle n’existe que relativement à celui ou ceux qui l’éprouvent en tant qu’ils se laissent être déterminés à agir par autre chose qu’eux-mêmes et confèrent, à cela qui les détermine, la capacité d’agir sur eux et à travers eux. » (Franck Fischbach, La Production des hommes : Marx avec Spinoza, Presses universitaires de France, 2005, p. 75).
[ 13] Anne Longuet Marx, ibid., p. 31.
[ 14] Je pense que, dans le contexte du roman, les études de Bakhtine ont montré l’intérêt de cette démarche avec les notions de dialogisme et de polyphonie. En ce qui concerne leur application au théâtre, on peut consulter Dialoguer, un nouveau partage des voix, Vol. I., « Dialogismes », Actes du colloque international, Université Paris-III, mars 2004 ; Études théâtrales, n°31 / 2004 et 32 / 2005, Louvain-la-Neuve, Centre d’études théâtrales, février 2005.
[ 15] « La Chambre d’Isabella : entretien avec Jan Lauwers », sur le site Théâtre-contemporain, 2001. www.theatre-contemporain.net/spectacles/chambre_d_isabella/entretien.htm
[ 16] Artaud pousse cette analogie jusqu’à ses limites lorsqu’il dit que « du point de vue humain, l’action du théâtre comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartuferie ; elle secoue l’inertie asphyxiante de la matière qui gagne jusqu’aux données les plus claires des sens ; et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu’elles n’auraient jamais eue sans cela » (Le Théâtre et son double, Gallimard, 1964, p. 46).
[ 17] « Ils appartenaient au père de Jan Lauwers, qui les a laissés, après sa mort, à sa femme et ses enfants. Ce sont des objets qui ont été arrachés à leur contexte culturel par un regard d’un autre temps — un regard colonial et exotisant. Ce sont des objets dans lesquels un monde — l’Afrique — s’est arrêté, pétrifié, mis de côté, muséifié et fétichisé. » (extrait du dossier de presse).
[ 18] Lauwers, ibid., p. 17.
[ 19] « Le trait marquant du réalisme grotesque est le rabaissement, c’est-à-dire le transfert de tout ce qui est élevé, spirituel, idéal et abstrait sur le plan matériel et corporel, celui de la terre et du corps dans leur indissoluble unité. » (Bakhtine, ibid., p. 29).
[ 20] « Rabaisser consiste à rapprocher de la terre, à communier avec la terre comprise comme un principe d’absorption en même temps que de naissance : en rabaissant, on ensevelit et on sème du même coup, on donne la mort pour redonner le jour ensuite, mieux et plus. Rabaisser, cela veut dire faire communier avec la vie de la partie inférieure du corps, celle du ventre et des organes génitaux, par conséquent avec des actes comme l’accouplement, la conception, la grossesse, l’accouchement, l’absorption de nourriture, la satisfaction des besoins naturels. Le rabaissement creuse la tombe corporelle pour une nouvelle naissance. C’est la raison pour laquelle il n’a pas seulement une valeur destructive, négative, mais encore positive, régénératrice : il est ambivalent, il est à la fois négation et affirmation. » (Bakhtine, ibid., p. 30)
[ 21] Antonin Artaud, ibid., p. 216.
[ 22] « La parodie carnavalesque est très éloignée de la parodie moderne purement négative et formelle ; en effet, tout en niant, la première ressuscite et renouvelle tout à la fois. La négation pure et simple est de manière générale totalement étrangère à la culture populaire. » (Bakhtine, ibid., p. 19-20).
[ 23] « L’auteur satirique qui ne connaît que le rire négatif se place à l’extérieur de l’objet de sa raillerie, il s’oppose à celui-ci ; ce qui a pour effet de détruire l’intégrité de l’aspect comique du monde, alors que le risible (négatif) devient un phénomène particulier. tandis que le rire populaire ambivalent exprime l’opinion du monde entier en pleine évolution dans lequel est compris le rieur » (Bakhtine, ibid., p. 20-21).
[ 24] En effet, une conception issue d’une culture dominante, comme le christianisme le fut pendant des siècles en occident, peut prendre un sens nouveau, et donc forcément hérétique, une fois traduite dans une langue populaire, comme Alexandre Koyré le montre dans son ouvrage Mystiques, spirituels et alchimistes du XVIe siècle allemand, Gallimard, 1971, p. 17, note 1 : « Combien d’“hérésies” ne doivent-elles leur origine qu’à un passage d’une formule ou d’une théorie d’un milieu théologique dans un milieu populaire ! Ou, ce qui veut dire la même chose, à leur traduction en langue vulgaire. » Carlo Ginzburg souligne également l’importance de l’influence réciproque entre culture populaire et culture savante à l’époque : « Avec une terminologie imprégnée de christianisme, de néoplatonisme, de philosophie scolastique, Menocchio cherchait à exprimer le matérialisme élémentaire, instinctif, de générations et de générations de paysans. » (Le Fromage et les vers : l’univers d’un meunier du XVIe siècle, Aubier, 1980, p. 103)
[ 25] Cette « magie naturelle » est une manière pour l’homme de comprendre et d’utiliser la productivité infinie et inépuisable de la nature : « Pour Paracelse, et en cela il n’est que le fils de son temps, la nature n’est ni un système de lois, ni un système de corps régi par des lois. La nature, c’est cette force vitale et magique qui, sans cesse, crée, produit et lance dans le monde ses enfants. » (Koyré, ibid., p. 83)
[ 26] Bakhtine, ibid., p. 362. Selon Michel Foucault, la pensée du microcosme « garantit à l’investigation que chaque chose trouvera sur une plus grande échelle son miroir et son assurance macrocosmique ; elle affirme en retour que l’ordre visible des sphères les plus hautes viendra se mirer dans la profondeur plus sombre de la terre » (Les Mots et les Choses, Gallimard, 1966, p. 46, je souligne).
[ 27] Bakhtine, ibid., p. 360. Cette vision hiérarchique, véhiculée par l’idéologie scolastique, est le propre du cosmos médiéval. Celle-ci reprend l’enseignement d’Aristote pour le rendre compatible avec la théologie chrétienne. La division entre un monde terrestre ou sublunaire fait de quatre éléments (terre, eau, air, feu) en transformation et un monde céleste ou supralunaire formé d’une matière (la quintessence) dont le mouvement parfait est immuable, peut se superposer à la conception hiérarchique du monde chrétien : « Plus l’élément est situé à un degré élevé de l’échelle cosmique, plus il est proche du “moteur immobile” du monde, meilleur il est, plus parfaite est sa nature. » (Bakhtine, ibid., p. 361)
[ 28] Selon Carlo Ginzburg, « c’est cette tradition, profondément enracinée dans les campagnes européennes, qui explique la persistance tenace d’une religion paysanne, rétive aux dogmes et aux cérémonies, liée aux rythmes de la nature, profondément préchrétienne. » (ibid., p. 161). Il cite Carlo Levi : « Dans le monde des paysans, il n’y a pas de place pour la raison, la religion ni l’histoire. Il n’y a pas de place pour la religion, justement parce que tout participe de la divinité, parce que tout est de façon réelle et non symbolique, divin, le ciel comme les animaux, le Christ comme la chèvre. Tout est magie naturelle. Même les cérémonies de l’Église deviennent des rites païens, qui célèbrent l’existence indifférenciée des choses, et les innombrables dieux terrestres du village. » (Le Christ s’est arrêté à Eboli, Gallimard, 1948, p.109-110).
[ 29] Bakhtine, ibid., p. 363.
[ 30] En fait, c’est à la Renaissance, « un âge caractérisé par la présence d’échanges souterrains féconds, dans les deux sens, entre la haute culture et la culture populaire » (Ginzburg, ibid., p. 177), que cette conception apparaît dans la culture écrite, mais on peut supposer qu’elle a été plus généralement répandue à d’autres époques, dans la culture populaire essentiellement orale.
[ 31] Bakhtine, ibid., p. 365.
[ 32] « on éprouve l’impression d’être “du peuple” au travers de ce qu’on admire comme de ce qu’on rejette et, plus généralement, au travers d’une expérience syncrétique de l’“appartenance” » (Richard Hoggart, La Culture du pauvre, Minuit, 1970, p. 44). Hoggart développe cette notion dans le chapitre 3.
[ 33] Bakhtine, ibid., p. 254.
[ 34] Walter Benjamin, « Expérience et pauvreté », in Œuvres, Gallimard, coll. Folio, 2000, t. 2, p. 372.
[ 35] Bernard Stiegler, « De la misère symbolique », in Le Monde, 10 octobre 2003.
[ 36] « Ce partage ne consiste pas uniquement dans la reconnaissance d’une sympathie à l’égard de ceux qui partagent mes goûts, comme l’affirme la sociologie critique du goût. Il consiste, d’un point de vue anthropologique, dans la transmission de l’émotion que j’ai ressentie au contact d’une œuvre, qui constitue précisément la manière de cultiver mon expérience de l’art en échangeant avec d’autres personnes et en confrontant nos expériences. » (Leveratto, ibid., p. 26).
[ 37] Dernièrement, j’ai fait cette expérience avec l’acteur Bill Murray, dans les films Lost in Translation (2003) de Sofia Copolla et Broken Flowers (2005) de Jim Jarmusch. Son visage impassible déclenchait systématiquement l’hilarité d’une partie de la salle, alors qu’il peut exprimer une gamme de sentiments très large en fonction du contexte. Jean-Michel Frodon constate que, bien souvent, « l’acteur a désormais atteint un état stable de représentation qui ne laisse pratiquement pas de place à de la singularité pour ses personnages » (« Les trois niveaux de la tristesse : Broken Flowers de Jim Jarmusch », in Cahiers du Cinéma, septembre 2005, n°604, p. 14).
[ 38] Les textes principaux sont « Expérience et pauvreté » (ibid., t. 2, p. 364-372) et « Le conteur. Réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov » (ibid., t. 3, p. 114-151).
[ 39] Cette notion est centrale dans l’œuvre de Pier Paolo Pasolini (voir en particulier L’Expérience hérétique, Payot, 1976) et elle est développée par Gilles Deleuze dans L’Image-temps, Minuit, 1985. Voir également mon article, « Transhumaniser et organiser les multitudes », in Multitudes, n°18, automne 2004.
[ 40] Nicole Mossoux, ibid., p. 59.
[ 41] Mikhaïl Bakhtine, Pour une philosophie de l’acte, L’Âge d’homme, 2003, p. 53.
[ 42] Bakhtine, ibid., p. 57-58.
[ 43] Mikhaïl Bakhtine, Esthétique de l’expression verbale, Gallimard, 1984, p. 331.
[ 44] Bakhtine, ibid., p. 316.
[ 45] Bakhtine, ibid., p. 323.
[ 46] William Shakespeare, La Tempête, Gallimard, coll. Folio théâtre, 1997, Acte IV, Scène I.
[ 47] « C’est surtout chez le mourant que prend forme communicable non seulement le savoir ou la sagesse d’un homme, mais au premier chef la vie qu’il a vécue, c’est-à-dire la matière dont sont faites les histoires. De même qu’au terme de son existence, il voit défiler intérieurement une série d’images (…), ainsi, dans ses expressions et ses regards, surgit soudain l’inoubliable, qui confère à tout ce qui a touché cet homme l’autorité que revêt aux yeux des vivants qui l’entourent, à l’heure de la mort, même le dernier des misérables. C’est cette autorité qui est à l’origine du récit. » (Benjamin, ibid., p. 130, je souligne).
[ 48] Richard Hoggart explique que ces « aphorismes traditionnels de la culture populaire ne sont jamais utilisés ou pensés comme les moments logiques d’un raisonnement ou d’une argumentation » et ne doivent donc pas être évalués en tant qu’expressions d’une vérité banale mais qu’ils sont comme des incantations ponctuant le discours et qui possèdent une « fonction de réassurance dans au monde changeant et difficile à maîtriser » (La Culture du pauvre, Minuit, 1970, p. 59). En termes linguistiques, on dirait qu’ils marquent essentiellement la fonction phatique de contact et la fonction conative de lien de connivence avec l’interlocuteur.
[ 49] Spinoza, Éthique, Seuil, coll. Points essais, Livre V, Proposition 39.
[ 50] Anne Longuet Marx, ibid., p. 30 (je souligne).