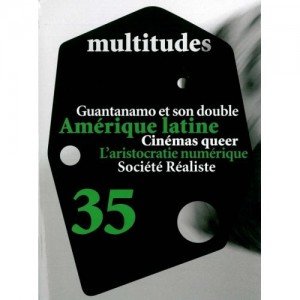« L’art est tout ce qui mobilise et agite. L’art est ce qui nie ce mode de vie et qui dit : faisons ce quelque chose pour le changer. » (1)
En Amérique latine, « art-action » est une expression communément admise pour parler de la performance. Depuis les années 1960, cet art de résistance et d’insubordination, intrication de la politique et d’un art du corps, s’est emparé de tout un continent, en résonance avec l’histoire spécifique de l’Amérique latine, entre insurrections, révolutions et dictatures, avec l’urbanité comme cadre, la rue comme espace primordial et l’importance du corps collectif (en écho avec les rituels indigènes et les fêtes populaires). Art de l’action (2), il travaille à une efficace politique assumée. « Art inobjectuel » (3), il se détache de la production de l’objet et de l’œuvre, pour mieux s’intéresser au faire, au processus, à notre puissance et capacité d’agir sur le réel, dans une indistinction entre pensée et action, art et vie, scène et spectateurs. C’est un appel à l’action.
Au sein de cette tradition de l’art-action à forte teneur politique, de nombreuses expériences collectives ont surgi, principalement aux alentours de 1968. Elles relèvent, au-delà de la performance, de formes d’intervention urbaine et d’actions artistiques qui ne sont jamais séparées de l’activisme politique. Tel était le cas, par exemple, de la Génération des Groupes au Mexique, directement issue du mouvement estudiantin de 1968 et active entre les années 1970 et le début des années 1980. Cette tradition n’a jamais cessé depuis d’essaimer sur l’ensemble du continent latino-américain.
De là s’origine également l’éclosion, principalement depuis les années 1980, d’un très grand nombre d’artistes performeuses, œuvrant depuis le même lieu d’un travail féministe de l’art ou intégrant à leur travail la dimension du genre, de la sexualité et de l’identité culturelle.
Parallèlement, une scène de la performance latine composée d’artistes chicanos ou d’origine latino-américaine existe en Californie, depuis les années 1970.
Nous présentons ici le travail de deux collectifs d’artistes issus de ces différents contextes, et qui travaillent respectivement, l’un depuis cette scène de la performance chicana (Guillermo Gómez-Peña et son collectif de performeurs, La Pocha Nostra), l’autre depuis l’intervention urbaine (le collectif féministe bolivien Mujeres Creando).
Ces deux collectifs nous paraissent décisifs à plus d’un titre. Guillermo Gómez-Peña et la Pocha Nostra articulent une esthétique post-identitaire du passage et de la frontière – un queer créole – à une réflexion autour des processus postcoloniaux de la culture spectaculaire globale contemporaine. Ils proposent une méthodologie active de décolonisation des corps par le biais de la performance. Les Mujeres Creando placent leur démarche au cœur des mouvements révolutionnaires latino-américains récents, tout en contribuant à y réinventer une langue et une politique minoritaires, depuis une perspective anarcho-féministe spécifique de politisation du corps et d’exploration d’un imaginaire radical. Le travail visuel de vidéoperformances de ces deux collectifs est issu à la fois de captations qui documentent leurs actions et performances, et d’objets vidéos d’ordre poétique, entre fiction et documentaire.
« I’m a Queer Chicano / A native in no land / An orphan of Aztlan / (…) With one foot / on each side / of the border / not the border / between Mexico / and the United States / but the border between / Nationality and Sexuality (…) » (4)
Un nouveau monde de la frontière
Guillermo Gómez-Peña, Chicano « post-mexicain » immigré aux États-Unis – « l’Amérique latine du Nord », comme il l’écrit –, est performeur, théoricien, écrivain chroniqueur, artiste de radio, vidéaste. Ses vidéo-performances activistes œuvrent à l’émergence d’un monde de la frontière : un « new world border » alternatif au nouvel ordre mondial (« new world order »), par l’invention d’une formidable langue poétique spanglish et des mises en scène grotesques et rageuses qui mettent en cause l’Amérique raciste, sexiste, capitaliste et homophobe.
Guillermo Gómez-Peña est le directeur artistique de la compagnie de performeurs La Pocha Nostra, basée à San Francisco, qui a le projet de traverser et d’effacer les frontières dangereuses entre art et politique, pratique et théorie, artiste et spectateur. « Nous nous efforçons d’éradiquer les mythes de la pureté et de dissoudre les frontières entourant la culture, l’ethnicité, le genre et le métier. » (5)
Le néologisme spanglish Pocha Nostra vient du terme pocho, dont le sens littéral est « fruit pourri ». C’est une insulte qui a fait l’objet de nombreuses réappropriations. Elle désigne les Chicanos nés ou élevés aux États-Unis qui parlent le spanglish sans savoir parler « correctement » l’espagnol. Pour Gómez-Peña, le terme marque une volonté d’hybridation culturelle et linguistique et de dissolution des appartenances nationales, en partant de son identité fragmentée de Chicano qui défie les essentialismes de l’Amérique nationale blanche mais aussi du territoire mexicain.
Ainsi, sa langue expérimentale, faite d’interjections, de jeux de mots et de trafics approximatifs entre plusieurs langues – l’espagnol, l’anglais, le spanglish (ou gringoñol), les langues indigènes, le mauvais français, ainsi qu’un recyclage du langage d’Internet –, invalide la pureté des cultures, des identités statiques ou des nationalités fixes. C’est par un nomadisme des langues franches (linguas francas), comme autant de zones franches, bâtardes, impures, faites de pollution et de contaminations, mal ou non traduites, qu’il retranscrit l’expérience de l’exclusion partielle ou complète d’une langue, commune à la condition des migrants.
Cette langue dessine une cartographie utopique, décentrée des projets états-unien et mexicain. Un nouveau pays dans un nouveau continent, encore à nommer : une autre Amérique latine, flottante. Un monde de l’abolition des frontières, un internationalisme ex-centris, qui évite les capitales du pouvoir et se fomente plutôt depuis les « trous noirs » de l’Occident, les géographies périphériques. Une autre Amérique qui appartient aux sans-abri, aux nomades, aux migrants, aux exilés, et qui pourrait avoir pour noms : Amerindia, Americamestiza-y-mulata (Amériquemétisse-et-mulâtre), Afroamerica, Hybridamerica, ou encore Arte-America, une Amérique conceptuelle redessinée par l’art et les idées, organiquement produite par la géographie réelle, les migrations, les cultures (6).
Une cartographie renversée et tournoyante, s’ancrant dans des identités trans- et post-nationales, où le quart-monde inventerait la rencontre entre indigènes et migrants des Amériques, où le Mexique, pays d’exode et nation déambulante, serait redessiné par la mémoire de ceux qui sont partis (les Chicanos) et de ceux qui restent. Un continent où l’hybridité prendrait corps dans un projet de démocratie sexuelle.
La lecture politique de Gómez-Peña prend la mesure des processus postcoloniaux contemporains, qui ont désormais les atours du néocolonialisme économique, de la violence des expulsions et des déportations migratoires, de l’ethno-tourisme, du spectacle de la culture globale et de l’exploitation capitaliste des différences culturelles édulcorées, réifiées, avalées par la machine du marché de l’art. Contempteur du backlash survenu contre les politiques identitaires aux États-Unis et du délitement de la culture critique, désormais confinée au milieu universitaire et au monde de l’art, Gómez-Peña trace aussi le sombre portrait d’une Amérique contemporaine, l’Amérique post-11-Septembre de Bush, où se déploient la censure d’une contestation assimilée au terrorisme, la paranoïa nationaliste et le désengagement de l’État envers la culture, qui entraîne une paupérisation des artistes et une autocensure généralisée.
Formé à la performance politique au Mexique avant de migrer en Californie en 1978, Gómez-Peña participait dans les années 1980, ainsi que d’autres performeurs chicanos de la scène californienne, à l’expérience du Taller de Arte Fronterizo/Border Art Workshop, qui mène des interventions sur la frontière entre Mexique et États Unis. Avec la Pocha Nostra, formée en 1993 avec Roberto Sifuentes et Mola Mariano, il a continué de mener des performances dans l’espace public, et notamment autour de la frontière – Cf. The CruXi-fiction Project (1996), où, habillé en mariachi, il se crucifiait dans le désert, en protestation contre la police migratoire américaine. Depuis quelques années, avec les performances/spectacles/mises en scène The Museum of Frozen Identities (1997), The Museum of Fetishized Identities (2000), Ex-Centris (2003), Mexican Artists in Search of Aggressive US Curator to Domesticate Them (2003), la galerie et le musée comme lieux de déconstruction du colonialisme culturel du monde de l’art mais aussi de « transformation et d’imagination radicales », comptent parmi ses espaces privilégiés.
L’esthétique de la Pocha Nostra mélange un univers prosthétique et technologique proliférant que Gómez-Peña qualifie de « robo-baroque » ou d’« esthétique-ethno-techno-cannibale », dévorant et samplant les cultures chicano et télévisuelle, le clip, la pornographie, la mode, l’imagerie religieuse et militaire, le western, l’anthropologie, le journalisme ou l’histoire des arts visuels et de la performance. Ses vidéo-performances, pour la plupart tournées par le réalisateur Isaac Artenstein, mettent en scène Gómez-Peña dans des monologues biographiques, utilisant l’invective, la caricature kitsch, le pastiche, le jeu de rôles, le détournement du « folklore ».
Les questions de genre prennent chez lui la forme d’une traversée des frontières, médiée par l’usage du travestissement, ethnique et « genré ». Le passage, la non-appartenance, et tout à la fois l’identité, constituent pour lui autant d’enjeux politiques. « Nous sommes des créatures interstitielles et des citoyens frontaliers par nature » (7), écrit-il. Ce jeu de collage, de patchwork identitaire, depuis des personnalités mouvantes, multiples et toujours réinventées, dessine une « post-identité rebelle et diasporique » (8), Gómez-Peña esquissant ainsi, conjointement aux autres artistes performeurs queer chicanos de la scène californienne, un queer créole. Ses personnages de S/M Zorro, Chaman travesti ou Samoan cyborg exacerbent les signes identitaires sexuels ou « folkloriques », les accessoires érotiques, les masques mexicains ou amérindiens, dans une atmosphère chamanique fortement sexualisée et ritualisée. Ses mises en scène, peuplées de corps maquillés, peints, tatoués, piercés, et de nombreuses références au S/M mélangeant cérémonials ancestraux et fêtes jouant des artifices, relèvent de la dimension cathartique du body art, telle qu’elle a pu être utilisée par Ron Athey ou les Modern Primitives, par Fakir Mustafa entre autres.
Décoloniser le corps
« Nos corps sont aussi des territoires occupés. Peut-être que le but ultime de la performance, spécialement si tu es une femme, gay ou une personne de couleur, est de décoloniser nos corps et de rendre ces mécanismes décolonisateurs apparents pour notre public dans l’espoir qu’il s’en inspire et fasse de même avec le sien » (9).
C’est ici que s’ouvre le chantier de Pocha Nostra autour de la déconstruction du regard colonial et réificateur. La déconstruction sera permise par la mise en scène, lors de leurs spectacles/performances à partir de tableaux et musées vivants interactifs co-créés avec le public, d’un muséum naturel des identités fétiches, composé de dioramas (10) ethnographiques ou de freak shows, qui, en exhibant et exacerbant la fétichisation des identités subalternes, parodient les pratiques postcoloniales contemporaines de représentation, tel un miroir tendu au spectateur.
Gómez-Peña dresse en effet le constat d’une fétichisation des identités dans la société contemporaine américaine et mondiale, à travers les médias – ce qu’il appelle le « Corporate multiculturalism ». Un multiculturalisme apolitique et capitaliste qui repose sur une fascination pour les différences culturelles, raciales et sexuelles domestiquées, érotisées et dépolitisées (« différences à la carte ») que véhiculent l’art global, Internet, Hollywood et la télévision globale.
« Le nouveau fétiche, c’est la différence anodine, domptée, stylisée, Altérité low-cal, dépouillée de toutes ses implications politiques. Le nouveau discours dominant déclare que nous sommes déjà installés dans une société post-sexiste et post-raciste. »
Il s’agira donc, pour Gómez-Peña, de repolitiser ce corps blessé par la chirurgie invisible de la pop culture. Une opération d’incorporation des stéréotypes permet tout d’abord de dénaturaliser et de désigner ces images qui stigmatisent « les Autres », et d’inverser la pyramide sociale et raciale par un jeu de mime, d’exagération et d’ex-position de la spectacularisation de ces identités fétichisées.
Ainsi, dans ses dioramas de « sauvages artificiels », il met à jour la relation de voyeurisme que le centre autoproclamé entretient désormais avec ses marges, une nouvelle relation épistémologique entre sujet et objet, entre le mainstream et les subcultures, et une relation qui s’exempte de tout questionnement sur le pouvoir et les privilèges.
Les performeurs de la Pocha Nostra, offerts à la merci du public, révèlent ce que la télévision produit chaque jour : l’humiliation des sans-emploi, des femmes, des personnes de couleur, des gays et des lesbiennes, des prolétaires, des étrangers, des handicapés.
C’est là qu’opère ce que Gómez-Peña désigne comme un geste d’anthropologie renversée : il s’agira de traiter la culture dominante comme si elle était marginale, exotique. Le spanglish utilisé pendant les performances sera un médium particulièrement puissant, contraignant une partie du public à l’expérience de l’étrangeté. Être une minorité dans son propre pays.
« Le public doit travailler avec ce miroir, comme dans un exercice démocratique. C’est une aventure hypertextuelle, un voyage à plusieurs niveaux ; réfracter leur position de voyeur. » En effet, à la fin du show, la distance entre le performeur et le public s’annule. Le public peut toucher, sentir, manipuler les corps des performeurs et il est invité à performer lui-même ses propres identités fétiches. La confusion du spectateur invité à participer, confronté à son propre imaginaire à décoloniser, permet, pour Gómez-Peña, un processus d’exorcisation des démons postcoloniaux, racistes, hétéronormatifs, sexistes, incorporés et présents en chacun. Il s’agit d’une mise à plat destinée, par la suite, à initier des relations qui s’affranchissent des rapports de domination. Ce processus de prise de conscience doit permettre de défaire les présupposés du public, mais ceux aussi des performeurs eux-mêmes, jamais totalement libérés de leurs propres préjugés.
Pour Jean Genet, l’artiste minoritaire est celui qui se donne la charge d’éliminer ce qui subsiste en lui de la pensée de la domination, ou de la soumission de cette pensée à l’ordre majoritaire. Il s’agit ainsi, comme le formule l’écrivain antillais Patrick Chamoiseau, d’interroger sa propre écriture, de « suspecter les conditions de son jaillissement et déceler l’influence qu’exerce sur elle la domination-qui-ne-se-voit-plus. » (11). Si « la psychologie de l’opprimé est façonnée par celle de l’oppresseur » (12), on doit penser aux manières de décoloniser le corps et tous les imaginaires, de lutter contre les fictions établies des « colonisateurs ». C’est d’une telle entreprise qu’il s’agit pour la Pocha Nostra, qui englobe à la fois les performeurs et leur public, au sein de la culture postmoderne de l’ultra-spectacle.
Nous sommes un mouvement social
« Folles, agitatrices, rebelles, désobéissantes, subversives, sorcières, filles de la rue, graffiteuses, féministes-anarchistes, lesbiennes et hétérosexuelles ; mariées et célibataires ; étudiantes et employées de bureau ; Indiennes, souillons, pauvres filles et demoiselles ; vieilles et jeunes ; blanches et brunes, nous sommes un tissu de solidarité, d’identités, d’engagements, nous sommes des femmes. » (13)
Mujeres Creando, collectif multiple de femmes en rébellion, mène en Bolivie depuis quinze ans une passionnante élaboration entre intervention urbaine, critique radicale, utopie irrépressible et célébration faste et tendre du corps, du plaisir, du quotidien, des puissances de l’imaginaire. Leurs « actions » ou performances de rue dessinent une posture éthique, unique en son genre, d’agitatrices en lutte contre les oppressions patriarcales, les schémas coloniaux, les politiques néolibérales. «Ni intellectuelles ni artistes », graffiteuses et vidéastes de leurs actions, elles rejettent toutes les formes de « séparation » de l’art et la division entre travail intellectuel, manuel et créatif. Elles dessinent une démarche féministe originale, en phase avec le courant féministe autonome anarchiste latino-américain qui prône une alliance, faite d’hétérogénéités et de multiplicités, entre lesbiennes, Indiennes, hétérosexuelles et prostituées. Elles dénoncent les politiques de contrôle de la natalité des ONG, et fomentent une attitude de « désobéissance culturelle » à la fois loyale et critique vis-à-vis des cultures indigènes andines.
Le collectif Mujeres Creando (14) est né en 1992 à l’initiative de Mónica Mendoza, Julieta Paredes et María Galindo, ces dernières ayant été l’unique couple ouvertement lesbien de l’histoire de la Bolivie, bientôt rejointes par une quinzaine de femmes d’origines diverses. Le groupe a commencé par ouvrir des espaces alternatifs autogérés avant d’apparaître sur la scène publique bolivienne, en 1993, à travers la pratique du graffiti. Elles recouvraient les murs de La Paz d’interpellations toniques à l’égard du pouvoir politique, mais aussi du système patriarcal. « Il est temps de passer de la nausée au vomissement. Jugement pour Banzer » (15), « Un pénis, n’importe quel pénis, est toujours une miniature », « Désobéissance, par ta faute je vais être heureuse », ou bien « Pour tous les systèmes de fachos et de machos, la femme est une pute. Mort aux systèmes, vive les putes », ou encore « Face à la rupture entre sentir et penser, Mujeres creando, pour une autre société ». Ces énoncés, d’une précision tranchante et toujours inscrits dans un registre poétique, ont contribué à populariser leur style, construisant, depuis la rue, la présence incandescente et voluptueuse d’un féminisme pédagogique et insolent. « Graffiter est quelque chose de très sérieux, c’est une action par laquelle nous mettons nos corps dans une lutte historique pour transformer notre société. Nous n’y mettons pas un corps héroïque, un corps militarisé ; nous y mettons un corps vulnérable, sensible, sensuel, créatif, désarmé et non violent. » (16) Cette attitude s’est trouvé renforcée par la suite à travers des prises de position et des publications. Dans une langue amoureuse et frémissante, tentant de ne jamais se départir d’une posture célébrant l’irrévérence et l’insurrection politique des désirs et de la raison, elles ont dessiné les soubassements méthodologiques et idéologiques de leur collectif, singulier à la fois au sein du féminisme latino-américain et des mouvements sociaux de gauche boliviens.
Le féminisme de Mujeres Creando critique les normes esthétiques, la domestication des corps, le patriarcat – qui n’a, selon elles, rien perdu de sa vigueur, sous les traits de la famille, du mariage et des fidélités inconditionnelles –, mais également des formes dévalorisées du travail féminin, du contrôle social exercé sur le plaisir et la sexualité, des politiques de natalité dans le contexte très particulier d’un pays où l’avortement est illégal mais où les politiques internationales d’injonction au contrôle de la natalité vis-à-vis des peuples indigènes andins déshérités ont souvent revêtu un caractère eugéniste et raciste (17). C’est ainsi qu’il faut comprendre l’attitude intransigeante de Mujeres Creando face au féminisme institutionnel et aux errements de certaines ONG de femmes en ce qui concerne les campagnes de stérilisation forcée menées dans les Andes à l’encontre des pauvres, hommes et femmes, d’origine indigène. Mujeres Creando dénonce, aujourd’hui encore, l’utilisation des thèmes de l’avortement et de la contraception et la rhétorique des « droits sexuels et reproductifs des femmes », liées à l’injonction constante au contrôle de la reproduction des peuples andins déshérités (18).
Leurs interventions dans l’espace public trouvent une autre modalité en 1999, lorsqu’elles sont invitées à s’exprimer, en toute liberté et avec un plein contrôle éditorial, par la chaîne de télévision bolivienne PAT, qui leur offre huit plages d’émissions. Elles donneront à voir des performances de rue qui seront regardées d’un bout à l’autre du pays et qui, au-delà des controverses, procureront au collectif une envergure majeure en tant qu’acteur de la vie sociale bolivienne, haï par beaucoup mais important pour d’autres.
Ces performances intitulées Creando Mujeres, acciones [actions de rue (2001) mêlent avec expressivité et force d’interpellation des thématiques diverses (féminisme, traces de la dictature, justice corrompue, racisme, critique des accointances des ONG avec le néolibéralisme ou la corruption). C’est au cours de l’une de ces actions que María et Julieta assument, crânement, face à la ville et au monde, l’amour qui les unit.
En 2003, María Galindo, co-fondatrice de Mujeres Creando signe une fiction aux splendeurs oniriques, Mamá no me lo dijo [Maman ne me l’a pas dit, à partir de cinq figures de femmes boliviennes (l’Indienne, la mariée, la vendeuse du marché, la pute, la nonne). Ce sont autant de récits de vie qui tissent une narration entre réel et performance. Le film est scénarisé et il met en scène la polyvocité des femmes de la société andine. María Galindo voit dans la télévision l’un des espaces les plus politiques de la société, un « espace colonisé par le regard commercial et patriarcal, et surtout yankee, de nos corps, nos peaux et nos rêves ».
Les Mujeres Creando s’exemptent du champ de l’art pour lui préférer l’imagination de nouvelles formes de lutte, vues comme pratiques créatives. Le graffiti, les actions de rue et les films télédiffusés constituent pour elles une méthode dont l’adresse, le « tu » dépouillé de conventions et de hiérarchies, prend également la forme d’une interaction directe avec la population. La lutte ne doit pas être sacrificielle, disent-elles, mais doit plutôt se conjuguer avec aimer, sentir et créer. Leur politique est une tâche vitale et une façon de vivre, arraisonnée à la quotidienneté des femmes du peuple qui doivent se débrouiller avec leurs enfants, adossées à l’anxiété économique. Il s’agit de fêter la vie sous toutes ses formes possibles, dans la pleine confiance de la créativité de tou/te/s, dans un geste d’embrassement du quotidien transmué en art et, réciproquement, un art fait vie, dans la plus pure tradition féministe de l’abolition privé/public. Mujeres Creando énonce sa volonté de dissoudre les distinctions classistes entre artistes et travailleurs, pour mieux réserver ses égards aux potentialités créatrices de chacun/e, y ajoutant le dessein d’incorporer et de faire reconnaître comme formes de résistances culturelles, mais aussi faits créatifs, les pratiques et techniques de survie de leur peuple, les inventions du quotidien et autres arrangements astucieux.
On sait que, depuis le génocide des peuples originaires, la société bolivienne n’a jamais cessé d’être pigmentocratique. Depuis son origine, Mujeres Creando a pris en charge le combat antiraciste sous la bannière d’une multitude joyeuse et d’« alliances insolites » entre femmes indiennes, blanches et métisses, travaillant, conjointement au féminisme latino-américain, autour de cette articulation entre les oppressions spécifiques de genre, de classe et de race. Les fondatrices de Mujeres Creando ont rapidement critiqué aussi les logiques machistes présentes à gauche ainsi que dans les mouvements indigénistes, pour leur opposer un féminisme anarchiste. Elles ont participé à la scission majeure du mouvement féministe latino-américain, survenue à partir des années 1980, celle d’une dissidence « autonome ». Les féministes autonomes présentes sur tout le continent se sont souhaitées indépendantes des partis politiques et des États et elles se sont opposées à l’institutionnalisation du féminisme, qui, à travers l’implantation d’ONG pour les droits de femmes, perpétuait une situation de subordination vis-à-vis des pays du Nord. Leurs stratégies et missions se déployaient en effet selon les cadres imposés par les pourvoyeurs de fonds occidentaux, qui décrétaient les priorités et agendas du féminisme à partir d’un maniement souvent peu subtil des catégories du « progrès » et du « développement » – usage se révélant bien souvent impérialiste, laissant sur le bas-côté, par exemple, les spécificités des lesbiennes ou des femmes issues des cultures originaires ou de l’esclavage (indiennes et noires) et neutralisant les aspirations révolutionnaires de renversement des ordres politiques.
Dans leur grammaire des appartenances identitaires hétérogènes, les Mujeres Creando, affinent leur attitude de « désobéissance culturelle » (19). Elle consiste à trouver dans chaque culture des interstices, des lieux d’où il est possible de partir pour poser des gestes de dissidence, féministes en l’occurrence. Ainsi en va-t-il de la possibilité de critiquer l’idéologie de la complémentarité entre homme et femme dans la cosmovision andine, tout en refusant l’écueil d’une posture de progrès à l’occidentale qui ferait le jeu d’un impérialisme culturel. C’est dans cet espace fragile que tente, avec plus ou moins de succès, de se trouver Mujeres Creando (20). Nous sommes d’autant plus sensibles à une position qui invente sa loyauté envers des cultures d’origine minorisées mais en y ménageant des gestes souverains de rébellion, qu’elle trouve des échos dans les féminismes qui nous sont tout proches. C’est une invitation lancée aux féminismes liés à la postcolonialité en France, à une réelle autonomie à l’égard, tout à la fois, de l’État français et de ses politiques racialisantes d’instrumentalisation du féminisme ; des impensés coloniaux qui habitent encore les féminismes majoritaires ; des dynamiques sexistes des multiples communautés d’appartenance. Autrement dit, en France, cette notion de désobéissance culturelle pourrait permettre aux féminismes issus des immigrations postcoloniales, et sans pour autant rompre avec leur éthique communautaire, de fomenter leur féminisme d’insubordination.
« Nous sommes un mouvement social », disent les Mujeres Creando. Et, en effet, sur la scène contemporaine, l’œuvre des Mujeres Creando se rattache moins aux pratiques de la performance qu’à celles d’un art de la rue (« arte callejero », d’intervention urbaine) qui se confond avec les « nouveaux mouvements sociaux » latino-américains (parmi les nombreux collectifs qui ont participé activement aux bouleversements politiques récents en Amérique latine, on peut citer le Colectivo Sociedad Civil et La Resistencia, au Pérou, qui ont favorisé par leurs actions la chute du régime de Fujimori en 2000 et le retour de la démocratie). Le travail des Mujeres Creando se confond entièrement avec une praxis politique. Constructrices, transformatrices de l’espace social, leurs actions sont indissociables de cet agir politique direct. Ainsi, parmi tant d’autres exemples, lorsqu’elles envahissent la Cour de justice de La Paz, au cours des Acciones (2001). Leur action relève indissociablement de l’intervention politique : elles y répandent des monceaux d’ordures et des milliers de dossiers d’affaires non traitées – et notamment celui d’une jeune fille violée et assassinée –, aux cris de : « Messieurs, juges et procureurs, seigneurs du système, reprenez vos poubelles ! ». Mujeres Creando a aussi participé à des mouvements sociaux plus larges, notamment à La Paz en 2001, lors des grèves des endettées, prises à la gorge par les taux d’intérêt usuriers de banques pratiquant le micro-crédit. De même en en 2003, Mujeres Creando a pris part au mouvement de la « guerre du gaz » qui a conduit le président Goni, responsable d’une violente répression militaire, à s’enfuir aux États-Unis. Mais c’est surtout à partir de leurs actions symboliques et poétiques, qui utilisent et transcendent à la fois une dimension plastique, et qui tentent de forger un nouveau vocabulaire contre la langue du pouvoir (21), qu’elles redessinent l’espace politique.
« Entrer et sortir de l’art » (22), disait Gustavo Buntinx, grand acteur du mouvement antifujimoriste au Pérou et membre du collectif Sociedad Civil : non pas une liquidation de l’art mais une « transfusion artistique » vers le corps social.
1. Clemente Padín, L’Art dans les rues, rapport présenté lors de la première rencontre biennale alternative d’art Tomarte, Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Rosario, Santa Fe, Argentine, 1990. Clemente Padín, performeur uruguayen, est l’un des principaux acteurs de la scène de la performance politique en Amérique latine depuis les années 1960.
2. Selon l’expression de Clemente Padín.
3. Surnommé ainsi par Clemente Padín dans les années 1970 et rassemblé dans les années 1980 sous la catégorie d’« art non objectuel » par le critique péruvien Juan Acha.
4. Luis Alfaro, « Cuerpo Politizado », in Rodney Sappington et Tyler Stallings (dir.), Uncontrollable Bodies : Testimonies of Identity and Culture, Seattle, Bay Press, 1994, p. 217-41. « Cuerpo Politizado » est une performance du performeur et écrivain queer chicano Luis Alfaro.
5. Écrivent les membres de Pocha Nostra dans Ethno-Techno, Writings on Performance, Activism And Pedagogy, 2005, New York, Routledge, p. 78.
6. Voir le magnifique livre de Guillermo Gómez-Peña, The New World Border, San Francisco, City lights, 1996.
7. The New World Border, p. 23.
8. Antonio Prieto Stambaugh, Cuerpos grotescos y performatividad queer, Seminario Permanente de Género, Sexualidad y Performance, 2007.
9. The New World Border, p. 24.
10. Le diorama est une technologie de représentation des peuples indigènes utilisée par le musée ethnographique. Inventé au début du XIXe siècle par Daguerre, il est constitué de grands tableaux éclairés par l’arrière. Il a été employé depuis le début du XXe siècle pour les reconstitutions ethnographiques, présentant des mannequins en situation, avec costumes, outils, armes, parfois habitations entières, le tout sur un fond peint représentant le paysage, l’environnement de la scène. Gómez-Peña utilise ces mises en situation sous forme photographique ou dans ses performances, ses personnages recourant à des panoplies d’objets et de signes identitaires.
11. Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé (1997), Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2002, p. 21.
12. Préface inédite à une réédition des Nègres, archives Jean Genet-IMEC, citée par Didier Éribon in Une morale du minoritaire, Variation sur un thème de Jean Genet, Paris, Fayard, 2001
13. Mujeres creando, Porque la memoria no es puro cuento, La Paz, Impresiones Quality, 2001, p. 7.
14. Qui signifie littéralement « Femmes en train de créer ».
15. Hugo Banzer a occupé à deux reprises la présidence bolivienne : de 1971 à 1978 comme dictateur militaire, de 1997 à 2001 comme président élu démocratiquement.
16. María Galindo, « Ponemos el cuerpo » in Grafiteadas, La Paz, Éd. Mujeres creando, 1999, p. 7.
17. María Galindo, « Manchas comunicantes », in Bolpress, 17 avril 2005.
18. María Galindo, Mujeres creando, A la espera de renovadas recetas desde el norte – El « género » en la retórica neoliberal, p. 12, 2003. [http://www.ongdeuskadi.org/files->http://www.ongdeuskadi.org/files/PonenciasJornadasGeneroBizkaia2003.pdf
Voir également l’entretien de María Galindo avec Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff, mars 2007, [www.lepeuplequimanque.org->www.lepeuplequimanque.org
19. Concept travaillé par le philosophe de l’interculturalité d’origine cubaine Raúl Fornet-Betancourt et par l’écrivaine lesbienne chicana Gloria Anzaldua.
20. La séparation du couple fondateur de Mujeres creando a entraîné une scission du groupe en 2002 en deux mouvances : María Galindo, désormais cheffe de file officieuse de Mujeres creando, a rassemblé les activités du collectif autour de La Virgen de los deseos (La vierge des désirs), maison autogérée et centre culturel, et un projet de radio, Radio Deseo (à partir de 2007). Elle a travaillé récemment sur les questions de prostitution, en association avec une femme argentine, Sonia Sánchez. Cet engagement a fait l’objet d’une exposition et d’un livre, Ninguna Mujer Nace para Puta (Aucune femme ne naît pour être pute), Buenos Aires, Éd. La Vaca, 2007.
De son côté, Julieta Paredes a créé un nouveau collectif, l’Assemblée féministe, qui reprend l’idée d’une Assemblée constituante. Dans le projet d’Evo Morales, cette Assemblée devait rédiger une nouvelle Constitution à partir de la consultation de divers secteurs de la société.
Tentant de se frayer un chemin à travers certaines dérives antiféministes du mouvement indigéniste, Julieta Paredes formule un projet de féminisme indigène qui repose sur la construction d’alliances avec divers mouvements de femmes. Elle propose de subvertir l’idéologie aymara de la complémentarité homme-femme (chacha-warmi), qui a pour corollaire l’hétérosexualité obligatoire et une forme de subordination sexiste, par les principes de l’autonomie, de l’auto-représentation et de l’auto-organisation.
Elle apporte également un soutien critique à la politique du président Evo Morales. Prenant acte de sa politique volontariste de nationalisation des ressources naturelles, des avancées sociales, de la représentation plus importante des femmes dans son gouvernement et de la révolution culturelle qu’a représentée son élection, elle n’en critique pas moins les limites de la prise de conscience féministe du gouvernement et la verticalité du pouvoir inhérentes à une gauche gouvernementale qui a pourtant été portée au pouvoir par les mouvements sociaux. Elle en appelle, face au gouvernement, à une démarche de contre-proposition qui s’ancre dans une dynamique révolutionnaire, tout en veillant à ne pas faire le jeu de l’extrême droite oligarchique sécessionniste et raciste de la région de Santa Cruz (qui s’efforce par tous les moyens d’empêcher Morales de gouverner) et en tenant compte du risque de guerre civile alimenté par les surenchères indépendantistes des régions qui détiennent les hydrocarbures. (Voir à ce sujet l’entretien accordé par Julieta Paredes à Sabine Masson, « Féminismes, lesbianismes et processus révolutionnaires en Bolivie », in Nouvelles Questions féministes, vol. 26, n° 3, 2007, p. 109-125.)
21. « Il n’y a pas de lutte sans paroles et sans voix propres – seules ces voix et paroles sont subversives, le reste est routine bruyante, parler mais sans dire. » disent-elles. Voir Maria Galindo, « No hay lucha sin palabra », in Mujeres Grafiteando, La Paz, Grupo Desig, 2003.
22. Gustavo Buntinx, « Lava la bandera : El Colectivo Sociedad Civil y el derrocamiento cultural de la dictadura en el Perú », in e-misférica, Hemispheric Institute for Performance Politics, vol. 3, n° 1, juin 2006.