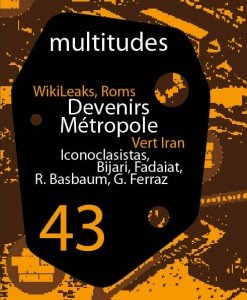Penser aujourd’hui les grandes métropoles brésiliennes implique de saisir la relation nouvelle entre le Brésil et le monde qui fait suite à l’écroulement d’un des mythes fondateurs de la nation moderne. Selon Viveiros de Castro[1], « On a toujours affirmé que le Brésil était le pays de l’avenir. Pas du tout, c’est l’avenir qui est devenu Brésil. En bien comme en mal, maintenant tout est Brésil ». Dès les années 80, la référence au Brésil servait plutôt à qualifier péjorativement le processus de globalisation comme un processus homogène (et paradoxal) d’hétérogénéisation : on parlait de « brésilianisation » du monde. La « favélisation » signifiait fragmentation sociale et ségrégation spatiale, avec violence civile et affaiblissement de la protection sociale comme conséquences. Alain Lipietz, dans une conférence prononcée précisément à Rio de Janeiro en 1988, traçait deux trajectoires possibles de la flexibilité post-fordiste, modernisatrice ou conservatrice. Dans ce dernier cas, Lipietz voyait se créer des villes post-modernes « flexibles » et, pourquoi pas ?, des maisons flexibles : les bidonvilles et favelas comme horizon indépassable de notre temps[2]. En 1995, le nord-américain Michael Lind dénonce aussi la brésilianisation comme principal danger auquel les États-Unis feront face au XXIe siècle, plutôt que la balkanisation. « Par brésilianisation, je ne comprends pas la séparation des cultures par l’éthnicité, mais la séparation de l’éthnicité par les classes »[3]. La métaphore s’est alors généralisée. Dans une interview concédée à l’activiste du web Geert Lovink, l’indien Ravi Sundaram[4] affirmait que l’Inde courrait le risque de la brésilianisation. Au tournant de la décennie, Ulrich Beck parlait aussi de brésilianisation de l’Occident pour illustrer sa théorie de la société du risque. Elle représentait ainsi un risque occidental pour l’Inde et exotique pour l’Occident !
La plus fameuse revitalisation d’une fracture brésilienne de la mondialisation se trouve dans Planet of Slums de Mike Davis[5] dont la traduction brésilienne est Planeta Favelas. Son discours qui parle de favelisation plutôt que de brésilianisation semble gauchiste mais s’inscrit parfaitement dans le cadre des idéologies sécuritaires en termes statistiques de gestion du risque. Ici, le risque serait la favela et sa pauvreté. Sa dénonciation atteint le paroxysme dans l’affirmation selon laquelle, dans les années 70, « les gouvernements du Tiers Monde ont abdiqué la bataille contre les favelas » alors que les institutions de Bretton Woods assumaient un « rôle […] prédominant dans la détermination des paramètres pour la politique de logement dans les grandes villes ». Pour les mouvements des habitants des favelas contre les expulsions et destructions de leurs maisons c’est tout au contraire une victoire, d’ailleurs inscrite dans la Constitution démocratique de 1988 qui a renversé la politique conservatrice de d’État jusqu’alors restreinte à l’éradication des favelas. Dans un chapitre dédié à l’« écologie de la favela », Mike Davis décrit comme « lieu de risque et de danger pour la santé, les zones géographiques d’occupation et d’invasion » pour la construction de favelas. Or c’est justement au nom de cette gestion du risque que des plans d’expulsion et de destruction des favelas sont définis de nouveau à Rio en 2010, comme si l’actuel maire et son adjoint au logement (du Parti des Travailleurs !) s’inspiraient directement de Mike Davis. Ils se sont servis des pluies diluviennes et meurtrières de l’été pour imposer le premier vaste plan d’expulsions des favelas depuis l’époque des militaires. La critique oscille entre un moralisme impuissant et l’ambiguïté politique du culte des victimes et du déterminisme économique.
Sans référence à aucune dynamique de résistance, Mike Davis finit ainsi par faire une apologie à l’envers du pouvoir du capital global.
Brésilianisation du monde
et urbanisme post-moderne
La thèse de la « fracture brésilienne du monde » a été aussi discutée au Brésil. Le philosophe Paulo Arantes[6] précise la thèse de Lind, en particulier quand celui-ci caractérise la « condition brésilienne » « par le pouvoir d’une oligarchie à laquelle ne s’oppose pas une classe subalterne solidement ancrée sur la privation mais des fragments sociaux d’un monde déstructuré du travail continûment désarticulé ». Ces « fragments » n’ont de sens qu’au sein du nouveau pouvoir du capital global où, d’après Arantes, les nouvelles figures du travail sont structurellement et irréversiblement incapables de reproduire l’organisation et les luttes propres au mouvement ouvrier et, plus généralement, au conflit social qui caractérise la modernité industrielle. D’une manière générale, les approches progressistes et brésiliennes de ce thème de la brésilianisation du monde sont marquées d’un paradoxe. D’un côté, elles dénoncent la crise de la modernité comme cause de la destruction de l’horizon radieux d’un futur industriel, et donc ouvrier. De l’autre, elles saisissent les théories postindustrielles des réseaux et de la flexibilité comme un pur régime discursif, c’est-à-dire des productions essentiellement idéologiques au sein d’une dynamique matérielle inchangée. Le capitalisme industriel et l’État resteraient centraux selon eux. L’urbaniste Otília Arantes[7] critique de son côté l’urbanisme post-moderne et, en particulier, les méthodes de « planification stratégique » du catalan Jordi Borja. Elle attribue aussi le dépassement de la planification urbaine de la fin du XXe siècle à un « tournant culturel » de l’urbanisme entraîné par mai 1968, « apparu dans les milieux de gauche des universités anglo-américaines en désignant un de ces changements de paradigme soit disant révolutionnaire et grâce auquel tout serait devenu « culturel ». Le mouvement de 1968 n’est pas mobilisé pour qualifier le « tournant culturel », mais pour déqualifier « la nouvelle gauche anglo-américaine » précisément par le fait qu’il s’agit « avant tout d’une gauche culturelle (qui), par cette raison même, justifie sa présence politiquement nulle dans le monde réellement existant du travail » (souligné par nous). Le monde de la culture, et du spectacle, serait celui du simulacre et de la déréalisation, comme l’apologétique de la post-modernité et de l’esthétique de la disparition de Baudrillard ou Virilio, entre autres, face au monde réel, celui d’un travail qui continuerait à n’avoir aucun rapport avec la culture ! Pour les urbanistes progressistes aussi, la ville qu’il faut planifier reste toujours celle de la reproduction d’un travail réel et non pas celle de la culture. Ensorcelés par les simulacres qu’ils prétendent dénoncer, les développementistes progressistes restent étrangers aux mutations de la ville réelle.
C’est là que rien ne va plus car, dans le capitalisme globalisé et hégémonique depuis le début des années 80, qu’est-ce que le travail et où se trouve-t-il ? Il se peut que la « nouvelle gauche » nord-américaine n’ait pas su répondre à cette question mais, pendant ce temps, Otília Arantes avec une part considérable des urbanistes progressistes brésiliens de même que de nombreux sociologues – critiques – du travail et, en général, les différentes tendances marxistes jusqu’en 1999 n’avaient pas même formulé le problème. La focalisation sur les « trous noirs de la globalisation » porte en elle le paradoxe ironique d’une sociologie de la ville et du travail plongée d’entrée dans le bien plus terrible trou noir du manque d’analyse des transformations matérielles du capitalisme et, surtout, du travail. Les professions de foi sur la persistance de ce « monde réellement existant du travail » n’appréhendent pas les transformations du capitalisme, du post-fordisme à la globalisation financière en passant par la chute du socialisme « réel », la nouvelle centralité productive des métropoles et les métamorphoses de leur urbanisme qui ne sont nullement de l’ordre de l’apparence ou du mythe.
Le Cultural Turn n’a rien d’un discours de ruse derrière lequel la « réalité » continuerait comme avant alors que ce sont tout au contraire les transformations matérielles, du travail et de la ville notamment, qui confortent les nouveaux régimes discursifs du pouvoir. Exactement comme ce fut la crise de l’État fordien dans les années 70 qui ouvrît le chemin aux innovations néolibérales, et non pas le néolibéralisme qui détermina seul la crise de l’État. Comme l’impuissante critique élitiste de Mike Davis sur les favelas appréhendées comme « pire des mondes possibles », celle des urbanistes progressistes vis-à-vis de l’urbanisme post-industriel passe à côté des dynamiques matérielles du capitalisme contemporain, tous incapables de saisir les mouvements de luttes qui traversent et qualifient les mégalopoles des pays émergents et notamment les favelas du Brésil.
Biopouvoir versus biopolitique
La favelisation a toujours été un processus contradictoire. L’arrivée des pauvres dans les villes brésiliennes a deux déterminants principaux. D’abord, la persistance du latifundisme : de la même manière que l’abolition tardive de l’esclavage avait conduit les esclaves libérés à former les premières favelas, l’expulsion des populations rurales menant les mouvements pour la réforme agraire par la dictature militaire a continué de les peupler. Ensuite, l’exode rural vers de meilleures conditions de vie et de travail a renforcé le processus d’urbanisation au-delà de ses capacités de créations d’emplois industriels. Les favelas sont donc des zones d’auto-construction d’espaces urbains de résistance et volonté des pauvres à vivre, désirer, danser et créer. La fuite des migrants des régions pauvres et rurales type Nordeste vers les régions riches et industrialisées, celle de Lula est caractéristique, constitue donc un mouvement paradoxal, à la fois produit des relations violentes de pouvoir (inégalité, racisme et neo-esclavagisme) et, en même temps, terrain de résistance, lutte et invention. Les favelas, comme de nombreuses formes d’occupation illégales, informelles et désordonnées de l’urbain dans les « pauvres grandes villes »[8] brésiliennes, sont aussi l’emblème de cette ambiguïté. Elles sont à la fois la honte d’un pouvoir qui gère les pauvres comme des ordures et la fierté de la résistance de ces mêmes pauvres qui constituent la part essentielle de la richesse et les valeurs de Rio et du Brésil. Les favelas constituent un « monstre » que l’élite neo-esclavagiste aimerait pouvoir déplacer vers la périphérie et rendre invisible. Mais elles sont aussi l’espace de dignité des anciennes et des nouvelles générations de pauvres qui luttent et inventent, résistent et créent.
Dans une ville comme Rio de Janeiro, plus encore qu’ailleurs, les relations de pouvoir et de production traversent et sont traversées par les conflits qui concernent principalement les favelas et les pauvres. C’est le grand défi posé au bloc de pouvoir, un mélange sui generis d’élites archaïques, biens représentées par les grands groupes de la communication, de segments institutionnels de type mafieux liés à la corruption et au trafic de drogue ainsi que de secteurs technocratiques des grandes entreprises et de l’appareil d’État, qui doit régler la vie des quantités énormes de pauvres dans la ville par le biais du contrôle des processus de favélisation. C’est pour cela que ce bloc de pouvoir se présente comme un Biopouvoir, un pouvoir organisé sur la vie des pauvres[9]. Depuis l’ouverture démocratique de la fin des années 1980, l’enjeu des luttes populaires est d’organiser les pauvres, de constituer une représentation de cette subjectivité sociale qui s’exprime et se forme dans les formes de résistance et de construction de la ville par et pour les pauvres. Les favelas sont des lieux caractéristiques d’innovations de nombreuses « informalités », c’est-à-dire de formes constituées par en bas dans les réseaux de socialisation des pauvres, complètement exogènes du formalisme juridique de l’État.
Le clivage social et éthique semble clair : le pouvoir d’un côté, les pauvres de l’autre, mais il ne tient pas debout en termes politiques. Les secteurs « progressistes », modernisateurs pourrait-on dire, de droite et de gauche convergent vers un point de vue négatif de la pauvreté et des pauvres. Il se traduit, par exemple, dans le consensus dans lequel les médias et la gauche intellectuelle se rassemblent pour fustiger le « populisme ». Tous les préjugés de classe y sont étonnamment clairs : les pauvres sont un vrai problème et, lorsqu’ils n’acceptent pas les « solutions » technocratiques et bureaucratiques que les institutions leur proposent, ils méritent la misère dans laquelle ils se trouvent.
Mais le capitalisme contemporain − cognitif, globalisé et financier − se caractérise par sa mobilisation des pauvres en tant que tels. Non pas des pauvres devant choisir entre leur transformation en travailleurs de masse dans l’industrie ou les services et leur exclusion néo-esclavagiste, mais bien des pauvres en tant que pauvres ! D’un côté, l’on cherche à les « inclure » par l’urbanisation des favelas comme celui du programme Favela Bairro en même temps que par la privatisation des services essentiels comme l’eau, l’éducation, la téléphonie, les autoroutes. De l’autre, le conflit actuel est clairement celui qui oppose les élites du bloc du biopouvoir et les pauvres avec leur puissance biopolitique. Dans la mesure où l’élite découvre cette ligne de conflit, elle cherche à le contourner en mystifiant surtout ses termes. Elle rencontre des alliés dans deux lignes de discours académiques, l’anthropologie et la science politique sur la violence. Paradoxalement, les anthropologues se transforment en darwinistes sociaux alors que les politologues dénaturent les mythes fondateurs de la théorie du contrat. Ils convergent pour affirmer que, en l’absence d’État, la condition des pauvres est celle de l’état de nature c’est-à-dire la guerre de tous les pauvres contre tous les pauvres. Le roman ethnographique A Cidade de Deus (La ville de Dieu) de Paulo Lins et sa version filmée sont le produit de ce travail systématique d’évacuation de toute dimension éthique de la vie et de la lutte des pauvres : ils ne peuvent qu’avoir honte d’eux-mêmes.
Encore le changement paradoxal. Les pauvres sont perçus comme un sujet essentiel, objet des nouvelles technologies de pouvoir et alors soumis à des politiques contradictoires, voire schizophréniques. La répression des pauvres comme des travailleurs informels s’articule ainsi dorénavant à l’urbanisation de quelques favelas, les plus petites et concentrées dans les zones les plus riches (programme Favela Bairro).
Les prochains trois méga évènements à Rio (Rio +20 en 2012, la coupe du monde en 2014 et les olympiades en 2016) produisent une inflexion de l’hégémonie. Certaines forces proposent de résoudre la schizophrénie par ces méga évènements qui poussent à l’évolution du projet carioca. Une vision plus nette par les élites du conflit de classe vise à contourner cette ambiguïté pour assurer une base métropolitaine du nouveau cycle d’accumulation capitaliste. Tout le Brésil vise une nouvelle accumulation au cours de la prochaine décennie dans une perspective de rentabilité que les dérivatifs financiers du Nord ne garantissent plus.
Les pauvres, le risque et la démocratie
La notion de risque qualifie ici la nouvelle mode de la « ville créative ». Cette notion de risque s’est lamentablement répandue en même temps que les terribles pluies d’avril 2010 à Rio dans une acception nullement géologique, urbanistique ou philanthropique mais bien biopolitique et, pour cette même raison, financière. Ce sont les finances qui visent à construire les scénarios biopolitiques d’accumulation. Avec la crise de la gestion du « risque » des bourses traditionnelles, la quête d’applications rentables se tourne vers les pays émergents et, notamment Rio. Et le risque que l’on cherche alors à diminuer est celui des investissements nécessaires aux prochains méga évènements. Ce risque a un nom et un déterminant, la puissance des pauvres qui vivent, travaillent et s’amusent dans les quartiers devant être le théâtre de cette valorisation, en l’occurrence. La diminution de ce risque dans les morros (collines) du sud, à Santa Teresa, dans le centre-ville et la zone portuaire implique une diminution de la puissance et de l’autonomie de la vie des pauvres avec, de surcroît, leur expulsion pour valoriser l’immobilier de ces zones urbaines. Ces expulsions sont, en réalité, des déportations !
La ville n’est pas seulement perçue comme une machine urbaine qui doit être « globale » pour séduire les grandes entreprises multinationales et les classes créatives dans l’actuel jargon de l’employabilité et du marché. Elle est aussi perçue comme étant elle-même une entreprise, un nouvel espace de valorisation et d’investissement (d’où l’exaltation paradoxale du thème du « risque »). Mais cette mutation se réalise sous le point de vue des intérêts du capitalisme cognitif, foncier et financier, un nouveau capitalisme qui devient rentier et vise à capturer et contrôler les flux métropolitains de la coopération sociale. C’est ainsi que la ville est maintenant perçue, voire même gérée, comme une firme.
De grandes villes de pauvres
Mais la dynamique matérielle des processus sociaux ne se réduit ni à ce dessin du biopouvoir pour investir et contrôler la vie des pauvres et des favelas, ni au régime discursif académique ou médiatique qui le soutient. Le soi-disant désordre urbain est également le théâtre, aussi dramatique que réel, de la constitution d’un autre ordre. Les « pauvres grandes villes » du Brésil sont aussi des « grandes villes de pauvres » et c’est cette dernière multitude qui constitue la richesse et la créativité des métropoles du Brésil, en particulier de Rio. La ville est traversée par un grand nombre de luttes de travailleurs informels, d’occupations des sans logis et des mouvements culturels des favelas et des banlieues (« periferias »). Les favelas et d’autres formes d’occupations irrégulières de la « périphérie » sont le fruit d’un puissant processus d’auto-construction de l’espace urbain, d’auto-valorisation par les pauvres, qui a ouvert des brèches inattendues dans les lignes de ségrégation sociale et raciale en réussissant à affirmer une urbanisation prolétaire dans des espaces que le capital immobilier avait l’intention d’exploiter.
Les pauvres persistent, toujours, à vivre. La favela compte ses victimes du pouvoir mais affirme simultanément la puissance des pauvres, leurs affects, leurs communautés, leur travail. C’est leur souffrance qui est le point de départ de leur capacité productive et constitutive, même lorsqu’il ne leur reste qu’à ramasser des ordures sur lesquelles ils sont parfois contraints de vivre. Cette puissance des « grandes villes de pauvres » avec leurs vies, leur musique, leurs fêtes et leurs luttes est insupportable pour le pouvoir ! C’est ce paradoxe ironique qui est insupportable pour l’élite.
Les pauvres persistent et leurs vies sont puissantes. Ce sont eux qui produisent les grandes villes, une production biopolitique des métropoles brésiliennes qui ne seraient rien sans le travail des pauvres, formel ou informel, d’autoproduction du territoire urbain. Si la favela est un « champ », à l’intérieur de ce champ se trouvent la valeur et la richesse. C’est dans la favela que l’écroulement du mythe moderne du « pays du futur » s’ouvre sur un nouvel horizon de possibles pour penser la ville. Dans cette perspective biopolitique, nous pouvons opposer à l’infamante hypothèse de « brésilianisation du monde » un autre plan, celui d’un « devenir-Brésil du monde » qui est forcément, en même temps, celui du devenir-monde du Brésil[10]. C’est au sein de ce double agencement du devenir que nous retrouvons les processus de subjectivation des pauvres. Ceci signifie que les grandes villes brésiliennes et leurs favelas ne sont plus soumises à un avenir d’homologation par l’expulsion (remoção) ou la planification, mais constituent désormais en soi le plan du devenir des métropoles, un devenir qui est un devenir-Brésil du monde : devenir-favela des villes et devenir-ville des favelas.
Précisons. Nous avons donc, d’un côté, la « brésilianisation » comme futur dramatique du monde et du Brésil, c’est-à-dire comme globalisation de l’im-monde, appauvrissement de la politique, la politique des riches. De l’autre, nous visons la mondialisation, c’est-à-dire le devenir-monde du Brésil et le devenir-Brésil du monde comme création du monde, devenir-pauvre de la politique, la politique des pauvres !
Ceci signifie que si le monde à venir est devenu Brésil, le conflit qui traverse le monde est le même que celui qui traverse le Brésil, et vice-versa même lorsqu’il s’agit d’échelles et de degrés très différents. Le rapport de l’armée d’Israël à la bande de Gaza en Palestine correspond par exemple en quelque sorte au rapport de la Police Militaire de Rio de Janeiro avec l’une des régions les plus violentes de la zone nord de la ville, dénommée précisément aussi la « bande de Gaza ». Le conflit est le même et, en même temps, sa caractéristique générale est son hétérogénéité croissante. De même, les images des policiers cagoulés dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble en juillet 2010 nous rappellent les interventions de la Tropa de Elite de Rio. La brésilianisation est un plan d’organisation que nous pouvons définir comme verticale et organiciste où la bifurcation « hominiscente », pour utiliser le terme de Michel Serres, de notre siècle apparaît alors comme une mortifère machine d’exclusion. Fragmentation sociale et ségrégation spatiale correspondent à un « état d’exception » permanent comme cadre de la prolifération de l’im-monde. Nous sommes au sein d’un processus de précarisation du statut du travail où l’informalité et l’incertitude des systèmes traditionnels de protection du travail du Brésil deviennent la condition générale du travail à l’intérieur de l’ensemble du capitalisme global des réseaux. Le temps devient alors linéaire comme un futur bloqué où se perdent toutes les expériences qui pourraient nous permettre de justifier le monde. Il ne reste qu’« une douleur d’une telle profondeur qu’elle devient une inversion extrême, une cause négative du monde finalement »[11]. L’ontologie surgit dans ses dimensions complètement négatives, la vie dans les favelas et dans les banlieues ressemble à la suspension de l’être dont parlent Agamben et, avant lui, Pasolini. Les jeunes noirs et habitants des favelas sont des figures de son Homo Sacer, celui qui peut être tué mais non pas sacrifié. Les exécutions journalières par les forces de police, mais aussi par les commandos du narco-trafic et les milices, appliquent une peine de mort que le système politique et judiciaire brésilien ne pourraient légaliser.
Le livre de Mike Davis sur la « favelisation » du monde représente exactement ce premier plan vertical et, comme nous l’avons vu, en reste prisonnier : « quelle ville sera Los Angeles en l’an 2000 si nous ne parvenons pas à répondre à ses besoins de logement ? Une ville de ségrégation avec des régions de richesse et de pauvreté comme Rio de Janeiro ? Une ville de gated communities entre lesquelles les sans logis vagabonderont, de la même manière que le font des millions d’enfants dans les rues au Brésil ? ». La critique progressiste au Brésil adopte cette ligne : « Notre travail informel (au Brésil) en métastase annonce le futur du secteur formel dans le monde. Voici un des grands laboratoires de la « Troisième Révolution Industrielle »[12] et ceci dans un « panorama dominé par un monde-favela traversé par le tumulte d’un gigantesque prolétariat informel » (Arantes 2007). Roberto Schwarz dit aussi : « […] le développement des forces productives détruit une partie de l’humanité au lieu de la sauver; le sous-développement cesse d’exister mais non pas ses calamités ; le travail informel, autrefois recours hétérodoxe et provisoire d’accumulation, devient un indice de délitement du lien social, et ainsi de suite »[13].
L’urbanisme progressiste est incapable de voir que la favélisation et/ou la prolifération métropolitaine représentent un mouvement puissant, même dans son aspect dramatique, de rupture de l’ancien ordre spatial de l’aménagement planifié vers une mobilisation productive qui a lieu directement dans les métropoles[14]. Cette puissance est saisie par Rem Koolhaas et son équipe du Harvard Project on the City jusque dans le cas extrême de Lagos dont la dynamique urbaine doit être « comprise en même temps comme le paradigme et la forme extrême et pathologique de la ville de l’Afrique de l’Ouest. Lagos impose une énigme fondamentale : elle continue d’exister et de maintenir sa productivité malgré l’absence quasi totale d’infrastructure, de système, d’organisation et de planification qui définissent le concept de « ville » dans le sens occidental. […] Cependant, Lagos est vraiment une ville et une ville qui fonctionne ». Et l’équipe de Koolhaas insiste : « […] Lagos a créé un urbanisme élastique, intensément matériel, décentralisé et multiple. Cette ville pourrait bien représenter l’urbanisme le plus radical de nos jours, mais celui-ci fonctionne »[15]. Il y a certes dans ces affirmations une dimension apologétique extrêmement ambiguë. Mais Koolhaas fait le choix de la puissance qui existe dans les favelas et dans les mégalopoles périphériques. Nous devons en prendre note, tout en évitant l’apologie relativiste et l’esthétisme de l’architecte hollandais. Dans la terrible image de l’imposante favela de Rocinha à Rio, nous percevons une beauté sublime attirant – de façon morbide éventuellement – les touristes européens délaissant la prévisible géométrie des bâtiments luxueux de la plage du quartier de São Conrado. Dans ce monde qui devient Brésil et dans le centre qui devient périphérie s’effectue un déplacement de points de vue. Mouvements qui ne sont pas uniquement spatiaux dans la mesure où ils impliquent une transformation des concepts même de monde et de Brésil, de centre et de périphérie. De surcroît, nous ne devons plus nous focaliser sur le centre et ses valeurs pour pouvoir penser la « transmutation de toutes les valeurs » ! Nous disposons alors d’une autre dynamique du temps, non plus la linéarité chronologique du futur et du progrès (y compris quand il en vient à s’appeler décroissance) mais le devenir et ses métamorphoses. Le devenir ouvre un horizon constituant une liberté associée à une nouvelle dynamique de la production de valeurs, c’est-à-dire de création émancipée de la seule production instrumentale. Nous pouvons alors penser à une nouvelle pratique du rapport entre l’homme (la culture) et la nature au-delà de la dialectique sujet-objet. Le devenir-Brésil du monde et le devenir-monde du Brésil correspondent à un « plan de consistance » qui n’existe ainsi pas préalablement aux mouvements de déterritorialisation qui le déploient et aux lignes de fuite qui le dessinent et le font émerger, c’est-à-dire aux devenirs qui le constituent[16]. Un mouvement profondément lié aux dynamiques de l’exode et du nomadisme. La crise du rapport entre centre et périphérie surgit comme une opportunité de dépasser ses dimensions hiérarchiques et déterministes. Le centre dans la périphérie, ou mieux, les dynamiques qui se constituent « dans la périphérie et pour la périphérie sans passer par le centre amènent les périphéries, au lieu de disparaître, à résister et parler toujours plus fort en produisant des mondes culturels parallèles […] au sein desquels vit, chaque jour plus, la plupart de la population de plusieurs pays, dont le Brésil »[17]. Ivana Bentes[18] nous parle d’ « images et de musiques de “protestation” créées par des jeunes des favelas et des periferias et commercialisées sur le marché, qui fonctionnent à la fois comme produit et contre-discours. […] De la mode à l’activisme, de l’attitude à la musique et au discours politique, nous voyons émerger de nouveaux sujets du discours, qui sortent des territoires réels, mornes et banlieues, ghettos […] ».
Dans ce deuxième plan alors, la résistance devient ontologique, ontologie pratique, devenir-pauvre de la politique, politique des pauvres. Selon Negri : « La libération est une impulsion qui surgit au début de la phénoménologie de l’être. La libération n’est pas une fin, mais un début ». Le « pauvre » est ce point de départ de cette puissance incommensurable : devenir-Brésil du monde et le devenir-monde du Brésil.
Traduit du portugais du Brésil par Barbara Szaniecki