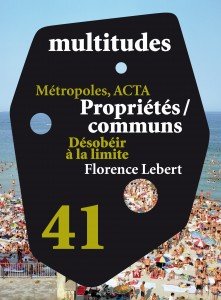La pratique de l’artiste Florence Lebert est liée très intimement au voyage et au déplacement dans l’espace. Dans son travail, nombreuses sont les séries d’images qui ont pour thématique le voyage dans un ailleurs lointain. La place faite au portrait et à l’altérité y est prépondérante, parcourant le Maghreb, les Pays de l’Est ou la pointe de l’Asie orientale. Chaque série est un entrecroisement d’images qui saisissent des portraits, des pratiques ou des lieux[1]. Pourtant au fil des séries, le regard de la photographe se tend invariablement vers des mondes en voies de disparition. Permis de démolir a ainsi pour sujet principal des ruines et des vestiges d’un monde qui n’est plus et que les êtres habitent encore sans trop savoir de quoi sera fait l’avenir. La préoccupation essentielle de Florence Lebert transparaît alors : qu’en est-il de ces mondes en voie de disparition ?
La caméra photographique devient alors le médium grâce auquel elle va tenter de retenir le temps – et l’instant devient alors image pour essayer de chasser ce lent déclin qui entraîne la démolition non pas seulement des édifices, mais de l’histoire. La non-narrativité de l’image photographique construit ainsi des icônes d’un temps (récit) qui fût et qu’elle cherche à retenir par l’image et la pellicule. Raison pour laquelle, sans doute, ses séries tentent d’embrasser différentes formes : portraits, situations, édifices, travail. Rien ne doit être écarté. Pour capturer la mémoire de la chose vue. Pourtant, la fragile mélancolie qui traverse la série Mer(s) noire(s) indique bien combien ce geste photographique est vain pour Florence Lebert. Tout est là et pourtant tout lui échappe : d’où la tristesse discrète des images.
De la série Mer(s) noire(s)
Les photographies sur le ferry sont remarquables, car elles ont pour décor unique la table et les banquettes du ferry où chacun occupe l’espace impersonnel à sa manière, recréant des tableaux à chaque fois empreints de nostalgie et de géométrie. L’homme qui dort, on ne sait s’il est fatigué, désespéré ou juste ennuyé par son voyage, tout est possible, mais chaque possible est marqué par cette douce tristesse qui habite les images de Lebert. Rien de trop exacerbé, mais juste une couleur ou une gestuelle qui signale une incertitude, une fragilité devant l’implacable. La géométrie elle-même s’écroule dans ses images, les bâtiments sont vétustes ou en ruine. Ils signalent une flamboyance passée. Le voyage et l’inconnu donnent sans doute une motivation à l’auteur des images. Mais au fond, ils ne font que permettre d’exprimer un univers interne. Par la mise en écho de soi et de cet autre monde qui est en train de disparaître.
La géométrie permet aussi de donner un style à ces images, un trait : des formes construites, mais aussi des formes épurées. Cette géométrie qu’elle retrouve dans l’espace, la nature et les constructions, sert aussi à renforcer le cadre et à saisir avec force les lignes, les couleurs, les personnes, mais surtout la tonalité de la pratique photographique. Le temps devient infini dans la géométrie spatiale.
L’angle de vue
Si la prise de vue varie, un autre point qui attire mon attention sont les images où des gens ordinaires sont pris de biais par rapport à la caméra. Si l’appareil photographique est bien situé de face, la perpendicularité des sujets pris en diagonale entraîne la mise en présence très forte de l’œil de la caméra et par cela même celui du photographe. Comme si, entre le sujet et l’artiste, il y avait un dialogue intime et silencieux. Le protocole de prise de vue introduit par Walker Evans et qu’on retrouve dans la manière de saisir l’étrangeté de l’existence de Diane Arbus, ou les magnifiques prises de vue d’adolescents sur les plages d’Irine Drinka, ici, ce protocole frontal est pour ainsi dire tordu, par cet angle qui rend compte de l’œil qui saisit les sujets, les dévoile au spectateur. L’usage de l’angle est ainsi tout à la fois le reflet de sa présence dans l’image, mais aussi une manière de permettre au regard du spectateur de se glisser vers son sujet, de s’y attacher.
L’angle qui apparaît de manière répétée pourrait aussi signaler ce désir d’entrer en communication et son impossibilité, sa mise en échec, le sujet s’écartant de la photographe par l’effet de la diagonale. Ainsi en va-t-il, par exemple, du couple au bord de l’eau, mais aussi de la femme blonde dans le ferry, ou de la jeune fille assise sur un muret. Non seulement il y a une forte géométrisation qui traverse l’image, mais ce rapport d’angle à 90°, qui construit l’image, souligne aussi le lien entre modèle et photographe. Les personnages sont donc capturés, mais le regard sur eux (qui les saisit) aussi et finalement l’écart entre le sujet et l’artiste.
L’ensemble de la série Mer(s) noire(s) souligne ce temps qui bientôt n’existera plus et dont avec sa caméra elle rend compte une dernière fois, avant sa mort : ces pays, ce mode de vie et ces gens qui vivent une période en cours de désagrégation. Le Post-communisme. Les ruines de l’époque soviétique s’égrènent, elles aussi, dans la série, des terrasses d’hôtels ou de bâtiments condamnés à la démolition. Ces lieux sont autant de supports-écrans où se projettent le regard et le sentiment de l’artiste pour exprimer une part d’intime.
L’autoportrait : la lucidité de la photographe
La photographie est alors conservation. Mais, dans le même temps, cette unité que la photographie réalise est fictive, elle est le médium à travers lequel nous croyons voir une unité qui n’existe pas, que ce soit celle d’un sujet ou d’une période ou même d’un paysage. La photographie implique un sentiment faux qui nous conduit à ressentir une disparition tout en ne permettant pas véritablement de la saisir. Cette tension est sans doute l’une des sources de la force nostalgique des images de Florence Lebert, la raison pour laquelle il y a cette projection de l’intime sur ses propres images.
Elle explique aussi pourquoi malgré les couleurs de ses images, l’impression d’une tonalité bleu-grise qui traverse la série, et qui encadre cette petite flamme de couleur (comme pour la photo des ballons ou celle avec des toboggans en arrière-plan) et reflète leur caractère mélancolique. Comme le disait Diane Arbus, « le photographe nous pousse à regarder des choses et les rend intéressantes par son regard »[2]. S’agissant de Florence Lebert : ses images sont profondément marquées par cet intérêt de saisir ce qui est loin de nos yeux, mais le premier sujet est sans doute la conscience aiguë de la lente désagrégation du monde qu’elle contemple et qui vient se refléter sur ces prises de vue. Malgré le geste de photographier – saisir par l’image –, Florence Lebert construit des images avec la lucidité de savoir que la caméra ne nous donne qu’une illusion. Dans le champ de cet art, elle se trouve dans la constellation de ceux qui font de la caméra un usage lucide et paradoxal, loin de la mythologie qui soutient la pratique, elle ressemble plus aux héros de Wenders qui ont un usage désespéré de leurs appareils et qui, luttant contre l’érosion, sentent que cette lutte est perdue d’avance. Comme Tom Ripley (L’ami américain) se photographiant sur le billard, ou Philip Winter (Alice dans les villes) partant à la recherche d’un regard authentique. Nous pouvons ainsi parcourir ce dossier Icônes, où loin des mirages de l’image et de la représentation, Florence Lebert nous invite à saisir que si elle fait œuvre de trace, ces traces elles-mêmes se dissolvent avec le temps.

Le travail de Florence Lebert est consultable à l’adresse : http://florence.lebert.site.picturetank.com