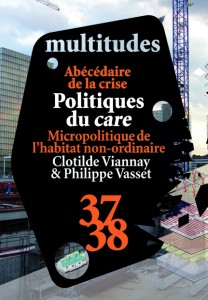Aborder la question de l’habitat non-ordinaire dans la ville post-fordiste, au travers des expériences d’habitat solidaire de femmes vieillissantes, pourra paraître incongru. Mais la ville post-fordiste n’est pas seulement le résultat subi de l’exclusion économique et sociale, des recompositions du capitalisme cognitif ou de la segmentation salariale. Elle est aussi celle de l’émergence d’un « habitat choisi ». Si les femmes vieillissantes sont à l’origine de projets d’habitat radicalement innovants et différents de ce qui est prévu pour elles par « les équipements du pouvoir », c’est parce qu’elles constituent une part statistique importante de la ville d’aujourd’hui, mais une part invisible et qui cumule les discriminations de tous ordres. Des femmes vieillissantes, dans la plupart des villes d’Europe, ont décidé de prendre leur destin en main, au risque de raviver à leur égard le fameux stéréotype du gender cross-over lié à l’âge : « Du fait qu’elles ne se remarquaient ou ne se remarquent pas en public, elles sont à peine perçues. Pour les «autres» elles forment un groupe homogène et anonyme. Un groupe qui constitue, dès lors, une excellente zone de projection pour toutes les angoisses et les agressivités de notre société. Si malgré tout, certaines femmes âgées réussissent parfois à attirer l’attention, leur comportement ne fait que confirmer exactement le jugement que l’on a toujours porté sur elles (qu’elles sont querelleuses, masculines, etc.) »[2].
Le mal-logement ordinaire : le poids du genre et le poids de l’âge
La ville n’étant pas faite par les femmes, elle a peu de chance d’être faite pour les femmes ; « elles constituent 80 % des travailleurs pauvres, 70 % des usagers des transports en commun, 90 % des personnes qui subissent des violences sexuelles dans l’espace public, 85 % des chefs de familles monoparentales, 70 % des personnes qui font les courses, 70 à 80 % des personnes âgées, 80 % des prostituées, etc. mais 20 à 30 % des élus » rappelle Denèfle[3]. Le mal-logement est un phénomène typiquement féminin, bien qu’il soit peu perçu comme tel[4]. Bien au contraire, la part moindre des femmes dans la population sans domicile fixe[5] – ainsi que dans les habitats non-ordinaires des travailleurs mobiles évoqués ici par Arnaud Le Marchand – peut laisser penser que les femmes sont moins touchées par les difficultés de logement. Mais elles font « tout pour éviter d’échouer à la rue », rappelle Bernard[6] : la présence fréquente d’enfants à leurs côtés et la crainte des violences attachées à ce mode d’existence, sont des facteurs qui contraignent les femmes à trouver un toit à tout prix, aussi sommaire soit-il.
La première cause de mal-logement en est leur précarité économique, phénomène bien connu comportant de multiples dimensions se renforçant les unes les autres : faiblesse des salaires et des statuts ; restriction des métiers accessibles ; part de travail à temps partiel subi ; différentiels de carrières avec les hommes (surinvestissement dans le travail domestique) ; parcours professionnels discontinus (travail de care des enfants et des personnes dépendantes). Au-delà de la précarité économique, l’obligation de trouver un toit à tout prix pour les familles monoparentales (qui ne sont autres, dans leur immense majorité, que des femmes seules avec enfants) et les réticences des propriétaires à leur louer, renforcent le phénomène du mal-logement. Il n’est dès lors pas étonnant « que pour une mère en couple «pas du tout satisfaite» de son logement, on en trouve cinq au statut d’isolées avec le même ressentiment »[7].
L’âge vient accentuer les discriminations liées au genre. Le différentiel entre les retraites des hommes et des femmes atteint plus de 40 %[8] (soit le double du différentiel traditionnellement admis entre les salaires des hommes et des femmes). Ici encore, les effets se cumulent au fil du temps : différences de statuts dans l’emploi, temps partiels, ruptures de carrières, etc. La précarité économique, comme pour les plus jeunes, est elle-même accentuée par la solitude, de plus en plus fréquente au fur et à mesure de l’avancée en âge ; en raison de leur longévité par rapport à celle des hommes, les femmes vivent moins souvent en couple[9].
En résumé, les femmes âgées sont donc plus nombreuses, plus pauvres et plus seules. La question de l’habitat est pour elles essentielle. Deux possibilités s’offrent à elles, dont aucune n’est satisfaisante : soit le maintien à domicile le plus longtemps possible, grâce à la mise en place d’un réseau d’aide de proximité ; soit l’entrée en hébergement collectif plus ou moins médicalisé, lorsqu’elle est devenue incontournable. Tel est en effet le schéma, correspondant à la dichotomie entre 3e et 4e âge, ou encore entre seniors et dépendants, sur lequel sont structurées les politiques publiques de la vieillesse. Bien qu’ayant fortement évolué depuis son origine hospiciale, l’hébergement collectif des personnes âgées, soit encore la traditionnelle « maison de retraite », fait toujours office de repoussoir[10].
Le maintien à domicile est donc devenu l’objectif incontournable des politiques publiques, grâce à ses supposées vertus : préservation de l’autonomie du sujet, stabilité de son environnement, etc. Cette politique fait pourtant l’objet d’un nombre croissant de critiques : « lorsque le conjoint est décédé, lorsque les commerçants ont fermé boutique, que les enfants se sont éloignés pour leur travail, lorsque le réseau de vie sociale s’est peu à peu dissous, le maintien à domicile est alors un maintien dans la mort sociale »[11]. Les décès liés à la canicule de 2003 ont ainsi révélé, à ceux qui l’ignoraient encore, la solitude immense dans laquelle se trouvent nombre de personnes âgées en raison d’une politique de maintien à domicile qui reste centrée sur la notion de « dépendance » (aide à la toilette, portage de repas, soins infirmiers, etc. mais absence de prise en compte des dimensions culturelles, sociales, psychologiques du vieillissement). Les femmes sont les premières victimes du maintien à domicile : les relations sociales centrées sur le couple ou les collègues du mari se diluent ; le logement conçu pour la famille devient trop grand, trop lourd à entretenir ; l’absence de permis de conduire et la faiblesse du transport collectif conduisent au repli. « Tout fonctionne comme si les politiques publiques étaient conçues pour les hommes, qui ont une femme à leur côté, et peuvent de ce fait rester à domicile »[12]. C’est souvent au moment de la perte de leur conjoint, et non pour des raisons de santé, que les femmes entrent en institution.
L’ « habitat solidaire » : une pratique en émergence, un concept à construire
Au cours des vingt dernières années, une offre d’« habitat intermédiaire » pour les personnes vieillissantes a cherché à émerger, entre les deux pôles de l’hébergement collectif et du domicile individuel : foyers logements, petites unités de vie, hébergements temporaires, accueils de jour, domiciles protégés, etc. Ces innovations, proposées par des acteurs de terrain (CCAS[13], associations, etc.) n’ont pas toujours bénéficié du soutien des pouvoirs publics centraux. A l’heure actuelle, qui est celle d’affronter le défi de la gérontocroissance, cette offre d’habitat intermédiaire tend à se privatiser sous l’effet de l’entrée de nouveaux acteurs sur ce « marché porteur ». Les résidences seniors ou résidences services, conçues par des groupes immobiliers privés pour les retraités aisés, bien que loin de connaître le développement qu’elles connaissent en Amérique du Nord, constituent la part la plus visible de la nouvelle offre d’habitat intermédiaire. Au-delà de l’intérêt évident que représente une demande croissante et solvable, les possibilités de défiscalisation de l’épargne séduisent les investisseurs[14]. Tandis que la question du traitement de la dépendance reste l’apanage du secteur public médico-social, dans le cadre des EHPAD[15], d’autres acteurs comme les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les associations et les mutuelles continuent d’imaginer de nouvelles formules respectueuses de l’autonomie des personnes et tenant compte des contraintes économiques ou géographiques. La formule la plus radicale, du point de vue de l’innovation sociale qu’elle représente, est celle de l’« habitat groupé autogéré », où les personnes âgées elles-mêmes conçoivent et organisent leur habitat de façon collective. Dans le champ de l’habitat intermédiaire, cette formule constitue une réalité marginale, mais le contenu des projets qui émergent en France et la force avec laquelle ils sont portés par leurs initiateurs – qui sont le plus souvent des femmes – interpellent. Ce phénomène est-il lié à l’arrivée à l’âge de la retraite de la « génération 68 » désireuse de vieillir autrement que ses aînés[16] ? Ou encore à l’émergence du fameux « pouvoir gris » décrit par certains auteurs[17] ?
Nous proposons le terme d’« habitat solidaire » pour qualifier les initiatives actuelles, de plus en plus nombreuses, qui consistent pour les citoyen-ne-s, quel que soit leur âge, à élaborer des modes d’habitat collectif de façon autonome par rapport aux pouvoirs publics et mettant le lien social au cœur de leurs préoccupations. Le terme d’« habitat communautaire », qui qualifiait les expériences des années 70, nous semble mal rendre compte des pratiques récentes – ouvertes sur la cité, empruntes de mixité sociale et démocratiques dans leur fonctionnement – très éloignées des gated communities à l’anglo-saxonne. Ce terme reste cependant largement en vigueur en Europe du Nord[18] ou encore au Québec, sans soulever autant de préventions que dans le contexte français, marqué par l’impératif universaliste. Le terme d’ « habitat coopératif » insiste quant à lui sur le statut de la structure porteuse du projet (une coopérative d’habitants)[19] mais laisse dans l’ombre les projets portés par d’autres types de structures, les associations en particulier. Le terme d’ « habitat groupé autogéré » commence à apparaître chez les spécialistes du vieillissement, afin de qualifier des projets dont les personnes âgées sont à l’origine[20].
Bien qu’il reste largement à affiner, le concept d’ « habitat solidaire » nous paraît le plus pertinent. C’est dans le sillage du développement des expériences et des recherches en « économie solidaire », que la notion de solidarité a bénéficié d’un écho renouvelé par rapport aux approches traditionnelles. Au-delà d’une solidarité re-distributive et impersonnelle chère à l’État-Providence, il s’agit dans ce cas d’une solidarité vécue de type réciprocitaire : « des personnes s’associent librement pour mener en commun des actions qui contribuent à la création d’activités économiques et d’emplois tout en renforçant la cohésion sociale par de nouveaux rapports sociaux de solidarité »[21]. L’autre caractéristique essentielle des expériences d’économie solidaire est leur capacité à « démocratiser l’économie à partir d’engagements citoyens »[22] (Laville et Cattani, 2005) : le fonctionnement démocratique en interne (autogestion) est le propre des projets solidaires, qui conduit ainsi à une réappropriation par les citoyens d’une capacité à décider de leur avenir (démocratie participative ou délibérative). Enfin, l’habitat solidaire repose sur un modèle d’économie plurielle, articulant des logiques privées (marchandes et non marchandes) et publiques.
Les Babayagas de Montreuil et les OLGAs de Nuremberg : de l’utopie à la réalité
Longévité, précarité, solitude… les femmes vieillissantes n’ont pas d’autre choix que d’être solidaires entre elles. Notre recherche[23] a démarré en Bavière et en banlieue parisienne. Les OLGAs[24] sont un groupe de onze femmes âgées de 62 à 80 ans et qui vivent en habitat solidaire depuis 2003. Les Babayagas[25] sont un groupe d’une vingtaine de femmes âgées de 61 à 89 ans et qui portent un projet similaire depuis presque dix ans. La non-mixité du point de vue du genre est l’élément saillant de chaque projet, souvent décriée par les observateurs extérieurs, alors que la non-mixité du point de vue des origines est moins souvent relevée : toutes les femmes sont « blanches », de nationalités européennes. La mixité sociale, par contre, est réelle. Issues de milieux familiaux très divers et ayant eu des parcours de vie tout aussi divers, les OLGAs et les Babayagas ne disposent pas toutes des mêmes revenus aujourd’hui (plusieurs d’entre elles doivent encore travailler pour les compléter). Toutes ces femmes, qui pour la plupart ont été mariées et ont eu des enfants, vivent aujourd’hui seules, soit parce qu’elles sont divorcées, séparées ou veuves ; les autres sont célibataires. Sans être toutes des militantes aguerries, un point commun entre elles est leur ouverture sur la vie de la cité (métiers au service des autres, engagement associatif, politique, syndical, etc.) ; on remarque qu’aucune n’a été « femme au foyer » autrement que de manière transitoire. Leur autre point commun est « un certain féminisme », qui ne s’affiche pas toujours comme tel, mais qui consiste à constater le manque d’autonomie des hommes de leur génération et à ne pas souhaiter vieillir en s’occupant d’eux. La non-mixité des deux projets, revendiquée par les fondatrices, est acceptée par celles qui s’y sont intégrées par la suite. Beaucoup ont souffert des conditions de vie imposées aux femmes de leur génération (renoncement aux études, maternités contraintes, avortements illégaux, parcours professionnels discontinus, divorces conflictuels, etc.) et si elles n’ont pas toujours pu « vivre autrement », au moins souhaitent-elles aujourd’hui « vieillir autrement ».
Se soutenir, s’entraider, s’accompagner dans le processus de vieillissement constituent le socle de chacun des deux projets. Il s’agit de le faire aussi bien dans les domaines socioculturels (sorties ensemble, activités partagées, etc.) que dans le domaine des soins et des services (soins médicaux, toilette, aide au ménage, préparation des repas) ainsi que dans la mort, envisagée au sein même de l’habitat collectif. La solidarité de type réciprocitaire dont il s’agit ici – on aide l’une ou l’autre sans savoir qui vous aidera en retour – n’est pas un vain mot : elle s’exerce au quotidien selon les femmes du projet OLGA, qui ont toutes bénéficié d’une formation aux premiers soins. La solidarité jusque dans la mort a été éprouvée pendant les mois qui ont précédé le décès de l’une des fondatrices du projet. Côté français, cette solidarité est « théorisée » de façon approfondie et ne deviendra une pratique qu’au moment de l’entrée en résidence. D’ores et déjà, les Babayagas envisagent ce que sera leur conduite collective face à la dépendance ; contrairement à ce qui se passe dans les résidences seniors, tout sera fait en interne (entraide, mutualisation du financement des soins et services, désignation de personnes de confiance en cas d’altération mentale, etc.) pour éviter ou retarder le départ vers une structure médicalisée. La solidarité est également d’ordre financier. En France, chacune paiera son loyer (proportionnel au revenu) mais une cagnotte est prévue en cas de défaillance de l’une d’entre elles, tandis qu’outre-Rhin, le loyer (proportionnel à la surface occupée) est payé de façon collective par le groupe qui se porte garant en cas de non-paiement.
Le fonctionnement démocratique en interne est la clé du succès de telles structures. Au-delà des conflits interpersonnels (nombreux) et de l’influence des fondatrices (indéniable), la recherche du consensus collectif est l’horizon des deux groupes de femmes, qui multiplient les réunions et bénéficient de l’aide de médiatrices. Dans le cas français, l’auto-organisation en interne renvoie à une autre forme de démocratie, en externe, non moins réelle : les Babayagas se sont battues pour frayer un chemin à leur utopie dans le maquis des politiques publiques de la vieillesse et de l’habitat (les deux s’ignorant largement par ailleurs)… « On ne rentre jamais dans les cases » constate l’une d’entre elles. Les différentes collectivités territoriales concernées, l’État et des financeurs privés s’associeront finalement autour d’un projet porté par l’Office Public de l’Habitat de Montreuil. Un immeuble constitué des studios des Babayagas, ainsi que d’un espace de vie collective ouvert sur la cité, devrait finir par sortir de terre à partir de 2010. C’est aussi une société immobilière communale – la Wohnbaugesellschaft (WBG) de Nuremberg – qui porte le projet des OLGAs. Cette fois, le projet a été proposé par la WBG au groupe des femmes ; il a consisté en la rénovation d’un immeuble comportant des appartements individuels, dont un géré en commun et destiné aux activités collectives, ainsi qu’un grand jardin. Moins ambitieux que le projet français, dans sa conception architecturale, son coût financier et surtout son contenu politique[26], le projet allemand a pour lui le mérite de fonctionner depuis plusieurs années. Il témoigne, de la part des pouvoirs publics allemands, largement soutenus par des fondations privées, d’une politique d’empowerment de communautés dites « fragiles » (les vieux, les pauvres, les migrants…) conduites à prendre en charge elles-mêmes leurs « problèmes ». Ce qui pourrait s’avérer économiquement et socialement avantageux pour un État-Providence en déclin. Le gain réalisé se fera au détriment des femmes, qui au sein de chacune de ces communautés, assument la part la plus indispensable et la plus invisible du travail d’autorégulation, soit le fameux travail de care.
Dans le cas de l’habitat solidaire, comme face à nombre d’initiatives dans le champ de l’économie solidaire, on hésite donc entre deux lectures possibles. L’option pessimiste pointe l’instrumentalisation de ces initiatives par l’État, qui privatise ainsi une partie de ses engagements traditionnels[27]. Au-delà de ce constat, les projets d’habitat solidaire évoqués ici interpellent les pouvoirs publics dans une démarche démocratique et citoyenne, qui vise à transformer les représentations courantes du vieillissement et à revendiquer pour les personnes concernées la capacité de prendre leur destin en main. Il s’agit alors d’un nouveau mode de production du commun par des femmes toutes singulières.
Notes
[ 1] Freud S., 1913, «La disposition à la névrose de contrainte», Extrait de Névrose, psychose et perversion, in Freud S. (1992), PUF. Cité par Pasqualina Perrig-Chiello, « Images sexuées de la vieillesse : entre stéréotypes sociaux et auto-définition », Retraite et société, n° 34, vol. 3, 2001, p. 69-87.
[ 2] P. Perrig-Chiello, op.cit., p. 84.
[ 3] Sylvette Denèfle, « Ouvrir la ville aux femmes : rêves et réalités », Sylvette Denèfle (sous la dir. de), Utopies féministes et expérimentations urbaines, Rennes, PUR, 2008, p. 9.
[ 4] Nicolas Bernard, « Femmes, précarité et mal-logement : un lien fatal à dénouer », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1970, 2007, p. 5-36.
[ 5] Un tiers des personnes ayant recours à des services d’hébergement et de distribution de repas à Paris sont des femmes (INSEE, 2004, cité par Bernard, op. cit.).
[ 6] Bernard, op. cit., p. 23.
[ 7] Bernard, op. cit., p. 14.
[ 8] Margaret Maruani, « Repenser la solidarité… sans faire l’économie du genre », Serge Paugam (sous la dir. de), Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF, 2007, p. 397-414.
[ 9] Selon les derniers chiffres de l’INSEE : 6,6 % des hommes et 10,6 % des femmes ont plus de 75 ans ; on compte 12,4 % de veuves pour 2,7 % de veufs dans la population de 75 ans et plus.
[ 10] Un récent sondage TNS-Sofres effectué pour la Fédération Hospitalière de France révèle que près de 80% des personnes interrogées y placeraient leurs parents ou grands-parents « à contrecœur »
[ 11] Daniel Reguer, « Interroger les évidences. Vieillissement de la population, maintien à domicile », Vie sociale et traitements, n° 99, 2008, p. 21.
[ 12] Reguer, ibidem.
[ 13] Centre communal d’action sociale.
[ 14] Dominique Argoud, « La gérontologie et l’habitat : deux cultures en voie de rapprochement ? », Rapport de recherche au PUCA, 2008.
[ 15] Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
[ 16] Petra Bruns, Werner Bruns, Rainer Böhme, Die Altersrevolution. Wie wir in Zukunft alt werden, Aufbau Verlag, 2007.
[ 17] Jean-Philippe Viriot-Durandal, Le pouvoir gris. Sociologie des groupes de pression de retraités, Paris, PUF, 2003.
[ 18] On parle ainsi, par exemple, de Wohngemeinschaft ou Hausgemeinschaft en Allemagne.
[ 19] De nombreux projets d’habitat coopératif sont fédérés au sein du réseau ( www.habicoop.org).
[ 20] Valentine Charlot, Caroline Guffens, Où vivre mieux ? Le choix de l’habitat groupé pour personnes âgées, Fondation Roi Baudouin, 2008.
[ 21] Bernard Eme, Jean-Louis Laville, « Économie plurielle, économie solidaire », La revue du MAUSS, n° 5, 1995, p. 255.
[ 22] Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani, Dictionnaire de l’autre économie, Desclée de Brouwer, 2005.
[ 23] Cette recherche est menée avec Karine Chaland, Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Strasbourg.
[ 24] Oldies Leben Gemeinsam Aktiv (les femmes âgées vivent ensemble de manière active).
[ 25] Nom des sorcières dans les légendes russes.
[ 26] L’habitat des OLGAs ne comporte pas la dimension citoyenne que les Babayagas souhaitent donner à leur maison commune : activités socioculturelles ouvertes au public, échanges avec d’autres structures associatives et surtout mise en œuvre d’une UNIversité du SAvoir des VIEux (UNISAVIE) destinée à « changer le regard sur la vieillesse ».
[ 27] Mathieu Hély, « L’économie sociale et solidaire n’existe pas », La vie des idées, 11/02, 2008.