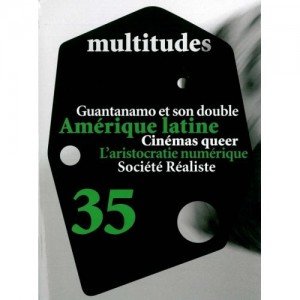Entre puissance constituante et nouveau welfare
Depuis le soulèvement zapatiste en 1994, l’Amérique latine respirait une nouvelle fraîcheur politique sans qu’il faille en déduire pour autant un continuum linéaire entre cet événement et la multiplicité des nouvelles expériences politiques des gouvernements qui lui ont succédé : de l’ascension de Lula au Brésil, en passant par celui de Kirchner en Argentine, celui de Tabaré Vazquez en Uruguay et de Michelle Bachelet au Chili, jusqu’au Venezuela de Chavez, la Bolivie de Morales et l’Equateur de Correa, et récemment le Paraguay de Lugo. Le processus qui s’exprime dans l’ensemble des changements de gouvernements, confirme que le consensus de Washington est arrivé à son terme. Il s’agit d’expériences hétérogènes, avec leurs propres contradictions et limites, leurs diverses conceptions de la politique économique et leurs manières spécifiques d’envisager la relation entre le gouvernement et les mouvements sociaux.
L’Amérique latine dans le nouveau contexte
En effet, malgré le dénominateur commun mis en avant (auquel on doit ajouter d’autres similitudes comme les processus insurrectionnels au Venezuela en 1989, au Mexique en 1994, en Argentine en 2001, en Bolivie en 2003 et 2004), il faut reconnaître l’hétérogénéité de la composition politique et technique des mouvements qui sont à la base de ces changements. Le profil et le contenu politique de la lutte des zapatistes, des indigènes boliviens ou équatoriens n’ont pas grand chose à voir avec les mouvements des droits de l’homme qui furent l’avant-garde du Cône Sud dans le processus de démocratisation qui dénonçait la continuité entre les politiques dictatoriales et les politiques néolibérales. Il y a peu en commun entre la mobilisation des ouvriers de l’ABC pauliste et celle des piqueteros argentins ; entre les réponses politiques des banlieues de Caracas et celles des favelas de Rio de Janeiro. L’hétérogénéité de ces luttes et mouvements témoigne de la richesse des comportements et des pratiques d’insubordination sociale qui se sont multipliés dans les années 1980 et 1990 en Amérique latine. La crise des politiques néolibérales est à chercher dans ces mouvements d’opposition, qui ont déployé leurs potentialités innovatrices en fonction des attentes que les nouvelles expériences gouvernementales avaient créées en proposant de redéfinir la démocratie et de construire de nouvelles formes de relations avec les mouvements. Il est certain que la lutte continue, bien que nous devions reconnaître que les niveaux de virulence ont diminué et que l’angle de confrontation s’est modifié. Le processus latino-américain donne des signaux peu encourageants : harcèlement du processus bolivien ; tarissement des grandes avancées au Brésil grandes avancées, Lula rencontrant d’évidentes difficultés à approfondir sa relation avec les mouvements ; Chavez contraint de naviguer entre des plans sociaux au caractère indubitablement innovateur et une bureaucratisation croissante du processus, soutenue chaque fois davantage par la figure charismatique de son chef. Les marges d’espoir dynamisant se réduisent.
À l’exception des riches processus bolivien et équatorien, la profusion tant encensée d’expérimentations politiques et démocratiques qui, au début du nouveau millénaire, s’ouvrait en Amérique latine et permettait d’imaginer des solutions politiques novatrices basées sur de nouvelles relations entre gouvernements et mouvements et basées sur une interprétation des changements obtenus après la crise des politiques néolibérales, s’est diluée.
Le cycle des luttes entreprises essentiellement par les communautés et peuples indigènes vers le milieu des années 1990 paraît bouclé. Bolivie : 2000, guerre de l’eau ; 2003, guerre du gaz ; 2005, chute du gouvernement de Lozada y Mesa. Équateur : 1997, chute de Bucaram ; 2000, chute de Mahuad ; 2005 (incluant les secteurs urbains) chute de Gutierrez. Mexique : zapatisme (aujourd’hui confiné au Chiapas) ; 2006, Atenco ; 2006-2007, Oaxaca. Dans tous les cas, il s’agit de secteurs sociaux comptant sur une large base rurale ; des communautés locales avec une organisation flexible et des structures internes souples ; basés principalement sur l’autorité morale de ses dirigeants traditionnels et de ses porte-parole ainsi que sur un consensus collectif quant à des objectifs spécifiques. Le trait commun a été la défense des ressources naturelles, comprises comme patrimoine collectif tant de la nation que des communautés, et le droit de chacun à décider pour son patrimoine dans ces sphères respectives.
La lecture qui privilégiait les changements intervenus dans le grand pays du Nord Américain – de l’unilatéralisme au multilatéralisme – comme un élément ayant une incidence notable sur les processus de mobilisation et sur leurs potentialités, semble ne plus pouvoir rendre compte du contenu des mobilisations. La capacité sociale et politique de veto des mouvements s’est manifestée contre des formes déterminées de la politique néolibérale touchant à la privatisation de la richesse publique ou collective.
L’empreinte de la composante paysanne et indigène a eu une influence particulière dans ce processus. La signification politique de l’insurrection paysanne et indigène peut être perçue grâce à ses répercussions sur les structures de pouvoir ainsi que sur les dispositifs et agencements politiques de l’État. Les conséquences politiques les plus importantes de ce processus apparaissent dans les gouvernements de Morales et Correa en tant que produits directs de la confrontation.
L’Assemblée constituante bolivienne mérite une mention particulière. Dans l’imaginaire des peuples indigènes et originaires, elle était conçue comme l’instrument par excellence qui allait permettre d’initier un processus radical de décolonisation. Toutefois, l’Assemblée constituante en tant que telle – qui était censée se faire l’instrument du pouvoir constituant originaire, c’est à dire de la mobilisation, de l’action et de la pratique de transformation des réseaux communautaires et d’organisation qui ont traversé le processus bolivien –, s’est trouvée affaiblie avant même sa naissance par le caractère limité de la convocation (qui laissait de côté les autonomies et le pouvoir constitué). La Bolivie, comme d’autres nations latino-américaines, est porteuse d’une démocratie immature, relativement jeune, dont le principal obstacle réside dans la certitude que le pouvoir constituant – basé sur des mouvements indigénistes – sera forcé de s’arrêter et sera exclu de sa propre constitution. Malgré cela, on peut dire que la nouvelle carte institutionnelle est une combinaison de formes libérales, indigènes et populaires, dans le sens du Welfare State. Ce qui est une avancée. Certains l’appellent « État plurinational ». La grande nouveauté réside dans le fait que la Constitution ne peut être vue comme un élément de régulation sociale mais au contraire comme le produit de l’antagonisme social. La preuve en est donnée par l’offensive de la droite bolivienne, qui a été le moment de plus grande faiblesse du processus bolivien. L’offensive dépasse la simple querelle pour les revenus de l’énergie, comme on a voulu le faire croire. L’objectif était clairement de déstabiliser le gouvernement de Morales, de provoquer sa chute et de freiner ou mettre en échec le processus bolivien. Il s’agissait de retirer au pouvoir constituant ses potentialités et de le geler dans la Constitution. L’importance de la révolution bolivienne en cours réside dans sa capacité réinventer le commun sous la forme d’une gestion politique démocratique des biens communs, comme le gaz et l’eau (l’énergie). En étendant et en reconnaissant les droits économiques, politiques et sociaux de l’ensemble des habitants, la transformation bolivienne s’est faite dans le cadre de la reconnaissance du creuset des races et des cultures qui forment la nation andine.
Notre problème est de prendre la mesure de la potentialité excédentaire actuelle des mouvements quand tout paraît indiquer que le cycle latino-américain s’est refermé. Parmi ces potentialités : que reste-t-il de ces groupements humains pour mener une action collective, pour se donner une nouvelle forme, pour s’articuler et s’organiser et se propager politiquement tout en mesurant les limites et les portées stratégiques ?
Tout semble indiquer une bureaucratisation croissante du processus vénézuélien, Chavez associant l’idée de socialisme du XXIe siècle à l’étatisation de l’économie (nationalisation de SIDOR). Souvenir monstrueux, la pire des caricatures des débuts de la révolution cubaine. En se présentant comme alter ego d’une URSS inexistante dans un monde bipolaire disparu, la politique extérieure de Chavez laisse parallèlement peu de place à la construction d’une position alternative (Iran, Chine). Anomalie majeure si on intègre le multilatéralisme en tant que forme politique internationale. La question qui se pose devient alors : peut-on remettre sur les rails le processus vénézuélien ou est-il déjà trop tard ?
Il y avait deux projets intégrateurs qui visaient à impulser le Mercosur : la banque du Sud (Banco del Sur) et le gazoduc du Sud (Gasoducto del Sur). Ils sont tous les deux restés dans l’ombre. La paralysie du projet de la Banque du Sud provient de la rivalité et de la concurrence entre le Venezuela, le Brésil et l’Argentine, plus que d’obstacles réels. Quant à la vieille gauche latino-américaine, elle continue de voir dans le Mercosur une proposition expansionniste ourdie par les multinationales latino-américaines, un espace de disciplinarisation du Venezuela par le Brésil et l’Argentine. Face au « localisme » des mouvements et à l’atonie des gouvernements, ne faudrait-il pas penser à un processus en matière d’énergie et d’alimentation (gaz bolivien, pétrole vénézuélien, équatorien et à présent brésilien conjointement aux matières premières alimentaires argentines) qui renforcerait et déclencherait une intégration latino-américaine ?
Argentine : le devenir des mouvements durant le kirchnérisme
La dynamique des mouvements en Argentine s’inscrit dans le cadre de la dynamique latino-américaine qui s’insère elle-même dans la dynamique du capitalisme global. L’accession à la présidence de Kirchner en 2003 ne peut s’expliquer sans la révolte des 19 et 20 décembre 2001, et il en va de même de la politique néodéveloppementiste, néo-keynésienne à caractère redistributif du gouvernement kirchnériste – une anomalie en cette époque de globalisation –, qui ne peut se comprendre que comme une nécessité pour le capital de diminuer les tensions et de récupérer son commandement face au travail vivant. Kirchner a parfaitement interprété les revendications des 19 et 20 décembre, qui portaient sur une politique différente, sur une modalité de gestion politique et économique d’un nouveau type. Le gouvernement s’est rapidement fait l’écho de la critique du néolibéralisme, en liaison avec le nouveau pôle latino-américain de centre gauche : Lula, Vazquez et Bachelet, auxquels se sont joints par la suite Evo Morales en Bolivie et Correa en Equateur esquissant un profil plus combatif, initié par le chavisme vénézuélien.
En consonance avec les affrontements latino-américains, le cycle de lutte politique argentin, stimulé en 2001 par les mouvements de sans-emploi et de piqueteros, a touché à sa fin à cause de deux faits principaux. 1) le gouvernement kirchnériste s’est conduit à l’égard des mouvements comme un bulldozer, intégrant les uns, affaiblissant les autres, voire en remettant en cause leur existence même ; 2) les mouvements, dirigés par une gauche atavique et aux propositions de type fordiste, n’a pas compris les caractéristiques du nouveau type de capital qui se profilait.
1) Les premières mesures du gouvernement kirchnériste – changements imposés à la Cour suprême de Justice, changement d’attitude face aux organismes des droits de l’homme et face aux organismes de crédit internationaux (FMI) – ont généré de grandes attentes au sein d’un mouvement usé, persistant à lutter en dépit des maigres résultats obtenus. En 2003, la solidarité sociale et la lutte qui avaient réuni les travailleurs et les sans-emploi sous le slogan emblématique « piquetes, cacerolas, la lucha es una sola » était bien loin. Les espaces communs ont été dissous à la suite d’une criminalisation de la protestation sociale et d’un isolement politique des mouvements entrepris par le gouvernement de Duhalde – une politique suivie épisodiquement par le gouvernement de Kirchner.
En effet, le kirchnérisme a essayé d’intégrer politiquement les mouvements les plus combatifs, et de les dominer. Bien qu’il ait reconnu l’existence de nouveaux acteurs et de nouvelles subjectivités sociales, il a nié la dimension constituante des mouvements (pratique de l’assemblée, critique de la représentativité, méthodes d’action directe, production de moyens alternatifs de communication) ainsi que la créativité et la capacité à générer de nouvelles politiques. Dans cette dynamique, la liberté politique des mouvements face à la liberté officielle s’est rapidement dissoute. On a assisté ainsi à une intégration subordonnée au kirchnérisme, en situation de dépendance à son égard, qui s’est consolidée dans une relation gouvernement-mouvements fort éloignée d’une reconnaissance du travail des mouvements qui constituait en lui-même une production politique. Le gouvernement de Kirchner a fini, de la sorte, par intégrer dans les institutions les mouvements de sans-emploi qui lui étaient le plus proches : leur direction fait aujourd’hui partie de la structure du gouvernement, particulièrement dans la province de Buenos Aires, et elle siège au Congrès national. Conséquence de cette désarticulation, ils ont perdu un certain degré de liberté – leur capacité de mobilisation et de débat interne.
2) La perte d’autonomie et de liberté politique des mouvements a également été promue par la gauche acquise à la « pensée unique », qui a agi en tant que direction politique de l’ensemble des luttes. L’analyse de cette gauche finit une fois de plus par imputer l’échec de la résistance de ces dernières années à la fragilité organisationnelle, à l’immaturité de la conscience politique et à la prédominance du spontanéisme politique. Poser aujourd’hui le problème du parti signifie que l’on laisse de côté une lecture critique de la représentation : il s’agit en tous les cas de détruire, de déstructurer la représentation et de poser le problème de l’expression, de construire le concept d’expression. C’est ici qu’apparaît une nouvelle problématique : celle de la relation du mouvement avec la structure institutionnelle du pouvoir. Quand le mouvement devient l’affaire du gouvernement, et nous sommes face à la gouvernance, les mouvements acquièrent plus d’importance que le parti.
On ne peut toutefois nier la volonté politique du gouvernement de modifier les règles du jeu internationales en questionnant les institutions de type financier (FMI, Banque mondiale) qui dirigent et régulent le commandement global. Tout comme l’initiative des politiques du Mercosur et les alliances avec les gouvernements de Chavez, Lula et Morales.
Il faut aussi reconnaître la productivité politique du gouvernement sur le terrain des droits de l’homme, qui est fondamental pour la démocratisation de la société. Il a assumé un discours qui, à de nombreux égards, renoue avec la mémoire des luttes des années 1970 et affronte ouvertement la politique de la terreur d’État.
Face à la biopolitique du gouvernement, deux options se sont ouvertes. 1) Celle qui refusait la construction d’espaces sociopolitiques extérieurs au commandement du capital : création d’économies de subsistance, entreprises communautaires (boulangeries, usines de cache-poussière, potagers communautaires). Il s’agit d’une construction hors de l’histoire et basée fondamentalement sur une pensée négative inspirée de John Holloway. 2) Il y eu aussi le choix de la construction d’espaces politiques de contre-pouvoir, un mode d’affrontement avec le commandement du capital qui reproduisait de vieilles formes organisationnelles de l’époque fordiste.
La première a consisté à résister en construisant des espaces éloignés du commandement du capital qui se sont révélés non seulement naïfs mais aussi dangereux dans leurs conséquences politiques. Cette gauche partage avec celle qui s’est associée au gouvernement l’idée que l’État est l’acteur principal de tout changement et que la précarité et le travail informel sont le produit du néolibéralisme. Mieux, elles plaident pour l’industrialisation, le marché interne et le plein emploi.
Toutefois, ni les mouvements intégrés au gouvernement ni la gauche dans ses diverses composantes ne se montrent capables d’expliquer comment il se fait, malgré les taux de croissance « à la chinoise » de ces quatre dernières années et demi, que 38 % de l’emploi, seulement, relève du secteur formel, alors que 60 % de la force de travail se trouve dans des conditions de précarité, lorsqu’elle est recensée et qu’elle n’est pas tournée vers des activités de subsistance. Du point de vue des salaires, 55 % de la force de travail se trouve en dessous du salaire minimum ; si l’on prend les travailleurs, 48 % ont des salaires inférieurs au minimum. Seuls 38 % des salariés ont un contrat de travail.
Il n’est pas possible d’interpréter les conditions de vie des quartiers de la périphérie de la province de Buenos Aires sans partir de la crise de la production fordiste, qui s’est traduite par une diminution drastique de la main-d’œuvre non qualifiée. Les habitants de la périphérie ont été confinés non seulement dans l’espace, mais aussi dans le passé. La périphérie a été cataloguée comme le lieu de l’improductivité.
La réalité qui exige des sans-emploi qu’ils se fassent les sujets de leur propre parole, de leurs propres actes, malgré et à cause de la perte de leur travail, a signifié la redécouverte de la puissance de la subjectivation. C’est à partir de cette dimension commune relative aux conditions matérielles, politiques, sociales et économiques qu’elle s’est développée sur le territoire. Qu’y avait-il de commun dans la bouche des acteurs ? La précarité. Il s’agissait et il s’agit d’une précarité non choisie, mais bel et bien vécue, et qui touche aux conditions matérielles d’existence autant qu’aux conditions de la reproduction. La virulence des occupations et des piquets ne peut s’expliquer que si l’on voit dans la puissance de son action le reflet de la survie. La multitude se fait présente : agencement de singularités avec d’innombrables différences, invention d’un « nous » provisoire, celui du quartier, articulé stratégiquement de manière locale et située temporellement, en fonction d’objectifs spécifiques produits dans un contexte de lutte et susceptibles d’être redéfinis en fonction d’autres contextes de lutte et d’autres stratégies.
Le défi qui se présente est double : 1) Comment démonter la naïveté politique et la fuite qui y conduit tout droit, et mettre en place en même temps une résistance véritable, un antagonisme réel avec le commandement capitaliste de type nouveau ? 2) Comment surmonter l’ambivalence d’une violence exercée sur la vie elle-même et développer en même temps un pari sur la puissance de la vie ?
Le pacte fordiste du nouveau millénaire ?
Les débuts du gouvernement kirchnériste ont correspondu aussi à une tentative de construction basée sur une politique transversale – on cherchait à recréer la vieille représentation politique en crise à partir de nouveaux espaces incorporant les secteurs de différents partis politiques traditionnels. Face à l’échec de ces premières tentatives, le kirchnérisme a misé sur la récupération des vieilles structures politiques partisanes et syndicales – le Partido Justicialista et la CGT – ainsi que sur la recréation du Pacte social. Tous ces objectifs se donnent pour idéal le passé fordiste, bien plus qu’un capitalisme de type nouveau.
Dès les débuts du premier mandat de Kirchner, le gouvernement promouvait l’idée d’une concertation sociale, dont l’objectif était de remettre au goût du jour un pacte fordiste : un compromis social entre État, syndicats et organisations patronales pour garantir la croissance économique tout en veillant à une redistribution équitable entre profits et salaires. Dans les conditions actuelles du capitalisme, pourtant, le pacte social est une chimère. Comme nous l’avons déjà signalé, le compromis social promu par le gouvernement laisse de côté 60 % de la force de travail. Quel type d’accord est-il possible avec les sans-emploi et les pauvres de la périphérie ? Qui va les représenter à la table tripartite ? Il est clair que l’accord ne peut éclore que d’une base commune. Mais qui définit aujourd’hui ce qui est commun ?
Revenons sur les trente glorieuses. La réponse du capital à la rupture du pacte fordiste, à la crise financière de l’État est bien connue. Pour dépasser les limites imposées par la résistance ouvrière, on a cherché à déréglementer et à déréguler le Welfare State et à avancer dans les divers processus de privatisation. Néanmoins, dans les pays latino-américains et dans la phase actuelle de déclin du néolibéralisme, alors que certains aspects du Welfare State se maintiennent malgré tout (retraite, éducation, et santé dans une certaine mesure), nous pouvons affirmer que la bataille pour le Welfare State est toujours vivante, ouverte. Mais il s’agit dès lors d’un autre Welfare State, éloigné du travail salarié industriel, des formes de représentativité syndicale et même de la représentation patronale. Éloigné, en définitive, des réminiscences du pacte fordiste.
L’opposition entre les piqueteros et le gouvernement a déplacé le terrain de l’affrontement entre capital et travail. Si, par le passé, l’affrontement se jouait sur le salaire, aujourd’hui, la précarisation du travail est telle que la lutte des piqueteros et des sans-emploi est devenue une lutte pour la vie, pour la subsistance. Et c’est pour cela que leurs objectifs sont aussi ceux des travailleurs immatériels : autonomes et indépendants exploités par le capital à travers le réseau de coopération productive qu’ils ont établi entre eux.
Dans le contexte de l’immatérialité du travail, l’exploitation est devenue l’exploitation non pas tant de la consommation de la force de travail que de sa disponibilité à s’offrir en tant que sujet d’exploitation. L’exploitation ne réside pas seulement dans la production mais aussi dans la coopération. Le capital capte l’excédent au niveau social. Et c’est à ce niveau social, précisément, qu’a lieu la lutte des précaires et des sans-emploi. La mobilisation des précaires, la résistance des piqueteros, la revendication des sans-emploi, la lutte contre la précarisation des travailleurs informels témoignent des traits qu’adopte la lutte salariale dans une société biopolitique. Que demandent-ils d’autre qu’un logement, de la nourriture, l’accès aux soins et à l’éducation pour leurs enfants, le droit de fonder une famille qui ne soit pas menacée par les conditions de vie actuelles ? Ils revendiquent de participer à la vie citoyenne, à la création d’espaces publics et aux nouveaux modes sociaux de vie. En dernière instance, ils crient que la vie n’est pas négociable. Quelle différence y a-t-il entre cette revendication et celle du travailleur informel : celle des services informatiques qui sollicitent l’accès libre au software propriétaire, celle de l’étudiant qui demande du temps pour sa formation ou celle de la mère qui reste à la maison pour s’occuper de ses enfants ? Dans tous les cas, c’est la vie de ces femmes et ces hommes qui est à la base du processus productif ; et inversement, la valorisation traverse l’existence de chacun d’entre eux.
Le gouvernement, tout comme la gauche traditionnelle, considère que les politiques actives d’emploi sont la condition nécessaire pour sortir de la société d’assistanat et refonder une société du travail. Le travail rend digne, nous disent-ils, de manière très wébérienne. La réalité démontre que l’emploi ne représente pas grand-chose dans une société précarisées et flexibilisée ; les working poors touchant un salaire en dessous du seuil de pauvreté le confirment. Nous avons affaire à la première déconnexion interne à la logique du capital global : l’emploi n’est pas une garantie de revenu acceptable. L’expérience argentine témoigne également du fait que la croissance de la production et les bénéfices ne garantissent pas la création d’emplois comme à l’époque fordiste.
Le passage du Welfare State au Workfare State – qui répond aux exigences des industriels et des chambres de commerce et subordonne le social à l’économique, ou qui rétablit l’ordre correct entre production et redistribution, dans la version du ministère du travail – doit être radicalement renversé. Il ne s’agit pas d’« incorporer » la croissance des dépenses sociales mais d’analyser leur composition, dans la mesure où c’est leur composition qui exprime la portée et le contenu du projet social poursuivi.
Le seul pacte possible est celui qui place le travail au-dessus des relations capitalistes de production et de domination en ouvrant de nouveaux espaces et de nouveaux temps constructifs. Il ne s’agit pas de la distribution des fruits de la croissance, mais des différentes dynamiques de production de la richesse. La constitution des bases matérielles de la citoyenneté s’identifie à cette dynamique de production de la richesse : construire, produire de la richesse équivaut à avoir des droits.
Il s’agit de penser à des stratégies qui empêchent cette appropriation des biens collectifs et communs par la finance globale : faire reconnaître la nouvelle nature de la coopération sociale de production de biens collectifs et communs ainsi que les sujets de cette production. D’où la nécessité d’un revenu garanti comme processus nécessaire à l’ouverture d’une phase constituante au niveau économique et social ; non comme élément de redistribution mais comme dépassement radical de la répartition de la richesse fondée sur le capital et le travail ; comme élément de dépassement de la relation entre coopération sociale et division smithienne du travail, qui s’affirme comme véritable élément d’autovalorisation de la coopération, de la puissance créatrice de la multiplicité et de la différence.
Le conflit avec les campagnes
Les changements qui se sont produits dans la société argentine ces vingt-cinq dernières années se sont manifestés dans le conflit qui oppose le gouvernement kirchnériste et les secteurs agro-exportateurs. La structure socioéconomique s’est modifiée en raison des changements dans la composition technique et politique de la force de travail urbaine et agraire.
Voyons cela de plus près. Le 10 mars dernier, le gouvernement a introduit une modification substantielle dans le système de rétentions appliqué aux matières premières d’exportation, fondamentalement le soja. Il était établi que les rétentions seraient mobiles et suivraient les variations des cours internationaux. C’était une manière de rendre les prix nationaux indépendants des variations internationales. Avant le 10 mars, les rétentions s’élevaient à 35% pour le soja et le blé.
La mesure était indépendante du volume de production et s’appliquait à tous les producteurs de soja, y compris ceux qui louaient les champs. C’est ce qui a entraîné la réaction immédiate de tout le secteur, des plus petits aux plus gros producteurs. Au-delà du caractère légitime et politiquement correct des rétentions, en ne faisant aucune distinction quant au volume de production, on touchait de la même manière les bénéfices des petits producteurs et des pools de culture. La réponse fut un lock out des entreprises, principalement impulsé par les petits producteurs. Les barrages routiers (110 jours) empêchèrent la circulation des marchandises, provoquant un défaut d’approvisionnement en aliments dans les grandes villes. Le climat politique se tendit.
Le gouvernement et ses alliés interprétèrent la réponse comme un proto-coup d’État et une déstabilisation politique et rendirent les campagnes responsables d’une hausse des prix liée à la pénurie. La lecture officielle du conflit trouvait une confirmation dans le point de vue historique qui veut que les campagnes soiennt l’ennemi du péronisme et de toute position de centre gauche. Le conflit prenait des allures politiques bien plus qu’économiques. Le kirchnérisme s’appuya sur la CGT et les mouvements sociaux alliés pour s’opposer aux campagnes. Habitué à choisir l’ennemi pour le diaboliser, le kirchnérisme commit l’erreur politique de choisir une oligarchie d’éleveurs déjà inexistante. Actuellement, les grands producteurs agraires de la campagne argentine ne sont plus propriétaires de la terre. Ce sont des groupes extérieurs qui investissent la rente extraite du nouveau capitalisme (cognitif). Grobocopatel, le plus grand producteur de soja du pays, se présente ironiquement comme « sans terre ».
Le kirchnérisme, ignorant les changements intervenus dans la production agricole et la nouvelle composition de classe de la campagne, a recouru à de vieilles catégories politiques, binaires et démodées. Il a réussi ce faisant à s’allier d’important secteurs de l’intellectualité académique et politique, qui avaient vu dans la résistance agraire une attitude putschiste.
Quels sont les changement qui se sont produits au cours des vingt-cinq dernières années ? 1) La frontière agricole s’est étendue, en raison principalement de la culture du soja, aiguillonnée par la hausse des prix internationaux au dépens d’autres exploitations. 2) L’introduction de NT (semis direct) et de semences transgéniques (agrochimiques) a notablement augmenté les rendements par hectare, relativisant la composante de rente différentielle naturelle de la terre, réduisant significativement les temps de production et permettant deux ou trois récoltes annuelles sur la même propriété. 3) Le vieux fermier qui louait sa terre au propriétaire pour une exploitation de type familial a été remplacé par le fermier propriétaire de petites et moyennes surfaces, qui exploite le champs avec très peu de personnel. Il doit s’associer avec d’autres petits producteurs pour faire face à l’augmentation des coûts. Ce nouveau sujet, qui manifeste une subjectivité différente, enclin à défendre le produit de son travail, surgit après la crise des années 1990. 4) De nouveaux investisseurs agraires apparaissent qui, sans appartenir à la campagne, absorbent la rente produite ailleurs, caractéristique du nouveau capitalisme, et la dédie à l’exploitation agricole en raison des bénéfices juteux qu’a connus ce secteur au cours des dernières années. Il s’agit des grands pools de culture. 5) Un certain nombre de producteurs de taille moyenne préfèrent louer leur terre aux pools afin de garantir leur revenu sans courir de risque. 6) Il y a concentration de la richesse et de la production, bien qu’il n’y ait pas concentration de la propriété : 80 % des petits et moyens producteurs produisent 20 % de la production agraire totale. Dans le cas du soja, 4 % des exploitations (sur 75 000) accaparent 60 % de la production, ce qui revient à dire que 96 % d’entre eux ne produisent que 40 % de la récolte.
Simultanément, les organisations paysannes se sont vidées de leurs affiliés. C’est le reflet des changements qui ont modifié la composition de classe dans les campagnes, auxquels s’est ajoutée l’arrivée de nouveaux acteurs.
Le conflit agraire actuel a été dirigé de l’intérieur par ceux que l’on appelle les « autoconvocados del campo ». Il s’agit de petits et moyens producteurs qui ont ravivé le souvenir des assemblées urbaines de 2001, reprenant la pratique des assemblées au niveau de la région ou de la ville – dans les villes de l’intérieur du pays qui avaient été au centre du conflit –, et se regroupant dans une certaine anarchie, avec de grandes différences d’un groupe à l’autre et un manque d’affinités manifeste (chacun coupait les routes selon des modalités différentes),. Les auto-convoqués sont à la campagne ce que la multiplicité de singularités « assembléistes » ont été dans les grandes villes en 2001. Pendant ce temps, en choisissant les entités corporatives de la campagne comme interlocuteurs, le gouvernement les légitimait. Il cherchait à institutionnaliser le conflit pour éviter qu’il ne déborde. Le nouveau capitalisme promeut de nouvelles formes de résistance.
La société urbaine dans son ensemble s’est contentée d’attendre, regardant avec méfiance un gouvernement qui paraissait décidé à faire durer l’affrontement pour l’affaiblir et mettre en échec les campagnes. Les habitants des villes de l’intérieur du pays ont eu un comportement différent, soit qu’ils aient été directement impliqués, soit en raison du ralentissement économique manifeste, produit du chômage agraire dans les petites et les moyennes villes. Le gouvernement a tenté d’effacer l’opposition des campagnes sans en mesurer les coûts politiques : il s’est trouvé coincé entre les tentatives qui visaient à la briser et une opposition aux rétentions qui venait du sein même des troupes péronistes.
La gauche traditionnelle, qui méconnaît la nouvelle composition sociale et les nouveaux acteurs de la campagne, critique les uns (le gouvernement) autant que les autres (les mouvements de la campagne), en ciblant son analyse sur la relation capital / travail à la campagne (exploiteurs et exploités). L’opposition politique institutionnelle défend la grève dans les campagnes et s’oppose aux rétentions, au prétexte qu’elles seraient utilisées pour exercer une discipline monétaire sur les intendants et gouverneurs des villes de l’intérieur du pays.
Certains secteurs minoritaires sont les seuls à poser des critiques plus sensées : besoin de dépasser le modèle de production du soja, plan de développement pour la campagne et les économies régionales, discrimination dans les rétentions (petits et grands producteurs). Ces groupes cherchent à utiliser le conflit pour démocratiser les relations entre le gouvernement central et les provinces ; une sorte de recherche d’équité fiscale pour partager les rétentions.
Ce qui est sûr, c’est que le bras de fer n’a pas seulement affaibli le pouvoir politique de Cristina Fernández, à qui il reste un mandat quasi complet à accomplir, mais qu’il a entraîné aussi une détérioration économique progressive, qui s’observe dans une forte chute de la consommation dans les villes de l’intérieur du pays.
De larges secteurs de la société sont restés en marge du conflit, non par désintérêt, mais parce que le conflit ne les a pas effectivement interpellés, même s’ils étaient préoccupés par la tension politique et le niveau de polarisation sociale. Il s’agit de secteurs sensibles, potentiellement mobilisables, mais déconcertés face au discours traditionnel développé par l’« officialisme » et les secteurs de l’opposition, qui décrivent les campagnes selon les vieux clichés de l’oligarchie et des revenus excessifs, et cet autre discours officiel qui s’arroge toute la dimension progressiste qui s’est manifestée au cours du conflit. C’est un signe des temps, les discours se projettent de manière diffuse, combinée et entremêlée.
Il s’agit bien souvent de travailleurs appartenant à la nouvelle composition technique du travail – qui expriment une nouvelle composition sociale, cognitive, abstraite, mobile, précaire. Ils font partie dans certains cas de l’opposition démocratique dans des syndicats d’enseignants de l’intérieur du pays. Nombre d’entre eux se sont rapprochés du kirchnérisme de la première époque, attirés par sa politique démocratique (les droits de l’homme) et sa transversalité, dépassant les structures de parti (Partido Justicialista) anachroniques et discréditées. Il s’agit de secteurs qui vivent dans les grandes villes de l’intérieur du pays et de la province de Buenos Aires dont le désenchantement vis-à-vis du gouvernement a été manifeste lors des dernières élections. Ce sont des secteurs politiquement erratiques, mais dont la sensibilité n’exclut pas qu’ils puissent se retrouver dans une politique de radicalisation démocratique, réfractaire à la politique idéologisée de la gauche traditionnelle et aux idées nationalistes et étatistes. Ils se sont éloignés du kirchnérisme quand sont apparus les manipulations discrétionnaires du pouvoir et les profils autoritaires. Ce sont des secteurs dans lesquels, loin d’approfondir l’individuel, on valorise la singularité et la participation au commun en construction. Immanence de la singularité dans le commun, dirions-nous.
Nous devons parier sur les potentialités sous-jacentes de ces vastes secteurs sociaux, travailleurs autonomes de seconde génération, qui, sans appartenir aux partis politiques, sont particulièrement intéressés par la politique, perméables à la solidarité sociale et aisément mobilisables dans une perspective de démocratie radicale. Il s’agit des produits les plus authentiques de la crise de la représentation politique. Nous sommes face à un système de formation et de transition de la volonté politique d’un nouveau type – c’est peut-être précisément ce qui caractérise aujourd’hui la démocratie.
Córdoba, 9 juillet 2008
Traduit de l’espagnol par Bénédicte Martin et Mouss