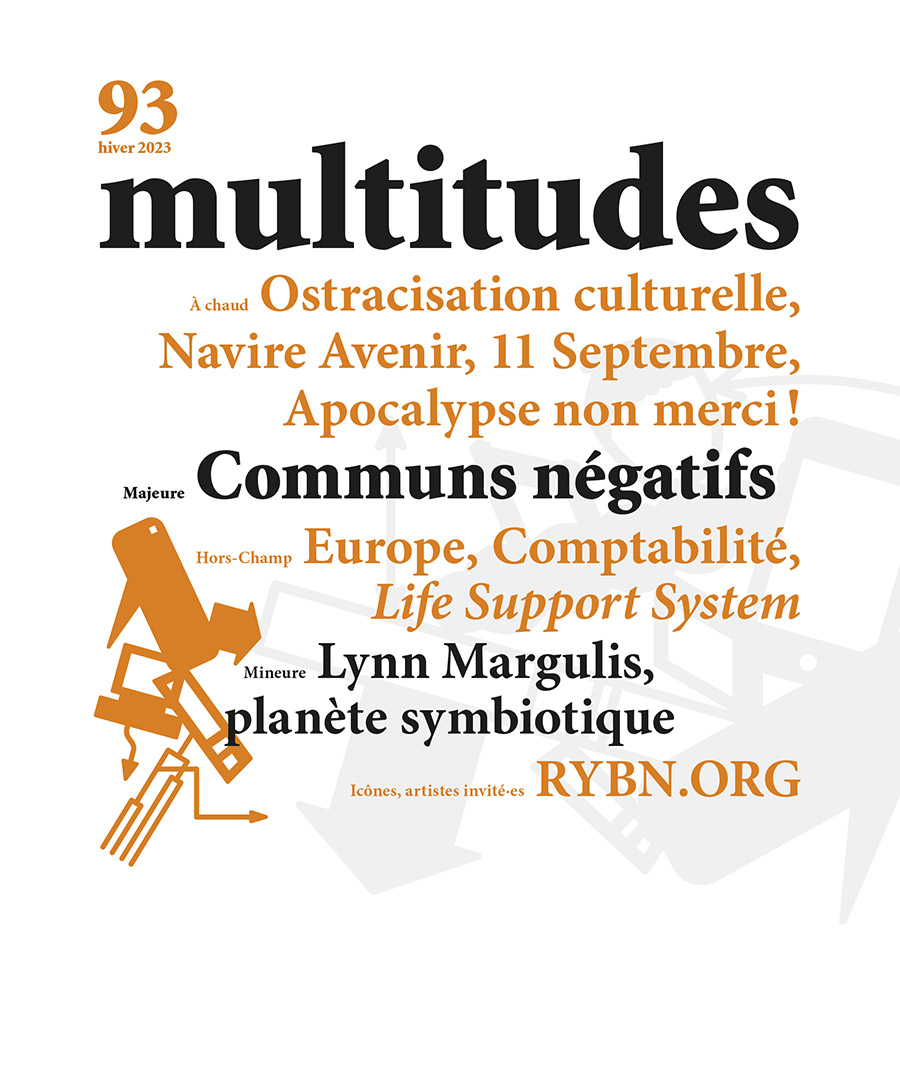La pandémie de Covid a donné lieu à une surenchère d’interprétations recyclant le concept de biopolitique quitte à l’user jusqu’à la corde. De nombreuses analyses « critiques » ont, dans le sillage des pensées d’Ivan Illich ou encore Giorgio Agamben1, dénoncé la fétichisation de la vie – et, conséquemment, la peur de la mort – pour mieux fustiger la soumission à des mesures de confinement, jugées autoritaires, de même que le recul des libertés dont elles auraient attesté, minimisant au passage le bilan d’une pandémie qui causa vraisemblablement entre 20 et 30 millions de morts à travers le monde 2.
À rebours de ce narratif, des collectifs d’auto-défense sanitaire ont fermement dénoncé ces discours, fustigeant tant les mesures gouvernementales et leur incurie prononcée (discours confus en début de pandémie, absence initiale de masques, lenteur à reconnaître le caractère aéroporté des contaminations, promesses non-tenues de mise en place de purificateurs d’air, etc.), que les réponses vitalistes qui parcoururent les milieux intellectuels et militants – en particulier la dénonciation abstraite d’un attachement aveugle à la vie lors même que les patient-es en situation de handicap faisaient l’objet d’un tri dans les services de réanimation…
Finalement, l’appel à « vivre avec » le virus et à ne pas sacrifier la santé mentale et les libertés de la majorité de la population au profit d’une minorité connut un très fort écho tant du côté de la gauche radicale que de l’extrême-droite. Curieusement, l’abandon des mesures sanitaires et l’alignement de fait entre les souhaits exprimés par ces groupes et les mesures gouvernementales qui ont suivi n’a pas suscité, depuis, la même frénésie d’analyses3.
Le collectif Cabrioles réalise depuis plus de trois ans un travail absolument remarquable autour de la pandémie. En introduction à son dossier sur le validisme au temps de la Covid, publié en novembre 2022, il présentait ce phénomène de la façon suivante :
« [le validisme est] un système de domination spécifique qui, de la totalité de l’environnement bâti jusqu’à nos manières de nous subjectiver et de tisser des relations, impose comme norme les corps et les esprits construits comme “sains”, “valides” et donc productifs. Les autres sont prié·es de rester enfermé·es ou de se faire soigner, de devenir normal·e ou de mourir en silence. D’une mort sociale, ou physique.
La pandémie a révélé la profondeur de la structuration validiste du système capitaliste, sa hiérarchisation meurtrière de la valeur des vies. Elle nous a également appris à quel point la gauche radicale et les mouvements autonomes et libertaires – si prompts à faire leur le “vivre avec” eugéniste du gouvernement Macron – en sont également profondément imprégnés ; et cela de leur négligence totale de toute accessibilité à la manière d’essorer jusqu’à l’épuisement les personnes qui y prennent part 4. »
Cabrioles a publié le 20 août dernier une traduction d’un entretien donné par collectif Out of the Woods, inséré dans un ouvrage récemment traduit, L’Utopie maintenant. Perspectives communistes face au désastre écologique. On y découvre la notion de « communisme de désastre » : « Il s’agit de savoir dans quelle mesure nous pouvons nous entraider pour aller au-delà de la subsistance de quelques-uns et sortir de la série actuelle de catastrophes, pour bâtir un monde dans lequel nous espérons que personne n’aura plus à les subir. Un monde au-delà de la catastrophe est possible. ».
Ce communisme est un communisme du soin, qui interroge tout ce qui entrave la capacité à subsister, à commencer par la dépendance à des organisations marchandes. En temps normal, cette dépendance renvoie à la nécessité de gagner sa vie et d’être productif (manière de générer une valeur capturée par l’organisation pour ainsi espérer demeurer en son sein). En temps de pandémie, cette nécessité se double de l’exposition à un risque létal. Il fut en partie atténué au plus fort de la crise par des mesures imposant notamment le port du masque ou la généralisation, pour celles et ceux qui le pouvaient, du télétravail – mesures toutefois très partielles car bien des travailleurs et des travailleuses y échappèrent – les fameux-ses travailleur-euses essentiels-les parce que travaillant dans le cadre de relations humaines. Aujourd’hui, ces protections – déjà fortement inégalitaires – se sont évanouies, quand bien même le virus n’en a cure et circule toujours.
Yves Citton, dans le texte qui accompagne cette Majeure, relève avec justesse la question que pose le concept de communs négatifs et la primauté du soin à leur porter qui en découle. Je cite ce passage in extenso :
C’est précisément au titre d’une telle infrastructure de soustraction que le revenu universel mérite d’être promu. Seules nos autruches politiciennes ne veulent pas voir que de larges secteurs de nos économies (publicité, production d’emballages, agrochimie) devront être « fermés » (ou drastiquement réduits en taille) – et cela du fait de leur bilan écologique négatif, […]. Nous nous leurrons collectivement en continuant à les soutenir (parfois à force de subventions publiques, comme dans le cas des SUV électriques) en défendant leurs mérites en termes « d’emplois ». Même si la fonction socialisante d’un emploi dépasse bien entendu largement son seul revenu monétaire, l’introduction d’un revenu universel établi à un niveau élevé (comparable au SMIC) construirait une infrastructure sociale permettant d’opérer beaucoup moins douloureusement la soustraction nécessaire de telles productions à haut impact féral, en attendant et en favorisant leur reconversion vers d’autres formes d’activités5.
Cet éloge du revenu universel ouvre sur une contestation plus large des formes dominantes de l’économie – sans oublier la prévalence des organisations / corporations dans nos vies, un attachement devenu littéralement vital. Aujourd’hui, le travail nécessaire pour démanteler et remanteler les communs négatifs excède clairement la capacité à s’emparer de ces questions à partir des emplois disponibles ou entrevus dans les innovations de la « start up nation ». Qu’il s’agisse de légitimer la prise en compte et le traitement des communs négatifs en créant de nouveaux emplois de redirectionnistes ; de réinvestir le salariat via le salaire à vie afin d’en faire le support d’une sécurité sociale de la redirection écologique 6 destinée à permettre à chacune et à chacun de rediriger son métier ou tout simplement de bifurquer ; d’instaurer de nouveaux modes de financement du travail par-delà la catégorie de l’emploi au moyen d’un revenu universel comme de transition ou tout autre dispositif du même acabit ; voire de concevoir d’autres modes d’organisation, plus ou moins en rupture avec les formes d’économie en vigueur. Toutes ces stratégies ont leur place en ce qu’elles articulent des postures (vis-à-vis des institutions) et des temporalités (à plus ou moins long termes) complémentaires.
Le plus paradoxal dans tout cela tient sans doute au double constat de la nécessité d’une économie du soin qu’il convient d’apporter aux communs négatifs (assimilable à un communisme de désastre), et, concomitamment, à son défaut actuel et passé, qui explique sans doute très largement le profil économique de celles et ceux qui dénoncèrent avec le plus de vigueur, et souvent jusqu’à l’excès, les mesures prises durant la pandémie, du confinement à la vaccination. Comme l’écrivirent William Callison et Quinn Slobodian dès le mois de janvier 2021 : « menés dans de nombreux cas par des freelances et des indépendants en colère, amplifiés par des entrepreneurs en prophéties spéculatives et totalisantes, ces mouvements sont moins ce que José Ortega y Gasset appelait “la révolte des masses” que “la révolte du Mittelstand”, autrement dit des petites et moyennes entreprises7 ».
Ce n’est pas un hasard si cette révolte a rassemblé des (auto)-entrepreneurs et des freelances, figures par excellence du capitalisme tardif (ou du néolibéralisme), rendues particulièrement vulnérables par la succession des confinements : « dans le monde entier, les manifestations ont souvent été menées par des propriétaires de petites entreprises et des travailleurs indépendants, qui n’ont généralement pas les liens sociaux d’appartenance à un syndicat et qui ont moins de sécurité de l’emploi que les fonctionnaires ou les employés des grandes entreprises autorisés à travailler à domicile dans le cadre d’une “quarantaine pour cols blancs”8 ».
Ce n’est pas non plus un hasard si nombre d’entre eux se sont par la suite reconvertis dans le bien-être mâtiné de conspirationnisme : ce que l’on nomme depuis une dizaine d’années la conspiritualité9. Sans argumenter en défaveur de la sincérité de ces démarches (il est inutile de prendre parti sur ce point), il faut néanmoins souligner le rôle ambivalent que jouèrent ici les technologies numériques. Tantôt redoutées en tant que medium d’une surveillance généralisée, tantôt protection offerte aux employés recourant au télétravail – une option largement inaccessible aux (auto)entrepreneurs, elles constituent en même temps des opportunités de se muer en « automédia » via la monétisation de contenus conspirationnistes.
Si les outils et technologie du télétravail protégèrent les cadres, les indépendant-es en quête de sécurité économique la découvrirent au contact de dispositifs numériques bien différents des logiciels de visioconférences comme Teams ou Zoom, à savoir les plateformes de diffusion telles YouTube ou Twitter. Ces plateformes, dominées par la quête d’audience et le jeu des algorithmes, mettent en valeur des contenus sans cesse plus extrêmes tout en arrimant les personnalités les plus en vue aux souhaits d’un auditoire particulièrement versatile10. Ainsi se met en place « une économie de l’incurie », selon l’expression de Bernard Stiegler, accentuant les communs négatifs, au lieu d’une économie du soin susceptible de favoriser leur prise en charge. La bascule vers des conduites plus écologiques nécessitera rien moins que l’édification d’une telle économie du soin par des groupes locaux, des collectifs professionnels ou encore des institutions – un horizon proprement révolutionnaire à condition de renouveler le sens de ce vocable.
1Sur l’usage qui fut fait de la biopolitique en général et sur Agamben en particulier (voir Illich), je renvoie aux analyses de Benjamin Bratton, The Revenge of the Real: Politics for a Post-Pandemic World (Verso Books, 2022). Voir également la réaction d’Adam Kotsko, le traducteur d’Agamben en anglais, dans « What Happened to Giorgio Agamben? », Slate, 21 février 2022, https://slate.com/human-interest/2022/02/giorgio-agamben-covid-holocaust-comparison-right-wing-protest.html. Pour une analyse des biopolitiques « négatives » d’Agamben et « positives » de Bratton, voir Chris Hall, « Ambivalent thinking amid pandemic biopolitics », European Journal of Political Theory, 8 décembre 2022.
2www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates.
3« Jusqu’à l’abandon des mesures sanitaires au printemps 2022, l’opposition au macronisme avait majoritairement pris le parti de dénoncer la « dictature sanitaire », en un douteux contre-pied. Cela fait bientôt dix-huit mois que nos vies sont piétinées par le déni de la pandémie et le rétablissement à marche forcée mais les voix qui s’y opposent sont encore bien faibles. Les anti-pass et anti-masque communient depuis tout ce temps (https://blog.ecologie-politique.eu/post/La-grande-convergence) avec un gouvernement qui fit l’objet jadis de leur haine féroce et semblent de plus rien avoir à dire en la matière. Qui désormais pour critiquer cette biopolitique de l’indifférence ? », in Aude Vidal, « Pas de Covid long pour la chair à patrons », Substack newsletter, Cabrioles – #AutodéfenseSanitaire face au Covid-19 (blog), 24 septembre 2023, https://cabrioles.substack.com/p/pas-de-covid-long-pour-la-chair-a
4Cabrioles, « 12 novembre 2022 · Validisme », Substack newsletter, Cabrioles – #AutodéfenseSanitaire face au Covid-19. (blog), 12 novembre 2022, https://cabrioles.substack.com/p/12-novembre-2022-validisme
5Cf. supra.
6C’est l’enjeu du projet du même nom, porté notamment par l’Institut Rousseau, le collectif Pour un réveil écologique, le Réseau Salariat, les Shifters – Groupe Local d’Aix-Marseille, le Réseau action climat France et le Printemps écologique avec le concours de la formation que je dirige, le MSc Strategy & Design for the Anthropocene.
7William Callison et Quinn Slobodian, « Coronapolitics from the Reichstag to the Capitol », Boston Review, 12 janvier 2021, www.bostonreview.net/articles/quinn-slobodian-toxic-politics-coronakspeticism. Dans cet article, Callison et Slobodian écartent les notions de populisme et de conspirationnisme au profit d’un terme qu’ils introduisent, le « diagonalisme » : « Nés en partie des transformations de la technologie et de la communication, les diagonalistes ont tendance à contester les appellations conventionnelles de gauche et de droite (tout en s’orientant généralement vers des convictions d’extrême droite), à exprimer leur ambivalence, voire leur cynisme, à l’égard de la politique parlementaire et à mêler des convictions sur le holisme, voire la spiritualité, à un discours obstiné sur les libertés individuelles. À l’extrême, les mouvements diagonaux partagent la conviction que tout pouvoir est une conspiration. ». Sur cette notion, voire la récente discussion (publié le 12 octobre 2023) des auteurs avec les animateurs du podcast Conspirituality, sur www.conspirituality.net/ episodes/diagonalism-william-callison-quinn-slobodian
8www.nytimes.com/2020/03/27/business/economy /coronavirus-inequality.html
9Alexandre Monnin, « Conspiritualité : du bien-être au conspirationnisme », La Prospective de la Métropole de Lyon, Millénaire 3 (blog), 2 août 2023, www.millenaire3.com/ressources/2023/veille-m3-conspiritualite-du-bien-etre-au-conspirationnisme
10Un exemple extrême en la matière nous est fourni par le comique, acteur et animateur britannique Russell Brand, au cœur d’un récent scandale qui vit plusieurs femmes l’accuser de viols et d’agressions sexuelles. La radicalisation de Brand lui a ouvert l’accès, au cours des dernières années, à une audience en ligne beaucoup plus large mais aussi beaucoup moins constante. Ce public, peu enclin à suivre les vidéos hors de ses thèmes de prédilections, contraint en retour Brand à surenchérir en restreignant ses sujets possibles, l’amenant à dévaler graduellement une pente de plus en plus réactionnaire. Sur ce point, voir en particulier les analyses du podcast QAnon Anonymous et l’interview du chercheur Robert Topinka : www.patreon.com/posts/episode-251-part-91182082. Cf. également, www.bbc.com/news/uk-66842630