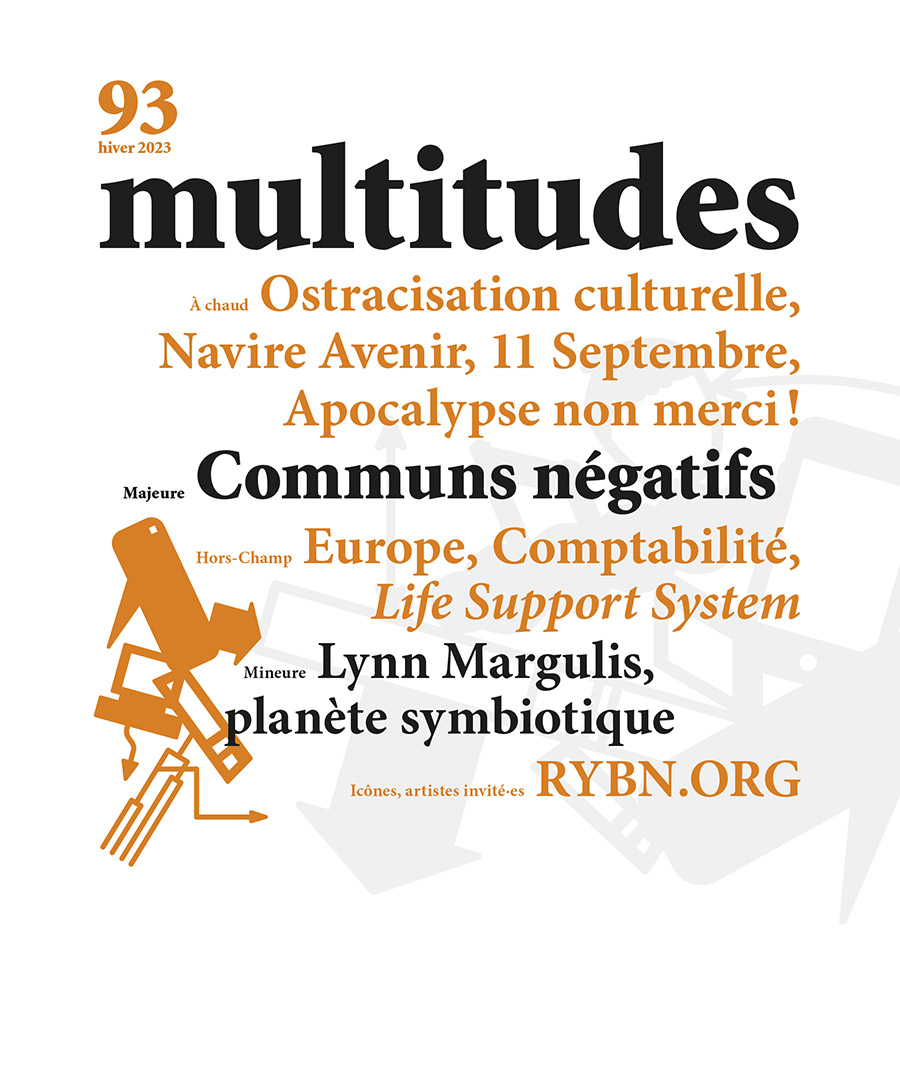Dans La Mesure de la réalité 1, Alfred W. Crosby dresse, dans le chapitre qu’il dédie à la comptabilité, un constat sans appel : « Sept siècles de comptabilité ont plus fait pour donner forme aux perceptions d’un plus grand nombre de gens que n’importe quelle innovation singulière de la philosophie ou de la science. Rares sont ceux qui ont médité les paroles de René Descartes et d’Emmanuel Kant ; des millions d’autres, en revanche, plus frivoles et plus laborieux, ont inscrit des chiffres dans des livres de comptes bien tenus, puis ont rationalisé le monde pour l’adapter à leurs livres. » La comptabilité en vigueur aujourd’hui a été inventée autour des XIIe et XIIIe siècles, dans les villes d’Italie du Nord qui développaient fortement leurs échanges commerciaux. Elle a un nom : comptabilité en ou à partie double 2. Ses principes ont certes été raffinés mais ils n’ont fondamentalement pas changé depuis lors, accompagnant et contribuant aux révolutions industrielles mais aussi à l’essor du capitalisme. Il y a là de quoi s’étonner puisque le monde a pour sa part passablement changé. La comptabilité, qui est assez majoritairement dénigrée des intellectuels, occupe cependant, dans le monde entier, une place de choix et, en un certain sens, façonne nos existences.
Ce dénigrement n’a pourtant pas toujours été aussi patent. Les peintres s’y sont intéressés. Des écrivains également, le dernier en date étant sans doute B.-S. Johnson, dans son Christie Malry règle ses comptes 3. Il serait plus que jamais utile que des artistes, des écrivains et des poètes s’en saisissent afin de mettre en lumière ses limites et, surtout, les effets néfastes de ses principes sur nos vies. Même les designers pourraient bien avoir leur rôle à jouer pour enfin compter et prendre en considération la valeur économique autrement.
Aux origines de la comptabilité en partie double
Les origines de la comptabilité en partie double remontent à la deuxième partie des années 1200. « Jusque vers 1250 les commerçants italiens ne connaissaient que la comptabilité simple. Le crédit était resté peu développé, et restreint à un cercle géographiquement restreint de correspondants connus ; le chef d’entreprise pouvait, sur un simple carnet, noter les créances et des dettes qui ne figuraient pas au compte de caisse ; c’était là un aide-mémoire budgétaire, qui n’avait rien de comptable, puisque la caisse ne le contrôlait pas », expliquent Jean Fourastié et André Kovacs. Ce sont en effet les opérations de crédit et dette mais aussi de change qui, en se développant entre des zones éloignées les unes des autres, vont obliger les marchands à trouver des manières de les comptabiliser. « Il était fatal que cette introduction en comptabilité des comptes de créances et de dettes inconnus auparavant aient d’importantes conséquences ; cependant il faut attendre 1290 pour que se révèlent certains liens entre les nouveaux comptes et les comptes traditionnels de recettes et de dépenses », poursuivent-ils4. Ce sont dans les livres de la maison Bonsignori de Sienne que l’on trouve pour la première fois trace de ces nouveaux comptes.
Mais Francesco di Marco Datini (1335-1410) reste la figure d’une évolution déterminante dans l’invention de la comptabilité en partie double. « Transportons-nous par exemple à Prato (près de Florence) et voyons comment, vers la fin du XIVe siècle, Datini, l’un des plus grands capitalistes de l’époque, à la fois industriel de la laine, commerçant et banquier, qui a déjà de nombreuses filiales en Europe (dont en France à Avignon), calcule ses profits avec une comptabilité mise au point par son comptable ; […] pour Datini, ce « capitaliste praticien », son capital n’est absolument pas un moyen ou un actif mais bien une dette, qui plus est, une dette de sa propre entreprise envers lui ! […] Datini se considère comme un créancier de sa propre entreprise. Il a ouvert un compte capital non pas pour suivre des mouvements d’actifs concrets (dont d’argent) mais pour conserver sa mise, cette mise devant lui être remboursée par son entreprise ! », détaille Jean Richard dans Révolution comptable 5. La comptabilité évolue ainsi d’abord dans la pratique, sous l’impulsion des marchands. Il faut attendre encore de nombreuses années avant de la voir théorisée.
Luca Pacioli6 est connu pour être le théoricien de la comptabilité en partie double. L’avant-dernière partie de la Summa de arithmetica, geometria, de proportioni et de proportionalita parue à Venise en 1494 s’intéresse notamment à la tenue des comptes alors en vigueur dans cette cité. Au début du deuxième chapitre, Pacioli, partant du principe que tout agent est mû par une fin, avance que celle du marchand est de réaliser un profit qui lui permette de satisfaire ses besoins (« licite e competente guadagno per sua substentatione »). Littéralement, le marchand vise un gain, qui est licite et compétent, soit, au sens ancien du terme, qui appartient, qui revient à quelqu’un en vertu d’un droit, ou bien, si l’on considère l’étymologie qui renvoie au latin competo, qui convient, qui est obtenu avec. Au début du dixième chapitre, Pacioli présente le journal, qui est l’un des livres à tenir, comme un livre secret (« nel qual giornale [per essere tuo libro secreto] »). Le secret surgit ainsi dès la théorisation de la comptabilité en partie double. On se souvient au passage que Pierre-Damien Huyghe relie étymologiquement l’industrie au secret en raison du préfixe indus, qui est relatif à la sécrétion. Deux chapitres plus loin, Pacioli explique qu’il s’agit de commencer l’écriture du journal au nom de Dieu (« Adonca con la nome de Dio comenzarai a pondre nel tuo giornale la prima partita des tuo inventario »). Le cadre est ainsi posé. Celui qui écrit ses comptes, qui est un marchand, vise un gain (profit7) afin de se sustenter ; il consigne ses secrets dans son journal au nom de Dieu. Peu importe le reste, pourrait-on dire.
Le livre de Jacob Soll intitulé The Reckoning 8 est particulièrement utile à une contribution à l’histoire de la comptabilité. Il montre aussi comment le capitalisme n’aurait probablement pas existé sans l’invention de la comptabilité en partie double : « sans la comptabilité en partie double, ni le capitalisme moderne, ni l’État moderne ne pourraient exister, car c’est l’outil essentiel de calcul des profits et des pertes, la base de la gestion financière9. » The Reckoning montre que la comptabilité en partie double a permis, par le calcul d’un profit, de créer une monnaie de crédit tout en respectant le dogme catholique qui interdit le prêt d’argent10, mais il montre aussi en quoi la dette publique en est devenue la contre-partie essentielle, à travers l’étude du déploiement de cette nouvelle comptabilité dans plusieurs États européens, l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France.
De trop rares récits littéraires
Une telle emprise de la comptabilité sur les existences et la société ne pouvait que concerner les peintres et les penseurs. Jacob Soll nous rappelle que de nombreuses peintures abordent des questions liées à la comptabilité. À commencer par le Portrait de Luca Pacioli (ca. 1500) de Jacopo de’ Barbari qui représente en son centre le mathématicien franciscain touchant du doigt la Summa de arithmetica, geometria, de proportioni et de proportionalita, ouvrage dans lequel Pacioli fixe donc les principes de la comptabilité nouvelle. En retrait, à sa gauche, figure Guidobaldo da Montefeltro, son élève, duc d’Urbino, rare sinon unique occasion de voir représenté un noble derrière un comptable. À la même époque, le tableau Death and the Miser, du peintre hainuyer Jan Provoost (1465 – ca. 1525), en mettant en scène un cadavre, montre qu’il sera sans doute toujours impossible d’équilibrer les comptes… à moins de faire revenir les morts à la vie afin qu’ils règlent leur dette ou de s’en remettre au Jugement dernier. Le Prêteur et sa Femme (1515) du peintre flamand Quentin Metsys représente un homme qui compte de l’argent aux côtés de sa femme. Celle-ci, tout en observant son époux manipuler des pièces de monnaie, tourne les pages d’un livre d’heures dans lequel la figure de la Vierge Marie est reproduite, ce livre permettant de suivre la liturgie des heures. Dans le Marriage a-la-Mode, The Tête à Tête (ca. 1743) de William Hogarth, un couple résultant d’un mariage sans doute arrangé apparaît désuni. Surtout, l’intendant de la maison s’éloigne du couple en levant les yeux au ciel alors que sa main droite, d’un signe, pourrait bien vouloir conjurer le sort ou toute malédiction. Il tient des billets de sa main gauche et un livre de compte sous le bras. L’intendant n’a probablement pas pu s’entretenir avec le couple, ce qui laisse les comptes de la maison dans un état incertain.
Arnaud Orain dans La politique du merveilleux11 a rappelé à quel point les penseurs et les dramaturges du XVIIIe siècle, en France, sont impliqués dans les discussions relatives à l’économie et à la finance, notamment au moment de l’instauration du Système de Law qui, entre 1716 et 1720 a développé l’utilisation du papier-monnaie en lieu et place des pièces métalliques. Quelques années plus tard, comme l’a montré Yves Citton12, l’économiste Jean-François Melon, dans son conte Mahmoud le Gasnévide paru en 1729, met notamment en exergue la nécessité de la confiance en matière de finance. Au XIXe siècle, en raison de l’essor des places boursières, la spéculation est plus particulièrement scrutée par les écrivains qu’il s’agisse par exemple du Faiseur de Balzac13 ou de L’argent de Zola14. Plus près de nous, parmi les œuvres littéraires du XXe siècle, rares sont celles qui s’intéressent frontalement à la comptabilité ou au fonctionnement des marchés économiques et financiers. Souvent, les écrivains mais aussi les réalisateurs, préfèrent s’emparer de figures déchues, notamment en abordant leur psychologie. Le roman Christie Malry règle ses comptes15 de B.-S. Johnson est de ce point de vue une exception des plus remarquables. Son auteur, il est vrai, est au courant de ces techniques puisque, lorsqu’il quitte l’école à l’âge de 16 ans, il devient comptable. Plusieurs années après, Johnson fait publier ce roman dans lequel Christie Malry devient employé de banque et découvre le principe de la comptabilité en partie double, une découverte qui va littéralement le rendre fou et le mener à sa perte. Et pour cause : Christie Malry en vient à représenter et à résumer son existence sous forme d’un compte. Le roman est ainsi ponctué de tableaux de compte qui, à l’instar de ceux de la comptabilité en partie double, par définition, sont équilibrés. D’un côté de chaque tableau, à gauche, figure le débit ou préjudice, de l’autre, à droite, le crédit ou réparation. Une offense subie est inscrite au débit de son propre compte. En revanche, dès qu’il porte atteinte à la société, il est crédité. Christie Malry est seul contre la société, seul contre les autres. Le libellé du compte dont on suit l’évolution dans le roman ne laisse planer aucune doute : « Christie Malry en compte avec eux ».
Les intitulés des opérations sont cocasses et pour certains tout à fait pertinents quant aux problèmes que tout un chacun connaît en entreprise. Par exemple, au débit, dans le premier compte : « Ambiance de l’agence », « Réprimandes particulières du Chef et de l’Aide-comptable », « Quasi obligation de devenir membre de l’Association du Personnel » ou encore « Manque d’amabilité du Chef de Bureau ». Les montants qui y sont associés sont loufoques mais l’équilibre est assuré. Un peu comme maintenant : dans le meilleur des cas, une rupture conventionnelle permet de régler le harcèlement en bonne et due forme d’une direction envers un salarié ou d’indemniser un burn-out passé. Dans ce même premier compte, au crédit figure par exemple le « Non paiement de la facture des Pompes funèbres ». Ce faisant, B.-S. Johnson attire également notre attention sur la question du bien-être des salariés qui est absolument absente des principes comptables.
Au fur et à mesure du roman, les atteintes que Christie Malry porte à la société gagnent en ampleur. Le troisième arrêté de compte fait notamment état au crédit d’une « Fausse alerte à la bombe à l’Aldwych Theatre » (le 2 juin, pour un montant de 381) ou encore d’un « Canular téléphonique aux membres du conseil des ministres » (le 13 juin, pour un montant de 70), à comparer par exemple à la « Surcharge de travail imposé par Wagner » enregistrée le 12 mai pour un montant de 700. Le roman se termine par un compte final qui est clos après que Christie Malry meurt d’une pneumonie au chapitre 24 : « Lorsque la pneumonie s’installe, les autres patients s’en aperçoivent rapidement et lui donnent le nom de râle de la mort. Par égard pour eux, Christie est transporté dans une salle d’isolement. La pneumonie n’est pas soignée : inutile, même si elle devrait l’être. / Chrisite n’est pas ranimé. / eXit Christie ».
Parmi les œuvres plus récentes encore, il faut mentionner Les frères Lehman de Stefano Massini16. Si ce roman raconte de façon prodigieuse l’histoire de la banque des Lehman Brothers sur la durée d’un siècle et demi, de la fondation de la société à son effondrement à l’occasion de la crise financière de 2008, jamais il ne rentre en revanche dans les mécanismes comptables ou les phénomènes purement économiques.
Un étonnant silence
Pourquoi les philosophes, les artistes et les écrivains contemporains sont-ils si timorés à l’égard de la comptabilité et des mécanismes de l’économie et de la finance, alors qu’il y a largement de quoi s’étonner dès lors que l’on s’y intéresse17 ? Ainsi ne peut-on que rester médusé devant la manière dont on fonde une société. Notons d’ailleurs qu’il s’agit bien de fonder une société et non une entreprise, ce sur quoi il est important d’insister alors même que la vulgate néo-libérale ne cesse de louer l’esprit d’entreprise et que, en France, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, l’auto-entreprenariat a été promu en tant qu’alternative crédible au salariat. Car le Code du commerce n’autorise que la fondation d’une société, nullement d’une entreprise. Et pour cela, encore faut-il nécessairement apporter de l’argent sur un compte bancaire afin de constituer le capital social de la société avant de faire immatriculer ladite société en question et d’en déposer les statuts auprès du greffe du Tribunal de commerce.
Jean-Philippe Robé ne cesse, depuis des années, de souligner la confusion récurrente entre les notions de société et d’entreprise. Dans L’entreprise et le droit, il écrit : « […] pour les juristes, l’entreprise n’existe pas en soi. Le tout que constitue le circuit de contrats servant de support juridique à une entreprise n’a pas d’existence juridique propre. […] Cette existence de fait de l’entreprise en tant qu’unité, et cette inexistence en droit en tant que telle, permet une vie très particulière à l’entreprise, entre droit et non-droit ». L’une des conséquences de cet état de fait est qu’une action ne donne pas un droit direct sur l’actif utilisé dans l’entreprise. Robé écrit encore : « L’action ne fait que donner le droit de participer aux mécanismes organisés par le droit des sociétés en matière d’exercice du pouvoir dans l’entreprise et de participation au résultat. Elle ne donne pas un droit de copropriété sur les actifs18 ». Or qui n’est pas tenté de croire que tel serait le cas ? Qui ne croit pas que l’actionnaire, lui-même en premier lieu, possède l’actif 19?
Il faut ici revenir à Luca Pacioli. Dans le dernier chapitre de la « Summa », il indique qu’il s’agit avant toute autre chose de procéder à un inventaire de ce que le marchand possède. Pourquoi ? Parce que ses biens vont être apportés en nature à son affaire. Qui n’a pas d’apport en nature, qui plus est qui n’a pas d’apport financier, ne fondera pas de société et n’entreprendra pas. Corrigeons : un salarié dans une entreprise « entreprend » sans doute plein de choses, mais au nom d’actionnaires pour lesquels le travail représente toujours un coût, une charge d’exploitation, en aucun cas un apport, tandis que ces actionnaires passent pour les « entrepreneurs » effectifs.
Voilà encore qui étonne si peu : considérer unilatéralement le travail comme une charge, un coût pour l’entreprise, dont les « entrepreneurs » sont des gens qui ne « font » rien. Comment se fait-il qu’il ne soit pas possible d’apporter du travail, une volonté d’entreprendre ensemble ou des idées autrement qu’au travers d’une charge financière, qu’une obligation à partir du moment où l’on est subordonné par la signature d’un contrat de travail signé entre une personne physique et une société, une personne morale, né d’une rencontre sur un subliminal « marché du travail » ?
Pire, dans le cas de sociétés cotées, souvent leur valorisation passe par le calcul d’un goodwill, immobilisation corporelle qui figure à l’actif du bilan qui correspond par exemple à la réputation, aux brevets, à la marque de qualité de l’entreprise. Oui, l’entreprise, non pas la société. On peut d’ailleurs souligner que les salariés d’une société travaillent effectivement ensemble, et que la manière dont ils travaillent ensemble a bien évidemment une influence sur la production de l’entreprise, et par conséquent sur la réputation des biens ou des services qu’elle produit. Pourtant, in fine, lors d’une transaction de vente d’une société, la valeur du goodwill viendra enrichir les vendeurs, soit les actionnaires. Mais de tout cela, qui est au fondement de nos principes de comptabilité, personne ne parle. Surtout pas les artistes, les écrivains ou les philosophes – peut-être parce que, à l’instar de Christie Malry, en eux tend à réellement se confondre une personne morale et une personne physique, à la manière d’un auto-entrepreneur tel que les gouvernements néo-libéraux les promeuvent actuellement ? Cette superposition comptable de l’artiste et de l’auto-entrepreneur pourrait bien être partie de notre malheur de l’heure.
Et que dire de la manière dont les règles comptables sont imposées sans l’once d’une discussion d’apparence même démocratique. Car qui décide, en France, des règles comptables et du plan comptable général ? Une institution : l’ANC, soit l’Autorité des normes comptables qui fait face à la pression exercée par l’IASB (International Accounting Standards Board). Cette organisation définit les IFRS (International Financial Reporting Standards) qui se trouvent régulièrement au centre de polémiques. À leur propos, Édouard Jourdain écrit : « La normalisation comptable n’est pas élaborée par un polycentrisme qui verrait la concurrence de différents modèles à travers le globe, mais elle fait bel et bien l’objet d’une véritable constitution mondiale. Celle-ci ne se réduit pas à quelques principes généraux adaptables selon les cultures et les systèmes politiques, mais pose les fondements d’une comptabilité capitaliste avec des directives très précises, recueillies dans un code de 3 000 pages qui est le code des IFRS produits par l’IASB20 ». L’IASB est dirigé par des administrateurs et administratrices qui sont membres de la fondation IFRS lesquels n’ont en réalité de compte à rendre à personne.
Mais revenons maintenant à l’époque de la théorisation de la comptabilité en partie double. Proche de Léonard de Vinci et de Piero della Francesca, Luca Pacioli écrit De divine proportione entre 1496 et 1498 qui sera publié en 1509. Il y traite du nombre d’or et de l’usage de la perspective notamment par Piero della Francesca. Il est étonnant de noter la synchronicité de l’apparition de la comptabilité en partie double et de la perspective linéaire.
Rappelons une fois de plus que le marchand vise un gain. N’y aurait-il pas un étonnant alignement entre la manière d’envisager la réalité politique, économique et sociale du point de vue, déterminé, du marchand, et la perspective linéaire ? Que l’on considère le terme de Leon Battista Alberti, la perspective (« vue à travers »), ou celui de Piero della Francesca, la prospectiva (« vue en avant »), il est frappant de relever que, dans la comptabilité nouvelle qui est sur le point d’être formalisée, le marchand et son comptable entendent eux aussi voir à travers des comptes (qui s’écrivent de plus en plus souvent en chiffres arabes plutôt qu’en chiffres romains, ces derniers étant source d’erreur et peu pratiques), ainsi que voir en avant le gain (prévoir, piloter le résultat, ainsi que l’on s’exprime de nos jours).
Qui, ces vingt dernières années, aura été amené à demander des subventions au nom d’une association loi 1901 aura sans doute constaté l’apparition de la valorisation du bénévolat. Comment a-t-on pu arriver à valoriser comptablement le bénévolat ? Le gouvernement nous l’explique : « La valorisation a pour objet de rendre compte de l’utilité sociale du bénévolat. Or, comme le bénévolat ne génère pas de flux financier, il n’entraîne pas de comptabilisation systématique et il n’apparaît donc pas dans les documents composant les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). Il peut en revanche être intéressant, pour l’association, de faire apparaître le bénévolat, en complément des flux financiers, pour donner une image fidèle de l’ensemble des activités développées. Cette recherche de fidélité peut servir aussi bien une finalité de communication externe que répondre à des motivations internes21 ». La notion d’image fidèle, qui renvoie à une croyance, certes laïque, est inscrite à l’article L123-14 du Code de commerce22 toutefois sans plus de précision.
Pour un autre design de la comptabilité
Faire un gain afin de se sustenter. Sans doute un marchand des XIIIe et XIVe siècles a-t-il besoin de sustenter. Peut-être n’a-t-il d’autre moyen que de mobiliser les moyens qui sont les siens et d’organiser leur maintien dans l’optique d’obtenir le moyen de se sustenter. Et d’imaginer, d’inventer en conséquence une manière de compter. Mais sommes-nous dans la même situation lorsque nous comptabilisons le bénévolat ? Ne sommes-nous pas entrés dans l’ère de l’Anthropocène ? Le temps d’essayer de conjuguer démocratie en entreprise et travail salarié n’est-il pas venu, comme le suggère Isabelle Ferreras23 ? Si l’on peut raisonnablement interroger la pertinence d’un indicateur tel que le PIB pour mesurer la richesse d’un pays, ne serait-il pas bienvenu d’imaginer d’autres manières – différemment comptables – d’envisager la représentation d’une activité économique, d’une entreprise ?
Des initiatives en ce sens existent, principalement autour de la triple comptabilité qui consiste à calculer les impacts environnementaux et sociaux de l’activité d’une société par l’établissement d’une liasse écolo-sociale. En plus des classes comptables classiques numérotées de 1 à 8 24, Laurent Didelot et Éric Ferdjallah-Chérel suggèrent la création d’une classe V (comme verte) qui pourrait permettre l’enregistrement, par exemple, « dans les informations environnementales : des actions de formation, des moyens consacrés à la prévention des risques, du montant des provisions et garanties pour risques, du coût des mesures de prévention, réduction, réparation, recyclage, élimination en matière de pollution et de gestion de déchets, des consommations de ressources et de leur évolution, des données liées aux gaz à effet de serre… ; dans les informations liées aux engagements sociétaux en faveur du développement durable : les actions de partenariat ou de mécénat, l’importance de la sous-traitance et les surcoûts liés à une politique responsable25… » À l’heure actuelle, dans ce registre, le modèle le plus abouti et le plus discuté est probablement la méthode CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology26) notamment conçue par Jacques Richard et Alexandre Rambaud. Celle-ci propose de faire évoluer les bilans et comptes de résultats des entreprises dans le but de préserver des entités capitales naturelles et humaines qui sont employées par les entreprises, de manière à ce que ne soit plus seulement maintenu ou conservé le capital financier. Franck Adebiaye, expert comptable mais également typographe, promeut de son côté une comptabilité par projet. Cette dernière vise à se substituer à la comptabilité analytique, elle-même ayant été introduite afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l’activité d’une entreprise donnée alors que la comptabilité en partie double est devenue légale et liée à des considérations fiscales. La comptabilité par projet autorise une vue en coupe d’une entreprise tout en suivant un projet de son début à sa fin au contraire de la comptabilité traditionnelle qui cantonne la mesure de l’activité à la durée d’un exercice comptable d’une année. D’autres initiatives sont plus radicales, comme la proposition de faire disparaître les fonds propres. « Cette hypothèse de société sans fonds propres avait été retenue par Jaroslav Vanek, dans son traité macroéconomique The General Theory of Labor-Managed Market Economies (La Théorie générale des économies de marché dirigées par le travail) […] Plutôt que de chercher à les [les actifs] évaluer, ne devrait-on pas poser comme principe que tout actif, matériel ou immatériel, se doit d’être financé et que le montant de ce financement préjuge de sa valeur ? », interroge Benoît Borrits dans Au-delà de la propriété 27. Et pourquoi ne pas envisager la fondation d’une société sur l’engagement d’un apport en travail qui pourrait être régulièrement réévalué ?
Mieux la comptabilité ne pourrait-elle pas être un sujet pour le design dans la mesure ou celui-ci vise à résoudre des problématiques en mobilisant différents champs du savoir au service de l’usage ? En définir la problématique constitue probablement le premier enjeu. Quitte à en proposer plusieurs, qui pourraient ensuite être soumises à la sagacité démocratique. Car c’est d’une conception et d’une écriture du compte commun dont la comptabilité est le système. Pour orienter cette pratique de design, il pourrait être opportun de se référer aux enseignements de Jack Goody quant à la manière dont l’écriture en tableau instaure un mode de raisonnement ou encore de Clarisse Herrenschmidt sur l’invention de la première des trois écritures qu’elle définit entre langue, nombre et code. Des artistes ont accompagné l’émergence des principes de comptabilité, tels que nous les connaissons et appliquons encore aujourd’hui. Il serait temps qu’ils en dynamisent les nécessaires métamorphoses à venir.
1Alfred W. Crosby, La Mesure de la réalité, traduction Jean-Marc Mandosio, Allia, Paris, 2003.
2Depuis 1755 seulement on utilise le terme « comptabilité en partie double » après l’édition du Trattato del modo di tenere la scrittura dei mercanti a partite doppie, cioè all’italiana de Piero Paolo Scali.
3Bryan Stanley Jonhson, Christie Malry règle ses comptes, traduction Françoise Marel, Quidam, Meudon, 2004.
4Jean Fourastié et André Kovacs, La comptabilité, Que sais-je, PUF, Paris, 1992.
5Jean Richard, Révolution comptable, Pour une entreprise écologique et sociale, en collaboration avec Alexandre Rambaud, les éditions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2020.
6Luca Pacioli (ca. 1446-1517) était un franciscain et un mathématicien.
7Habituellement, on retient la formule connue en ces termes « Au nom de Dieu et du profit », qui a été découverte par Raymond de Roover dans un registre de comptabilité de Castra Gualfredi. On lui préfère cependant celle de Pacioli, que l’on simplifie à l’extrême : « guadagno per sua substentatione ».
8Jacob Still, The Reckoning, Financial accountability and the making and breaking of nations, Penguin Books, Londres, 2014.
9« Without Double entry accounting, neither modern capitalism, nor the Modern State could exist, for it is the essential tool in calculating profit and loss, the basis of financial management ».
10Datini était pieux, son nom reste aujourd’hui encore associé à la fondation pour les pauvres de Prato, la Casa Pia dei Ceppi.
11Arnaud Orain, La politique du merveilleux, Une autre histoire du système de Law (1695-1795), L’épreuve de l’histoire, Fayard, Paris, 2018.
12Yves Citton, « Les comptes merveilleux de la finance. Confiance et fiction chez Jean-François Melon », Féeries, No 2, 2005, p. 125-160 (en ligne sur http://feeries.revues.org/document109.html)
13Honoré de Balzac, Le Faiseur, Flammarion, Paris, 2012.
14Émile Zola, L’argent, Folio, Paris, 1980.
15Le titre anglais est plus explicite, Christie Malry’s Own Double-Entry, la comptabilité en partie double étant désignée en langue anglaise par l’expression double-entry bookkeeping.
16Stefano Massini, Les frères Lehman, traduction Nathalie Bauer, Globe, Paris, 2018. Ce livre, présenté comme un roman en vers livre, avait été précédé d’une première version, non moins réussie, destinée à la scène, Chapitres d’un chute, Saga des Lehman Brothers, traduction Pietro Pizzuti, L’Arche, Montreuil, 2013.
17Mentionnons le récit 6 (Zones sensibles, Bruxelles, 2014) d’Alexandre Laumonier dans lequel l’auteur aborde le trading haute fréquence.
18L’entreprise et le droit, Jean-Philippe Robé, Que sais-je ? PUF, Paris, 1999.
19Ne parle-t-on pas aussi de chef d’entreprise, notamment dans les PME, dont le chef est en général aussi le principal sinon unique actionnaire de la société correspondante ?
20Édouard Jourdain, Quelles normes comptables pour une société du commun ?, éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2019.
21Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Guide pratique Bénévolat : valorisation comptable, en ligne, consulté le 28 février 2023.
22Article L123-14 du Code du commerce, version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe. Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise ».
23Voir Isabelle Ferraras, Gouverner le capitalisme, PUF, Paris, 2012.
24Les huit classes sont les suivantes : classe 1 : comptes de capitaux, classe 2 : comptes d’immobilisations, classe 3 : stocks et en-cours, classe 4 : comptes de tiers, classe 5 : comptes financiers, classe 6 : comptes de charge, classe 7 : comptes de produit, classe 8 : comptes spéciaux.
25Laurent Didelot et Éric Ferdjallah-Chérel, « La recherche comptable au service du résultat fiscal », Revue Française de Comptabilité, no 573, 2023, p. 16-19.
26Jacques Richard l’introduit dans La révolution comptable, op. cit. : « Ces propositions concernent les fondements même de l’économie. Elles pourraient être complétées par des mesures plus ciblées telles que celles qui figurent dans certains cahiers de doléance des gilets jaunes, notamment des réductions de taxes pour les travailleurs les plus pauvres ».
27Benoît Borrits, Au-delà de la propriété, Pour une économie des communs, La Découverte, Paris, 2018.
Sur le même sujet
- Subjectivités computationnelles et consciences appareillées
- Pour Gaza, contre l’antisémitisme, autrement
Fragiles propositions vers une gauche d’émancipation internationaliste - Certification Background Principes et modalités de rémunération des activités artistiques
- La créolité contre l’enfermement identitaire
- Une urgence pour une autre