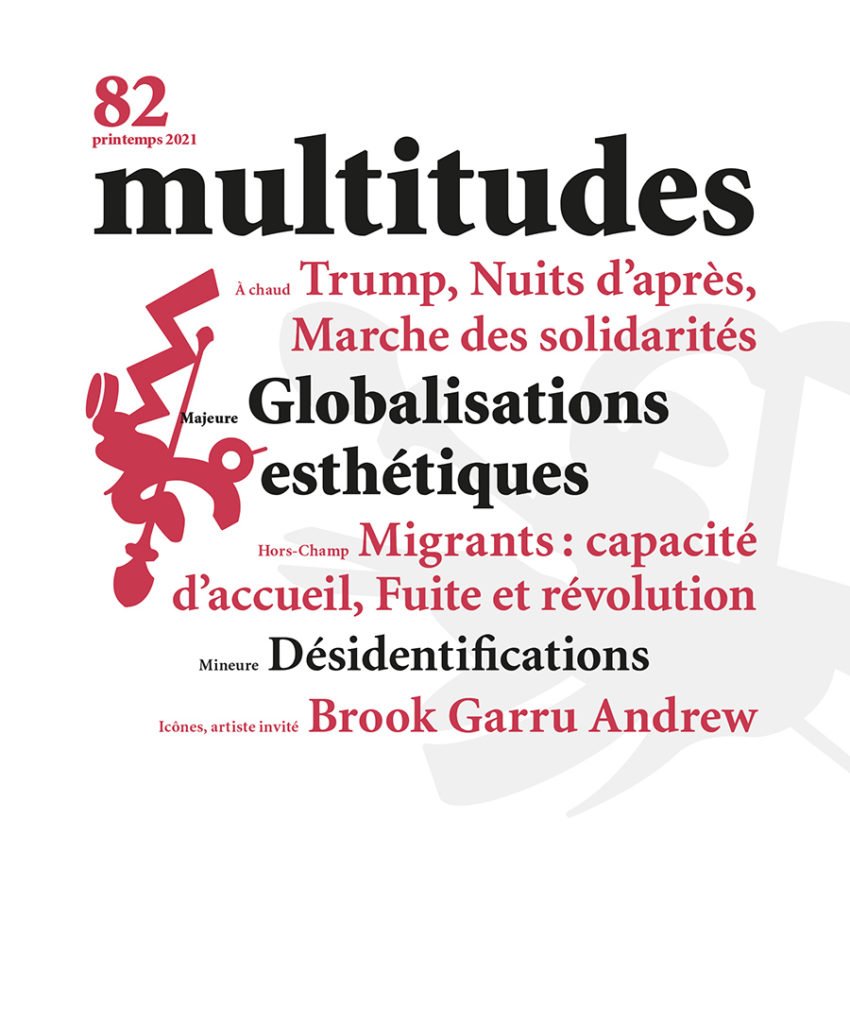Porte Saint-Denis à Paris, « la Marche des Solidarités », fête le 18 décembre, anniversaire de la journée où fut adoptée par l’OIT la Convention internationale sur « la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille » : résolution 45/158 du 18 décembre 1990. 20 ans après, en 2020 les objectifs de la Convention revisités par l’ONU, sont traduits ainsi : « dissiper les préjugés et (de) sensibiliser l’opinion à leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination. »
Les femmes et les hommes qui arpentent les grands boulevards, ne marchent pas pour commémorer les phrases creuses de l’ONU, mais pour dire haut et fort que les droits « convenus » en 1990 ne sont toujours pas au rendez-vous, que ce sont toujours eux et elles, travailleurs et travailleuses migrants qui prennent tous les risques de la précarité de l’emploi, de l’exploitation, de la pénalité, du licenciement, de l’expulsion etc. Ce sont les raisons pour lesquelles illes sont là, venu·es des divers arrondissements de Paris et des villes alentour comme Vitry, Saint Denis, Montreuil, Aubervilliers, Clichy où se concentrent les foyers, les centres d’hébergement, les campements, les squats. Illes veulent la liberté, l’égalité et la clef pour y prétendre : des « papiers ». C’est écrit, imprimé, exhibé. Sur les posters une femme africaine arbore devant elle la devise de la république où fraternité a été remplacée par « papiers », socle des autres valeurs républicaines. Ce sont eux, les papiers, qui libéreront les travailleur·ses des chaînes qui aujourd’hui les retiennent prisonnier·es, de traitements iniques, comme de faire des heures supplémentaires ou travailler de nuit sans compensation. En janvier, grâce à des grèves et des occupations à répétition une vingtaine de postiers, postières de Chronopost Alfortville ont été régularisé·es, les autres étant sommé·es d’attendre leur tour. Les « admissions exceptionnelles de séjour » sont à la fois soumises à des conditions draconiennes, du côté migrants, mais laissées à la discrétion du Préfet, coté département. Illes sont donc revenu·es dans la rue réclamer leurs droits, ensemble avec les autres collectifs de sans-papiers et les régularisé·es pour qui la possession de « documents » n’a pas tari l’esprit de solidarité. Ainsi ce jeune homme élancé, au premier plan, dont le drapeau haut dressé, au-dessus de la marée humaine, fait figure de proue de l’arc de triomphe derrière lui. Son fanion est celui du collectif de Vitry, c’est la puissance du collectif dont il brandit l’insigne en tête de manif.
En hors-champ, serrés les un·es contre les autres, on devine les membres des autres collectifs de sans-papiers accompagnés des organisations syndicales, humanitaires, juridiques, politiques, élu·es uni·es derrière les bannières arborant les revendications : régularisation des travailleuses et travailleurs sans papiers, fermeture des centres de rétention administrative (les CRA), accès au logement pour tous et toutes. Ces mots d’ordre allient une multitude d’associations engagées dans la défense des droits de l’homme, des droits des étrangers, de l’égalité des femmes, du droit au logement, du droit au travail et combattent l’enfermement des migrants, le racisme, les violences policières et judiciaires exercées à l’encontre des migrants particulièrement. Si ces sujets débordent la cause des seuls migrants, ils la traversent tous. Ces mots d’ordre sont repris des Marches précédentes, ils sont le fil rouge qui les lient. Ils estampillent ces Marches nommées Acte I, II, III, IV qui ont eu lieu les 30 mai, 30 juin, 17 octobre et 18 décembre, comme le design en jaune et noir des posters et des autocollants emblématisent ces Marches. La répétition a eu raison. Les marcheurs sont venus de plus en plus nombreux malgré ou à cause des interdictions qui ont frappé les deux premières manifestations. Leur nombre croissant a levé les barrages physiques et symboliques et rendu licite les deux dernières Marches des Solidarités du 17 octobre, 18 décembre. Le 17 octobre, 250 associations se sont mobilisées, contribuant à faire sortir de l’ombre et de la misère sociale, juridique, politique, les « sans papiers ».
Confinement la colère des « premiers de corvée »
Pendant le premier confinement de février à mai, les sans-papiers ont été soumis·es à deux régimes contradictoires : ne pas paraître sur la place publique afin d’éviter les contrôles qui se sont généralisés à toute personne soupçonnée de contrevenir aux règlements d’urgence sanitaire d’un côté ; de l’autre se déplacer et prendre les transports en commun pour assurer les tâches essentielles indispensables au bon fonctionnement de la vie publique et de la vie domestique incluant les activités agricoles et échanges commerciaux. Les êtres invisibles ont crevé les yeux aux postes d’entretien, de surveillance, de livraison. Les travailleuses de l’aide à domicile, aide-soignantes, caissières, femmes de ménage, livreurs à vélo, travailleurs du nettoyage ou du bâtiment, les travailleuses et travailleurs sans papiers, ont été les « premier·es de corvée ». Mais quand le confinement a été suspendu, « exploité·es dans les pires conditions ou perdant leur emploi, sans chômage partiel, vivant dans des hébergements souvent précaires et insalubres ou dans la rue, les travailleuses et travailleurs sans papiers n’ont reçu aucun signe de reconnaissance de la part du gouvernement pour leur apport pendant la crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui. » Il y a encore une troisième catégorie, ceux et celles qui travaillant dans le bâtiment, la restauration, le ménage dans les entreprises et se sont vu remercie·es, sans indemnités ni chômage puisqu’illes travaillaient la plupart du temps avec des alias. Et même certains employeurs ont profité de la Covid-19 pour débarquer des sans-papiers, devenus inessentiels, sans indemnités, sans chômage. Les sans-papiers sont choqués et veulent réagir. Leur colère n’est pas très loin de celle des gilets jaunes, mais leurs situations très différentes. Les sans-papiers sont au bas de l’échelle ; être sans papier, sans logement, sans attache territoriale est perçu comme un défaut, voire une menace pour ceux qui en sont pourvus. Leur estime réciproque est plus que problématique. Et pourtant quelque chose les rapproche : le sentiment de contribuer à l’économie et au développement national mais de n’être pas payé en retour, de ne pas compter aux yeux de la société qui compte, légifère, gère. Ils ne feront pas cause commune, sinon exceptionnellement. Les gilets jaunes se méfient des sans-papiers.
À l’issue du confinement, les sans-papiers qui avaient travaillé pendant l’épidémie puis avaient été débauchés, les intérimaires qui avaient perdu leur emploi pendant cette période, sans compensation, ont décidé de se rappeler à l’attention du gouvernement et de la population. Illes se sont mobilisé·es et ont activé la Marche des Solidarités le 30 mai. La demande d’autorisation déposée à la Préfecture de Paris s’est soldée par une fin de non-recevoir « en vue de prévenir la propagation du virus Covid-19 ». Compte tenu de la présence des sans-papiers sur le terrain pendant la période le confinement, l’argument de l’urgence sanitaire était irrecevable. Compte tenu du peu d’attention des ministères de l’intérieur, du logement, du travail, de la santé aux conditions de vie des étrangers contraints de vivre sous la tente, dans des squats insalubres, dans des foyers surpeuplés, le prétexte sanitaire de la contamination était inconvenant. La manifestation fut maintenue et suivie, quand le motif invoqué de l’interdiction fut connu. Dans une vingtaine de villes les collectifs et les associations ont défié les interdictions.
Le succès de ces rassemblements ne fut en revanche suivi d’aucun effet du côté du gouvernement, aucune ouverture, même esquissée. « Le pouvoir n’entend pas, il faut crier plus fort. Après le 30 mai, le 20 juin ! » (appel/communiqué du 5 juin 2020). Fin juin, une seconde Marche des Solidarités dans le droit fil de la première, a été appelée par les mêmes collectifs, sous la responsabilité des mêmes signataires, soutenue par les mêmes associations et plus encore. L’Acte II est prononcé, une dramatique à plusieurs épisodes est initiée. Les mêmes mots d’ordre sont repris. « La régularisation de touTEs les Sans-Papiers, fermeture des Centres de Rétention, logement décent pour touTEs. » Ces slogans ont l’air vieux, et pourtant ils ne cessent d’être actuels.
Mémoires et actualité des Marches
En 2010 « la France de toutes les couleurs » a oublié qu’elle a fait une marche pour l’égalité 20 ans avant. Alors « il faut continuer à marcher », dit Toumi Djaidja, (un des initiateurs de la Marche des Beurs de 83) à l’occasion de l’anniversaire de la Marche des Beurs. Continuer de marcher pour que la société bouge encore, c’est ce qu’ont entrepris une centaine de marcheurs, dont une grande majorité de sans-papiers dans le sens Paris-Nice, du 1er au 31 mai 2010. Un collectif de sans-papiers de Paris, CSP 75 déclare Ministère de la Régularisation de Tous les Sans Papiers (MRTSP) l’immeuble du CPAM rue Baudelique qu’ils occupent. Ce ministère inaugure sa charge par une Marche à travers la France. Le premier but est de rallier des gens à la cause de la régularisation des sans-papiers, le second, circonstanciel mais essentiel, est de se rendre au sommet des chefs des États africains réunis à Nice. Des accords bilatéraux signés avec la France doivent favoriser l’intégration des étrangers mais aussi l’expulsion des migrants non désirables. Les marcheurs dénoncent l’immigration choisie et les conséquences désastreuses de cette politique : contrôles aux faciès, stigmatisation de tous ceux qui sont désignés comme étant « d’origine étrangère », multiplication des centres d’enfermement des étrangers, expulsions, couples séparés, familles brisées… Ils remettent en cause la politique européenne de l’immigration et la complicité des chefs d’États africains qui soutiennent l’asservissement de leurs ressortissants. Le porte-parole du collectif, a sollicité en vain un entretien avec le Président du Sénégal.
Juin 2017, les Marches des Solidarités sont des chambres d’échos des mobilisations des sans-papiers pour leur régularisation mais aussi contre les violences policières dont ils sont la cible. Ainsi accompagnent-elles la manifestation organisée par le comité « Vérité et justice pour Lamine Dieng » et le collectif « Vies volées » en mémoire du jeune homme franco-sénégalais mort asphyxié dans un fourgon de police du XXe arrondissement de Paris, dix auparavant, comme Adama Traoré mort dans les mêmes conditions (plaquage ventral) un an avant. Ce jour anniversaire de la mort du franco-sénégalais Lamine, la foule réclame justice. Les policiers inculpés, ont été acquittés. La chambre d’instruction de Paris a conclu à un non-lieu, confirmé en appel en juin 2015. La famille manifestant sa volonté se tournera vers la Cour européenne des droits de l’homme, une négociation est alors proposée par la France à la famille.
En 2018, la Marche Solidaire : Vintimille-Londres est organisée par l’Auberge des Migrants de Calais, en lien avec Roya-Citoyenne et Utopia 56. Du 31 avril au 7 juillet, elle se déroule en 45 villes-étapes pendant la lecture au Sénat du projet de loi Asile et Immigration, qui restreint les droits des étrangers en France, et criminalise ceux qui les accueillent (la loi assouplit mais ne supprime pas le délit de solidarité). Cette marche a pour but de parler aux gens et de leur expliquer pourquoi l’accueil est une nécessité : guerre, persécutions politiques, religieuses et de genre, changement climatique et économique catastrophique, désir de vivre mieux. Y participent des migrants, des demandeurs d’asile d’Afghanistan, Pakistan, Bangladesh… L’initiative a le soutien de la Ligue de l’Enseignement, du Réseau Éducation Sans Frontières, de S.O.S. Racisme, du Parti de Gauche, NPA, de nombreuses associations, comme la LDH, la Cimade, Emmaüs-France, et du parrainage des États Généraux des Migrations. À la frontière entre la France et l’Angleterre, les sans-papiers marcheurs se font refouler, malgré leurs titres de voyage, et sont dirigés sur un centre de rétention administrative.
En mars 2018 et 2019, la Marche des Solidarités lance à nouveau un appel à manifester « contre les violences policières, contre la chasse aux migrant·es et contre le racisme », en soutien au collectif les « Vies volées » qu’accompagnent une cinquantaine de collectifs portant le nom des morts par balle, asphyxie, violence… : Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, Comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, Collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri, Collectif Vérité et Justice pour Babacar Gueye, Comité Vérité et Justice pour Nicolas Manikakis, Comité Vérité et Justice pour Hocine Bouras, Comité Vérité et Justice pour Angelo Garand, Comité Vérité et Justice pour Hakim Ajimi, Comité Vérité et Justice pour Youcef Mahdi, Comité Vérité et Justice pour Mourad Touat, Comité Vérité et Justice pour Mahamadou Marega, Comité Vérité et Justice pour Naguib Toubache, Comité Vérité et Justice pour Curtis, Comité Vérité et Justice pour Liu Shaoyo, Comité Vérité et Justice pour Tina Sebaa, Comité Vérité et Justice pour Abou Bakari Tandia, Comité Vérité et Justice pour Baba Traoré, Comité Vérité et Justice pour Yacine, Comité Vérité et Justice pour Mahamadou M.
Cette Marche est également rejointe par tous les collectifs des sans-papiers et le Copaf, (collectif pour l’avenir des foyers) une association qui a une longue histoire avec la gestion des foyers de migrants africains, et qui lutte pour conserver ses budgets et ses activités d’accueil des réfugiés.
Octobre 2020, la Marche des Solidarités, baptisée Acte III, appelée par 15 collectifs de sans-papiers et une centaine d’organisations, s’est étendue sur un mois, du 16 septembre au 17 octobre. Partant de 60 villes dont Alençon, Annecy, Bayonne, Caen, Figeac, Grenoble, Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Martigues, Mayenne, Montpellier, Nice, Rennes, Romans, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Tarbes, Toulouse, Saint-Nazaire, en direction de Paris, des collectifs de sans-papiers et leurs complices régularisés, naturalisés et nationaux, ont parcouru l’hexagone, traversant villes et villages, pour rencontrer des citoyens, faire connaissance avec la population, expliquer leur parcours, d’où illes viennent, leur culture, et quelle est aujourd’hui leur situation en France. Des accueils, des cantines, des hébergements, ont été organisés en amont par les collectifs des sans-papiers aidés des associations ainsi que par des mairies déjà convaincues de l’hospitalité à accorder aux migrants. C’est toute une intendance que les collectifs ont mise en place au cours des semaines précédentes, pour rendre possibles ces voyages en période automnale. Bien sûr il y a plus d’hommes que de femmes sur les routes, mais aux arrêts les « petites mains » féminines et masculines se rejoignent, pour sustenter les marcheurs et préparer salles de repas et dortoirs. Les femmes migrantes, sont venues, avec leurs enfants par voiture et par train, hébergées dans des habitats de fortune, pour participer au cortège parisien où leur existence, d’ordinaire effacée, emplissait l’espace public de mots, de chants, de musiques. Certain·es entrevoient la régularisation pour des raisons familiales, mariage, éducation des enfants, mais c’est par le travail que la plupart de ces jeunes, femmes et hommes espèrent être régularisé·es.
Le travail est un signe d’insertion dans l’économie et la culture françaises pour la Préfecture, et il est un signe d’intégration dans le monde des ouvriers pour les syndicats. Le travail et son antonyme la grève sont une arme qu’il est possible de retourner contre les employeurs, encore faut-il que le travailleur ne soit pas un fantôme, présent une semaine, disparu la semaine suivante, ce qui est souvent le cas du sans-papier. Dans les petites entreprises de restauration, de nettoyage, de sécurité, d’aide à domicile, agence d’intérim où les sans-papiers trouvent à se faire embaucher, la flexibilité, le provisoire sont la règle. Les entreprises d’État, ont des stratégies pour sous employer du personnel, le privant de tout droit. La poste, sa vitrine Chronopost, sous-traite le transport des cargaisons à des entreprises de manutention qui elles-mêmes s’adressent à des agences d’interim qui emploient de jour comme de nuit des sans-papiers sur un mode temporaire. En dehors de toutes dispositions légales, conventions salariales, ces sous-salariés ne peuvent ni en référer au droit du travail, ni se syndiquer, ni a fortiori être reçus au ministère du travail.
Si la convergence des marches venues de 60 villes a été un succès, le point final, l’Élysée, n’a pas eu lieu. C’était un signal fort qui avait motivé des marcheurs, le projet d’une entrevue à la hauteur des enjeux : déchirer le silence du Président, obtenir des régularisations en nombre, écorner la politique du gouvernement. Les dernières opérations massives de régularisations sont un souvenir lointain, remontant à Mitterrand et Jospin (130 000 puis 80 000). Hollande s’est contenté de régularisations au cas par cas, en s’appuyant sur la circulaire Valls qui a établi de nouveaux critères. Ensuite ce fut des vagues de régularisations gagnées par les grèves. Après le confinement, les marcheurs attendaient une entrevue, un geste. Rien. Les collectifs ont décidé de déposer des listes de marcheurs sans-papiers dans différents ministères, selon des modalités à propos desquelles un consensus est à trouver.
À la suite des manifestations de mai et de juin, d’octobre et décembre, de nouveaux collectifs de sans-papiers se sont créés dans diverses villes de France, comme à Montreuil où des dizaines de jeunes Maliens multiplient les initiatives. Des réseaux de communication et de traduction en arabe, bangladais, anglais, espagnol ont été créés via Facebook par des militants afin de relier des populations isolées par la langue et de les tenir informées des diverses actions entreprises. Des rendez-vous hebdomadaires, au niveau régional et national se maintiennent. La Marche des Solidarités constitue un front dont les capacités de souplesse et de résistance, de réceptivité et de rebonds résistent à la politique électoraliste et destructive du gouvernement vis-à-vis de l’immigration.
À suivre sur www.multitudes.net
Quelques aperçus de la politique de l’immigration :
régularisation, éloignement / bannissement, logement
Légende de l’image : 18 décembre, journée des migrants © Claude Calame