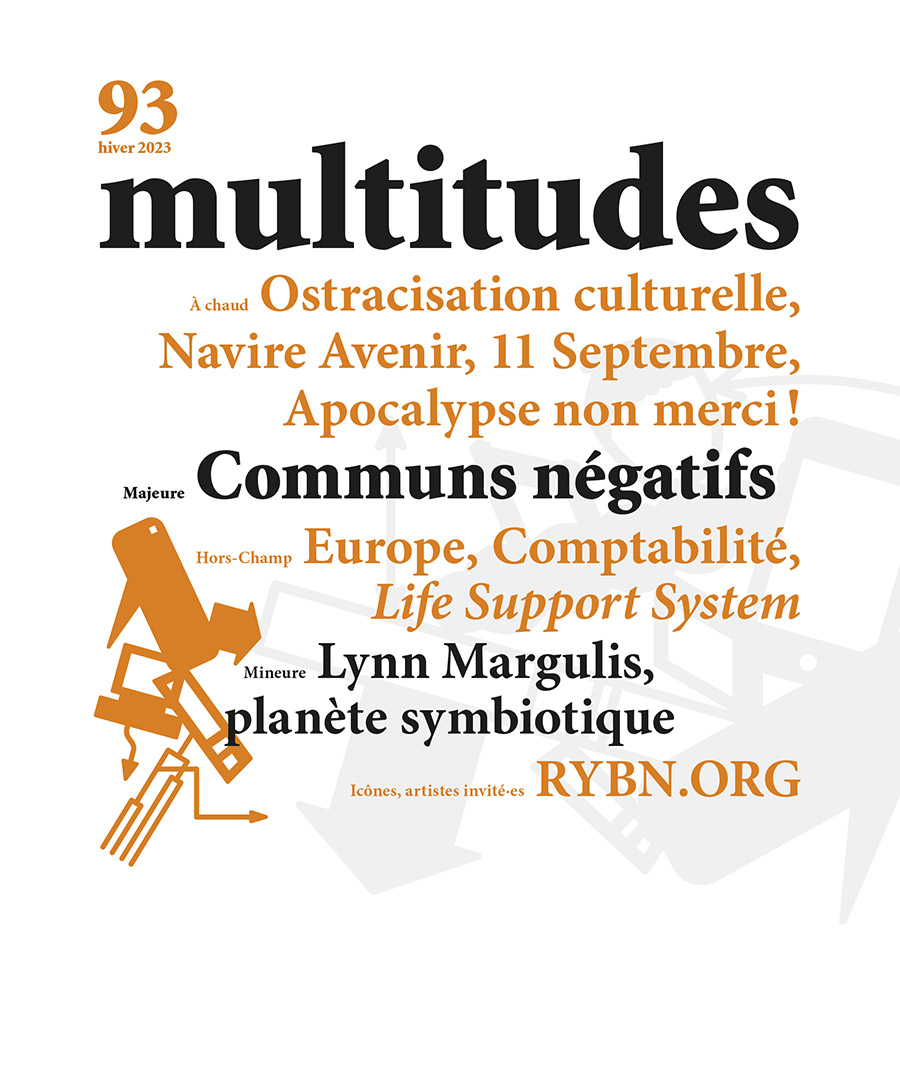La commune de Loos-en-Gohelle (7 000 habitants) dans le Bassin minier (Pas-de-Calais) est désormais connue pour avoir réussi à passer d’une ville « sinistrée », à la suite de la fermeture de ses mines, à une « ville pilote du développement durable », selon l’ADEME (2014). En 30 ans, cette commune a fait émerger un tout nouveau modèle territorial, a mis en récit son histoire et repensé l’implication des habitants dans les politiques publiques, en faisant le deuil de son passé, sans le nier, pour se transformer. Comment cette commune, en héritant d’un monde en « ruine », a-t-elle pu se relever et passer « du noir au vert » ?
La patrimonialisation a joué un rôle majeur dans le changement de trajectoire de la commune de Loos-en-Gohelle, dont les terrils sont aujourd’hui inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco. La patrimonialisation est ici pensée comme un processus par lequel une communauté ou un collectif reconnaît une valeur à un objet considéré comme « digne » d’être préservé, transmis et reconnu, de par sa force historique, mémorielle et symbolique. La patrimonialisation n’est pas appréhendée comme un processus de « mise sous cloche » ou de muséification d’un monument mais bien comme un processus vivant, protéiforme, qui a permis à un territoire endeuillé de renaître de ses cendres. Ce qui nous intéresse ici, selon Romain Demissy1, c’est tout le « processus de construction, de mobilisation et de développement de patrimoines collectifs », et le moment de « révélation » de ce patrimoine, qui a amené à la reconnaissance et à la réappropriation de ce bien commun (matériel et immatériel).
Si la patrimonialisation a été mobilisée pour réinvestir et se réapproprier son territoire malgré les traumatismes économiques et psychiques dus à la fermeture des mines, c’est notamment grâce au travail au long cours d’implication et de « capacitation » des habitants. La commune a pu se constituer en communauté, à même de reconnaître, gérer et animer les communs du territoire. La municipalité, elle aussi, a dû se transformer en interne pour porter et piloter ce changement de trajectoire, et assumer des arbitrages politiques forts. Cette alliance entre les habitants, le tissu associatif et la municipalité a rendu possible la patrimonialisation active d’un commun et a évité les écueils de la muséification ou du marketing territorial. Cette démarche peut-elle inspirer d’autres territoires à l’heure de l’Anthropocène ? Retour sur la trajectoire de Loos-en-Gohelle sous la plume d’acteurs de terrain.
De la fin brutale du monde industriel
à la mise en scène de son héritage
Sur ces vastes plaines de craie du Crétacé, la découverte du charbon dès 1720 va inaugurer une « épopée » minière qui durera 270 ans2 et transformera radicalement l’histoire, l’économie, la géologie, le paysage et les mentalités du « Bassin minier ». Toute la vie était alors articulée autour de la mine : le travail, le temps, le logement, et même la pratique musicale ou le jardinage, encadrés par les Houillères. « Pour qui connaît l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, l’emprise des houillères y compris sur l’individu était totale 3 ».
À l’arrêt des mines en 1986, le chômage atteint des taux records, les sols et les terres sont pollués, le sol est affaissé de 15 mètres, les mineurs malades meurent de la silicose. On assiste à la disparition non seulement du travail d’une grande majorité de la population mais surtout à l’effondrement des modes de vie, de la culture et de l’histoire même de ces habitants qui s’était constituée depuis des siècles. Toute l’identité collective d’une classe ouvrière était soudainement reléguée au passé et dévalorisée. Il fallait passer à autre chose, oublier les « gueules noires », les « verrues noires » (les terrils), tourner la page de ce lourd passé.
L’époque est au pessimisme mais certaines personnes pressentent qu’on ne peut pas se relever en faisant table-rase du passé. La commune doit se réinventer. « Mais à une condition première : qu’elle ne perde pas ses racines. Des racines pourtant perdues dans les méandres des galeries souterraines 4. » Ces personnes s’incarnent à travers la figure de Marcel Caron, futur maire de Loos entre 1977 et 2001, qui aura à affronter la récession, bercé par l’éducation populaire et le scoutisme, futur directeur d’une SCOP. Il décide dans sa jeunesse de faire un tour de France en stop et se rend compte que d’autres territoires ont des sites patrimoniaux préservés dont ils sont fiers. Alors que le Bassin minier n’est fait que des terrils, des fosses, des corons, des crassiers sinistrés, comment raviver un sentiment d’appartenance au territoire en prenant soin des attachements certes matériels mais aussi symboliques à ce qui paraît sale, noir et laid mais pourrait, à certaines conditions, éclater de beauté et raviver un sentiment de fierté ?
« Terril, monstre noir,
Résurgence de forêts englouties terre à feu et à sang,
terre du travail et de la peur aussi.
Terril, butte témoin et acteur
des luttes ouvrières.
Terril, monument au travail, devenu souvenir 5 »
Après un premier mandat de gestion de crise et de constat des dégâts économiques et sociaux qui s’accumulent, Marcel Caron, poussé dans ses retranchements par un groupe de littéraires locaux intéressés par l’idée d’écrire la première monographie de la ville6, a l’idée de célébrer ces liens d’attachements au territoire, célébrer l’histoire des mineurs plutôt que de la refouler. Cette idée folle, ce sont les Gohelliades, un grand festival culturel pensé à l’échelle de la Gohelle, qui mettrait en récits ces attachements, une sorte d’Olympiades culturelles qui pourrait révéler les multiples façons subjectives de vivre et apprécier son territoire. Avec les Gohelliades, « le but était de mettre en scène un héritage collectif […] et de présenter au grand public les multiples facettes d’une tradition et d’une culture dignes d’être aussi connues que celles d’autres régions françaises moins discrètes 7 ». Il s’agissait de réactiver la fierté d’être loossois, de refonder l’identité locale en s’appuyant sur les imaginaires des habitants. En témoigne le concours organisé à cette époque pour doter la commune d’un blason, où toutes les propositions avaient en commun la représentation d’une lampe de mineur, d’un épi de blé rappelant la mise en valeur des « Rietz », et du phénix, symbole de la renaissance d’une cité plusieurs fois détruite8, ou bien encore les spectacles culturels son et lumière écrits, mis en scène et joués par les habitants acteurs.
Cependant, aux débuts de cette démarche, certains publics s’offusquent qu’on puisse rire, jouer la comédie sur des lieux de labeur que sont les carreaux de fosses lors des Gohelliades. Pour ceux qui sont attachés à la mine, les mettre en scène c’est entériner le fait que c’est fini, et c’est douloureux. Même le rachat des terrils par la commune à cette époque est vécu par certains habitants et certains élus comme une trahison.
Néanmoins, Marcel Caron poursuit cette intuition culturelle. Une première édition des Gohelliades a lieu en 1984 sur le thème « Hommes et Richesses de la Gohelle – Terre et Industrie – Arts et traditions », l’année d’après, huit concours sont organisés autour de différents thèmes (peinture, photographie, poésie, cartes postales, cinéma, land art) et les terrils qui arborent le cœur et l’épi, symbole des Gohelliades. « Les ressources à mettre en valeur et que Marcel Caron et ses équipes vont s’employer à activer sont les ressorts de la culture populaire, de la mémoire minière des lieux, et de la construction d’événements festifs. L’idée est d’activer les potentiels de la population, en l’associant à la production et à la construction de cette offre culturelle, pensée souvent comme gratuite pour les personnes venant y participer (les coûts de production étant assumés par la mairie)9. »
Au fil des années, la fête s’est constituée comme « une mise en récit renouvelée du territoire, mais aussi d’un processus de patrimonialisation ascendant, populaire et enthousiaste10. » La commune a démultiplié les espaces festifs qui réactivent l’histoire passée, à l’image de la fête de la Sainte-Barbe patronne des mineurs, dont le jour était autrefois férié pour les mineurs. Tous les ans, le 4 décembre, les Grands Bureaux des Mines de Lens, le quartier Saint Amé de Liévin, les terrils de Loos-en-Gohelle ou encore le 9-9bis de Oignies, sont enflammés. Cette patrimonialisation « ascendante » a été pensée comme « une manière de créer du lien et des attachements sans que ceux-ci deviennent des fixations passéistes. […] La culture a permis à l’administration et aux habitant∙e∙s de se réapproprier leur passé sans romantisme ou nostalgie de l’épopée minière 11 ».
Loos-en-Gohelle aurait pu tomber dans une glorification passéiste de son patrimoine minier. Mais c’était sans compter sur la perspective politique que ce patrimoine retrouvé permettait de poursuivre.
Penser le devenir du Bassin minier :
assumer un patrimoine matériel et immatériel
et des arbitrages politiques
Ce processus de patrimonialisation ne s’est pas fait sans négociations ni conflits. Le portage politique local a été clé pour faire des terrils et du Bassin minier un « commun ». Dès 1988, sous l’impulsion notamment de Jean-François Caron, héritier de Marcel tant sur le plan familial que politique, la Chaîne des Terrils est créée avec cette idée que « les reliefs de l’exploitation charbonnière seront la base d’un développement nouveau ». Alors que les terrils sont encore pour beaucoup les « verrues du territoire », des associations, des amoureux du patrimoine industriel minier et des naturalistes vont se constituer en collectif de défense de la valeur de ces terrils, pour renverser le regard qu’on leur portait. S’ouvre alors tout un travail de négociation avec les Houillères et l’État sur l’avenir des terrils. Pour empêcher le rachat des mines par le secteur privé (Charbonnages de France), les élus locaux et régionaux vont négocier des années avec CdF et finir par racheter une centaine de terrils via la création d’un établissement public foncier. Sauver les terrils revenait ainsi à conserver des « marqueurs spatiaux de l’activité extractrice et prédatrice12 », et à reprendre la maîtrise de son patrimoine.
Dès lors, comment penser collectivement le devenir de ce patrimoine commun ? Alors qu’il est élu depuis 1992 au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Jean-François Caron se voit confier la mission d’animer la « Conférence Permanente du Bassin minier » en 1996. Près d’un millier d’habitants, techniciens, responsables associatifs, élus locaux, chefs d’entreprises ou universitaires vont participer à 40 ateliers autour de la mémoire, la culture, l’aménagement du territoire, l’économie, pour dessiner un diagnostic partagé et proposer différents scénarios, rassemblés dans un livre blanc13. Le Bassin minier incarne désormais un nouveau champ des possibles qui se traduit notamment par de nouveaux modèles économiques territorialisés fondés sur la valeur patrimoniale et culturelle : au pieds des terrils de Loos-en-Gohelle, l’ancienne fosse 11/19 se transforme en Base 11/19, incarnant le changement de trajectoire du charbon à la transition, avec l’installation du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (Chaine des Terrils), de Culture Commune (devenue Scène nationale), le Centre de Création et de Développement des Éco-Entreprises (Cd2e), ou encore le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD).
La création de Culture Commune en 1999 par 22 communes du Bassin minier va d’ailleurs contribuer à forger une mémoire vivante des mineurs, à donner un nouvel élan culturel au Bassin sans renier son passé, en organisant des spectacles de théâtre, danse, cirques, arts de la rue, ou des randonnées avec la Chaîne des Terrils. « Loin d’un processus de “muséification” statique de la mémoire de la mine et des mineurs, il s’agit bien ici de valoriser cette mémoire en l’inscrivant comme matière première d’une véritable dynamique de création artistique et culturelle contemporaine14 ».
Le processus de patrimonialisation arrive à son apogée avec l’inscription du Bassin minier patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre de « paysage culturel évolutif vivant ». Les terrils sont désormais réhaussés au même rang que les pyramides d’Égypte.
Cependant, ce processus de patrimonialisation n’est ni linéaire ni parfait. L’inscription au patrimoine mondial amène également son lot de lourdeurs, d’immuabilité. « La prise de conscience de la valeur patrimoniale de l’ensemble de l’héritage minier se heurte à sa place ambivalente pour les habitants du bassin minier entre attachement et rejet, volonté de se souvenir du travail des aînés et désintérêt pour des marqueurs quotidiens15 ». À mesure que les générations passent et que les anciens mineurs se font de plus en plus rares, la transmission de ces attachements peut s’étioler : les terrils restent, mais leur héritage commun continue-t-il autant de structurer un rapport au territoire en commun et de rassembler ses habitants ?
Vers une patrimonialisation active :
des habitants « acteurs » (au sens culturel) à une culture d’habitants acteurs dans le projet de ville
Pendant ce temps, à l’échelle loossoise, la municipalité va œuvrer dès les années 1990 à dépasser la trajectoire de patrimonialisation classique pour recréer le désir d’œuvrer en commun, en offrant des espaces aux habitants pour qu’ils puissent reprendre les rênes longtemps confisquées de leur territoire. La révision du Plan d’occupation des sols en 1995 a été un levier d’implication et d’éducation populaire, au travers de réunions de travail sur les besoins des habitants, leurs usages, leurs représentations. Dans les années 2000, un programme participatif d’amélioration et de préservation du cadre de vie a mené à l’adoption d’une Charte du cadre de vie, à la suite d’une démarche d’enquête, d’écoute sociale des quartiers et de diagnostic.
Sous l’impulsion de Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle dès 2001, la commune va travailler à créer les conditions d’un terreau fertile à l’implication pour que les citoyens ne soient plus spectateurs mais de véritables co-constructeurs de l’action locale pour reconstruire la communauté loossoise. « L’idée était de reconnaître à tous un droit d’initiative et donc de développer chez chacun une capacité d’initiative, d’autonomie et de coopération16 » dans l’idée de sortir d’une logique de « consommation de l’action publique ». Autonomiser pour réellement sortir d’un « système presque militaire », « d’encadrement de la population » et paternaliste17. Le dispositif de « fifty-fifty » (une idée, un appui technique et financier de la commune, et une convention) incarne cette logique de « donnant-donnant » et de partage des responsabilités, et reconnaît un « droit d’initiative » et la « co-responsabilité d’un bien commun qu’est la commune18 ». La commune n’a alors plus le monopole de l’intérêt général. Il fallait certes ouvrir des espaces d’implication, mais également pérenniser ce désir de définition collective de l’avenir du territoire sur le temps long, et créer les conditions d’un renouveau démocratique.
Un changement de posture pour les habitants donc, mais aussi en miroir des élus et des agents. Au fil de ce processus, les rôles se déplacent : les élus passent de « décideurs à animateurs d’un processus décisionnel », les agents « d’exécutants à des facilitateurs des processus participatifs19 ». C’est une capacitation collective : la municipalité se transforme à mesure qu’elle crée les conditions de l’évaluation continue de ses postures et de ses actions en s’appuyant sur des espaces réflexifs, lors des vœux du maire, comme à l’occasion des « Ch’ti TAIDX » (licence libre, open source, pour Territoires d’Apprentissage Démocratiques XXL). Ces petits théâtres d’expression libre offrent un espace à des habitants pour témoigner avec leurs mots de leur projet et de leur collaboration avec la municipalité, devant un public d’élus, agents et d’habitants. Ce « forum narratif 20 » permet de soulever les tensions, les ratés, les réussites mais aussi de comprendre les contraintes respectives de la municipalité et des habitants, ainsi que de reconnaître celles et ceux qui s’engagent. Ils constituent des temps de célébration et d’évaluation pour accueillir des récits contradictoires entre la mairie et les habitants. Ces espaces de mise au travail des conflits et d’apprentissages continus apparaissent comme indispensables pour éviter de tomber dans les écueils d’une patrimonialisation qui figerait la dynamique territoriale.
Loos-en-Gohelle, modèle pour penser
la trajectoire d’autres communs ?
Ainsi, les terrils et le passé qu’ils symbolisent incarnent un « commun » dont il a fallu apprendre à « vivre avec, désormais21 », sans volonté d’effacer la mémoire, mais en démultipliant les espaces d’implication, d’expression, et de mise en récits des traumatismes, comme de la fierté d’être héritier de cette histoire commune. A posteriori, sans que cela ait été formulé à l’époque, le processus de patrimonialisation a permis de soutenir un rebond nécessaire face à la fermeture de la mine. Sans l’instauration d’une culture d’habitants acteurs, sans la transformation interne de la collectivité – à même de repenser sa manière de faire des politiques publiques et son management – et sans son inscription dans une dynamique régionale, Loos-en-Gohelle n’aurait sans doute jamais été « démonstratrice de la conduite de changement » selon l’ADEME.
Sans toute cette démarche de plusieurs dizaines d’années de « capacitation », d’implication, de travail sur la mémoire et l’identité locale, Loos-en-Gohelle n’aurait sans doute pas non plus réélu son maire, Jean-François Caron, avec 82,1 % des voix en 2008 contre une liste divers droite – dans un département où le RN reste très présent. « Il y a des réponses autoritaires avec le Rassemblement National, comme à Hénin-Beaumont » (à 17 km de Loos-en-Gohelle) ; « et des réponses démocratiques avec la recherche d’une transition apaisée et l’implication des habitants dans la recherche des solutions. Les gens entrent habitants et en sortent citoyens 22. »
Comment dès lors anticiper et provoquer ce changement de trajectoire sur d’autres territoires qui n’ont pas subi un « choc » à même de pouvoir les forcer à se réinventer ? Ce processus de fermeture-réinvention peut fonctionner pour des territoires ayant eu un passé « traumatique » comme à Loos-en-Gohelle mais fonctionne-t-il pour gérer des infrastructures qualifiées de « maladaptation » par certains (comme les « méga-bassines » par exemple) ? Ce changement de trajectoire, qui a pris près de 30 ans et continue encore aujourd’hui, peut-il être répliqué en s’appuyant sur ces enseignements, à l’heure d’une accélération du nombre d’arbitrages, de fermetures à opérer démocratiquement et de communs à soigner collectivement ? Des questions que met au travail la Fabrique des transitions, en s’appuyant sur un travail de recherche-action23 visant à repérer les principes directeurs et invariants de territoires pionniers à même d’outiller d’autres territoires par le transfert d’expériences, de savoir-faire et savoir-être.
Ainsi, sans patrimonialisation active, pas de communs à partir desquels inventer un nouvel horizon participatif. Lorsque l’État s’attèle à fermer les centrales nucléaires comme Fessenheim, existe-t-il des espaces pour exprimer cet héritage, et faire la part aux conflits de représentations ? En quoi la collectivité se transforme-t-elle en interne pour en tirer aussi des enseignements ? Comment crée-t-elle des espaces démocratiques sur le temps long pour évaluer chemin faisant son action, comment donne-t-elle l’espace pour accueillir des représentations conflictuelles et ouvrir ses espaces de décision ? Le risque serait de retomber dans des décisions arbitraires et descendantes qui blesseraient ou enterraient les attachements sans chercher à les explorer.
Pour gérer ces communs, il faut donc s’atteler à créer des espaces de démocratie narrative24, de révélation des attachements et de délibération autour des arbitrages ; des espaces partagés entre élus, agents, habitants, acteurs socio-économiques pour piloter les politiques de « démantèlement » et les controverses qu’elles charrient.
1Trajectoires sectorielles longues et actions collectives territoriales : quelles capacités d’intervention pour les acteurs locaux ? Romain Demissy, Thèse de doctorat de l’Université Sorbonne Paris Cité – LADYSS (2018).
2Melin, Hélène. « Loos-en-Gohelle, du noir au vert », Multitudes, vol. 52, no 1, 2013, p. 59-67.
3Cabiddu Marcel, Les chances et les moyens du nouveau développement d’un ancien bassin minier, Rapport au Premier ministre, éd. La documentation française, coll. « rapports officiels », Paris, 2001, p. 20
4Gagnebet, Philippe. « Les fondations », Résilience écologique : Loos-en-Gohelle, ville « durable », sous la direction de Gagneb et Philippe. Ateliers Henry Dougier, 2015, p. 13-26.
5Collectif associatif, Terrils, Bruxelles, Éditions vie ouvrière, 1978.
6Association Gauheria, le passé de la Gohelle ; Léon-Noël Berthe, Marcel Caron, Loos-en-Gohelle à la recherche de son passé, Liévin : Impr. Artésienne, 1982, 266 pages.
7Extrait de l’éditorial du premier appel à candidature du Comité des Gohelliades, 1984.
8Site de la commune de Loos-en-Gohelle.
9Daniel Florentin, Marie Veys, Thomas Beaussier, Margaux Blache, Cécile Schwartz. Transition systémique et nouvelles écologies territoriales – À la recherche du modèle loossois. [Rapport de recherche] ISIGE – Mines Paris PSL ; WAW ; IASS. 2021, p. 124. hal-03749910
10Ibid.
11Ibid.
12Camille Mortelette, « La patrimonialisation de l’héritage minier dans le Nord-Pas-de-Calais : un outil efficace de réconciliation de la population locale avec son passé ? », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, 2020.
13Livre blanc Acte 1 : Conférence Permanente du Bassin minier (1998).
14Scol Jean. « “Culture Commune – scène nationale” : l’expérience de l’intercommunalité et du partenariat au service du développement culturel et patrimonial du territoire ». In « Hommes et Terres du Nord », 2001/4. Culture et territoires. p. 221-229.
15Camille Mortelette, « La patrimonialisation de l’héritage minier dans le Nord-Pas-de-Calais : un outil efficace de réconciliation de la population locale avec son passé ? », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère [Online], 7 | 2020.
16Le référentiel loossois de l’implication citoyenne (30 mars 2020).
17Ibid.
18Ibid.
19Ibid.
20Ibid.
21Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin, Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement, Paris, Divergences, 2021, p. 168.
22Jacques Duplessy, « Les élections municipales, un enjeu de modèle de développement local, Loos en Gohelle : pyramide noire et énergie verte », Reflets Info, 14 mars 2020.
23Patrice Vuidel, Julian Perdrigeat, Référentiel de l’atelier « Villes pairs, territoires pilotes de la transition », Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération, mars 2019.
24Pierre Rosanvallon, Le Parlement des invisibles, Éditions du Seuil, 2014.