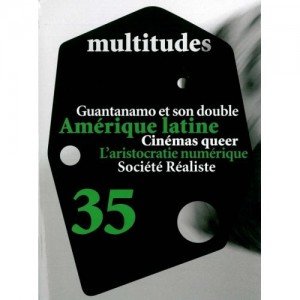1.
Quelques rappels historiques de base pour commencer. Depuis la fin de la dernière dictature militaire en Argentine (1983), deux grandes questions n’ont cessé de se poser à propos des dynamiques de la politisation.
D’un côté, l’approfondissement d’un modèle néolibéral : privatisation des entreprises publiques, ouverture aux importations, désindustrialisation, affaiblissement du monde syndical et augmentation exponentielle du chômage, faillite des économies provinciales, retour de l’économie vers le secteur primaire, hégémonie du monde financier, coupes budgétaires dans le secteur des retraites, de l’éducation et de la santé publique et crises successives du paiement de la dette extérieure auprès des organismes internationaux de crédit. Autant d’éléments qui ont fait des ministres de l’économie qui se sont succédé de bons élèves aux yeux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.
De l’autre, la lutte récente contre les politiques d’impunité que les gouvernements postérieurs à la dictature ont accordées aux cadres des Forces armées, à certains membres du clergé, à des fonctionnaires civils et à des hommes d’affaires (y compris au sein des grands médias) impliqués dans le génocide.
Comme on peut le voir clairement, ces deux lignes ont une origine commune, parce que c’est à partir la crise des années 1970 et du défi que constituaient les luttes populaires, que le capitalisme argentin a pensé sa restructuration.
Le système politique bipartite (Unión Cívica Radical et Partido Justicialista – péroniste) était chargé pour l’essentiel de réguler ces deux processus, en gérant un consensus institutionnel chaque fois plus éloigné du nouveau cycle de luttes, et ce cycle est devenu manifeste au cours de la seconde période de gouvernement de Menem. Entre 1996 et 1998 se sont produites les premières manifestations locales d’employés du service public qui ne percevaient plus leurs salaires ainsi que les premières puebladas( ) violentes dans les capitales de certaines provinces. C’est à cette époque également que sont apparus des mouvements de protestation dans les villes qui dépendaient de grandes entreprises, telles les Yacimientos Petrolíferos Fiscales, condamnées à disparaître avec la fermeture de leurs installations et celle du chemin de fer (privatisé lui aussi). Enfin, de nouveaux mouvements de chômeurs ont commencé à s’organiser. Ils participaient aux puebladas à l’intérieur du pays ainsi qu’aux alentours de Buenos Aires, généralisant la pratique des piquetes( ). Il faudrait ajouter les mouvements paysans à ce processus de re-politisation sociale. Ces derniers ne luttent pas seulement pour leurs terres et la promotion d’une production coopérative ; ils luttent aussi contre l’expansion des cultures de soja. Ils se font aussi les porte-parole des imaginaires de la lutte « indigéno-paysanne », en lien avec les grands mouvements du continent.
Ce renouveau activiste de la question sociale s’articule à l’innovation des luttes en faveur des droits de l’homme, qui tendent à englober chaque jour davantage les conflits entre une police qui a la « gâchette facile » et les jeunes des périphéries, l’invention des « escraches( ) » contre les cadres impunis de la répression et l’élaboration d’une mise en récit des luttes des décennies antérieures, en lien avec des dynamiques de politisation plus larges.
2.
La crise argentine de 2001 ne peut se comprendre à partir des seules variables macroéconomiques. La dynamique de la lutte sociale (qui a pris des formes multiples pendant la crise : les clubs de troc, la reprise des usines en faillite par leurs employés, etc.) a anticipé, préparé la crise, et elle est parvenue à la traverser en élargissant, chaque fois davantage, le répertoire de ses initiatives, jusqu’à inclure les classes moyennes urbaines (le phénomène des assemblées de quartier en 2001-2003) dont l’épargne avait été spoliée par le cercle restreint des banquiers du gouvernement de l’Alliance (1999-2001).
Les 19 et 20 décembre 2001, ces tous ces secteurs se sont retrouvés pour occuper la ville de Buenos Aires, organisant des cacerolazos( ) et des piquetes, mélangeant leurs revendications et donnant naissance à un slogan général dans les rues : « Que se vayan todos, que no quede ni uno sólo( ). »
La période qui a immédiatement suivi la chute de l’Alliance a été marquée par l’arrivée au gouvernement du péronisme : l’élection d’Eduardo Duhalde, grâce à un accord parlementaire et non par les urnes. Son gouvernement a tenté de stabiliser la crise en procédant à une dévaluation de la monnaie (fin de la parité entre le peso et le dollar, qui avait permis de stabiliser l’inflation dans les années 1990) et de multiplier les plans sociaux en faveur des sans-emploi. Pourtant, la répression des mouvements sociaux qui a abouti à l’assassinat de deux militants piqueteros, Dario Santillán et Maximiliano Kosteki, a contraint à la convocation d’élections anticipées. Elle a démontré une incapacité à stabiliser le conflit politique.
En 2003 se sont tenues par conséquent les premières élections nationales depuis la crise. Les deux partis politiques majoritaires se sont divisés. Trois candidats issus de l’Unión Cívica Radical sont entrés en compétition contre trois candidats péronistes. Parmi ces derniers, Carlos Menem a obtenu 30 % des suffrages et Nestor Kirchner, alors soutenu par le président Duhalde, 25 %. Convié au second tour, Carlos Menem a retiré sa candidature, et Kirchner s’est trouvé dans l’obligation d’assumer sa fonction en l’absence d’un véritable soutien électoral.
3.
Le gouvernement de Kirchner a profité d’une rapide reprise macroéconomique, fondée sur les prix internationaux des céréales (du soja, principalement, qui était déjà développé en semences directes et qui bénéficiait du « paquet technologique » associé à ce mode de culture) et sur une consommation interne reléguée au second plan. Ses efforts ont porté – avant tout sur le terrain symbolique du discours – sur la rénovation des conceptions de la relation entre le gouvernement et les mouvements sociaux, dans le cadre plus général d’une reprise en main de l’autorité par les institutions de l’État et d’une crise de légitimité des partis politiques et des discours néolibéraux. Ce mouvement s’est concrétisé par une reprise du lexique des luttes des années 1970 et, dans le domaine des droits de l’homme, par une abrogation des « lois d’impunité » qui a conduit à la réouverture des procès des cadres de la répression et à une reconnaissance large des organismes de défense de droits de l’homme. Le gouvernement a encouragé, à sa manière, une relation active avec un certain nombre de mouvements de sans-emploi, en s’abstenant de réprimer les mouvements qui étaient restés à distance ou dans l’opposition.
Mais ces innovations sur le terrain de la gouvernementalité sont demeurées partielles. Elles se sont développées en parallèle à un effort plus important de recomposition, sous son hégémonie, du vieux schéma syndical et politique du péronisme, qui constitue la base de son pouvoir territorial, parlementaire et électoral.
On ne saurait décrire complètement cette période sans mentionner la conquête, au niveau latino-américain, d’une autonomie géopolitique inédite et la rénovation du style de gouvernement des régions, déterminée par les résistances des mouvements sociaux à l’égard du consensus néolibéral. Dans ce contexte, le gouvernement a mené à bien une renégociation très médiatisée de la dette extérieure.
Qu’est-il arrivé depuis aux mouvements sociaux qui luttaient contre la gouvernementalité néolibérale des années 1990 ?
Ils se sont fragmentés, tout simplement – comme ils avaient toujours différé, d’ailleurs, quant à leurs perspectives de développement. Certains mouvements, d’un côté, avaient parié sur une insertion dans les espaces ouverts par le gouvernement. Ils ont renforcé leur présence dans l’espace public, leurs structures et leur insertion relative, et parfois précaire, dans le projet d’une nouvelle gouvernementalité encore naissante. Les secteurs appartenant au marxisme-léninisme classique ont continué d’appuyer des stratégies insurrectionnelles et ils ont peu à peu disparu de la scène. Quant aux secteurs qui avaient choisi la voie d’une autonomie sociale et politique, ils ont dû résoudre, avec plus ou moins de succès, les obstacles inhérents à une période de forte rétraction de la mobilisation sociale, concomitante à la récupération des réseaux sociaux appuyés par l’État.
4.
Cristina Fernández de Kirchner a accédé à la présidence en décembre 2007, l’emportant au premier tour avec près de 50 % des voix. Peu avant, à Buenos Aires, le candidat de la droite néolibérale avait gagné les élections avec près de 60 % des voix au second tour, contre le candidat du gouvernement.
Les propositions du nouveau gouvernement reposent sur l’idée (floue) d’un nouveau pacte social et politique, en prévision du bicentenaire de l’État national (2010). Le pacte vise à institutionnaliser la gouvernementalité entre les acteurs sociaux et économiques, sur la base d’une orientation néo-développementaliste, d’une intégration continentale et d’une restitution de la souveraineté de l’État, d’une économie industrielle exportatrice, d’une lutte contre la pauvreté et d’un prolongement des avancées en matière de droits de l’homme – permettant au passage de reléguer les mouvements sociaux au second plan.
Le 11 mars de cette année, le nouveau ministre de l’économie annonçait des modifications du régime des rétentions à l’exportation de céréales qui rendaient les taxes flexibles et augmentaient les quotas. L’opposition radicale à cette mesure soutenue par les quatre organisations patronales agraires (depuis la Sociedad Rural, traditionnelle et oligarchique, jusqu’à l’organisation qui, historiquement, représente les petits producteurs, la Federación Agraria) a donné lieu à une vaste mobilisation sociale. Le conflit a duré quatre mois et trouvé une issue au Parlement (le décret du pouvoir exécutif a été débattu par le pouvoir législatif). Il s’est soldé par la défaite, au Sénat, du gouvernement.
Pour autant qu’on puisse en juger avec un certain recul, tant par son ampleur que par ses implications et ses effets, ce conflit, n’aura pas été un simple conflit de plus. Il apparaît nécessaire de rappeler brièvement certains de ses aspects. La rationalité de fond de la politique des rétentions à l’exportation est partagée par tous les secteurs : la croissance de l’économie argentine repose dans une large mesure sur les énormes revenus agraires issus principalement du semis direct du soja. L’argument principal du gouvernement pour modifier le régime des rétentions a consisté à considérer que la hausse internationale des prix de la production exportée par des campagnes argentines très technologisées exigeait une régulation, si l’on voulait maintenir des prix raisonnables sur le marché intérieur de l’alimentation.
Les objections principales des secteurs de l’exportation opposés à la mesure étaient : (a) qu’il fallait différencier les rétentions pour les petits, moyens et grands producteurs ; (b) qu’il fallait mettre en œuvre une politique agricole intégrale ; (c) que le gouvernement cherchait à obtenir des revenus pour renforcer une légitimité fondée sur l’augmentation des dépenses publiques et les subsides accordés à d’autres secteurs du capital.
Au cours du conflit, les organisations agraires qui représentaient les petits, moyens et grands producteurs de soja se sont opposés à l’augmentation des taxes de rétention en empruntant des formes de lutte expérimentées dans une phase antérieure, avant l’année 2003 : assemblées, barrages routiers et piquetes, usage des cacerolas dans les villes, escraches visant des juristes du gouvernement et rhétorique de l’auto-organisation contre l’État. Le gouvernement, ses partisans et divers intellectuels qui se sont regroupés pour élaborer une argumentation ont construit une défense reposant, fonsamentalement, sur trois lignes discursives : les rétentions sont redistributives et visent à combattre la concentration des revenus ; la lutte contre les rétentions est putschiste ; l’urgence est de faire face à une nouvelle droite formée par les médias et les producteurs de soja, qui sont en train de reprendre à leur compte les imaginaires et le langage des luttes populaires des décennies précédentes.
La dynamique du conflit a produit une polarisation des imaginaires, ces derniers tendant à s’éloigner chaque jour de ce qui avait constitué l’objet premier du débat. Mais la dynamique a permis aussi d’agréger des revendications et de produire des alignements affectifs. Les opposants aux (timides) innovations du gouvernement se sont rangés du côté des organisations rurales, comme l’ont fait également d’autres acteurs, engagés dans des conflits spécifiques, qui trouvaient intérêt à affaiblir le gouvernement. Pour défendre le gouvernement, nous l’avons dit, une partie des intellectuels s’était mobilisée aux côtés de l’appareil d’État, d’une fraction du péronisme (qui s’est divisée pendant le conflit), des organismes de défense des droits de l’homme et des mouvements sociaux qui s’étaient rangés derrière le gouvernement et les syndicats.
La discussion parlementaire qui s’est traduite par la défaite du gouvernement a ravivé le jeu de partis politiques déjà très fragmentés – depuis la fracture du péronisme en particulier. Tandis que ce jeu partisan discréditait les drapeaux agités par le gouvernement (la régulation étatique et la redistribution sociale, en particulier), il a laissé l’initiative politique au bloc néolibéral « pur », le laissant seul en position d’organiser une formule efficace dans la perspective des élections législatives de 2009 et de la présidentielle de 2011.
5.
Quoi qu’il en soit, le trait le plus surprenant du conflit récent réside, à notre avis, dans un certain déphasage – difficile à penser – entre l’agitation des passions et des raisons qui a accompagné la lutte d’intérêts et de sensibilités et une sensation d’inconsistance politique( ), la sensation de ne pas parvenir à trouver une adéquation avec la dynamique de convulsion sociale.
Cette sensation nous amène à nous interroger sur le « retour du politique » que nous annoncent une série d’analyses et de prises de position relatives à la dynamique de ces derniers mois. C’est pourquoi nous ne prenons pas pour point de départ les intentions personnelles de chacun des acteurs visibles au cours du drame. Nous cherchons plutôt à comprendre l’efficacité des alliances politiques et sociales en jeu, car ce sont elles qui nous signalent les progrès ou les reculs dans la constitution de nouvelles luttes collectives.
Dans cette perspective, nous percevons une impasse( ), si l’on considère l’enlisement des deux dynamiques les plus novatrices, celles qui ont conduit à la crise de légitimité du néolibéralisme dur. Nous nous référons, d’une part, aux expériences collectives nouvelles qui ont surgi autour des mouvements sociaux (de la fin des années 1990 à la crise de 2001) et, d’autre part, à la tentative du gouvernement national d’interpréter certains des noyaux établis par ces mouvements (à partir de 2003).
Nous nous trouvons dès lors confrontés à un affaiblissement de la variété complexe des questions sociales formulées par les luttes, en ce qui concerne tant leur irruption que leurs replis et persistances : les questions qui touchent au travail salarié, à l’autogestion, à la reprise d’usines et d’entreprises, à la représentation politique, aux formes de délibération et de décision, aux modes de vie urbains, à la communication, à la souveraineté alimentaire et à la lutte contre l’impunité et la répression. Parallèlement, nous sommes confrontés à une crise parce que le gouvernement a reconnu l’importance de ces questions – même s’il l’a fait en termes de réparation, c’est-à-dire en suivant une logique de demandes à compenser –, et parce que, dans le même temps, l’on retrouve à peu de chose près les mêmes acteurs et les mêmes dynamiques d’introduction et de diffusion du néolibéralisme.
L’effet le plus visible de cette impasse est que la participation de la rue, le recours à l’assemblée et à la remise en question de la médiation politique ne viennent plus aujourd’hui de ceux qui luttent pour créer des modes de réappropriation des biens communs mais de ceux qui défendent (par action ou par omission) la capture privée des revenus globaux. Et, dans cette conjoncture, ils interviennent directement dans la définition d’une nouvelle gouvernementalité, envisagée moins comme une lutte pour l’appareil d’État que comme le gouvernement des processus concrets (que ce soit à travers le contrôle des circuits économiques ou de la gestion des subjectivités).
Dans le fond, ce qui est en jeu, c’est la manière même de poser la question de la démocratie au-delà des termes économicistes (qui font de l’augmentation de la consommation le seul indicateur de son contenu), au-delà aussi de la réduction institutionnaliste. Toutes ces variantes, y compris au sein du paradigme libéral, excluent la perspective d’une réappropriation sociale du commun issue de l’agenda des mouvements au niveau régional.
Nous constatons ainsi le paradoxe d’un « retour du politique » articulé à une dépolitisation du social : au moment même où l’on évoque les référents éthiques des luttes transformatrices, en tant qu’elles font partie d’un mouvement plus large de légitimation étatique, on dévalue les diagnostics que ces expériences peuvent offrir comme perspectives de compréhension de la « situation actuelle ».
Pour ce qui nous concerne directement, nous constatons l’enlisement de la dynamique constructive d’espaces autonomes d’énonciation capables de déstabiliser et de critiquer le néolibéralisme. Mais cette constatation ne prend pas le sens d’une attente, nostalgique, d’un « retour » au premier plan de ces mouvements. Elle cherche plutôt à réaffirmer les points d’ouverture et de conflit toujours présents sur la scène politique en prenant pour point de départ les pratiques qui gardent un objectif de réappropriation des biens collectifs.
6.
Au cours des dernières semaines, nous avons vu apparaître sur la scène publique la question de la souveraineté alimentaire, telle que les mouvements paysans et indigènes la formulent depuis des années. Cela témoigne de l’existence d’une accumulation de savoirs et d’expériences, d’une virtualité qui peut être convoquée et dont on peut tirer des enseignements. Mais on nous avertit dans le même temps de la difficulté à traduire ces initiatives dans des politiques concrètes.
Le fait que cette proposition n’ait pas été clairement définie ni déployée dans le débat public donne une indication de la faiblesse actuelle des sujets qui l’ont impulsée et autorise son utilisation rhétorique dans des contextes très divers. Mais cela traduit peut-être aussi un autre symptôme : cette question ne peut rester cantonnée à une perspective « sectorielle ».
La souveraineté alimentaire remet en question le lien de subordination entre les biens communs et la dynamique du marché mondial. Le principal défi de cette nouvelle souveraineté – avec toutes les ambiguïtés que le terme comporte – est de politiser la question de la faim et de la consommation pour contrer la manipulation des populations par les institutions et les entreprises. Il ne s’agit pas de définir à qui il revient de donner à manger aux pauvres. Ni de choisir les meilleures stratégies pour capturer une partie du marché mondial de l’alimentation. Le clientélisme et le marketing sont le langage qu’emploient les biopouvoirs pour gérer le social. Il suffit de constater que les cantines populaires et les allocations chômage ont cessé d’être des outils de reconstruction communautaires pour devenir des instruments de normalisation. Ou de constater qu’aujourd’hui, dans la ville, les hypermarchés et les centres commerciaux sont devenus l’espace public par excellence.
La souveraineté alimentaire n’est pas simplement une proposition des « paysans ». C’est un nouvel énoncé qui a surgi au cours des processus de lutte contre le néolibéralisme et qui a besoin des habitants de la ville pour devenir concret et se développer.
Par ailleurs, l’onde expansive que constituent certaines réalités indigènes est en jeu elle aussi, dans la mesure où elle a réussi à « actualiser » la force de leurs traditions. L’exemple le plus célèbre est celui de la Bolivie, où la souveraineté alimentaire est mentionnée dans l’un des premiers articles de la nouvelle Constitution et où (plus important encore) une véritable machine sociale communautaire a pénétré les villes grâce aux migrations et à leurs circuits complexes de production et de commercialisation.
7.
Le contexte sud-américain actuel demande que l’on évalue sans ambiguïtés une série de faits nouveaux. On ne saurait rester indifférent lorsque les élites traditionnelles commencent à menacer les processus de démocratisation sociale. La Bolivie mérite à nouveau d’être citée, parce qu’elle est à ce sujet paradigmatique.
C’est aujourd’hui un lieu commun, déjà, de souligner que l’Amérique du Sud constitue une sorte d’exception dans le contexte globalement réactionnaire que connaissent les autres continents. Mais on a tendance à attribuer cette singularité aux gouvernements plutôt qu’au processus – beaucoup plus riches, intéressants et prometteurs – ouverts par les nouveaux sujets sociaux. Pour cette raison, les gouvernements de la région doivent éviter de se refermer sur eux-mêmes et d’oublier les réseaux communautaires à qui ils doivent leur légitimité. Mais ces réseaux sont aussi la principale ressource d’une recomposition du social et la source de nouveaux possibles.
Le fait de lire le conflit actuel en Argentine à partir de ces données nous permet de comprendre pourquoi les rétentions aux exportations n’aboutissent pas nécessairement à une distribution de la richesse. Il ne s’agit pas de croire à la volonté du gouvernement, pas plus d’ailleurs que de ne pas croire à ses bonnes intentions, mais de préciser que seuls la réappropriation sociale de la décision et le contrôle sur ce qui est produit peuvent donner lieu à une remise en question du mode d’accumulation néolibéral. Sans cette reconnaissance, la « souveraineté alimentaire » évoquée plus haut, née des luttes paysannes, ne cessera pas d’être une mise en scène théâtrale, frustrante et instrumentale.
Un problème trouve les solutions qu’il mérite selon la façon dont il a été posé. La vision caricaturale d’un « retour de l’État » comme synonyme d’un retour de la politique transformatrice est porteuse d’un déni de l’expérience des mouvements et montre ses insuffisances, à l’heure où il s’agit de comprendre les phénomènes actuels de dégradation du social, et d’y faire face.
La vérité de ce « retour » de l’État est évidente : un geste qui se présente comme une volonté redistributive ouvre un conflit qui remet en question l’autorité étatique elle-même. Une analyse approfondie de la situation politique actuelle nous permet de restituer les termes de la conflictualité entre, d’une part, les appareils de capture et de médiation de la valeur sociale (particulièrement visibles dans les moyens de communication, sur lesquels le gouvernement a parié aveuglément toutes ces années) et, d’autre part, les réseaux qui – dans leurs tentatives de recomposition du social – constituent une source virtuelle de pratiques alternatives d’élaboration de sens et d’instances d’organisation.
Jusqu’à présent, l’équipe au gouvernement a su lire les signes d’une société blessée par plusieurs décennies de néolibéralisme, de terreur et d’impunité. Et elle a agi dans le sens d’une réparation symbolique et, jusqu’à un certain point, économique. Cette réparation a été rendue doublement effective. Elle a mis en place une narration « réparatrice », succédant à une histoire de mort et d’hypocrisie. Mais elle s’est traduite aussi par le « licenciement » d’une capacité d’agir sociale instituée au cours des cycles de lutte successifs, parce que l’on prétend désormais « gouverner » en son nom. En réaction aux évènements de 2001, les analyses qui nient la capacité matérielle de réinvention sociale sont un facteur de faiblesse plus qu’un geste de force politique, parce qu’elles omettent une puissance décisive – une virtualité réelle, micropolitique, adjacente à toute la réalité quotidienne –, qui ne peut pas être pleinement conçue sans un dépassement de la phase « réparatrice ».
8.
Les questions que la société a formulées elle-même au début de la décennie conservent leur actualité et appellent à un retour réel et effectif du politique, que l’on ne perçoit pas actuellement en dehors de la scène médiatique.
La scène, le langage et les modes d’expression impliqués dans ce drame ont autant sinon plus de signification que les mots qui sont effectivement prononcés. C’est pourquoi il est vital de souligner la commodité politique qui suppose d’accepter le monopole médiatique de la production des énoncés en se contentant de remettre en question leur contenus idéologiques. La démocratisation sociale ne peut s’en tenir à la seule dimension de la consommation. Elle ne peut se construire non plus par des gestes et des interventions totalement homogènes à la rationalité du spectacle.
La médiatisation est la cause et le support d’un « retour du politique » qui a pour effet paradoxal une dépolitisation, parce qu’il centralise l’attention sociale et diffuse des « possibles » préfabriqués. Il ne s’agit pas seulement de la prépondérance des moyens de communication de masse les plus concentrés mais aussi de la dévaluation des lieux de production, des pratiques et des pensées qui exigeaient la création de collectifs d’énonciation du discours politique.
La limite la plus évidente que nous constatons dans le panorama actuel est précisément l’inexistence d’un terreau propice à une mobilisation et une pensée qui ne soient ni celui que proposent les groupes encadrés par la politique gouvernementale, ni celui que formulent les réseaux d’une nouvelle droite prétendument post-idéologique.
9.
Il n’y a pas de place pour la nostalgie. Notre image de la recomposition du social ne peut restée « figée » sur les formes qui sont devenues visibles en décembre 2001. De la même manière, les discours et les styles des mouvements révolutionnaires des années 1970 doivent cesser d’inhiber les nouvelles façons de comprendre le politique. Ces deux séquences de l’histoire récente sont un réservoir d’images et de ressources collectives pour les luttes à venir. C’est l’inverse exact qui se produit lorsque le passé cesse d’être un point de départ pour devenir un horizon insurmontable.
Comment, dès lors, traverser un moment d’impasse sans recourir aux polarisations fausses (et faciles) et aux images nostalgiques ? Comment discerner dans cet état de suspension la disposition silencieuse de la pensée et les luttes comme un signe de politicité ?
Le mouvement de réappropriation du commun existe dans les pratiques collectives d’énonciation capables de reprendre, sous un jour nouveau, les questions relatives au travail (et à l’exploitation sociale : précarisation et condition salariale), à la gestion urbaine (ghettoïsation et privatisation) et à la représentation politique (sur la base d’une gestion des peurs et des angoisses productrices de nouvelles hiérarchies). Ces questions se tissent aujourd’hui dans la coexistence problématique d’une rhétorique pro-étatique et d’une normativité néolibérale persistantes, capable de régler les processus productifs (monde du travail, usufruit des ressources naturelles, privatisation des espaces publics).
C’est au revers de cette trame que se constitue le territoire conflictuel de l’élaboration (effective et potentielle) de nouveaux sujets politiques.
Sur la base des imaginaires qui surgissent de la crise des institutions et de la représentation politique (véritable trace présente de 2001), la réouverture d’une conflictualité politique ayant pour trame la matérialité de nouveaux sujets sociaux est possible. Elle ne doit donc pas se limiter à la défense ou à la demande de repositionnement des vieilles institutions.
10.
Une nouvelle série de questions en découle, qu’il s’agit d’ouvrir et de développer. Nous énonçons ainsi cinq hypothèses sur lesquelles pourraient reposer ce nouveau terrain d’investigation.
– Si l’appropriation de la valeur (l’exploitation des ressources naturelles et du travail) s’organise à partir de l’appropriation d’une rente globale (technologique, foncière, bancaire, immobilière), il faut comprendre la sphère proprement financière non seulement comme un espace économique au sens strict mais aussi comme un niveau supplémentaire où s’organise la gouvernementalité directement politique.
– C’est dans cet espace abstrait et complexe que se combine à nouveau la valeur produite par un large éventail d’activités et de bassins de coopération sociale. Quand les salaires, comme les prix des aliments, découlent de la complexité des dispositifs purement financiers, la crise alimentaire – encouragée par le modèle de la culture du soja – ne peut pas rester cantonnée au jeu de la distribution de la terre entre les différents acteurs de la « campagne » : elle concerne directement la métropole, dans la diversité de ses sujets.
– L’ouverture d’un nouveau cycle de politisation ne dépend donc pas tant de la cartographie des conflits antérieurs – tels ceux de l’année 2001 –, si l’on veut inscrire des continuités avec la situation présente, que d’une nouvelle subjectivité politique qui paraît prévisible à partir de la perception d’un essoufflement de certaines relations de pouvoir propres à la phase de stabilisation néolibérale. Chacune de ces crises ou de ces « désaccouplements » pousse le capital à organiser de nouvelles formes de « gouvernement », mais elle pose également un défi : l’imagination d’un nouvel espace de subjectivation.
– C’est pourquoi il est nécessaire, chaque fois qu’une crise se produit, de cartographier la brèche qui s’ouvre et les subjectivités qui émergent, pour anticiper d’hypothétiques formes de politisation. Un défi en découle : renouveler les initiatives de « militantisme d’investigation » qui correspondent à la nouvelle phase.
– Enfin : constater le besoin de déterminer de nouveaux territoires. Et articuler ces territoires avec les processus immatériels qui leur ont donné naissance et qui parcourent et forgent des situations de lutte et d’invention. Il faut les comprendre à partir de la complexité abstraite dans laquelle le capital se réorganise mais aussi à partir du niveau d’un espace-temps de l’acte dans lequel s’expérimentent des régulations et des imaginaires qui déjouent la reterritorialisation étatique et l’impuissance vis-à-vis des nouvelles ressources de la gouvernementalité capitaliste.
Ainsi, de même que la politique dépend de l’état de santé d’une large mobilisation sociale autonome, il faut parvenir à mobiliser des idées. Mais la pensée politique ne s’épuise pas dans la réfutation de l’image d’une « distance critique » (conception traditionnelle du savoir). Sur ce terrain, le défi le plus immédiat consiste à désinhiber la perspective critique capable d’expliquer la crise des relations de pouvoir promues par le néolibéralisme (État et marché), en étant attentifs au potentiel subjectif des nouvelles résistances.
Traduit de l’espagnol par Anne Vereecken