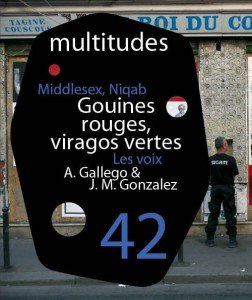« Du passé, faisons table rase »
L’internationale (chanson connue).
« Ah, redis-le, redis-le moi
Que je suis ta première fois ! »
Barbara (chanson moins connue).
Au commencement était la Femme
Donc, nous avons posé le mot « femme » comme un a priori, après tout c’était notre tour, on nous l’avait bien faite à nous, la blague, quand on était enfant et qu’on n’était pas encore devenues femmes. On nous disait qu’avant toute chose, nous étions, selon les dictionnaires, femelles de l‘espèce humaine. Dans un premier temps, ça rassure. Même si femelles, bon, ça rabaisse un peu du côté du biologique, de la matière et de l’espèce de sous-espèce que nous formions, de fait, en tant que groupe répertorié « femme ». Il fut précisé que nous étions, du sexe qui fait les enfants. Parce que bien sûr, la version mâle de l’espèce humaine ne fait pas d’enfants, elle en sème à tous vents comme elle sème sa semence (qui n’est pas commune mais précieuse, même si plus répandue sur la terre que le pétrole de la BP sur les rivages de Floride).
Quand la libération des femmes a été à l’ordre du jour, en 1970, année surnommée par quelques-unes l’année Zéro, nous sortions de ce guêpier qu’avait été le « devenir femme ». Nous avions perdu quelques plumes quand nous avions dû nous arracher à la cage (plus ou moins dorée et confortable), de LA femme. La Femme, entité censée nous mettre à l’abri de la sauvagerie de la condition humaine, et des hommes en particulier, s’était révélée à nos yeux pour ce qu’elle était : une forteresse où l’on enfermait les petites filles pour qu’elles soient sages, avant de les lancer toutes crues, toutes nues, dans l’enclos de la foire.
Des tas de filles venues d’on ne sait où (et même si on le sait un jour, qu’importe ?) se sont liguées, liées, déliées ensemble pour se débarrasser du modèle d’armure encombrant et stérile qu’elles auraient dû revêtir avant d’oser arpenter les rues de la cité. Hostile, la cité ? Elle allait voir ce qu’elle allait voir. Telles les sociétés communistes plus tard, on en a déboulonné, des statues. Abattu, des murs. Retracé, des chemins. Rebâti, des ruines. Réinventé, des vies. Chacune son chantier, à mener seule ou avec quelques copines. Et pour tous territoires, quelques rares lieux collectifs qui fonctionnaient clopin-clopant avec peu de moyens et un capital d’imagination dégradable à l’usage. Ainsi passèrent les années 80, et les années 90, et l’an 2000 qui fut suivi de 2001 partagé en deux entre l’avant et l’après 11 septembre, et même 2002 qui survécut à tout ce chaos.
Sous le tapis, la poussière
En 2008, la fièvre des commémorations gagna notre génération, qui s’épancha sur les glorieux jours de Mai 68 pour en tirer quelques conclusions et surtout, faire barrage aux mensonges éhontés qu’on entendait de-ci de-là à leur propos. On sut enfin ce qu’avaient fait les étudiants, ouvriers, paysans, ministres, préfets, chefs petits ou moyens, et divers anonymes qui l’étaient restés longtemps, pour permettre au pays de secouer le joug du passé et regarder résolument vers l’avenir. Toutes les questions étaient là, posées sur le tapis : la liberté, la permissivité, la libération (sexuelle), la libéralisation des mœurs, l’éducation des enfants, la raréfaction du travail, l’allongement de la vie, les mots d’ordre et leurs maux. Un grand souk où chacun cherchait à faire le tri entre ce qu’il fallait garder de l’esprit de Mai 68 et ce qu’on pouvait allégrement jeter.
D’autres questions se bousculaient pour faire débat comme autrefois, on se bousculait pour entendre les orateurs dans les amphis. Mais curieusement, dans ce concert polyphonique, peu de voix de femmes. Et encore moins de celles qui avaient voulu que les femmes restent visibles dans le paysage.
On se demanda pourquoi. On se dit que parce que… ils n’avaient pas compris. On pensa qu’ils avaient caché la question des femmes comme de la poussière sous le tapis quand les invités sont à la porte et qu’on n’a pas le temps d’aller chercher la pelle ni l’aspirateur. Poussière d’êtres, nous étions. Questions à résoudre, comme des énigmes. Ou comme des questions de cours pour apprentis administrateurs. Classées, étiquetées, rangées dans des cases à sujets délicats : mères naturelles ou adoptives, mères porteuses, assistées de la procréation, accouchées sous X, parent(e)s d’élèv(e)s –e facultatif. Liste que nous avions, bien malgré nous, amorcée en évoquant les femmes avortées, battues, vendues, violées… sauf que nous, nous ajoutions : ensemble, révoltons-nous.
Comme disent les femmes Africaines : seule la lutte libère.
Parcellisées, atomisées, toujours collées à quelque chose quand il s’agit du champ social : un statut (femelle ou victime), un homme (père, compagnon, conjoint, mari, souteneur, tuteur), des enfants dans la relation la plus édulcorée, i.e socialisée (surveillée).
Et pourtant, si nous regardions du côté des femmes, on voyait bien que sans elles rien n’aurait bougé. Que ce sont elles qui, au cours de ces quarante dernières années, ont posé la plupart des conditions à partir desquelles nos démocraties pourraient commencer à en être vraiment, des démocraties. Dénonçant l’esclavage familial, l’esclavage sexuel, les abus contre les personnes, les relais du pouvoir mâle dans l’ordre social… Une action invisible, inavouable. Comme un puzzle auquel il manque toujours une pièce. Comme un continent imaginaire, qui n’a jamais existé que dans les rêves les plus fous.
Pour être belle, il faut souffrir
Deux images. Postées le même jour de ce mois de juin 2010. Arrivées sur mon bureau en même temps. Pour annoncer la sortie de deux films qui n’ont sans doute pas grand-chose à voir l’un avec l’autre sinon qu’ils utilisent, pour leur publicité, deux images féminines.
La première est une jeune fille dessinée au trait noir sur fond blanc. Transparente, assise sur une sorte de boîte ou de cageot, un accordéon sur les genoux, dont elle joue probablement, mais on ne l’entend pas, c’est un dessin. De son corps, on ne voit pas grand-chose. Les pieds sont chaussés d’un truc informe genre sabots (deux ronds). Les mains, quelques doigts (même pas dix), sont disposées de part et d’autre du soufflet de l’instrument. Une sorte de cou tout maigre émerge d’un socle qui pourrait être un col roulé. Une bouille toute ronde où les yeux sont deux points (noirs), le nez un trait, mais qui n’a pas de bouche, est surmonté d’un gribouillis de cheveux raides d’où s’échappent deux nattes perpendiculaire au visage. C’est une personne singulière dont l’histoire singulière se déroule sous nos yeux : elle joue de l’accordéon pour récolter un peu d’argent dans l’assiette posée devant elle. Si on pense à quelque autre représentation féminine, c’est à la jeune aveugle des « Lumières de la ville » (Limelight) dont Charlot tombe amoureux. Cette première image apparaît détourée de blanc sur fond bleu, en dessous des lettres « Chantrapas » (chantera, chantera pas ?). Il s’agit de l’affiche du film qu’Otar Iosselani a présenté à Cannes cette année en sélection officielle.
La seconde image est sur fond blanc, mais pastissé de lettres roses : nous sommes du côté du féminin (plutôt que chez les femmes). C’est une pin-up torse nu, aux seins agressifs ou fiers, selon le point de vue, dont une aréole porte un sparadrap transparent (morsure, vestige d’un numéro de strip-tease ?). Ce pourrait être une Marianne, car elle n’a pas de bras, mais revisitée par la révolution car elle porte le couvre-chef du Che, d’où s’échappe un flot de cheveux savamment décoiffés. Le menton est dressé, le regard porte loin au-delà de qui le regarde (un peu sur sa gauche), les narines sont ébauchées et les lèvres, pulpeuses. Détail qui tue, l’étoile du béret du révolutionnaire cubain a été remplacé par… le symbole biologique féminin. C’est l’affiche du film « Dirty Diaries », qui promet : douze réalisatrices. Douze propositions POUR REPENSER LA PORNOGRAPHIE.
Entre la « Che » bien en chair qui arbore fièrement ses atouts et la petite fille à l’accordéon, figurine de fil de fer fragile et désuète, la représentation de la condition féminine fait le grand écart. C’est celui que toute personne qui devient femme aujourd’hui va devoir faire pour adhérer mentalement, à l’image sociale, à l’icône qui la représente dans nos sociétés où le pouvoir est encore amplement préempté par les hommes.
Souffrir n’est pas jouir
Les femmes ? Libérées, peut-être. Mais prisonnières, toujours. Comme si un décret ayant été pris là-haut, dans les sphères du pouvoir mâle, personne n’avait songé au lever d’écrou. Comme si des lois alignées depuis tant d’années (quarante, quand même) pour desserrer le nœud coulant de la condition féminine n’avaient eu pour effet essentiel que de nous faire croire que les femmes d’ici ou d’ailleurs, enfin, vous voyez, celles qui ne souffrent pas directement des mille maux encore imposés aux filles et aux femmes à travers la planète, ont été libérées. En réalité, prisonnières, nous le sommes toujours. Non pas de ces images, mais de ce qu’elles traduisent de la fondamentale impuissance de la société des hommes à imaginer un être humain de sexe féminin qui puisse être autre chose qu’un sexe ou son absence. Prisonnières non pas des images mais des efforts dramatiques qui nous sont demandés pour accéder librement et sans entrave à notre jouissance quand elle n’est pas centrée sur le plaisir du mâle.
Accessoire est notre plaisir : un accessoire de plus dans sa panoplie de peine à jouir – du moins, à jouir sans le recours d’accessoires plus ou moins contraignants, pour lui ou pour les autres, et contraints quand il s’agit de femmes ou d’enfants, ou d’hommes plus faibles que lui.
Pour contourner l’obstacle, certaines femmes ont fait scission, sexuellement et/ou politiquement. Les unes ont créé un mouvement de libération non mixte, les unes (et/ou les autres) se sont décrétées gouines (rouges), lesbiennes seulement, ou lesbiennes féministes, ou féministes lesbiennes, ou féministes tout court. D’autres encore, ou les mêmes plus tard, on ne sait pas, ont clamé qu’elles n’étaient pas des femmes mais peut-être un troisième sexe, non, genre, un troisième genre.
Rayer la mention inutile.
Toutes les mentions sont inutiles. Toutes les étiquettes. Tout ce qui se définit hors normes est encore dans les normes : dans le miroir des normes.
Le meilleur moyen pour se sortir de là ? Penser (à) autre chose.
C’est une leçon que j’ai apprise toute seule, un soir d’été où je perdais, dans ma vingtième année, mon encombrante virginité. Sur le tourne-disque (en langage d’aujourd’hui : la platine), mon amant d’une nuit avait mis du Léo Ferré. Drôle d’idée. Pas très érotique, Léo Ferré, sauf quand il chante « C’est extra ». Ce soir-là, ce n’était pas extra, c’était juste : « Poètes, vos papiers ». Alors j’ai décidé que je n’étais ni homme ni femme, mais poète. Poète sans papiers. Et même si c’est plus facile à penser qu’à vivre, une pensée comme celle-là, ça vous change une femme en quelque chose ou quelqu’un de non répertorié, non balisé, non étiqueté et pas très utile à l’ordre social. C’est déjà ça.
Après, le plus dur reste à faire : être soi avec les autres.
… et pour être re-belles, il faut se réjouir.
Tout ça pour dire que quand on a vu ça, le silence des soixante-huitards rejoignant celui de la droite la plus obtuse pour cacher les femmes sous le tapis, on s’est dit qu’il allait falloir se remuer encore un peu. Passer en revue, plus ou moins accélérée, ce que nous avions fait de nos vies, de notre libération, de nos espoirs et de nos batailles et même ce que nous n’en avions pas fait. Rameuter les copines et les autres. Regarder autour de nous ce que les jeunes femmes, qui maintenant se disaient féministes, tentaient de bouger et comment. Les écouter, puis examiner nos fondamentaux pour déterminer ce qui pourrait nous être utile et commun, à elles et à nous… Belles et re-belles, ensemble, re-faire mouvement. Comme disent les Africaines : seule la lutte libère.
On avait nos méthodes pas très modernes, mais qui marchaient encore pour certaines : réunions, ordres du jour, comptes rendus de réunions, propositions, votes collectifs, rendez-vous en sous-groupes. On en avait d’autres, acquises au fil des ans et de la vie professionnelle, et qui furent bien utiles aussi : on créa un blog[1], une association[2], on inventa une nouvelle signalétique pour affirmer qu’on n’allait pas recycler les vieux concepts sans les examiner avant : plutôt en créer d’autres si nécessaire. On laissa délirer l’une d’entre nous sur ce fameux – e – facultatif. Voilà, pourquoi ce signe de notre relativité a pris récemment un chemin de traverse pour s’imposer. Il s’est d’abord inscrit dans le fameux symbole biologique femelle, le cercle auquel est rattachée une pitoyable croix qui pendouille en dehors (quand le symbole mâle arbore fièrement son érection permanente fantasmatique). Puis lové au creux de son symbole biologique, le – e – a regardé autour de lui et un, il s’est trouvé bien à l’étroit dans ce cercle clos et deux, il a constaté que ses parenthèses lui manquaient.
C’est ainsi que l’année de la célébration des quarante ans du mouvement de libération des femmes a vu apparaître un nouveau symbole pour la caractériser. Le petit – e – du féminin s’est mis à trôner triomphalement entre ses parenthèses tandis que la croix, détachée de tout, flotte dans la page en attendant de disparaître en même temps que les parenthèses le jour où les femmes feront partie de l’espèce humaine aux yeux de tous et toutes.
En attendant, courage, les filles : ça va nous prendre encore pas mal de temps et d’énergie.
Ah, et à propos, pour l’énergie, on a une recette qui fonctionne très bien : faire la fête. Ensemble(es).*
* Euh, pardon, c’est encore moi qui délire sur la grammaire et l’orthographe !
Mais une deuxième fête, après celle du 6 juin à la Flèche d’Or, est prévue.
Elle aura lieu au Tango, 11 rue au Maire, 75003 Paris, le 17 octobre 2010,
dans le cadre des « Thés au gazon ».