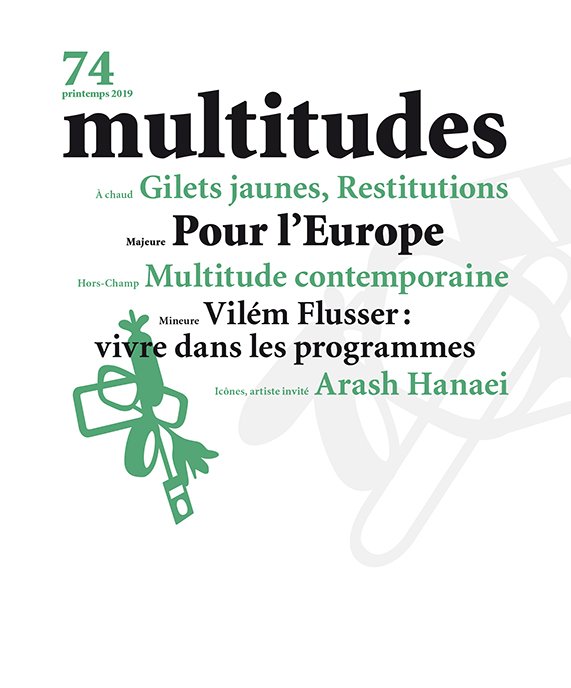Si on considère les résultats de l’informatique, tous ces calculateurs, word processsors, plotters, ordinateurs et les autres idiots ultra-rapides, on a tendance à croire que c’est leur vélocité qui caractérisera notre expérience temporelle dans le futur1. Nous serons à même de nous débarrasser de toute tâche plus rapidement, et par là, nous aurons du temps libre à notre disposition. Je confesse que ce n’est pas la vélocité et la conséquente économie de temps disponible qui m’inspire espoir et crainte. Toutes les machines précédentes, à commencer par le levier, et à finir par l’avion, en ont fait autant. La révolution informatique aura, je pense, des conséquences beaucoup plus profondes sur notre vécu du temps.
L’informatique simule le processus de la pensée dans ses appareils. Pour le faire, elle a recours à une conception plus ou moins cartésienne de la pensée. Penser serait computer des éléments clairs et distincts (par exemple des concepts ou des chiffres). Ces éléments sont des symboles qui signifient des points dans le monde étendu. Si on pouvait afficher à chaque point du monde un de ces éléments, la pensée serait omnisciente. Malheureusement, c’est impossible, parce que la structure de la pensée claire et distincte n’est pas adéquate à la structure de la chose étendue. Dans la chose étendue, les points sont compacts, tandis que, dans « la chose pensante », ils sont séparés par des intervalles. Par ces intervalles, la plupart des points de la chose étendue s’échappent. On peut, bien sûr, intégrer ces intervalles par des calculs appropriés, mais il se trouve que ces intégrales sont, elles-mêmes, des éléments clairs et distincts. C’est pourquoi Descartes, dans son temps, avait recours à l’aide Divine pour faire l’adéquation de la pensée à la chose étendue. Les ordinateurs, eux, n’ont plus la même foi, et ils essaient donc une méthode différente. Ils renversent les vecteurs de signification qui relient la pensée à la chose étendue. Ils projettent des univers où chaque point signifie un élément déterminé contenu dans leur programme. Dans de tels univers, la pensée est effectivement omnisciente. Or ce renversement des vecteurs de signification (le symbole n’est plus signifiant, mais signifié) caractérisera la société informatique. Mais, par là même, de tels univers projetés, dans lesquels l’humanité informatisée aura à vivre, seront des univers criblés d’intervalles.
La société informatisée habitera un univers ponctuel. Un univers de bits, d’atomes, de quanta. Un univers composé de minuscules pierres, donc un univers calculable. Un univers-mosaïque. Tout comme nous habitons un univers processuel, linéaire, historique. Et tout comme l’homme préhistorique habitait un univers scénique, plan, « imaginistique ». La société informatisée aura à vivre dans la dimension zéro, tout comme nous vivons uni-dimensionnellement, et l’homme préhistorique vivait bi-dimensionnellement. À chaque façon de vivre correspond un modèle du temps. Avant d’esquisser ces trois modèles temporels, il me faut dire quelques mots sur la fonction des modèles en général.
L’homme est un être qui abstrait. Il peut se retirer du monde, et il peut en retirer certains aspects. Il peut le faire pas par pas. Par exemple : les images sont des surfaces qui ont été retirées des volumes, elles sont des surfaces abstraites. Les textes sont des lignes retirées des surfaces, des lignes abstraites. Et les points de la computation sont des éléments retirés des textes, des points abstraits. Par chaque pas, l’homme s’éloigne du concret, afin de mieux le voir et le saisir. L’abstraction a pour but le retour vers le concret. Les modèles servent à ce retour. Ce sont des filets et des leurres pour la réinsertion du concret dans l’abstraction. Ainsi les modèles du temps doivent réinsérer le temps concret dans l’image, dans le texte, et dans la computation. Il se trouve, malheureusement, que le concret ne se laisse pas leurrer. Il exige d’être vécu. Pour le concret, c’est comme pour la virginité : une fois perdu, il est définitivement perdu. Et les modèles sont alors acceptés à la place du concret. Le modèle préhistorique du temps est accepté comme s’il s’agissait du vécu concret du temps, et le même vaut pour le modèle historique et post-historique du temps. Je vais essayer de les esquisser, les trois, parce que je crois qu’ils sont actifs, tous les trois, à l’intérieur de nos expériences, nos connaissances, nos valeurs, et nos actes.
Les images sont des surfaces significatives qui sont survolées par le regard qui essaie de découvrir leur signification. Qui essaie de retourner des images vers le concret. En le faisant, le regard tourne en rond, et il revisite les éléments pictoriels déjà vus. Et il revisite le plus souvent de tels éléments qui lui paraissent être les plus significatifs. Ainsi le regard établit des relations temporelles réversibles entre les éléments de l’image, et ces relations-là sont chargées de signification. Or, cette relation2 ainsi établie par le regard est projetée hors de l’image pour servir de modèle du temps dans un univers accepté en tant que contexte d’images, de scènes.
Le temps circule dans un tel univers, et il ordonne les choses d’une manière significative. Si une chose abandonne sa place, elle y est remise par le temps. C’est l’éternel retour. Le temps juge les choses, chacune à sa juste place, dans la scène. C’est dire que le monde est plein de significations. L’homme habite cette plénitude. En vivant, il se heurte contre ces justes relations par chacun de ses actes, il déplace les choses, il crée le désordre, il transgresse. Il sera jugé par le temps, ses transgressions seront châtiées. Il sera remis à sa juste place. Il ne peut pas échapper au destin. Mais il peut le propicier3, en sacrifiant à la chose qu’il a déplacée ou qu’il va déplacer. Il peut payer sa dette d’avance. C’est le modèle du temps du mythe, et de la magie.
Ce modèle a structuré la vie de la société pendant des millénaires incomptables, il le fait toujours pour de nombreuses sociétés, et pour nous tous, à d’innombrables occasions. Mais, il y a à peu près trois mille ans, on a commencé à questionner ce modèle quelque part dans le bassin de la Méditerranée orientale. C’est que, là-bas, on a donné un nouveau pas vers l’abstraction en reculant de l’image vers la ligne, en inventant l’écriture linéaire. Et le modèle mythique et magique du temps n’est pas adéquat aux textes. Dans les textes, le regard ne survole pas, mais il suit une ligne, pour découvrir sa signification à la fin de la ligne. Et il suit la ligne en obéissant aux règles de l’écriture, à la syntaxe. Or, cette relation entre les éléments du texte, établie par la lecture, est projetée hors texte pour servir de modèle du temps dans un univers accepté en tant que contexte de textes.
Le temps est un fleuve qui jaillit du passé, qui demande le futur, et qui arrache toute chose. Le présent n’est qu’un point fugace de transition entre passé et futur. Les choses ne sont pas là : elles deviennent, et elles montrent du doigt le futur. Rien ne se répète : toute nuit qui suit un jour est une nuit nouvelle, unique. Tout instant raté est une opportunité définitivement perdue. Toute action est irrévocable. Tout est donc processus, événement, progrès ou décadence, ordonnés par la chaîne inéluctable de cause et effet. Mais l’homme dispose de la faculté de connaître la chaîne causale et de la soumettre, malgré sa complexité inextricable, à ses propres dessins. C’est cela sa liberté : connaître la nécessité. C’est le modèle du temps de l’histoire, de l’engagement politique, de la science et de la technologie.
Ce modèle a été reformulé à diverses reprises, à commencer par les présocratiques et les prophètes, en passant par le christianisme, le mécanicisme, le darwinisme et le marxisme, et pour finir par le deuxième principe de la thermodynamique. Mais sa structure est restée la même pour autant, et nous continuons à vivre dans ce modèle grâce à notre conscience, dite « historique ». Néanmoins, il y a à peu près un siècle, ce modèle est devenu insoutenable. Les fils qui ordonnent les événements, qui inscrivent les phénomènes dans des processus, commençaient à se décomposer. Par exemple : les causes et les effets se mettaient à devenir réversibles dans le noyau des choses, et on commençait à suspecter que la chaîne causale ne se trouve pas derrière les choses, mais qu’elle a été projetée dans le monde par la pensée linéaire humaine. On commençait à suspecter que la science ne découvre que sa propre structure mathématico-logique, « derrière les choses ». Mais ce qui a contribué surtout à la décomposition du modèle historique du temps, c’est la constatation phénoménologique toute bête que le temps ne nous arrive pas provenant du passé, mais qu’il nous advient du futur, et que le modèle historique est donc renversé. La véritable explication de la décadence du modèle historique est, toutefois, que l’homme commençait, à ce moment, à faire un nouveau pas vers l’abstraction, en reculant de la ligne vers le point, du texte vers le calcul, et que, pour un tel univers en bits, en quantas, qui surgissait ainsi, le modèle historique du temps n’est pas adéquat. De ce nouveau pas vers l’abstraction sont nées, entre autres choses, la computation et l’informatique.
La structure fondamentale de cet univers vide, dans lequel bourdonnent les atomes, est le hasard (le clinamen démocritien). Les atomes ne sont pas préalablement des réalités, ils ne sont que des virtualités, et là où ces virtualités coïncident par accident, là, ils se réalisent. Cet univers a la structure d’un champ virtuel, sur lequel se forment les choses réelles selon les constellations les plus probables de sa forme. C’est pourquoi, pour s’orienter dans un tel univers, deux disciplines sont indiquées : la topologie, pour saisir la forme du champ, et le calcul des probabilités, pour saisir la formation des phénomènes. Or, cette méthode pour déchiffrer cet univers abstrait, en bits, est projetée hors cet univers pour servir de modèle du temps dans le monde.
Seul le présent est réel, car c’est là où les virtualités se réalisent, se présentent, par hasard. Et le présent se trouve là où je suis : je suis toujours présent. Je suis ce trou noir dans lequel se précipitent les virtualités pour s’y réaliser. Les virtualités s’approchent : elles sont mon futur. N’importe où je regarde, je trouve le futur. Ce futur, pour moi, n’est pas chaotique, comme si les virtualités qui m’entourent étaient semées sans aucune structure dans un temps sans limite. Au contraire : mes virtualités s’agglomèrent dans ma proximité, et plus elles sont proches, plus elles sont probables. Et elles se découpent contre l’horizon de ma mort, au-delà duquel il n’y a plus de temps, parce qu’il n’y a plus de présent. Les virtualités qui tombent sur moi, qui se présentent, se réalisent en moi, « je les réalise ». Et elles forment, en moi, une mémoire. Ce nœud de virtualités réalisées, lequel est le Je, va en croissant ma vie durant, et j’en suis partiellement conscient (mémoire disponible) et partiellement inconscient (mémoire refoulée). Il y a donc, dans ce modèle du temps, deux formes distinctes du passé.
Mais ce qui caractérise ce modèle sont les deux aspects suivants : les virtualités ne se présentent pas seulement par hasard, mais je peux les faire apparaître dans une certaine mesure : elles sont « futurables ». Le trou noir que je suis n’est pas passif : c’est un tourbillon qui peut aspirer les virtualités. C’est dire que j’ai la faculté de rendre probable l’improbable, que je peux établir des informations. Et aussi : je ne suis pas seul dans le monde. Je le découvre en « futurant ». Car, en le faisant, je ne me heurte pas seulement contre des virtualités futurables, mais aussi contre des trous qui sont comme moi, et qui m’aspirent. Ce sont des présences excentriques par rapport à la mienne, et elles sont au centre d’un futur différent du mien. Je ne peux donc pas les futurer, mais je peux me reconnaître en eux, en les reconnaissant. Avec cette reconnaissance d’autrui, l’horizon de mon futur s’élargit. Mais il peut se rétrécir brutalement ensuite, avec la mort d’autrui. Avec cela, mon futur tout entier peut entrer en collusion. Tout cela est mystérieux, peut-être parce que ce modèle du temps est encore tellement nouveau.
Ce modèle est tellement nouveau qu’on peut en discerner les origines : de la cosmologie, la physique nucléaire, la génétique, la psychologie, la cybernétique, l’informatique, la recherche phénoménologique. On peut constater qu’il s’agit d’un modèle qui a été projeté à partir de l’univers abstrait des atomes. Ce qui ne l’empêche pas de pouvoir être vécu en tant que temps concret. Néanmoins, ce modèle est très problématique du point de vue de la conscience « historique », et nombreux sont les aspects qui déroutent.
Par exemple : Le moi y est conçu, non pas en tant qu’identité, mais en tant que vacuité. On n’y peut pas distinguer entre le temps et l’espace, étant donné que les catégories « virtualité » et « proximité » sont spatio-temporelles. On n’y peut pas parler de « progrès » ni de « décadence », étant donné que le futur se trouve dans toutes mes directions. On n’y peut pas expliquer le présent par le passé, étant donné que le passé y est le produit du futur. Mais l’aspect le plus déroutant de ce modèle est la structure ponctuelle du temps qu’il propose. Comme cet aspect-là est lié à notre thème central, « l’informatique », c’est ce que je me propose de reconsidérer.
Le futur est composé de virtualités distinctes. Il ne coule pas vers moi comme un fleuve, mais il se précipite sur moi comme du sable. Sous forme, par exemple, de sensations distinctes. Et quand j’anticipe mon futur, quand je futurise, ce n’est pas que j’attrape une masse compacte, mais certaines virtualités distinctes. Par exemple, sous forme de décisions ponctuelles en structure d’arbre. C’est dire que le futur, donc le temps en général, est perforé par des intervalles, par lesquels j’aperçois ma mort. Or, ces intervalles-là ne sont pas du temps, et cela n’a donc pas de sens de vouloir les mesurer. Ils ne durent pas, ils ne sont ni longs ni courts. Ils ne sont rien, ils sont le néant. Le terme « ennui » articule cette expérience des intervalles.
C’est dans ce contexte qu’il faut, à mon avis, reconsidérer la vélocité des appareils informatisés, et de la vie de la société informatisée en général. Il s’agit là d’un effort pour faire en sorte que les grains du temps se suivent plus rapidement l’un l’autre. Pour diminuer les intervalles. La société informatisée vivra sous le pilonnage d’informations, de sensations, de connaissances, d’expériences, pour faire oublier l’ennui. L’homme informatisé jouera, produira de l’art, participera, anticipera, pour oublier l’ennui. Mais cette vélocité est absurde, parce que l’ennui ne peut pas être diminué par l’intégration du temps ponctuel. Au contraire : plus les informations se multiplient, plus leur caractère ponctuel, ennuyeux, apparaît. Plus vite les tâches sont accomplies, mieux elles révèlent leur vacuité, et plus j’anticipe mon futur, plus je le creuse. Je vous suggère que c’est sous le signe de l’ennui que le temps sera vécu dans la société informatisée.
Or, l’expérience de l’ennui, c’est celle du néant, de la mort. Il se peut que l’informatique, et tout autre aspect de la révolution technologique par laquelle nous passons, précisément parce qu’elle est ennuyeuse, nous aide à ouvrir vers ce néant, vers notre mort. C’est-à-dire, nous aide à nous ouvrir vers l’autrui. Et c’est cet espoir que je voudrai partager avec vous.
1 Ce texte a été rédigé dans le cadre d’une conférence donnée le 12 juillet 1983 aux Rencontres Informatique/Culture de Villeneuve-Lès-Avignon. Celles-ci se sont tenues du 8 au 13 juillet 1984 à l’initiative de Denis Raison (Centre international de recherche de création et d’animation, CIRCA). Ce document porte le no 862 dans les Archives Flusser ; il a été retranscrit du tapuscrit et édité par Romissa Dames.
2 Le manuscrit indique « ce relationnement ».
3 Favoriser, rendre propice.