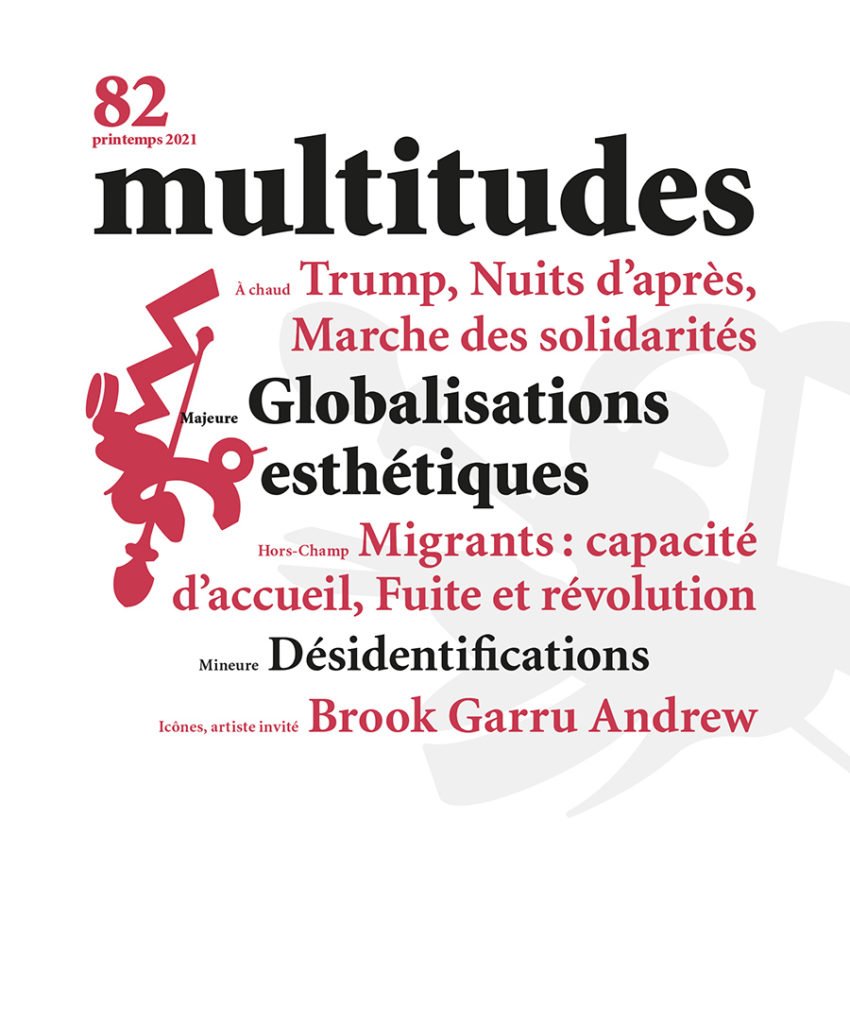En 1966, en réponse à une commande de la radio publique japonaise, Karlheinz Stockhausen compose Telemusik, une œuvre de musique électronique qui regroupe et articule « environ 55 extraits de musique ancienne de divers pays et époques ». Cette composition, insiste Stockhausen, n’est pas un collage, une mise bout à bout de ces morceaux choisis du monde des traditions orales, mais ce qu’il appelle une « intermodulation » ou « modulation réciproque » : « par exemple moduler le rythme d’un “objet trouvé” japonais avec celui d’une sévillane avec la qualité mélodique d’une musique des Indiens Kraho du nord de l’Amazonie, puis moduler ce résultat avec le spectre sonore des timbres d’une musique du Japon […]1 ». L’intermodulation, écrit-il ailleurs, est « la libre rencontre de leurs esprits », paradoxalement opérée par un seul homme, le compositeur. Et Stockhausen d’ajouter : « Je voulais me rapprocher d’un vieux rêve qui ne cessait de me hanter : faire un pas de plus en direction de mon désir d’écrire non pas “ma musique”, mais la musique de la terre entière, de tous les pays et de toutes les races2. » Cette musique planétaire dont Stockhausen se fait ici le compositeur et le prophète est la vraie « musique du monde », d’un monde où les traditions se mêleraient et s’influenceraient librement, d’un monde où elles ne seraient ni remplacées ni muséifiées, mais protégées et vivantes, assez pour en transformer d’autres et pour se laisser transformer par elles.
Dans un texte postérieur de quelques années – « Musique universelle », écrit en 1974 – il décrit le « processus de dissolution des civilisations individuelles3 » qui se produit sous ses yeux, effet conjoint du tourisme de masse, de l’industrie culturelle et du commerce planétaire. Mais il imagine qu’après une première phase inévitable d’« uniformisation » et de « nivellement », une deuxième « naîtra du processus de mélange et d’intégration de toutes les civilisations musicales de la planète, où […] se manifestera une tendance très opposée à celle d’une uniformisation. […] De tels styles individuels, formés consciemment et crées à partir des croisements les plus insolites de toutes les possibilités historiques et librement inventées, élargiront dès lors d’une toute nouvelle manière le monde des formes et des rites d’exécution musicaux4. »
Ce dont nous sommes témoins aujourd’hui ressemble plutôt à une superposition de ces deux phases, l’uniformisation se conjuguant sans contradiction apparente à l’individualisation, l’une nourrissant l’autre, le style le plus local et individué s’avérant susceptible de devenir du jour au lendemain une antienne au pouvoir normatif et prescripteur – avant de laisser sa place à un autre. La diversité des styles et l’insolite de leur croisement n’ont jamais été aussi grands, comme n’ont jamais été aussi grandes la puissance et la labilité des réseaux de contagion potentielle. L’opposition s’est estompée entre le singulier et le planétaire, entre l’« authenticité » d’une tradition ou d’une signature individuelle et l’« inauthenticité » d’un tube globalisé. Le premier n’est pas moins composite et métissé que le second. Et la multiplication comme la diversification des réseaux de diffusion et de propagation ont rendu le passage de l’un à l’autre, le devenir planétaire du singulier comme l’appropriation singulière d’un son ou d’un style mondialisé, difficile à prévoir et presque impossible à programmer.
Auto-Tune
Un cas exemplaire de cette uniformisation-individualisation est l’Auto-Tune. Invention du mathématicien Andy Hildebrand pour la compagnie Antares Audio Technology qu’il fonda en 1989, l’Auto-Tune avait pour objectif de réaccorder la voix quand elle cesse d’être juste en corrigeant ses écarts de hauteur. L’idée sous-jacente, clairement énoncée dans le brevet déposé en 1998, est qu’une voix désaccordée perd ses qualités émotionnelles. « Les voix et les instruments sont désaccordés quand leur hauteur n’est pas suffisamment proche des hauteurs standards attendues par l’auditeur, compte tenu de la structure harmonique et du genre de l’ensemble. Quand voix et instruments sont désaccordés, les qualités émotionnelles de la performance sont perdues. Corriger l’intonation, c’est-à-dire mesurer la hauteur réelle d’une note et changer cette hauteur en une hauteur standard, résout le problème et restaure la qualité de la performance5. »
Ce que semble vouloir dire Andy Hildebrand est qu’une émotion, pour être transmise à l’auditeur, doit respecter la grille tempérée des hauteurs (et plus généralement le système tonal qu’elle a rendu possible) qui, en Occident, encadre la réception de la musique depuis le XVIIIe siècle. L’Auto-Tune fait en sorte que l’émotion exprimée par la performance vocale ne déroge pas aux normes qui régissent notre écoute. Ce réaccordage, qui peut s’opérer au cours de l’enregistrement ou pendant la phase de post-production, présenterait, selon lui, un double avantage : 1) économique : il offrirait un gain de temps significatif, 2) esthétique : il permettrait aux interprètes de se concentrer sur la qualité émotionnelle de leur performance plutôt que sur sa justesse. « L’effet le plus important de l’Auto-Tune dans la communauté, c’est qu’il a changé l’économie des studios sons… Avant l’Auto-Tune, les studios passaient beaucoup de temps avec les chanteurs, ils devaient corriger leur hauteur et faire en sorte qu’il y ait de l’émotion dans leur performance. Maintenant, ils peuvent se concentrer sur l’émotion, ils n’ont plus à s’inquiéter de la hauteur, le chanteur rentre chez lui et ils la corrigent pendant le mixage6. »
Paradoxalement, le succès planétaire de l’Auto-Tune doit beaucoup moins à sa puissance standardisante qu’à la chanson de Cher qui, en 1998, popularisa son mésusage, « Believe ». Simon Reynolds a parfaitement décrit le moment où l’Auto-Tune, réglé de manière à ce que sa vitesse de correction soit maximale7, fait vaciller la voix de Cher, faisant muter son timbre. « On l’entend exactement à la trente-sixième seconde de la chanson – un aperçu de la pop à venir, un avant-goût du futur qui deviendrait notre présent. Les paroles “I can’t break through” se font cristallines, comme si la chanteuse disparaissait subitement derrière une paroi de verre dépoli. L’effet spécial rutilant ressurgit dans le deuxième couplet : cette fois, une voix robotique entonne “So sa-a-a-ad that you’re leaving”. Cette chanson est bien sûr “Believe” de Cher, tube planétaire dès sa sortie en octobre 1998. L’heure des adieux au XXe siècle avait sonné8. »
Ce sont ses potentialités musicales – et créatives – qui ont fait le succès de l’Auto-Tune, non ses capacités à faire passer les émotions à la moulinette du tempérament égal. Ce qui n’a pas empêché certains, de plus en plus nombreux, de l’accuser d’être responsable de l’uniformisation planétaire de la musique pop et de transformer n’importe quel morceau en marchandise standardisée et immédiatement monnayable sur le marché mondial. Il faut avouer à leur décharge qu’une très grande proportion de la pop actuelle, 99 % dit-on même si ce nombre est invérifiable, serait produite à l’aide de l’Auto-Tune ou d’un dispositif similaire (et, le plus souvent, sans que cet usage soit repérable). Cet appareil numérique – comme le nomme Hildebrand – produit des effets de ressemblance que l’on pensait avoir disparu depuis la contagion des styles qui ont jalonné la deuxième moitié du XXe siècle. Son originalité est d’être, précisément, transversal aux styles et aux genres musicaux – à condition qu’ils utilisent la voix, ce qu’ils font presque tous. Cette uniformisation doit être cependant nuancée. Dans son article, Simon Reynolds évoque les nombreux artistes qui en ont proposé un emploi singulier, et relativement méconnaissable, de Radiohead à Kate Bush et de Vampire Weekend à Justin Vernon (sous le nom de Bon Iver). Mais le cas le plus intéressant qu’il rapporte est son appropriation par le courant Afrobeat. Car son usage est non d’uniformisation mais d’exacerbation des traits de pop africaine et d’intensification de ses différences stylistiques et sonores. Loin de standardiser, et d’occidentaliser, le son des musiques urbaines d’Afrique, de l’Inde et des Caraïbes, l’Auto-Tune leur permet d’exagérer leurs spécificités, d’être plus intensément eux-mêmes. Et aussi peut-être de circuler un peu plus commodément au-delà de leurs frontières.
Nous voilà face à un paradoxe : ce qui uniformise peut être aussi ce qui singularise. Dit autrement, la circulation des marchandises musicales – morceaux, albums ou applications de réaccordage des voix – a des effets généralement imprévisibles et souvent contraires. Anna Tsing a appelé ce phénomène amphibologique, qu’elle a étudié dans un tout autre contexte, la « friction de l’interconnexion globale » : « Les effets des rencontres depuis la différence peuvent être compromettants ou émancipateurs. La friction n’est pas un synonyme de résistance. L’hégémonie peut être faite et défaite par la friction. […] La friction rend la connexion globale puissance et effective. En même temps, sans le savoir, la friction se met en travers des opérations sans à-coups du pouvoir global. La différence peut perturber, produire des dysfonctionnements quotidiens aussi bien que des cataclysmes imprévus. La friction refuse le mensonge selon lequel le pouvoir global opère comme une machine bien huilée. De plus, la différence inspire parfois l’insurrection. La friction peut être la mouche dans le nez de l’éléphant9. »
L’interconnexion globale est un fait. C’est elle qui permet, et accélère à mesure que la vitesse des flux connectés augmente, la circulation d’à peu près tout ce qu’il possible de transporter d’un point à un autre, dont la musique et ses appareils, pour beaucoup numériques, même si les valises des musiciens voyageurs sont encore saturées d’instruments acoustiques et analogiques. Première friction : l’hétérogénéité des moyens de la musique, qui fait que quel que soit l’appareil dominant, il sera toujours concurrencé par d’autres (ou couplés à d’autres), d’anciens revenus en usage ou de nouveaux s’attaquant à (ou profitant de) l’hégémonie du premier. En terre africaine, confronté à une autre culture que celle qui a vu sa naissance, l’Auto-Tune trouve un autre usage, déformant plutôt qu’uniformisant. Ce que démontre Anna Tsing, c’est qu’il est impossible de remonter les lignes de l’interconnexion sans mettre à jour des frictions : des frottements, des heurts, des disputes, des luttes de pouvoir, des dysfonctionnements et, bien sûr, des déconnexions. Elle fait même un pas de plus : la friction serait la condition de l’interconnexion. Ce sont les frictions qui font que le flux passe : que tel appareil, après d’âpres discussions, soit adopté par un groupe récalcitrant ou que tel style musical se voit réinventé par une imitation aventureuse. L’argument d’Anna Tsing est évidemment politique. La friction est l’effet inévitable de la connexion des différences : celles-ci peuvent être écrasées ou au contraire encouragées par le processus qui les relie. Dans les deux cas, quelque chose se produit qui vient modifier les termes de la rencontre. Car s’il est impossible de prévoir en amont les effets, positifs comme négatifs, des confrontations incessantes qu’entraîne la circulation des biens et des personnes, les confrontations, elles, sont inévitables.
Japanoise
Il y a un style musical qui doit beaucoup aux frictions, et aux malentendus, de cette circulation mondialisée des biens musicaux : la Japanoise. L’ethnomusicologue David Novak a consacré à ce genre, né entre le milieu des années 1980 et le début des années 1990, un ouvrage passionnant, dont le sous-titre énonce la thèse majeure : Music at the Edge of Circulation10. Difficile de le traduire sans en perdre une partie des nuances : l’expression « at the edge » permet à David Novak d’entrelacer trois sens : le bord (« the edge »), la pointe (« at the cutting edge ») et, par homonymie phonétique, l’âge (« at the age of »). La Japanoise n’est pas seulement un produit collatéral de la circulation, elle en réfléchit le fonctionnement et en opère la critique immanente. Mais elle modifie aussi le sens de la musique Noise, voire de la musique en général : elle représente ce que peut être une musique qui a fait de sa naissance à « l’âge de la circulation » un de ses traits constitutifs. C’est parce qu’une certaine musique populaire japonaise fut distribuée aux États-Unis au cours des années 1980 et au début des années 1990 que le mot « Japanoise » est apparu11. Il décrivait alors la manière dont les auditeurs nord-américains percevaient cette musique, jugée plus « authentiquement » Noise que celles qui étaient jusque-là qualifiées ainsi aux États-Unis. Ce mot qui reliait de manière vague un certain nombre de pratiques hétérogènes « bruyantes » devint celui d’une musique clairement identifiée comme japonaise, avant d’être celui d’une (sub)culture transnationale. La Japanoise a donc été le résultat d’un feedback culturel : le genre musical fut d’abord le nom de sa réception en Amérique du Nord, nom dans lequel beaucoup de groupes ne se reconnurent d’ailleurs pas12. Et ce produit de la circulation ne fut pas, en retour, sans effet sur la scène japonaise dont elle forçait le nom : le bruitisme des années 1990 fut sensiblement plus homogène et radical que celui des années 1980. C’est la circulation du feedback états-unien au Japon, et donc la recirculation des morceaux japonais encore non nommés, qui institua, comme un vice de recirculation, le genre de la Japanoise. Ce vice ne fut toutefois pas le premier. Une boucle en cache toujours une autre. Au Japon, le mot « Noise » précéda les groupes qui allaient illustrer le genre. Il fut utilisé, dès le début des années 1980, pour désigner les disques inclassables que les amateurs écoutaient dans des magasins de disque de Kyoto puis d’Osaka, des disques qui, pour la plupart, venaient d’Amérique du Nord et d’Europe : le Nihilist Spasm Band, Karlheinz Stockhausen [sic], le groupe anglais Whitehouse13, etc. C’est la réception par les auditeurs japonais de la musique expérimentale occidentale, et donc un tout premier feedback, qui fut chez eux constitutif du son « noise ». La pratique ne prit son essor qu’un peu plus tard. Et ce n’est qu’après le feedback nord-américain que le genre se cristallisa et que le mot prit le sens qu’il a encore aujourd’hui.
Dans l’introduction de son ouvrage, David Novak décrit ainsi son projet : « Dans ce livre, j’écris une histoire de la Noise en tant que circulation de la musique populaire14. » Il ajoute quelques pages plus loin : « Même si je décris la Noise à partir de sa circulation, mon but est de questionner les différents modèles d’échanges qui représentent la circulation comme quelque chose qui a lieu entre les cultures. Si je privilégie le concept de feedback, c’est afin de souligner le fait qu’elle est en elle-même productrice de culture. Le feedback est une critique de la globalisation culturelle, un processus d’interprétation sociale, une pratique d’écoute et de performance musicale et une condition de la subjectivité. En mettant l’accent sur le contexte transnational de la musique populaire, et sur le cas particulier de la Noise, je montre comment la médiation technologique transforme l’échelle globale de l’échange culturel, même si cela sape sa continuité historique15. »
La circulation comme culture, ou plutôt comme réserve de cultures potentielles : plus que le simple mouvement des biens et des personnes, elle permettrait la constitution de collectifs d’acteurs à l’échelle de la planète – ainsi que d’une subjectivité transnationale dont la condition d’existence serait d’être entre les cultures, les langues et les pratiques. Ce qui ressemble fort à un cosmopolitisme de fait. Être un musicien noise, c’est être chez soi au sein de toutes les micro-communautés interconnectées qui pratiquent et écoutent cette musique sur la planète, même si elles sont loin de s’entendre sur le sens à donner au mot Noise, voire se demandent s’il ne convient pas de lui donner un autre nom (ou plusieurs) tant la pratique évolue vite.
Afin de décrire comment, de manière immanente à la circulation, de nouveaux styles et genres musicaux s’inventent, David Novak utilise le concept, que nous avons déjà utilisé sans le définir, de feedback. Le feedback dans son sens le plus commun est la boucle de rétroaction qui se produit lorsqu’un signal s’ajoute à lui-même (par exemple quand, du fait de la trop grande proximité d’un microphone, le son d’un haut-parleur est réinjecté dans ce même haut-parleur, jusqu’à produire le fameux larsen, effet audible du feedback et communément identifié à lui). Plus généralement, il désigne le mode de réglage spécifique à un processus d’autorégulation : celui des causes par les effets. En mesurant, par leur feedback, les effets des actions qu’il produit, un système complexe est capable de s’autoréguler, mais aussi de s’améliorer (ce fut l’un des concepts majeurs de la théorie cybernétique de Norbert Wiener). David Novak en fait usage dans ces deux sens, à condition de penser un feedback qui ne soit pas seulement négatif (comme c’est le cas chez Wiener) : un feedback positif ou créateur, qui soit capable d’amplifier plutôt que de réguler ses effets, de produire de la différence plutôt que de l’atténuer. La circulation mondialisée, parce qu’elle interconnecte les cultures et rend désormais accessibles aux flux dominants la plupart des espaces qui avaient jusqu’à il y a peu échappé à sa puissance distributrice et publicitaire, produit fatalement toutes sortes de boucles de rétroaction positives. Si la plus commune est l’effet en retour de la périphérie vers le centre, typique par exemple du fonctionnement des grands labels discographiques, celle que décrit Novak à propos de la Japanoise est une boucle qui prit forme dans les marges des réseaux industriels de la circulation musicale, reliant entre eux une multitude de petits groupes fragmentés sur plusieurs continents. Et les malentendus nombreux qui l’accompagnèrent furent pour beaucoup dans la construction d’une relation interculturelle forte et durable. La friction, quand elle est surmontée, renforce l’interconnexion. À terme, les boucles de rétroaction transnationales produisent une (sub) culture relativement autonome qui fonctionne comme un système qui ne perdure que parce qu’il produit sans cesse de nouvelles normes : chaque nouveau feedback est créateur, il menace son intégrité mais contribue, si elle est surmontée, à l’étendre et à le renforcer.
La singularité de la Japanoise est qu’elle fit des distorsions propres à une rétroaction (volontairement) mal contrôlée le matériau même de sa pratique sonore. Adeptes de la transformation de tout signal musical potentiel en bruit, les musiciens noise produisaient des biens qui semblaient s’opposer radicalement à leur propre circulation et qui, quand ils circulaient malgré tout, laissaient derrière une dense traînée de larsens culturels. Le propre de la pratique noise du feedback est d’organiser son auto-génération à partir d’une chaîne de pédales d’effets branchés les uns aux autres de manière à constituer un dispositif dont le musicien doit contrôler les embardées sonores – exercice délicat dans la mesure où son principe est celui de l’accumulation des distorsions. Un tel dispositif est sa propre source sonore. Il n’est pas destiné à transformer un son originel mais à produire de lui-même une suite sans fin de distorsions. Ce qui, si l’on suit l’analogie de David Novak, permet de penser un modèle culturel rigoureusement acentré, sans origine locale autre que projetée et phantasmatique. Le feedback est un brouillage radical des origines, qu’elles soient sonores ou culturelles.
Une des conditions principales de ce feedback est bien sûr l’enregistrement. Ce sont eux qui circulent, bien avant et plus souvent que les musiciens en tournée. La productivité des musiciens Noise en la matière est symptomatique tant de son importance que du sens qu’ils lui accordent. Un enregistrement est le plus souvent le témoignage d’une rencontre ou d’un moment : produit aussi vite qu’il a été enregistré, confié aux bons soins d’un micro-label local, il circulera dans des réseaux alternatifs aux circuits de l’industrie musicale – mais non moins efficaces. Dans les années 1980, le support privilégié de la Noise était la cassette audio : difficile à trouver pour ceux qui ne savaient pas où chercher mais très bon marché et réutilisable à l’envie, elle fut le point d’orgue d’une véritable culture qui dépassait largement le strict cadre de la Noise. Support éminemment démocratique, il permettait à quiconque en avait le désir de produire chez soi des enregistrements qu’il envoyait ensuite à des labels ou déposait directement dans des magasins indépendants. Tous ces objets produits au hasard des déplacements, des concerts et des rencontres (CDs, vinyles, cassettes) sont pour ceux qui les écoutent à distance les traces nombreuses et hétéroclites que laissent derrière eux des musiciens qui semblent animés d’un mouvement perpétuel. Ils dessineraient, si l’on tirait les fils qu’ils ont tracés à la surface du globe, une autre carte de la mondialisation des échanges, parallèle à celle-ci mais opérant à un autre niveau et d’une autre nature : plutôt que de grandes lignes, on y verrait une multitude de points, chacun signalant un arrêt, une session, un concert, un magasin, un studio, un label, une rencontre, etc., non un réseau stable mais une toile dense et mouvante, qu’il faut sans cesse retisser et réactiver, bref une autre image du monde et de sa musique16.
Un des effets majeurs du feedback produit par la circulation, une des conséquences de son brouillage, est l’impossibilité relativement nouvelle de localiser clairement les musiques populaires, de les identifier à un lieu ou à une culture locale. Aucune qui n’ait été remédiée par l’enregistrement, contaminée par d’autres musiques et déplacée de sa localité première. La circulation délocalise et désidentifie. Cela ne veut évidemment pas dire que les lieux et les cultures locales disparaissent. Seulement qu’une musique ne peut plus, sauf exceptions, revendiquer son appartenance exclusive à l’un d’eux ou à l’une d’elles. Mais ces lieux et cultures n’ont en rien perdu leur puissance d’appropriation des styles, des sons ou des appareils qui les traversent. C’est l’autre effet du feedback : chacun peut, là où il se trouve, produire du nouveau, redéfinir l’usage de l’Auto-Tune ou donner une nouvelle branche à l’arbre de la Noise (ou une nouvelle racine à son rhizome).
Modularité
Dans une communication au colloque « Spectres de l’audible : sound studies, cultures de l’écoute et arts sonores » à Paris en 201817, David Novak a proposé, pour décrire ce qu’il considère comme une nouvelle pratique musicale de la circulation marchande, le concept de « modularité ». Plutôt que de travailler sur des dispositifs de feedback, depuis une dizaine d’années, les musiciens réinvestissent le fonctionnement modulaire qui était celui des premiers synthétiseurs, constitués de modules indépendants aux fonctionnalités variées (oscillateurs, filtres, amplificateurs, générateurs d’enveloppes, séquenceurs, etc.) et communiquant les uns avec les autres. Il s’agit d’une logique non de rétroaction, mais d’accumulation et d’assemblage qui leur permet de fabriquer eux-mêmes leurs propres dispositifs de synthèse et de traitement sonore. Le synthétiseur le plus couramment utilisé aujourd’hui est l’Eurorack, du fabricant allemand Doepfer. Il peut intégrer un nombre indéfini d’éléments et surtout accueillir des modules étrangers – conçus par d’autres fabricants ou fabriqués par les musiciens eux-mêmes (c’est pour cette raison que l’on désigne l’Eurorack comme un nouveau standard autant que comme un nouvel appareil). Selon David Novak, le trait saillant de ce nouveau paradigme est qu’il rend compatibles entre elles la pratique ouverte et souvent anarchique du bricolage et l’économie de la circulation marchande : il est possible de bricoler des modules pour sa propre pratique musicale et de les proposer en même temps à la vente aux amateurs de synthèse modulaire. Le mouvement des « makers » et les technologies DIY (« Do It Yourself ») sont particulièrement représentatifs de ces nouveaux enjeux. Leur caractère artisanal et leur fonctionnement participatif ne s’opposent plus à une logique entrepreneuriale à visée lucrative. Alors que les pratiques du feedback étaient critiques et transgressives, celles de la modularité sont généralement apolitiques. Il ne s’agit plus (par exemple) de détourner les objets électroniques de consommation courante – comme pouvaient le faire les amateurs de circuit-bending –, mais de trouver sa place au sein de la sphère technoculturelle, autrement dit de profiter d’un marché désormais ductile et décentralisé.
Ce nouveau paradigme ne serait qu’une manière euphémique de désigner le tour néolibéral que prend la pratique musicale s’il prenait la même forme partout où on l’observe. En l’occurrence, la question de sa localité devient ici primordiale. Être un « maker » à Berlin ou à New York et être un « maker » à Kinshasa ou à Yogyakarta sont deux choses très différentes. David Novak décrit le cas de l’artiste javanais Lintang Radittya, qui fabrique des instruments électroniques, et notamment des modules compatibles avec l’Eurorack, à partir de pièces détachées. Il a conçu l’un de ses appareils de manière à ce qu’il intègre les fluctutations du réseau électrique du quartier de Yogyakarta où il habite et travaille. « On vit avec un système électrique instable. Selon que tu utilises ton instrument la journée ou la nuit, ça peut être très différent. J’ai testé mon matériel dans la journée et dans la nuit, ça n’a rien à voir. La nuit, on obtient un ronronnement très doux car le voltage baisse avec tout le monde qui utilise l’électricité en même temps18. »
Fabriquer des modules commercialisables lui permet de gagner sa vie, mais il le fait en travaillant sur une matière première de seconde main, avec ce qu’il faut bien appeler les rebuts de la technoculture américaine, japonaise ou chinoise. Ce faisant, il les recycle, leur trouve un nouvel usage, les réintègre après quelques transformations dans le circuit de la circulation marchande. Mais surtout, il en fait les instruments de sa propre musique. Sa pratique est modulaire mais son contexte est celui d’un monde en ruine. Et c’est parce qu’il prend soin des rebuts de la circulation qu’il peut aussi tirer profit de l’instabilité structurelle du réseau électrique indonésien. Agir localement veut dire ici faire avec ce qu’on a sous la main et avec la déliquescence des infrastructures. C’est, d’une certaine manière, vivre dans les ruines de la globalisation économique. Mais ces ruines, loin d’être un des non-lieux que la circulation produit comme son dehors inévitable, sont précisément l’endroit où l’on fait quelque chose avec ce qu’elle rejette, où quelque chose s’invente qui, bien que résolument local, dessine ce qui pourrait devenir, qu’on le veuille ou non, une pratique majoritaire.
Cette figure n’est pas sans évoquer ce que Michel de Certeau et Luce Giard ont appelé les « shifters » : ces « intermédiaires » qui, au sein d’un réseau de communication qu’ils pontent ou détournent localement, opèrent des « opérations productrices19 ». Ils présentent cette double caractéristique d’être des acteurs à part entière (bien que souvent périphérique ou marginaux) du réseau de circulation et de permettre à ceux qui le subissent ou qui n’y ont pas accès l’appropriation de ce qui y circule (biens ou informations). En le branchant sur des « besoins pratiques » ou des « nécessités vitales », ce qui est une manière de le détourner sans s’y opposer, ils « stimulent » et « articulent » son fonctionnement. Sans eux, sans la multiplicité de ces opérations locales souvent très inventives, rien ne serait à même de circuler. Cette situation n’est toutefois pas exactement celle que décrit David Novak. Les « intermédiaires » dont parlent Giard et de Certeau n’ont pas disparu, mais ils ont pour une grande part changé de rôle. Ils ne se contentent plus de connecter les flux à des besoins, ils entendent en extraire un profit, faire en sorte que leurs opérations produisent une plus-value monnayable : ils sont devenus des makers. Mais, comme on l’a vu, être un maker peut aussi vouloir dire atténuer les effets négatifs de la circulation, rapiécer localement et provisoirement les trous du réseau, remédier à ses défauts (sans bien sûr renoncer à en faire usage). Les shifters sont aussi devenus, par nécessité ou par volonté, des repairers.
Nous avons depuis le début de ce texte rencontré un certain nombre de concepts – intermodulation, friction, feedback, modularité – qui sont, au fond, autant de manières de penser la même chose : ce qu’Anna Tsing appelle la « rencontre depuis la différence ». Cette différence, elle est inséparablement économique et culturelle. La mondialisation des flux marchands a précédé celle des biens culturels : la rencontre se fait le plus souvent dans un contexte d’échange, ou de prédation, économique. C’est pour cette raison que l’intermodulation de Stockhausen, malgré sa bienveillance, ressemble beaucoup au rêve d’un compositeur occidental faisant son marché dans les folklores encore à peu près intacts de l’Orient lointain – ce qui n’enlève rien à la puissante étrangeté de ces œuvres, nettement plus rugueuses (bruitistes ?) que les tentatives d’intermodulation pop qui furent réalisées dans les décennies ultérieures. Feedback et modularité sont deux manières de penser la friction que génèrent des rencontres généralement déséquilibrées et fortement dépendantes de leur contexte d’occurrence.
Il n’y a pas et il ne saurait y avoir de musique-monde ni de musique du monde. Les musiques se font ici ou là, interrompant le temps de leur fabrication la circulation de ce dont elles ont besoin pour exister (logiciels, sons, instruments, idées, personnes, objets, etc.), puis circulent à leur tour jusqu’à ce qu’un appareil ou un organe les saisissent et les intègrent ou non au cours discontinu et incertain de ses actions. Bien sûr, elles peuvent être écrasées par la puissance normative ou économique de ce qui circule, mais elles peuvent aussi en faire un usage nouveau, qui peut être aussi bien une manière de comprendre ce que l’on reçoit (« – cette Noise est plus radicale et puissante que tout ce que j’ai entendu sous ce nom jusqu’à aujourd’hui… ») qu’un travail de production originale. Et cet usage nouveau se répercutera le long de la chaîne, modifiant le sens de ce qui y circulait. Tout cela additionné, mais qu’aucune oreille ne serait capable d’entendre, fait un monde dans lequel chaque connexion peut être une bifurcation, un monde où les vices de la circulation sont plus certains que ses vertus20. Les champignons les plus précieux ne poussent-ils pas dans les forêts ravagées des zones post-industrielles ?
1 « Polyphonie de l’espace-temps » dans Écouter en découvreur, Karlheinz Stockhausen, trad. de L. Cantagrel et D. Collins, La rue musicale, Paris, 2016, p. 174.
2 « Telemusik », ibid., p. 109.
3 « Musique universelle », ibid., p. 134.
4 Ibid., p. 140.
5 United States Patent no 5. 973. 252 : « PITCH DETECTION AND INTONATION CORRECTION APPARATUS AND METHOD ». Nous traduisons. https://patents.google.com/patent/US5973252A/en
6 Entretien avec Andrew Matson dans le Seattle Times du 26 juin 2009. Nous traduisons.
7 L’utilisateur peut en effet régler « la vitesse à laquelle une note jugée fausse doit être poussée à la bonne hauteur » : moins la vitesse est grande, plus la transition se fera graduellement. « Gloire à l’Auto-Tune », Simon Reynolds, trad. de F. Quément et J.-F. Caro, Audimat 11, p. 21.
8 Ibid., p. 17.
9 Friction. An Ethnography of Global Connection, Anna Lowenhaupt Tsing, Princeton University Press, 2005, p. 6. Nous traduisons.
10 Japanoise. Music at the Edge of Circulation, David Novak, Duke University Press, 2013.
11 David Novak décrit deux vagues successives : Boredoms, Haino Keiji, Melt Banana, Omoide Hatoba, Ruins, Ghost, Grind Orchestra, Acid Mothers Temple, Ground Zero, Space Streakings, Zeni Geva, etc., dans les années 1980 ; Hijokaidan, Incapacitants, C.C.C.C., Solmania, Masonna, Monde Bruits, Astro, Aube, Government Alpha, Pain Jerk, K.K. Null, K 2, MSBR, Geriogerigegege, Violent Onsen Geisha et Merzbow au début des années 1990. C’est sur la base de ces deux vagues d’enregistrements que les auditeurs nord-américains forgèrent progressivement le nom du genre. Ibid., p. 11-12.
12 David Novak évoque le cas du groupe Boredoms, originaire d’Osaka, qui fut longtemps considéré comme une figure de la Noise malgré ses protestations réitérées. Ibid., p. 13-14
13 Ibid., p. 108.
14 Ibid., p. 5.
15 Ibid., p. 17.
16 Le retour en grâce de la cassette audio depuis quelques années est le signe d’une volonté partagée par un certain nombre d’acteurs de (re)trouver des réseaux de diffusion et de rencontre alternatifs à ceux qu’Internet offre depuis les années 2000.
17 Intitulée « From Feedback to Modularity: Hacking the Transcultural Sound Circuit » (« Du feedback à la modularité : pirater les circuits sonores transculturels »), dans Spectres de l’audible : sound studies, cultures de l’écoute et arts sonore, dir. par B. Gallet et M. Saladin, trad. de Michaël Spanu, La rue musicale, à paraître.
18 Propos recueillis par David Novak, ibid.
19 « L’ordinaire de la communication », dans La prise de parole et autres écrits politiques, éd. du Seuil, 1994, p. 172-174.
20 J’emprunte cette expression aux premiers mots du Finnegans Wake de James Joyce, qui poursuivent une phrase commencée à sa dernière page, bouclant le livre sur lui-même dans une circulation sans fin (où feedbacks et distorsions prédominent) : « Given ! A way a lone a last a loved a long the / riverrun, past Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs. », New York, The Viking Press, 1944 (1939), p. 629 et 3.