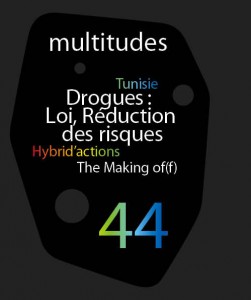Les images produites par une époque sont, évidemment, des expressions des subjectivités de cette époque ; signes de la forme comme elle se voit elle-même. Les images contemporaines – soit dans celles qui viennent de l’informatique, de la biotechnologie ou de la fiction scientifique – nous mettent souvent devant des figurations de l’hybridation entre l’humain et le synthétique qui nous éloignent d’une définition de l’humain exclusivement liée au « vivant » : les compositions avec le carbone cèdent place aux accords avec le silicium, dirait Gilles Deleuze[1]. Si, dans le champ de la techno-science, l’hybride est épisodiquement lié aux « étonnantes » découvertes scientifiques, une autre place de visibilité privilégiée exhibe le mélange de l’humain avec le synthétique d’une façon plus pervasive. Il s’agit de ces images médiatiques dans lesquelles la retouche digitale a assumé une dominance normative, répétant avec insistance une rhétorique visuelle de l’artifice. Cependant, non seulement le traitement d’images est devenu habituel, mais aussi la retouche digitale elle-même est devenue aujourd’hui un thème fréquent dans les médias.
Vrai et faux dans l’image contemporaine
Des polémiques récentes, comme celle concernant le blanchiment d’une chanteuse américaine[2] et un projet de loi en France proposant que toute image devrait venir accompagnée d’un avertissement à propos de son adultération[3], sont des exemples du soupçon qui guette l’image : elle n’arrive pas à convaincre qu’elle montre l’humain « naturel ». Cependant, ne serait-il pas plus correct d’affirmer que l’importance de cet « humain naturel » diminue de plus en plus dans l’image que nous nous faisons de nous-mêmes aujourd’hui ?
Un regard plus soigneux sur ce thème polémique ne peut pas ignorer la question : Tout compte fait, qu’est-ce qui serait vraiment en train d’être altéré ? On dirait que l’attaque n’est pas certainement dirigé à la « vraie représentation » du réel, en opposition à une « représentation corrompue » du même réel. Mais n’est-ce pas justement celle-là la forme par laquelle la discussion est présentée? Quand on accuse l’image contemporaine de « fausse », n’oppose-t-on pas un état « originel » de l’image à un état « altéré »? Ce duel se manifeste directement dans ce que, dans l’image, on apprend à identifier comme « inaltéré », à savoir, le signe photographique par excellence. Ainsi, la polarisation vrai/faux assume que la photographie traditionnelle représenterait « le réel » et la retouche serait du côté de la falsification.
La photographie et la peinture selon le pixel
Le dispositif qui est devenu emblématique des altérations dans l’image et est responsabilisé par son éloignement du « réel » ou « vrai » est, notoirement, le software Photoshop. Dans le présent essai, je propose d’examiner d’abord certains aspects de l’interface du Photoshop et ensuite réfléchir sur les images produites par lui, avec l’intention de mettre en évidence une certaine correspondance entre des discours autour de l’hybride humain-synthétique et des transformations des régimes dominants de représentation dans la contemporanéité.
La datation d’« inventions » technologiques comme la photographie, le cinéma, le Photoshop etc. est souvent accompagnée d’une anxiété quant à « l’avant » et « l’après » l’apparition de ces innovations. Ainsi, la perte du statut d’évidence de la photographie est créditée au surgissement du Photoshop. Cependant, condenser en un seul événement historique une telle responsabilité serait déconsidérer les multiplicités qui caractérisent l’outil technique et qui plusieurs fois se prolongent par-deçà et par-delà sa consolidation comme un événement. Les dates de naissance des appareils technologiques, en vérité, correspondent rétrospectivement à l’hégémonie ou mode dominant d’un dispositif déterminé.
Le concept de dispositif, tel qu’il a été formulé par Foucault et dédoublé par Gilles Deleuze et d’autres, permet une forme de penser les apparats technologiques au-delà de la cristallisation symbolique et de son insertion ponctuelle dans le calendrier des « révolutions ». La technique à laquelle on donne une identité unitaire (photographie, cinéma, image digitale) se répand, dans le concept de dispositif, comme un réseau de vecteurs historiques qui confluent et se maintiennent en cohésion sous une désignation, laquelle contient potentiellement une série de discours occultes qui peuvent devenir visibles moyennant un examen de leurs composants. Dans le présent essai, le concept est spécialement opératif pour identifier dans le Photoshop aussi bien ses héritages que ses possibles nouveautés. « Nous devons séparer en tout dispositif – dit Deleuze – les lignes du passé récent et les lignes du futur proche, la partie de l’archive et celle de l’actuel, la partie de l’histoire et celle du devenir (…)[4] ».
Pour essayer d’établir en quels termes il est possible de parler de la nouveauté du dispositif Photoshop, je propose de trouver dans son interface les aspects relatifs au passé récent de la visualité moderne – spécialement en ce qui concerne des questions autour du statut de la photographie – et à l’actuel régime duquel le Photoshop est, en même temps, intégrant et coproducteur.
L’écran d’ouverture du software fournit un bon commencement pour la discussion. Bien que le nom « Photoshop » (atelier de la photo) suggère la spécificité photographique, un examen des successives versions de son identité visuelle dénonce déjà, dans la promesse implicite de ses métaphores, qu’on n’est pas limité au domaine du photographique, mais à la promesse d’un mixage de techniques picturales et photographiques. La première version du logo évoque déjà les « Beaux Arts » : un œil inséré dans la forme d’un cadre. Les versions subséquentes assument de plus en plus des références à des clichés de la peinture et de la photographie : une ancienne caméra, une palette et un pinceau, la silhouette de plumes d’oiseaux dans lesquelles des couleurs tâchées suggèrent de la gouache ou de l’aquarelle, et ainsi de suite. Cette référence si évidente à la peinture est cohérente avec un des aspects fondamentaux du dispositif : la simulation, en un même outil digital, de techniques qui ont été, au cours de la visualité du XXe siècle, écartées et rivalisées en plusieurs aspects. Spécialement importantes dans cette mutuelle rivalité sont les qualités attribuées à chacune de ces techniques, en les séparant selon une polarité entre le « vrai » et le « beau». Comme Susan Sontag a observé de manière aiguë et concise, « L’histoire de la photographie pourrait être récapitulée comme la lutte entre deux différents impératifs : embellissement, qui vient des arts, et véracité, adaptée des modèles de la littérature du XIXe siècle et de la (alors) nouvelle profession du journalisme indépendant[5] ».
Ce qui reste sous-jacent au fond de cette « lutte » engagée dans l’intérieur de l’histoire de la photographie serait le conflit entre deux signes que Pierce a classifiés comme indiciaire ou iconique – des marques faites en contact direct avec le référent et des marques faites pour lui copier la ressemblance[6]. Ce que le Photoshop fait c’est réunir symboliquement, à travers les métaphores de son interface, deux procédés qui, auparavant, pleins de différences et de spécificités, trouvent ces différences techniquement nivelées par le pixel. Si la retouche d’une photographie traditionnelle demandait l’application de pigments avec pinceau et airbrush – dispositifs en tout étrangers aux opérations physico-chimiques impliquées par la caméra et par les procédés de développement – la retouche dans le Photoshop est exécutée par l’intermédiaire d’un procédé unifié : pratiquement toutes les opérations du software peuvent être réduites à une seule : le changement de l’indexation numérique de la couleur attribuée à chaque pixel. Ces opérations sont cachées à l’utilisateur par l’interface graphique, dans laquelle les icônes nous permettent d’entrevoir aussi bien des processus d’hybridation entre la peinture et la photographie (ou l’iconique et l’indiciaire) que le mélange de ces moyens avec d’autres totalement nouveaux.
La caisse à outils, déjà dans la version 1.0 du software, montre la réunion de métaphores techniques d’origine diverse. Des icônes qui se rapportent aux instruments de la peinture, comme le pinceau, l’airbrush, la gomme et le crayon coexistent avec des icônes qui symbolisent des techniques photographiques, comme focus, et des outils d’obscurcissement et blanchiment de l’image. Cependant il y a une icône qui ne vient ni des arts ni de la photographie. La métaphore du « cachet » – transférer de l’encre d’un tampon au papier au moyen de l’impression d’une image – se rapporte à l’opération essentielle de l’algorithme : transférer des valeurs chromatiques de pixels d’une région à l’autre de l’image. Cet outil, qui n’a aucune ressemblance avec les techniques de peinture, a été néanmoins, sans risque d’exagérer, la forme la plus efficace d’« embellissement », puisqu’il rend possible, par exemple, l’effacement de rides, en utilisant seulement des éléments existants dans la propre image.
La retouche exhibitionniste
On pourrait espérer que la précision obtenue par la manipulation de l’unité minime du pixel donne naissance à des images retouchées avec un aspect « naturel ». Dans ces images, la retouche n’apparaîtrait pas comme retouche, de même que l’idée d’une chirurgie plastique réussie était, au moins jusqu’il y a peu de temps, celle de cacher le procédé chirurgical. Mais ce qui est arrivé c’est l’opposé. À cause de sa nouvelle agilité, la retouche, qui – au niveau strict de l’outil – pourrait être utilisée discrètement pour cacher sa réalisation, finit par apparaître en premier plan dans la normalisation et l’uniformisation de la peau humaine dans les images médiatiques. La retouche devient exhibitionniste, semblablement aux lèvres gonflées de Botox, qui précipitent l’apparence du procédé de son application et de « maladies en vogue », comme l’anorexie et la vigorexie. Ainsi que, dans ces cas dans lesquels le sujet perd son référentiel, n’identifiant pas en soi-même maigreur ou gonflement suffisants, ces images perdent le contrôle et la mesure de leur super propreté, produisant une extrême homogénéisation.
Les procédés pour cette uniformité garantissent à la surface de l’image un niveau de contrôle qui peut être atteint difficilement avec des techniques strictement photographiques. Prenons les « corrections » de la tête humaine comme exemple. Outre les signes et rides, sont considérées comme des imperfections aussi la grandeur des yeux, du menton et du cou, tous les éléments pouvant être allongés, affinés, augmentés et pivotés. Un autre ennemi du visage poli sont les pores apparents. Des comparaisons entre « avant » et « après », aujourd’hui souvent divulguées dans des sites de designers spécialisés en retouche digitale montrent que le « peigne digital » corrige dans la photographie les porosités de la peau naturelle, générant une espèce de blindage. Les cheveux, partageant aussi l’obsession pour le lisse et privilégiant la force et l’uniformité, tombent sur le visage comme un tissu libre de ruptures et d’interruptions. Le cheveu aussi est blindé.
Toute cette esthétique de musée de cire, cette cristallisation glacée finit par éliminer de la photographie un de ses attributs les plus particuliers : la temporalité. Si le signe photographique actualise, comme le proposait déjà Roland Barthes, le « a existé »[7], ou encore, si sa spécificité indiciaire lui garantissait un rapport temporellement causal avec son référent, comme dans la classification de Pierce, enfin, si la photographie apporte un moment du passé, en le faisant coïncider avec le présent, les « photos » de mannequins dans les publicités de cosmétiques ne nous rappellent pas le passé, mais nous montrent un présent hypnotique. La rhétorique de l’image publicitaire est celle de l’intemporalité, exprimant la confection d’un visage qui utilise la capture photographique seulement comme base pour la « beauté éternelle ». On associe la matière humaine préfigurée dans la peau et dans le cheveu avec d’autres surfaces, dans une opération métaphorique qui prétend approcher l’organique de l’inorganique, ou post-organique. Ces images sont en consonance avec une subjectivité dans laquelle le corps cherche à se composer avec des matériaux et des superficies étrangers à son « état naturel ». Il s’agit d’une subjectivité que l’on voit déjà naturellement dans les compositions de l’humain avec des implantations de chips sous-cutanés, injections, silicone, Botox, transfert de la mémoire humaine à la machine etc.
Cependant cela ne veut pas dire que l’adjectif « artificiel » soit en déclin. Si l’on pense aux polémiques mentionnées au début de ce texte, on peut conclure que la retouche exhibitionniste rend l’artifice perceptible. Mais cette perception n’est possible que par la référence à des régimes de visualité antérieurs, dans lesquels – au niveau du sens commun, bien entendu – la photographie était associée au véridique et la peinture à l’ornement.
Avec l’artifice, ce qui apparaît en premier plan c’est l’hybride lui-même, exprimé esthétiquement dans l’image, soit pour nous séduire soit pour nous effrayer. L’hybride, évidemment, doit apparaître comme différence, ayant besoin d’inclure quelque chose de plus véridique pour qu’on puisse remarquer ce qui est lu comme « interférence ». Et, dans ce registre esthétique, depuis les premières icônes de l’interface du Photoshop jusqu’aux images par lui générées, l’opération implique une tension entre le signe photographique et le signe pictural qui n’est plus fruit du conflit de techniques diverses, mais produit d’une fusion. Ainsi, les images publicitaires re-territorialisent dans le pixel ces deux vecteurs historiquement constitués, de telle façon que la photographie cesse d’être seulement véracité et la peinture cesse d’être seulement embellissement, pour qu’elles puissent, ensemble, garantir la mise en scène et la rhétorique de l’hybride humain-synthétique.
Traduit du portugais du Brésil
par Maria Helena Martins