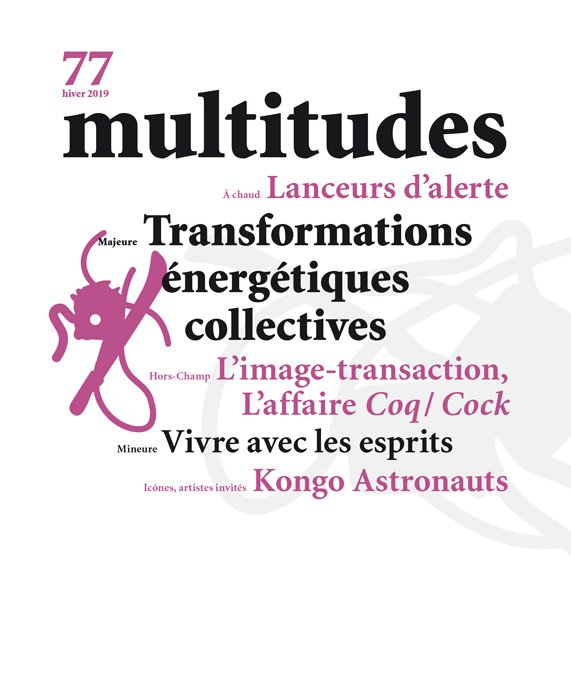En javanais, ngalor-ngidul signifie littéralement « aller-venir du nord au sud ». Mais aujourd’hui, ce terme désigne une conversation sans queue ni tête. C’est parce que nous avons oublié que l’eau de l’océan – au sud – et le sable du volcan – au nord – ont commencé à parler bien avant les hommes. Aussi avons-nous qualifié de « catastrophes naturelles » le séisme de 2006 et l’éruption de 2010 qui ont frappé la province de Yogyakarta. Alors que le volcan et l’océan sont les derniers locuteurs de cette langue à laquelle nous n’entendons plus rien : ngalor-ngidul. Seule Bu Pujo, la chamane du village sacré sur le mont Merapi, morte dans l’éruption, parlait encore cette langue du tohu-bohu…
Par chance, il y a cet almanach de divination, sorte de miraculé, dont j’ai hérité le dimanche où les amants du volcan étaient montés nettoyer les ruines de la maison de Bu Pujo. Après avoir creusé dans la couche de cendres encore chaude à une profondeur de deux mètres, leurs bêches avaient buté contre une armoire. Sri, la fille unique de Bu Pujo, ne voulait rien garder de tous ces débris qui sentaient le brûlé et la mort, sauf une liasse de billets de 2 000 roupies (15 centimes) qu’elle avait retrouvée presque intacte dans une boîte en bois. C’était là plusieurs années de son très modeste salaire de servante du palais que Pu Bujo économisait pour ses petits-enfants. C’est dans cette même armoire que les amants du volcan avaient trouvé l’almanach de divination, un amas de feuilles que la violence du souffle volcanique avait comprimées, puis cimentées avec le sable. Comme Sri voulait s’en débarrasser, j’avais glissé l’almanach dans un sac en plastique, sans savoir vraiment pourquoi j’emportais chez moi cette relique.
Ma maison, comme toutes celles situées dans le périmètre des vingt kilomètres au sud-ouest du cratère du Merapi, avait été envahie pendant plusieurs semaines par les cendres. Une fois chez moi, l’amas de feuilles s’était mis à faire l’éponge, et à absorber les cristaux gris encore en suspension sous les tuiles du toit que la pluie décollait. Bientôt sous le sac en plastique devenu étuve, l’almanach de divination avait commencé à dégager une odeur suffocante, mélange d’humus carbonisé, de poussières sulfureuses, de matières en putréfaction. Sorte de précipité du drame. J’avais failli le jeter. D’autant qu’il ne s’agissait, à vrai dire, que de l’édition récente d’un almanach de numérologie très commun, imprimé à des milliers d’exemplaires, cumulant des tableaux qui mettaient en résonance les jours lunaires et solaires avec les couleurs, les points cardinaux, les métaux, les liquides, les arbres et les plantes, les oiseaux, les divinités de l’horoscope et la position du dragon qui porte et fait tourner la Terre. Ceci afin de déterminer les jours propices ou néfastes pour se marier, nommer un nouveau-né, partir en pèlerinage, monter une charpente, creuser un puits ou désenvoûter un enfant mal né. Si je ne l’avais pas jeté, c’était à cause de Bu Pujo, de sa parole de tohu-bohu emportée dans la nuée ardente que je n’avais jamais pris la peine d’écouter. Espérais-je que ce manuel de magie populaire extrêmement codifié, abusivement qualifié de divinatoire, ne portant aucune annotation manuscrite de Bu Pujo, aurait un jour le pouvoir de restituer cette parole ? Cet espoir était insensé. Mais le temps des catastrophes ne distingue pas ce qui est sensé de ce qui ne l’est pas. Il est au-delà du sens.
Chaos cosmique et bureaucratie palatine
Bien qu’elle ne fût ni plus grande, ni plus corpulente que les autres villageoises, Bu Pujo avait quelque chose d’une géante. Elle se tenait toujours aux côtés de Mbah Marijan, le gardien du volcan, lorsque les offrandes étaient présentées une fois par an au Merapi. C’était elle qui cuisinait la résine de benjoin, les pétales de roses et de jasmins et les pièces de monnaie en fer blanc sur la grosse pierre de l’autel, face aux deux statues de Ganesh. Puis on la voyait s’agiter, ses bras s’ouvraient dans un mouvement ascendant, les paumes de ses mains tournées vers le ciel. Son regard traversait l’écran du monde et semblait vide tant il s’emplissait d’une toute autre réalité. Sa parole devenait incohérente, elle se désaxait comme pour s’accorder à une nouvelle syntaxe, celle du volcan, ou à une architecture sonore encore plus haute et essentielle que personne, même ses proches, ne saisissait. On disait alors communément qu’elle était en transe et dialoguait avec les esprits du Merapi. En fait, elle parlait la langue du tohu-bohu. A ses côtés, Mbah Marijan restait silencieux, presque fermé. Ce n’était que lorsqu’elle avait épuisé la transe que le gardien du volcan prononçait la prière coranique. Puis il procédait à l’inventaire des offrandes envoyées par le sultan. Il était aux ordres de la bureaucratie palatine, Bu Pujo était au service du chaos cosmique. Les offrandes terminées, elle disparaissait de l’espace public et regagnait l’ombre de son foyer. On oubliait même l’avoir vue aux côtés de Mbah Marijan, qui occupait toute la place.
Le titre complet de cet homme vénéré comme un vieux sage, était « gardien des clés du Merapi ». Un titre qui lui avait été attribué par le sultan de Yogyakarta. Bu Pujo, elle, n’avait pas de titre, sinon celle de « servante du palais ». La servante géante. Et le gardien des clés. Des clés pour ouvrir quoi ? Les portes du palais. Car le Merapi était considéré comme une réplique du palais du sultan tout en bas dans la plaine, mais un palais réservé aux morts. Mbah Marijan m’avait raconté comment il était entré une nuit en rêve dans ce palais. À cette époque, il n’était pas encore gardien des clés. Il était monté jusqu’à la « ceinture », c’est-à-dire la frontière entre la végétation et la roche et s’était endormi là. Dans son demi-sommeil, il avait été approché par une femme très belle, dénommée Dame Jasmin Vert, qui lui avait offert un petit tabouret bas et lui avait ouvert la porte monumentale du palais, verte elle aussi. À l’intérieur, c’était le cratère du volcan. Il y avait là une vaste salle pleine de chaises, toute bien ordonnées. L’accès à la vaste salle était gardé par un employé assis en face d’une table sur laquelle était posé un livre. Mbah Marijan n’avait pas eu le droit de s’asseoir sur une chaise, mais au sol, sur un tapis. Le rêve ne disait pas ce qu’il avait fait du petit tabouret bas offert par Dame Jasmin Vert, mais il est possible qu’il l’ait rapporté chez lui au sortir de son songe, car j’avais noté que sa femme s’asseyait sur un tabouret tout à fait semblable dans sa cuisine lorsqu’elle épluchait les légumes ou attisait les braises à même la terre.
Bu Pujo, elle, ne m’avait jamais raconté ses rêves. Je ne l’avais entendue qu’une seule fois parler de ses affaires avec le Merapi, lorsqu’un soir d’orage elle était montée de sa maison en contrebas du village chez Mbah Marijan. Elle avait raconté comment, trois jours après la cérémonie des offrandes, elle sortait en cachette de sa cuisine. Elle s’en allait loin, seule, sans escorte ni provision de route. Elle n’empruntait pas le sentier des offrandes, mais montait en amont de la rivière Jaune, puis pénétrait dans une épaisse forêt le long d’un ravin accidenté en direction de la grotte du Tigre, et plus haut encore. Elle traversait à gué un torrent gris dont elle était la seule à connaître l’existence, jusqu’à un rivage multicolore. Elle cueillait là deux fleurs rares qui poussaient dans les interstices des pierres : la gandapura, et la kalajanna. L’une était rouge vif, l’autre vert tendre. Elle rapportait ces deux fleurs rares au village, avec une poignée de soufre, et les confiait à Mbah Marijan qui les emportait à son tour au palais, au bureau des affaires rituelles, comme preuve que la cérémonie des offrandes s’était déroulée conformément au protocole. Personne n’avait jamais accompagné Bu Pujo jusqu’à ce rivage multicolore, pas même son mari, Pak Pujo, le maître palefrenier.
Une fois tous les huit ans, lors des « grandes offrandes » au volcan, Pak Pujo harnachait richement le cheval sacré et le conduisait à la bride en tête de la procession. Tout au long de l’ascension, il marchait à ses côtés sans jamais le monter, car ce cheval était une créature fabuleuse qui lui avait été confiée par le sultan. Ses fonctions demeuraient obscures. Peut-être témoignait-il pour tous les animaux qui avaient été jadis sacrifiés au sommet du volcan ? Quoi qu’il en soit, Pak Pujo ne s’en séparerait pour rien au monde. Et comme le plan d’évacuation de l’Agence nationale de prévention et de gestion des catastrophes naturelles ne prévoyait aucune mesure pour évacuer les bêtes, il était clair qu’en cas d’alerte, Pak Pujo ne partirait pas. Sa vie était liée à cet animal fabuleux, comme la vie de Bu Pujo l’était aux fleurs de gandapura et de kalajanna.
Leur maison était en pierre et le sol en terre. Elle était construite sur une sorte de petit plateau à droite en montant au village, et servait de gîte à la bande des amants du volcan qui s’étaient inventé là leur propre rituel. Quand le brouillard froid jetait sur la nuit son linceul trempé, ils mangeaient un bol de nouilles instantanées ou buvaient un verre de café au gingembre très sucré, accompagné d’arachides cuites à la vapeur ou d’une banane frite. Ils parlaient alors de déconstruire la laideur du monde et de planter dans ses ruines un vaste champ de ces fleurs si rares, nécessaires aux offrandes, pour que Bu Pujo n’ait plus besoin d’aller les chercher si loin en forêt. Puis quand leurs conversations clandestines s’épuisaient, ils s’enroulaient dans leur sarong et s’étendaient sur le large banc en bambous qui occupait la moitié de la pièce centrale. Des bambous immenses, de dix ou douze mètres de longs, comme on n’en avait jamais vu nulle part. C’était bien là assurément la maison d’une géante. C’était en fait le seul signe visible du gigantisme de Bu Pujo, et tous les amants du volcan s’endormaient confiants dans sa mansuétude gigantesque.
Lorsqu’ils se réveillaient pour faire l’ascension du volcan, Bu Pujo les accompagnait dans le brouillard froid jusqu’aux grands bambous de la route. Elle avait une manière très particulière de dire au revoir à ses hôtes. Elle ouvrait ses bras dans un mouvement ascendant, les paumes de ses mains tournées vers le ciel. Son souffle se faisait court, comprimant sa poitrine comme s’il lui pesait de les voir partir, comme s’ils étaient ses propres enfants. En fait, c’était le même geste que celui qu’elle traçait devant l’autel des offrandes. Toujours occupée à porter et à offrir. Porter et offrir. Par ce geste, elle élevait tous ses hôtes à sa gigantesque bonté.
L’extinction de la langue du tohu-bohu
Mais déjà, dans le village, on commençait à dire que Bu Pujo divaguait. La langue du tohu-bohu qu’elle était seule à encore parler faisait désormais peur. On disait aussi que brûler de l’encens était un acte satanique. Lors des offrandes de 2009, Mbah Marijan guidait la procession sous un parasol d’or qui n’éclairait plus rien. Derrière lui, Bu Pujo était méconnaissable. Elle avait la tête serrée dans un foulard noir qui obscurcissait son regard. Elle ne semblait pas voir le volcan radieux. Toutes les femmes du village portaient le même voile noir et grimpaient à sa suite en une colonne sinistre, tandis que les paniers de riz sur leur dos tremblaient de tant de mélancolie. À la station supérieure des offrandes, la grande pierre gravée aux armes du palais était toujours en place, mais les deux statues de Ganesh étaient décapitées. L’islam fondamentaliste avait lancé son filet gluant jusqu’au sommet du volcan…
Dans l’aube qui succéda à l’éruption du 26 octobre 2010, Bu Pujo succomba à ses brûlures. À cette nouvelle, le volcan disparut. Il ne restait plus, au nord, qu’un écran de nuages figés dans l’épouvante. Cela faisait un grand vide, un immense courant d’air froid dans lequel la montagne de feu avait été emportée. Au petit matin, le Merapi avait disparu parce que celle qui le portait était morte. Oui, Bu Pujo portait le volcan comme ces lourds paniers d’offrandes qu’elle chargeait sur son dos le jour de la procession. Elle en portait la responsabilité, comme son propre enfant, avec ses prodiges et ses tares. Voilà pourquoi Bu Pujo avait l’air d’une géante.
Le lendemain, on l’enterra dans une fosse commune avec les trente-trois autres villageois de Kinahrejo soufflés par l’éruption. Le corps de Mbah Marijan, lui, fut inhumé le même jour, à la même heure, dans un caveau à part, cent mètres plus haut. Jusque dans sa dernière demeure, la servante géante sera restée dans l’ombre. Qui allait désormais parler ngalor-ngidul, la langue du tohu-bohu ?
Quelques jours plus tard, vingt-et-un autres volcans de l’archipel entrèrent dans une phase d’activité intense : le Seulawah Agam, le Sinabung, le Talang, le Kerinci, le Kaba, l’Enfant du Krakaoa, le Papandayan, le Slamet, le Bromo, le Semerau, le Batur, le Rinjani, le Sangeang Api, le Rokatenda, l’Egon, le Soputan, le Lokon, le Karangetang, l’Ibu, le Dukono et le Gamalama. Etrange phénomène de contagion, à l’image de la transe javanaise qui s’empare d’un danseur de reog puis se propage sur ses camarades. Avec 17 000 îles et 150 volcans situées sur la ceinture de feu du Pacifique, les Indonésiens savent que leur terre n’est qu’un accident de relief surgit des caprices de l’océan. Le tremblement de terre de Palu, à Célèbes, le 28 septembre 2018, doublé d’un tsunami et d’une terrifiante liquéfaction, puis l’éruption de l’Enfant Krakatoa le 23 décembre de la même année qui provoqua un séisme et un tsunami, les ont rappelés à nouveau à ce prodigieux sens de l’éphémère.
Extraits aléatoires d’un livre à paraître sous le titre « Le Très Bel Arbre »