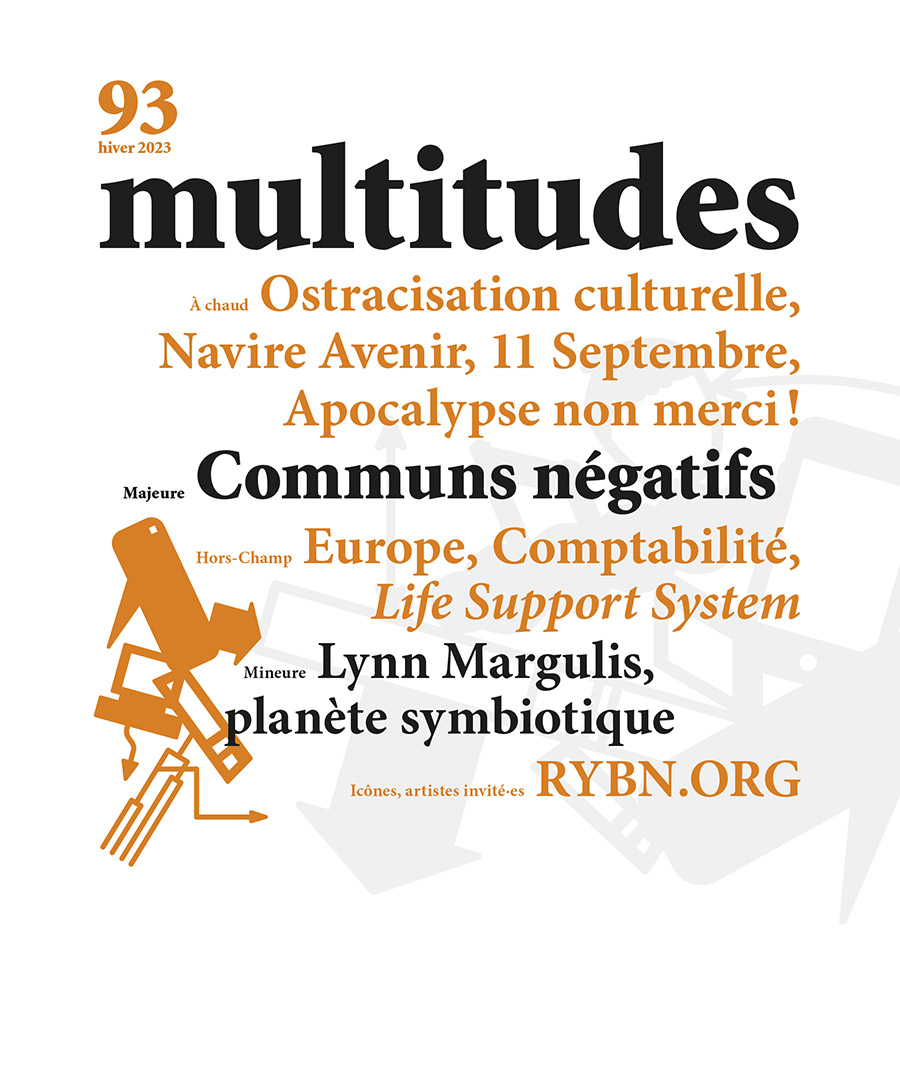Les écologies queers : des activismes et des sciences peuplées de créatures indociles. Dedans, il y a des lesbiennes en colère qui luttent contre le nucléaire, des trans rurales qui envahissent les villages et des pédales qui retournent à la terre1. Mais dedans, il y a aussi : des mouettes gouines, des pingouins pédés et des trouples d’oiseaux ; des colibris drag king qui arborent des couleurs chatoyantes (à l’instar de la plupart des oiseaux) tout en pondant des œufs (à l’instar de la plupart des oiselles) ; des plantes à fleur qui se rencontrent à distance avec des dildos transespèces (appelés poliment des « insectes pollinisateurs ») ; des espèces de lézards entièrement femelles ; des limaces léopard intersexes et des étoiles de mer qui se reproduisent asexuellement ; des champignons dotéEs de pas moins de 27 000 sexes et des protistes capables de produire 500 sortes différentes de cellules sexuelles2.
Les écologies transpédégouines sont la contre-nature qui se défend contre les visions hétéropatriarcales du vivant : quantités de vies queers y contestent la naturalité ou la prétendue supériorité évolutive du sexe reproductif et de la binarité des genres. Mais les écologies queers, ce sont aussi la contre-nature qui se défend contre la science moderne/coloniale : celle qui prétend « décrire » un monde pourtant étonnamment ressemblant au monde capitaliste, peuplé d’individus égoïstes censés être en compétition sur des places de marché (au sexe) pour la transmission de leurs patrimoines (génétiques). C’est ainsi que différentes chercheureuses queers se sont retrouvées à étudier des histoires de symbiose, de solidarités et d’alliances entre vivants, tandis qu’une multitude de symbiologistes se sont progressivement retrouvées à mettre au jour des vies qui déviaient des normes patriarco-coloniales 3. Cette rencontre entre féminisme queer et biologie se produit sur un terrain idéologiquement miné, où l’interdépendance, l’entraide, l’homosexualité et la variance de genre, quand leur existence est admise, sont encore vues, comme des « sensibleries » ou comme des comportements opportunistes, plutôt que comme des formations sociales à part entière.
En hommage critique aux héritages queers d’une des grandes propagatrices des théories de la symbiose, la bactériologiste Lynn Margulis, cet article se demande ce que les vies queers font à l’interdépendance, ce qu’elles ont à apprendre des bactéries, et quelles puissances politiques tirer des myriades de genres et de sexualités que Gaïa exhibe à qui veut bien se doter des bonnes lunettes (à paillettes) pour la regarder.
Le sexe comme cannibalisme avorté : l’hypersexe des bactéries
Lynn Margulis est célèbre pour sa théorie de l’endosymbiogenèse, un récit (aujourd’hui le plus communément admis) de l’émergence des êtres multicellulaires. On peut la raconter ainsi : dans la soupe de l’océan primaire, des créatures unicellulaires évoluent, dont certaines se mangent les unes les autres. Parmi les différentes stratégies développées pour survivre à cette situation, certaines se dotent de motilité, certaines se rendent allergiques les unes aux autres, et certaines, enfin, développent une technique bien particulière : elles se rendent indigestes. Des proies, originellement consommées par leurs prédatrices, s’apprennent ainsi à vivre dans le corps de celles qui, autrement, les auraient digérées. Elles s’abritent dans le ventre de celles qui les dévorent, et créent ainsi un « holobionte », une créature à plusieurs cellules, une somme de symbiotes.
Plus généralement, Lynn Margulis a la conviction que les bactéries ont inventé l’essentiel des comportements que les formes de vie ultérieures ont perdu et mis des millénaires à « récupérer ». Parmi ces inventions bactériennes, on trouve le sexe par méiose – la sorte de sexe que la plupart des animaux et des plantes pratiquent, par fusion de cellules sexuelles « réduites » (méiosées) ou « divisées » en deux puis recombinées. Elle reprend le récit de cette invention chez les protistes (micro-organismes dotés d’un noyau) par le biologiste L. R. Cleveland :
« Cleveland avait observé des tensions assez particulières dans les communautés [de protistes] en danger de mort : une amastigote affamée se retrouvait à dévorer sa voisine ; tandis qu’une autre se tortillait pour échapper à une prédatrice potentielle. Puis il réalisa qu’il était en train d’observer des formes de cannibalisme avortées. Certaines cannibales mangeaient et ingéraient jusqu’à la dernière cellule de leurs victimes, mais d’autres pouvaient souffrir d’indigestion, et épargner le nucléus et les chromosomes de celles qui leur avaient servi de repas. Les deux bactéries ainsi partiellement fusionnées constituaient une nouvelle cellule unique dotée de deux noyaux, et de deux ensembles de chromosomes. Cleveland, vivant quotidiennement dans son microcosme, put observer la trêve qui mit fin à ces cannibalismes : deux cellules voisines, fusionnant leurs noyaux au lieu de se manger. Cleveland reconnut là un équivalent formel à la fertilisation4. »
Cette description s’accompagne d’une image de Dorian Sagan, le fils de Lynn Margulis, où l’on voit un protiste « manger l’anneau de fertilisation » d’un autre par derrière, sobrement sous-titrée : « Accouplement de deux protistes. Le cannibalisme avorté chez les protistes a mené à la conclusion d’une trêve qu’on appelle le sexe. »
Lynn Margulis retire de ce récit des origines sa description générale du sexe : un « transfert horizontal » ou un « don de gènes » (une transgénie5). Cette définition inclut dans le sexe toutes sortes d’échanges génétiques qui peuvent se produire par ingestion (partielle ou totale), par friction, ou par fréquentation des mêmes milieux. Le sexe entre bactéries ne s’embarrasse ni des frontières entre espèces, ni même des frontières entre vie et non-vie (une bactérie peut avoir du sexe avec l’air ou l’eau qui l’entoure). Pas besoin de progénitures non plus : les partenaires sexuelles s’entre-altèrent, se passent des séquences génomiques de l’une à l’autre, ou laissent derrière elles des déchets que d’autres pourront s’accaparer puis abandonner.
Il est important de le souligner, pour Lynn Margulis, le sexe reproductif observé chez les plantes et les animaux présente un désavantage évolutif : il est à la fois plus lent et moins complexe. Le sexe reproductif et la binarité sexuelle mâle/femelle sont ainsi présentés comme des résultats accidentels, qui se sont simplement maintenus parce qu’ils n’étaient pas particulièrement nocifs. Voilà de quoi laisser toute la place aux reproductions asexuelles, aux vies intersexes et aux échanges érotiques non reproductifs dans le tableau général de la vie.
Vous êtes combien là‑dedans ? :
ce que la symbiose fait à la sexualité
Le tableau dressé par Lynn Margulis de l’« hypersexe » bactérien présente un contre-discours sur le sexe qui a de quoi alimenter les besoins des écologies queer en sexualités non-normatives. Pourtant, Lynn Margulis (surtout quand elle écrit avec son fils) a des propos souvent brutaux à l’égard des minorités sexuelles chez les mammifères. Ainsi, la première (et quasi-unique) mention de l’homosexualité dans Qu’est-ce que le sexe ? porte sur « les rats en situation de surpopulation qui se livrent à la violence de gang, à l’homosexualité et à l’auto-mutilation6 ». Et si les personnes trans* sont mentionnées avec une relative générosité dans La danse mystère. À propos de l’évolution de la sexualité humaine, une vision hétérocentriste et sexiste y reste désespérément la norme.
Sans chercher à sauver à tout prix Lynn Margulis d’elle-même, on peut cependant dire que si elle n’est pas très douée pour parler de la diversité de la sexualité humaine, c’est parce qu’elle y voit plutôt, en bonne bactériophile, une forme dégradée de l’hypersexe bactérien. Elle va ainsi jusqu’à écrire que « la symbiogénèse est infiniment plus splendide que le sexe 7 » (autrement dit : le sexe entre bactéries, c’est tout de même beaucoup mieux que le sexe entre êtres humains). Et elle ajoute :
« “Nous”, une sorte d’édifice baroque, sommes reconstruit·es entièrement à peu près tous les vingt ans, par toute une batterie de bactéries qui ne cessent de fusionner et de muter. Nos corps sont faits de cellules sexuelles de protistes qui se clonent par mitose. […] De ce point de vue, notre sens très marqué de la différence qui nous oppose aux autres espèces, le sens que certain·es d’entre nous avons de la supériorité de notre espèce, est une mégalomanie mal placée […] qui obscurcit la vérité symbiogénétique plus large de nos composants multi-espèces. La multicomposition est notre nature 8. »
En tant que résultats incessamment renouvelés de symbiogenèse, nous sommes le site d’une activité sexuelle permanente, ou plus exactement nous sommes nous-mêmes cet échange hypersexuel constant entre les différentes cellules qui composent nos corps.
Mais alors, comme le demande David Griffiths dans sa « Théorie queer pour les lichens », « si nous n’avons jamais été des individus – si nous sommes toustes composites, comme les lichens – qu’est-ce que cela implique pour la sexualité 9 ? » À cette question, des réponses écosexuelles plus ou moins foutraques ont été amenées par diverses créatures, telles que : des universitaires trans*écologistes (Eva S. Hayward, ses « femmes-araignées » et ses transitions-régénérations étoiles-de-mer), des militantes du mouvement EcoSex (Annie Sprinkle et Beth Stephens et leurs mariages avec la Terre) ou encore des artistes post-porn qui mêlent leurs chairs avec celles des plantes (le duo Quimera Rosa et son projet Trans*plant). Dans ces différentes aventures comme dans celle de Lynn Margulis, l’enjeu est de déstabiliser les humanités par ce qu’on pourrait appeler des inhumanités queer, des affirmations et des investissements de la nature définitivement débordante, et des multitudes qui se rencontrent à chaque fois que nous faisons du sexe, dansons ensemble dans une fête, ou crions ensemble dans la rue.
Des parentés queer :
micro-ontologie et sélection sociale
La théorie de la symbiose a-t-elle des choses à nous apprendre sur les formations sociales transpédégouines et sur les manières obliques de faire famille et de veiller les unes sur les autres ? Un élément clef des argumentaires concernant la contre-naturalité des vies queers tient dans ce qu’on appelle depuis Darwin la « théorie de la sélection sexuelle » qui veut qu’à l’intérieur d’une espèce donnée, les individus soient en lutte pour transmettre leurs patrimoines génétiques personnels. Dans un tel cas, les pédés et les lesbiennes n’auraient par exemple pas grande capacité à intervenir dans l’histoire de l’évolution – à moins de s’allier pour faire des bébés, comme on sait par ailleurs que cela a longtemps été le cas dans l’histoire humaine. Mais plutôt que de dire que si si, les queers se reproduisent iels aussi, des théoricien·nes de la symbiose ont proposé de déplacer la question : et si c’était l’idée même de course à la transmission du patrimoine génétique individuel qui était fausse ? Et si les vies queers, humaines et pas qu’humaines, attestaient justement d’autres facteurs dans l’évolution ?
Il se trouve que les théories de la sélection sexuelle, centrales dans les argumentaires queerphobes naturalistes, forment également la clef de voûte de la plupart des plaidoyers en faveur des biologies de la compétition et du gène égoïste. Ces biologies compétitives ne sont pas les seules disponibles, même si elles sont dominantes. Et de même qu’il est bien établi que Spencer a dévoyé le darwinisme avec sa théorie de la « survie du plus apte », de même on peut aisément montrer que les partisans de la guerre des sexes et de la compétition ont politisé leur description d’un monde où les femelles éprouvent le besoin de se reproduire avec des mâles « supérieurs », engendrant une « guerre » des mâles entre eux, des femelles entre elles, et même des mâles à l’assaut des femelles10.
Le caractère idéologique des théories de la sélection sexuelle a notamment été démontré avec rigueur par la biologiste transféministe Joan Roughgarden dans un plaidoyer contre les dévoiements du darwinisme, Le gène généreux. Pour un darwinisme coopératif. Roughgarden n’y cache pas les enjeux de justice sociale impliqués par son travail :
« La théorie de la sélection sexuelle présuppose une hiérarchie génétique lorsqu’elle naturalise un mythique “besoin de femelles” de localiser et de copuler avec les mâles dotés des meilleurs gènes. Ainsi comprise, la sélection sexuelle est une affaire d’aristocratie génétique. Pour moi, la réalisation d’une société égalitaire dépend d’une réfutation rationnelle de la sélection sexuelle. Si la sélection sexuelle est, en définitive, vraie, qu’il en soit ainsi ; et l’idée d’une société égalitaire n’est qu’un vain mirage. À l’inverse, si la sélection sexuelle n’est pas vraie, alors il ne faut pas attendre qu’elle s’éteigne doucement de sa belle mort. Il faut la discréditer, haut et fort, de peur que sans cela, la sélection sexuelle persiste dans les livres comme un obstacle à la justice sociale11. »
Pour contester la théorie de la sélection sexuelle, Roughgarden invite les communautés scientifiques à mettre à l’épreuve des faits une hypothèse alternative, qu’elle propose de nommer « théorie de la sélection sociale ». Elle arrive à cette théorie dans L’Arc-en-ciel de l’évolution. Diversité, genre et sexualité dans la nature et chez les humains 12, qui s’appuie sur un recensement des manières (queers et moins queers) de faire famille et de prendre soin des générations13. Elle y montre comment la diversité des rôles de genre, les adoptions homo ou multiparentales, les transitions sexuelles, les vies intersexes, les reproductions assexuelles, sont autant de solutions variées qui sont données, non pas tant à la question de savoir comment transmettre un patrimoine génétique individuel, mais plutôt à celle de savoir comment veiller à la survie des générations. Du point de vue de la théorie de la sélection sociale de Roughgarden, ce qui est « sélectionné », c’est le comportement ou les caractéristiques génétiques des collectifs multi-espèces qui sont impliquées dans la « survie des rejetons », et non celles des seuls parents génétiques. Autrement dit, ce n’est pas moi, mais « nous » – nous, collectives d’humaines et de pas qu’humaines, qui veillons aux futurs de nos plus jeunes – qui survivons, ensemble.
Un cas bascule pour Roughgarden est représenté par une espèce d’oiseaux échassiers, le combattant varié européen, dotée de mâles à cols blancs et de mâles à cols noirs qui forment des trouples avec une femelle. Pendant la période de nidification, les mâles à cols noirs défendent un territoire, appelé « lek », tandis que les mâles à cols blancs accompagnent les femelles occupées à se nourrir. Vient ensuite un temps où les cols blancs visitent les « leks », où ils sont invités par les cols noirs à se joindre au nid, les femelles ne se joignant qu’au dernier moment, et présentant une « préférence pour copuler avec une paire de mâle col noir /col blanc, plutôt qu’exclusivement avec un mâle à col noir14 ». Les livres de Roughgarden sont remplis de cas similaires qui présentent, rassemblés, tout un éventail d’« exceptions » à l’idéologie de l’égoïsme reproductif – des exceptions qu’il nous faut, de toute urgence, apprendre à renommer.
Comme le remarque en effet la sociologue queer écologiste Myra J. Hird, les enjeux portés par la biologie (compétition vs. symbiose) ne sont pas séparables des politiques qui s’inventent pour penser la responsabilité environnementale face à la crise écologique (changer les habitudes individuelles vs. lutter collectivement contre le capitalisme extractiviste).
« Le principe néodarwinien selon lequel la sélection naturelle opère au niveau individuel […] permet de considérer que les individus étant égoïstes, la responsabilité envers l’environnement demande un engagement bien trop ésotérique comparé aux désirs individuels immédiats. Qu’une telle explication de notre situation actuelle puisse s’appuyer sur le néodarwinisme n’est pas sans importance. Elle nous distrait de formulations alternatives, y compris des manières autrement éthiques de penser les rencontres entre espèces ou de s’engager dans des luttes plus globales contre le changement climatique15. »
Hird a travaillé dans le laboratoire de Lynn Margulis et voue son admiration à celle, écrit-elle, qui « a aidé les microbes à crier ». Ce cri des microbes est résumé par Lynn Margulis elle-même dans une interview au New York Times intitulée « GAIA IS A TOUGH BITCH ! » :
« Gaïa, c’est une peau de vache, une dure à cuire. Les gens pensent que la Terre va mourir et qu’il faut la sauver. C’est ridicule. Si vous débarrassez la Terre de ses fleurs, les êtres humains vont mourir, mais voilà tout. La Terre a existé sans plantes à fleur pendant la quasi-totalité de son histoire. Il n’y a aucun doute sur le fait que Gaïa compensera nos excès de gaz à effet de serre ; simplement, l’environnement qu’elle laissera derrière elle ne sera pas très hospitalier pour les gens16. »
Ce que Hird appelle la micro-ontologie de Lynn Margulis – son attention, non seulement aux vivantes qui sont « grosses comme nous », mais aussi à tout un univers bactériel microbiologique qui défie nos manières de vivre et de penser – a de quoi appeler à l’humilité. Mais humilité ne veut pas dire inaction. Au contraire, avec l’hypersexe bactérien, nous « édifices baroques », habitant·es de Terra, avons de quoi être chargées à bloc : nous sexons, nous vivons, nous luttons, en multitudes, aux côtés de multitudes.
Une première version de cet article est parue dans le numéro 2 de la revue Trou noir à l’automne 2023.
Merci à Léa Rivière, avec qui le slogan Nous sommes la contre-nature qui se défend
s’est tissé au détour d’une conversation, à Anne Querrien et Alice Cuvelier pour leurs relectures, et à Jay Jordan et Isabelle Frémeaux, qui m’ont glissé quelques‑uns des texte cités ici alors que j’écrivais cet article en squattant chez iels, et notamment leur très essentiel We Are « Nature » Defending Itself. Entangling Art, Activism and Autonomous Zones, paru chez Pluto Press en 2021.
1Myriam Bahaffou, Des paillettes sur le compost. Écoféminismes au quotidien, Lorient, Le Passager Clandestin, 2022 ; Léa Rivière, L’odeur des pierres mouillées, Rennes, Éditions du Commun, 2023 ; Cy Lecerf Maulpoix, Écologies déviantes. Voyage en terres queers, Paris, Cambourakis, 2021.
2Pour un élargissement de ce bestiaire queer, on peut se reporter en français au zine anonyme Zoologie queer, infokiosque.net, 2020, ou à Fahim Amir, Révolutions animales, (2018), traduit de l’allemand (Autriche) par Samuel Monsalve, Paris, Divergences, 2022.
3Cf. Kriti Sharma, « “Make Ourselves Anew”: Towards a Radical Biology », Science for the People, vol. 23.3, 2020 ; Tatiana Giraud, Dynamique de la biodiversité et évolution, Paris, Collège de France, 2022.
4Lynn Margulis, The Symbiotic Planet. A New Look At Evolution, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1998, p. 126-127 ; Lemuel Roscoe Cleveland, « The Origin and Evolution of Meiosis », Science, vol. 105, 1947.
5Lynn Margulis et Dorion Sagan, What Is Sex?, New York, Simon & Schuster Éditions, 1997, p. 52.
6Ibid., p. 137.
7Lynn Margulis, Symbiotic Planet, op. cit., p. 89.
8Ibid., p. 98.
9David W. Griffiths, « Queer Theory for Lychens », UnderCurrents, vol. 19.1, 2015, p. 36.
10Les bénéfices des études féministes matérialistes sur la naturalisation de la culture du viol et de l’appropriation du corps des femmes sont ici nombreux pour nous apprendre à voir le caractère crassement idéologique (« l’idéologie, c’est l’histoire présentée comme nature ») de ces descriptions. cf. notamment Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualités. Introduction à la philosophie féministe, (2008), Paris, Puf, rééd. 2021.
11Joan Roughgarden, Le gène généreux. Pour un darwinisme coopératif, (2009), traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Hoquet, Paris, Seuil, 2012, p. 12-13.
12Joan Roughgarden, Evolution’s Rainbow. Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People, Berkeley, University of California Press, 2004.
13Timothy Morton, « Queer Ecology », PMLA, vol. 125.2, 2010, p. 276.
14Roughgarden, Le gène généreux, op. cit., p. 36.
15Myra J. Hird, The Origins of Sociable Life: Evolution After Science Studies, New York, Palgrave MacMillan, 2009, p. 129.
16Lynn Margulis, « Gaia Is A Tough Bitch », in John Brockman (dir). The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, New York, Simon and Schuster, 1995 ; Elizabeth Royte, « Attack of the microbiologists », The New York Times, 14 janvier 1996.