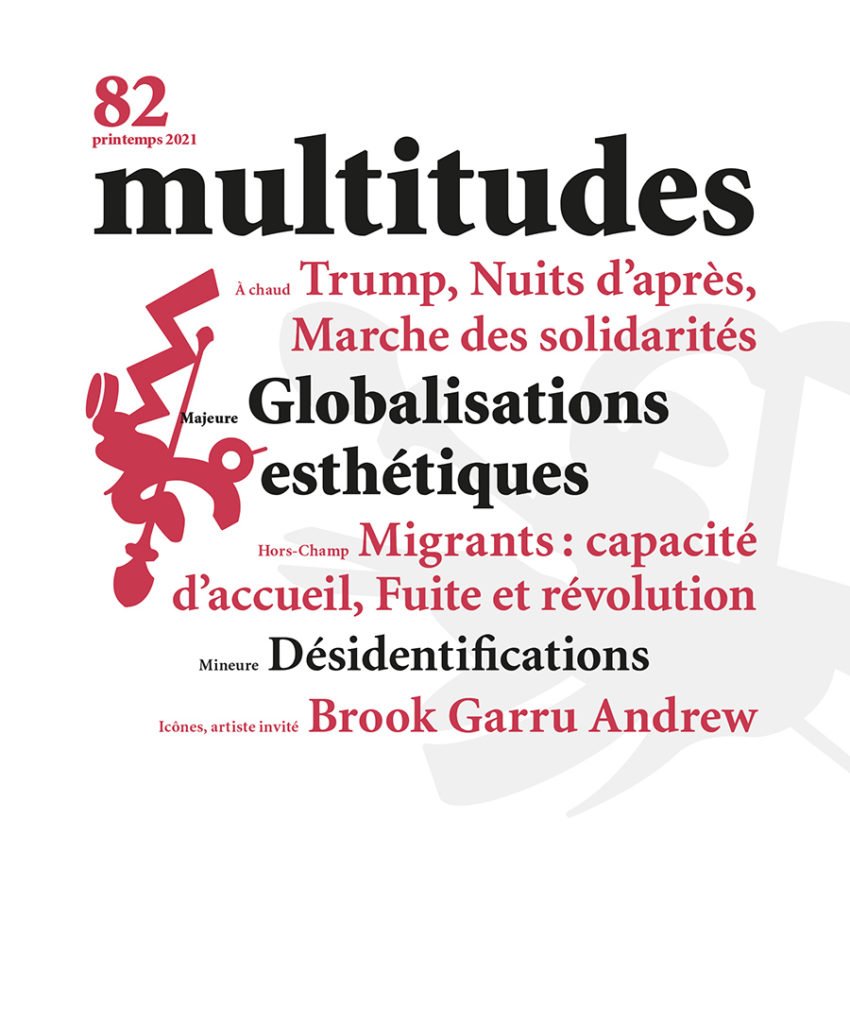Il s’agit de voix ordinaires. De voix ordinaires qui parlent de cuisines et de recettes, d’un savoir-faire culinaire. Ordinaires, mais pas tant que ça. Ordinaires, car on les décrète invisibles, voire absentes. Ordinaires, parce que leurs propos n’intéressent pas. Et qui ? Ordinaires, parce qu’elles sont mêlées à la répétition, aux routines quotidiennes de préparation des repas.
Mettre en avant ces voix ordinaires, c’est mettre en avant l’idée que les pratiques culinaires, notamment, auxquelles elles renvoient, sont substantiellement significatives des globalisations esthétiques, et des circulations régionales, nationales, internationales des personnes et des goûts. Ces recettes sont le produit des déplacements de leurs aut·eurs·rices et témoignent d’une nouvelle cuisine, celle des univers bigarrés de mondes en construction, des mondes matériels, mais aussi symboliques. Du côté matériel, il y a des matières premières et leur emploi. Du côté symbolique, des cultures se mélangent ainsi que des traditions culinaires. Un vrai feuilleté. Ces voix agencent et réagencent les injonctions contemporaines au prisme des subjectivités culinaires et de la circulation des affects en la matière.
En effet, ces récits qui contextualisent des recettes sont aussi une manière de protester contre la fermeture éventuelle de ce qui compte dans la vie de la cité. Quand Spivak discute les modalités de la prise de parole des subalternes1, il semble qu’une des manières de les faire parler est d’inclure d’autres modes de langage que la parole elle-même ou l’écrit. Une telle prise de position va de pair avec une compréhension étroite des modes de communication et une fermeture sur le langage à la parole. La cuisine est bien évidemment un mode de communication ou de relation sociale et environnementale, avec des êtres humains, des êtres vivants de toutes sortes, et des communautés organisées de non-vivants, par exemple ces ressources terrestres. Ce que mettent à l’honneur ces recettes, c’est un art de faire avec le contexte, avec la matière même de ce qui nous environne. Les recettes sont les histoires des lieux. En outre, les histoires de cuisine permettent de s’insérer dans le débat collectif associé aux qualités des lieux habités.
Ces voix parlent de cuisine, de nourriture, de mélange. Ces voix sont celles, souvent, de femmes, dans la mesure où la cuisine et les arts culinaires sont, habituellement, associés à des pratiques domestiques, synonymes de reproduction du foyer. Aujourd’hui, dans les repas collectifs sont présents aussi bien des hommes que les femmes qui échangent des recettes, qui en font part en ligne, inventent, réinventent ce que l’on peut appeler une culture locale ou globale ou les deux. Les récits liés aux recettes renvoient à des lieux et à des circulations, des globalisations. Le global n’existe que comme circulation du regard, de l’imagination ou encore pour celui qui fait de la carte ou de la totalité la possibilité de la mise en œuvre d’instruments de pouvoir. Ces récits-recettes proviennent de voix réunies de sorte à illustrer le mouvement d’une multitude localisée, globalisée. Michael Hardt et Toni Negri écrivent : « De nouvelles figures de lutte et de nouvelles subjectivités sont produites dans la conjecture des événements, dans le nomadisme universel […]. Elles ne se posent pas simplement contre le système impérial, elles ne sont pas simplement des forces négatives. Elles expriment, nourrissent et développent de manière positive leurs propres projets constitutifs. […] Cet aspect constitutif du mouvement de la multitude, dans ses myriades de visages, est vraiment le terrain positif de la construction historique de l’Empire, […] une positivité antagoniste et créatrice. Le pouvoir déterritorialisant de la multitude est la force productive qui soutient l’Empire et, en même temps, la force qui appelle et rend nécessaire sa destruction…2 »
Cette multitude parle de cuisine et ces globalités-localités que sont les recettes de cuisine, fondées sur des savoir-faire qui relèvent des arts mineurs, renvoient à des formes, corporellement vécues, d’engagement dans les territoires et leur épaisseur environnementale, éventuellement toxique. Ce sont ces modes d’engagement que privilégient aujourd’hui des démarches entre art et science, ou arts et savoirs populaires. Le projet à l’origine de ce récit relève d’une démarche de recherche-création3. Il s’inscrit éventuellement dans la continuité des projets d’art participatif qui font des pratiques quotidiennes la matière même (ou le fonds de commerce ?) d’une pratique artistique. Pour Estelle Zhong4, ces pratiques artistiques nouvellement fondées sur ces arts de faire en société jouent « d’une conception de l’art comme corps d’habitudes historiques et non comme essence anhistorique ; d’une révolution des formes : les formes anciennes sont récusées au profit de nouvelles qui n’ont pas l’air artistiques ; d’un idéal : changer l’art – qui passe par la transformation des “habitudes d’art” ; et, enfin, d’un pari : changer l’art et la vie – l’art est capable de changer la vie. » Souscrit-on à ces idées ? Pas forcément. Ces voix valent pour elles-mêmes, et ceux-celles qui les écoutent, ou les lisent.
C’est en ce sens que des chercheurs en sciences sociales et humaines5 ont entrepris de recueillir sur le territoire de Saint-Denis (qui compte 135 nationalités), des récits-recettes aux fins de promouvoir un terroir urbain spécifique associé aux habitants d’origines variées.
Pourquoi ?
Dans le cadre de La table et le territoire, programme de recherche-création porté par le Laboratoire de la culture durable soit le Laboratoire LADYSS en collaboration avec COAL et le Parti Poétique, une expérimentation a été lancée à Saint-Denis, en lien avec la ferme urbaine, aux portes de l’Université Paris 8. Cette ferme maraîchère du XIXe siècle a été reprise en 2017 par le Parti Poétique et les Fermes de Gally. Le Parti Poétique, collectif d’artistes apiculteurs, se voit alors devenir l’exploitant d’un hectare de terrain, qui conserve son statut de terre nourricière, mais est également ouvert à d’autres usages, pour le public, pour les artistes, pour les experts, ou encore pour les chercheurs de l’agriculture urbaine. Cette « ferme des cultures du monde » associe production maraîchère en permaculture, promulgue programmation culturelle et pédagogique, participation citoyenne (habitant, jeune public, visiteurs parisiens, tourisme culturel) et insertion de publics éloignés. L’objectif du projet de ferme est de valoriser, de manière innovante et interdépendante, le bien manger et le bien vivre, l’agriculture saine, locale et responsable, la biodiversité en ville ainsi que la diversité culturelle du territoire à travers la cuisine.
En réponse à ces objectifs très généraux, pertinents écologiquement sur ce territoire, pollué, traversé par de nombreuses tensions, notamment associées aux pauvretés et diversités des trajectoires sociales des personnes qui les habitent, l’objectif de recueillir des récits-recettes est aussi de donner place à une créativité ordinaire déjà mise en exergue par les travaux de Michel de Certeau et Luce de Giard6, un art de faire qui échappe aux injonctions sociétales, ou encore une façon de s’engager dans la vie de cité qui réordonne des modes de vie, comme en attestent les pratiques associées à l’alimentation durable. En outre, les recettes sont aussi des histoires de vie et, donc, de territoires. Il s’agit enfin d’histoires de transmission entre générations, et d’une volonté de réinvention des pratiques sociales dans l’optique du développement durable qui en appelle aux liens intergénérationnels.
Outre un travail de terrain autour de la Ferme Urbaine de Saint-Denis et du territoire de Plaine Commune, un suivi des évènements organisés par la Ferme auxquels se pressent des habitants de ce territoire7, de nombreux entretiens avec des acteurs du territoire ont été réalisés sur l’agriculture urbaine et l’alimentation durable ainsi qu’autour de la Ferme urbaine de Saint-Denis8. En tout, une trentaine de récits-recettes ont été récoltés, tous accompagnés d’un témoignage qui fait vivre la recette. En s’appuyant sur les qualités esthétiques, gustatives, nutritives des savoir-faire culinaires locaux, l’idée est d’imaginer ensemble quelles seraient les spécificités d’une alimentation durable à venir en Seine-Saint-Denis.
Des recettes
La recette est tout d’abord pensée comme un souvenir qui rappelle à la fois l’enfance et la place de la cuisine dans les vies. K, d’origine guinéenne, témoigne de cette place accordée aux lieux de la mémoire culinaire : « Je me souviens très bien du premier repas que j’ai préparé. Un jour, je me rappelle, ma mère ne pouvait pas faire la cuisine, parce qu’elle allait à un marché hebdomadaire. Mes sœurs étaient allées faire la lessive à la rivière. Parce que nous, on partait à la rivière pour faire la lessive. Vous voyez, ça, c’est purement africain. Les frères ne cuisinent pas. Et du coup, j’étais toute seule à la maison et ma mère m’a dit « Tiens, moi j’ai pas le temps, aujourd’hui c’est toi qui fais la cuisine. » J’avais 14 ans, et tout le monde partait, on m’a laissée faire. C’était un dimanche, je me souviens, donc je ne partais pas à l’école. Ma mère est allée faire les courses et elle est revenue. Elle a tout laissé et elle est partie. Et justement, c’est cette recette-là que je vais te donner, parce que c’est la première recette que j’ai eue à cuisiner dans ma vie : la sauce tomate. […] C’est un bon souvenir, j’ai une relation particulière à cette sauce, à cette recette. Ça m’a beaucoup marquée parce que ce jour-là dans la famille, tout le monde s’est régalé. Ils m’ont dit « Oh K, c’est bien, tu as bien fait la cuisine, on s’est régalés. » Et, parfois, il y avait des gens qui se moquaient, mon grand frère disait : « Mais il manque un peu de sel quand même… Il manque un peu de poivre… ». Et tout le monde rigolait, mais j’étais quand même contente parce que mon père a dit « Oh la la, ma fille elle étudie bien, elle cuisine bien, eh bien : j’ai une fille parfaite. » Et c’était assez rigolo, je me souviens de ça… Voilà, c’est cette recette que je vais donner. »
Ensuite, les recettes voyagent avec les personnes. Si K se souvient d’une recette, elle sait qu’elle a dû la transformer dans la mesure de l’immigration. Elle raconte : « Ma mère, elle partait chez l’éleveur, et elle achetait le lait caillé. Là-bas, on prépare le riz, et on met le lait dans le riz, avec du sel, c’est très bon. […] Ici, je le fais, avec de la crème et du yaourt. J’adore ça. Tu mets soit du sel soit du sucre, si c’est le soir je préfère le sucre. Il faut que le riz soit très, très bien cuit. En Guinée, il y a un riz spécial pour ça, on ne le trouve pas ici. J’ai une amie qui va en Guinée elle va en ramener pour moi, elle sait que j’aime ça. »
Il existe également des aliments qui sont eux-mêmes transportés à l’origine de transformations culinaires importantes. K explique son usage du piment : « Le petit piment sec, j’adore, je cuisine beaucoup avec. Même quand je fais des spaghettis bolognaise, moi, je mets un petit piment sec. C’est ma petite touche, tu vois, je le fais à ma façon. Moi, je prends des cuisines du monde et j’en fais ce que je veux. » La sauce soja est également un aliment nouvellement présent dans des recettes alors inédites, selon K : « Au Japon, je ne trouvais pas le cube Maggi, alors qu’est-ce que je faisais, j’utilisais la sauce soja ! Et c’était très bien. » Ou encore K explique son néo-fromage : « En Guinée, on n’a pas de fromage. Je l’ai découvert en France à Marseille, je me souviens très bien, et j’ai tout de suite aimé. Ça a étonné mon entourage ! […] On a une nourriture en Guinée, qui s’appelle le sumbara, qui pue comme le fromage. Et moi, j’adore. C’est à base de Nèrè, une plante qui pousse dans le Sahel. On met les noix du Nèrè à sécher, puis on passe ça au four, et puis après, on pile ça en poudre. Ça sent très, très fort, et le fromage, ça me rappelle cette odeur. »
La recette est également une identité culinaire à la fois géographique et personnelle. Le tiep « maison » que décrit K est ainsi une invention à l’origine marquée, mais née de sa propre inventivité : « La première fois que j’ai fait le tiep toute seule […] c’est quand je suis rentrée à l’université. J’ai invité des amis de l’université qui venaient chez moi, et j’ai fait le tiep pour eux. Ça remonte, ça fait vingt ans, et je me souviens très bien de ce jour-là, c’est comme si c’était hier. […] En Guinée, on n’a pas de raisins ni d’olives. Et ici, quand je fais le tiep, ce plat sénégalais, je mets des olives et du raisin. Des amis Guinéens qui sont passés à la maison ont dit : “Tiens… tu t’es trouvé une recette”. J’ai trouvé ma petite touche ! »
Cependant, cette identité peut se révéler problématique quand elle est également vécue comme une assignation à résidence ainsi que le raconte K : « Mes copines françaises, à chaque fois que je les invite, elles veulent manger Guinéen […]. J’ai envie de faire autre chose, mais elles ne veulent pas. Elles me disent « K on vient, tu nous fais le mafé, ou le tiep ? Un plat Guinéen toujours. […] Je joue le jeu jusqu’à présent, voilà… […] On me demande directement quelque chose qui vient de l’Afrique. […] C’est du racisme inconscient, les gens ne se rendent pas compte que j’ai envie de faire autre chose. Par exemple, j’ai envie de faire le gratin dauphinois ! »
En souvenir de soi
L’absence d’un aliment consommé usuellement dans une région et synonyme d’un type de nourriture peut être vécue comme un manque affectif, ainsi que le rappelle N en provenance d’Algérie : « C’est du lait frais, non pasteurisé, qu’on a laissé fermenter à température ambiante pour le cailler. […] On peut le boire, on peut le manger à la cuillère… Mais les gens le mangent dans le couscous généralement. Comme il n’y a pas de sauce dans le couscous au Ramadan, parce que c’est trop lourd, les gens mettent du lait caillé à la place.
– C’est quelque chose que vous ne pouvez pas manger en France du coup ?
N : Ah non, il faut ramener du lait de là-bas.
– Vous le faites parfois ?
N : Ici ? Non… Peut-être, un jour, je vais ramener un litre. Alger-Paris, c’est quoi, deux heures de route ? Il va être caillé en cours de route ! Il va se fermenter. Effectivement je n’avais jamais pensé à ça.
– Est-ce que ça vous manque parfois ?
N : Oui, ça me manque énormément. Parce que je vous dis que ce n’est pas du tout le lait caillé qu’on trouve ici. Ici, il y a de l’acidité à la fin, alors que celui-là non. C’est comme si on mangeait un yaourt nature. Pour l’épaisseur, c’est presque la même chose.
– C’est quelque chose que vous mangiez quand vous étiez petite ?
N : Ah oui, tout le temps. Ma mère faisait ça pendant le Ramadan. Tout le temps. »
– Est-ce que parfois, vous mangez du yaourt nature pour faire comme si vous mangiez du lait caillé ?
– Oui, je le fais parfois dans le couscous. Je triche oui. Mais ce n’est pas du tout le même goût, c’est pas du tout la même chose. Je triche parce que je ne trouve pas ce que je veux. »
N renchérit, mettant en évidence les liens forts qui existent entre la nourriture et le vécu personnel, y compris l’histoire des lieux avec le vécu de la colonisation : « Tout ce que je prépare chez moi, à la maison, je le fais par rapport à ma culture et mes traditions. Absolument tout. Le pain par exemple… Mais par rapport au goût, ce n’est pas la même chose. La viande a moins de goût ici. Bon le pain, n’en parlons pas, c’est vraiment français. Nous, on ne faisait pas de baguette, on l’a appris avec la colonisation. Mais en ce qui concerne le goût, les produits de là-bas, ils sont bios, ils sont frais. Alors ça change ! On constate le goût, on voit la différence, parce qu’il n’y a pas de produits chimiques. La terre est fertile, il a du soleil. C’est un grand pays : le grenier de la Méditerranée. […] Le rejet de certaines recettes peut s’assimiler au lien renouvelé à ses origines : « Je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis arrivée ici en France, j’ai préparé un couscous, et mon mari est parti acheter des merguez. Je lui ai dit : « Mais qu’est-ce que tu fais ? Nous ne mélangeons pas les merguez dans le couscous, on ne prépare pas de côtelette non plus dans le couscous. ». Il m’a dit : « Oui, mais les Français le mangent comme ça ». Je lui ai répondu : « on est dans une maison algérienne, on reste dans le traditionnel, dans nos coutumes ». À vrai dire, maintenant je fais des merguez dans le couscous, parce que mes enfants me le demandent. »
Quant à A, originaire de la fédération de Russie, elle retrace les liaisons entre son passé et son présent, là-bas et ici en relation avec la production alimentaire, et la culture jardinière : « J’ai l’habitude de travailler la terre, parce que mes parents habitent… Enfin, je viens d’une petite ville en Russie, Vladimir. Petite… Relativement petite, parce que, pour ici, c’est grand, mais pour nous, en Russie, c’est petit. C’est 500 000 habitants, mais c’est considéré assez petit. Et là-bas, chaque dimanche, plus souvent en été, on va souvent au jardin, au potager, pour faire pousser tout, en fait. C’est très très typique pour la Russie, pour les gens de l’ancienne génération – parce que mes parents ils sont assez vieux, 65 et 70 ans – d’avoir le jardin et de s’occuper de son jardin. En fait, c’était très typique pour l’époque soviétique, comme on n’avait pas beaucoup d’accès à la nourriture. La nourriture… C’était assez compliqué d’avoir de la nourriture, il y avait des queues longues dans les magasins et donc, à cette époque-là, cette culture de jardin, elle a commencé à se développer et elle se développe jusqu’à maintenant. Mais, c’est vrai que, maintenant, elle devient plus légère, parce que c’est vrai que les gens, normalement, ne mettent pas les patates ou des choses vraiment difficiles à s’occuper… Plutôt des fleurs, des fraises, c’est plus typique. Mais mes parents continuent de faire comme avant, donc il y a de tout. Et mon père, son idée, en fait, c’est de se nourrir de son propre travail, avec un minimum de produits achetés. Donc, lui achète au magasin uniquement du pain, du cuisimax, c’est une sorte de chose sucré, et du lait et, bien sûr, de la viande. C’est bien de produire soi-même, on sait comment on produit. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu’on produit est hyper propre et hyper bio car mes parents utilisent quand même des produits… Donc, ça ne reste pas tout à fait propre, mais mon père il est fort de cette idée. Ma mère est beaucoup plus sceptique, mais mon père aime beaucoup cette idée de se nourrir… […] Moi, j’ai suivi mes parents quand j’étais petite et quand j’habitais avec eux, jusqu’à 16 ans, parce que quand j’ai eu 16 ans, je suis partie, mais je pense que c’est quand même bien. […] Je partage aussi le jardin, mais c’est pas ici, c’est à Saint-Ouen. […] Juste une semaine, j’ai déménagé à Saint-Ouen et, pendant cette semaine, j’ai fait connaissance avec l’association. […] Je travaille comme bénévole, comme quelqu’un qui s’occupe de sa petite partie… Enfin d’une partie de l’association, mais c’est juste pour moi pour me changer les idées. Moi aussi, j’ai apporté des graines de la Russie, des salades, des cornichons, quelques fleurs… […] Pas nécessairement super typique, mais quand même oui, il y avait la salade, par exemple, qui est typique de la Russie, les cornichons aussi. […] C’est plus ou moins comme ici mais quand même. […] Pour moi, le jardin c’est pas forcément pour se nourrir mais c’est plutôt pour se distraire, se calmer, pour se changer les idées. […] À Saint-Ouen, c’est plutôt des herbes comme la menthe, les herbes aromatiques. Ça c’est bien et, surtout, je trouve que c’est très bien pour l’hiver et pour l’été aussi. Moi, j’adore les tisanes, toutes sortes de tisane. Je ne bois pas de café, ce n’est vraiment pas à mon goût. Par contre, j’adore les tisanes. Pour ça, j’aime bien aussi le jardin. Le laurier aussi. J’utilise aussi quand je fais des soupes ou quand je fais de la viande. Après, les salades aussi pas mal, les radis… Moi j’aime beaucoup les carottes, mais ils n’ont pas choisi de planter ça. […] Je pourrais proposer de planter, mais je n’ai pas fait ça et du coup je m’adapte à ce qu’il y a. […] Surtout que comme je n’ai pas énormément de temps, là-bas, je viens surtout pour me calmer, me détendre. Mais, c’est vrai que moi j’aimerais beaucoup planter des carottes, qu’ils n’ont pas et sinon tomates aussi, mais tomates c’est un peu compliqué, car je sais que les tomates ont besoin de beaucoup de soin, beaucoup plus que les autres plantes, donc je sais que c’est un peu compliqué. Mais des carottes, je pense que ce serait pas mal d’avoir des carottes. C’est pour ça que si vous voulez faire pousser des légumes [à la ferme urbaine de Saint-Denis], moi je serai pour les carottes. »
– Ça ne vous manque pas trop la gastronomie russe ?
A : Non, Je sais que si je veux quelque chose, je vais au magasin. Si vraiment je veux du tvarog, je peux aller […] ça existe dans les magasins russes. […] Métro Rome, il y a plusieurs magasins là-bas, la ligne deux. Il y a deux magasins russes.
– Ah, du coup, vous allez vous approvisionner là-bas ?
A : De temps en temps, oui. S’il y a, à Pâques, parce qu’à Pâques on fait le plat spécial avec du tvarog.
– Il y a pas une recette que vous aimeriez particulièrement transmettre, si vous aviez des enfants ?
A : Je pense que c’est la kacha. La chose qu’on mange le matin. Parce que c’est très équilibré, ce n’est pas facile à faire et, en même temps, c’est très bien pour, après, se sentir bien toute la journée… Moi, j’habite maintenant à la maison du CROUS et je suis entourée par les Africains. […] J’apprends de nouvelles recettes, c’est toujours agréable de s’intéresser aux choses comment elles sont faites par d’autres cultures. […] Quand je vois quelque chose et je vois que c’est simple et que je peux le reproduire après, ça se passe comme ça, je peux demander. Par exemple, les bananes plantins. […] Je ne l’ai pas fait, mais ça m’intéresserait de le faire. […] Je mange du couscous, que je ne mange pas en Russie, par exemple. »
Enfin pour B. d’origine bretonne l’essence de la nourriture est d’être un flux à toutes échelles. A explique : « Mon père avait une ferme, à Pontivy [commune du sud de la Bretagne], avant qu’il reparte sur la région parisienne. C’était le dernier à travailler à la ferme avec sa mère. […] On avait des pommes de terre, de l’ail, des oignons, poireaux, carottes, et des tomates aussi. […] On allait en avril planter et on récoltait ça en août. Je me rappelle, c’était les vacances, on ramenait les valises pleines de pommes de terre, de carottes… Qu’on gardait au moins six mois. […] On les gardait au frais dans la cave à Clichy. Ça permettait d’avoir des légumes frais. […] J’achète très rarement du fromage, je préfère manger de la qualité… Je sais que… Il y a deux ans, on était partis en Auvergne, à Saint-Nectaire. Là, on a fait une razzia de Saint-Nectaire, puisqu’on a été à la ferme chercher le Saint-Nectaire. Même le beurre, ça n’a rien à voir avec ce que vous mangeriez ici. C’est vraiment, quand vous coupez le fromage, vous avez l’impression de sentir la prairie dans le fromage, la rosée du matin, l’herbe mouillée… Vous le sentez dans le fromage. Et vous savez, il suinte encore un peu… Ou le beurre, quand vous coupez, il suinte encore un petit peu avec le petit lait du beurre. C’est incomparable au niveau du goût, et en plus de ça, quand vous voyez le prix au kilo que vendent ces producteurs et le prix au supermarché, c’est quasiment pareil […] Alors que c’est vraiment de la qualité. […] Dès que j’ai le temps, je les sors [ses enfants], je vais à Montmorency, à l’Isle-Adam [dans le département du Val d’Oise], dans la forêt. Et même la ferme juste à côté, Je vais souvent dans le 95 [Val d’Oise], il y a la ferme de Chauvry. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils n’ont que des chèvres, donc ils vendent des fromages de chèvre. J’emmène les enfants, ça fait une promenade à la campagne en même temps. C’est ce qui manque un petit peu, je pense, à Pierrefitte… C’est la bétonisation de la ville. […] Les espaces verts, on n’en a pas à Pierrefitte, on n’a pas de parc. »
Que retient-on ? L’hybridation en matière de cuisine est liée à la discussion sur les identités, celles qui sont attribuées aux personnes et celles qu’elles se donnent à elles-mêmes, notamment. Les territoires d’expérimentation sont mouvants et l’inventivité culinaire est largement liée aux rencontres, et aux usages développés dans les lieux. Il y a donc matière à changement en ce qui concerne l’art culinaire.
D’un point de vue théorique, comment appréhender ce déplacement de l’attention et même cette mise à l’honneur dans ce texte d’extraits d’entretiens ? Il s’agit de forcer le trait. Cela veut dire souligner le fait que la cuisine, issue des contextes en mouvement que sont les terroirs, force des identités discursives appelées à se promouvoir dans un univers narratif. Ici, se jouent les lieux de l’engendrement des récits en composition et recomposition permanente à l’aune des savoirs échangés par les personnes en mouvement. Il s’agit, peut-être, de la réinvention du sujet narrateur en contexte, à la mesure des matérialités et des identités narratives.
1 Gayatri Chakravorty Spivak, « Can the Subaltern Speak ? », in Cary Nelson, Lawrence Grossberg (ed.), Marxism et the Interpretation of Culture, Chicago, University of Illinois Press, 1988, p. 271-313. (Les Subalternes peuvent-illes parler ?, traduction française de Jérôme Vidal, Éditions Amsterdam, 2006).
2 Hardt M., Negri A., 2000, Empire, Cambridge Mass., Harvard University Press, p. 61
3 Blanc, Nathalie et Marine Legrand. 2019, « Vers Une Recherche-Création : Textes, Corps, Environnements », ACME, An International Journal for Critical Geographies 18 (1), p. 49-76. www.acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1625
4 Estelle Zhong, « Des formes cachées dans la matière. La bricologie de l’art participatif à la lumière de la pensée de Gilbert Simondon », Techniques & Culture [En ligne], 64 | 2015, mis en ligne le 24 mars 2016, consulté le 02 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/tc/7567
5 Ce travail a été mené en collaboration avec la géographe Pauline Guinard (ENS ULM) et avec l’aide de Lou Gauthier et de Pauline Briand, stagiaires de Master ainsi que, plus tardivement, pour les ateliers d’écriture, avec Marine Legrand.
6 Michel de Certeau, Luce Giard, 1994, L’invention du quotidien. (2). Habiter, cuisiner, Paris, Gallimard. Folio Essais.
7 Pauline Le Bras, La Table et le Territoire. Mémoire de Master 2 MECI, option Aménagement et développement local (ADL), Université Paris Diderot, 2017. Coline Biot, Fermes urbaines : lieux d’expériences artistiques et patrimoniales. Le cas de la Parcelle Kersanté. Zone Sensible / Parti Poétique et les Fermes de Gally en Seine-Saint-Denis. Réflexion sur les nouvelles ruralités dans l’art contemporain, Mémoire de Master 2 Ville Architecture Patrimoine, Université Paris Diderot, 2019.
8 Tous les entretiens autour des récits recettes ont été organisés de la même façon de sorte à notamment faciliter les retranscriptions. Une première partie est centrée sur les souvenirs liés à la cuisine, une deuxième sur la pratique quotidienne de la cuisine, et une troisième sur une perspective d’avenir : que changer en cuisine ? Cette dernière partie est la plus différente selon les individus. L’accent peut être mis sur la conservation de goûts et valeurs d’avant, ou sur l’inventivité, enfin sur le « nouveau ».