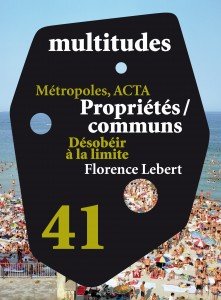1. Clairvoyance et barbarie
Frédéric Neyrat : Le rapport d’Amnesty International du 2 avril 2009, « France : Des policiers au-dessus des lois », dit que les polices françaises se livrent de plus en plus à des « représailles » contre des victimes ou des témoins de mauvais traitements, qui leur sont imputés, victimes et témoins étant attaqués pour « outrage », pour « rébellion »… Pour partir de ce cas, il y aurait diverses façons d’analyser cela, l’une du côté de la contingence, c’est l’effet-Sarkozy, une autre du côté de la structure étatique, c’est un avatar de la fonction répressive d’État. Or je me demande si nous ne sommes pas rentrés dans une autre séquence historique, qui n’empêche pas du tout de prendre en considération et cette fonction et cette contingence, mais les déplacent peut-être. Ce serait une sorte de mutation sociale que l’on voit apparaître au travers de la floraison des techniques juridico-policières dites « préventives », « proactives », qui tendent à criminaliser les intentions au lieu des actes, qui cherchent à identifier la « dangerosité » des individus, qui étendent à l’infini la notion de « terrorisme », et cela est valable bien ailleurs qu’en France, qui cherchent à déceler dès l’enfance les signes d’une délinquance à venir, etc. On serait passé des sociétés de surveillance aux sociétés de contrôle, puis des sociétés de contrôle aux sociétés de clairvoyance. En ce sens, les policiers ne seraient pas au-dessus des lois, mais appliqueraient au contraire un nouveau nomos… Est-ce que tu penses qu’on peut identifier une telle mutation ?
Isabelle Stengers : Je n’ai pas la moindre intention de sous-estimer la gravité des nouveaux agissements policiers et judiciaires, mais ta question me pose problème sur deux points. Mettre des « nouveautés » sous la même catégorie, et nommer cette catégorie « société de la clairvoyance », avec l’affirmation d’un « passage de société » sont deux actes lourds. Il ne s’agit pas de description d’état de choses, mais d’une caractérisation, et, comme tel, cela implique un engagement pratique de ta part. Foucault avait un tel engagement – ranger l’école, la prison et l’usine sous la même catégorie engage à des conséquences assez radicales. Parler de « société de contrôle » engage aussi, puisqu’il s’agit de résister à l’idée que là où la surveillance a reculé, une forme de liberté effective a été produite. En Belgique, lorsque j’étais chômeuse, je devais me présenter tous les jours à la maison communale pour « pointer. » Aujourd’hui les chômeurs doivent, sur convocation, apporter la preuve de leur motivation, du fait qu’ils cherchent ardemment du travail. Il est utile de nommer cette obscénité. Mais le projet de déceler des enfants « pré-délinquants » peut-il entrer dans la même catégorie que les poursuites pour « intentionnalité terroriste » ? Et qui plus est, sous la catégorie de clairvoyance ? N’est-ce pas faire de l’État le seul acteur, et le doter de nouvelles ambitions toujours plus redoutables ? L’État a-t-il une telle cohérence ? Ne pourrait-on pas dire que le premier projet caractérise la poursuite, avec les « rêves » associés aux moyens contemporains, d’une solution scientifique au mal-être, un très vieux projet, alors que les secondes marquent un moment où l’État fait face à une nouvelle « classe dangereuse », à la difficulté de discerner ceux qui sont « vraiment » engagés dans des actes illégaux de tous ceux qui éprouvent pour les premiers une certaine « sympathie », partagent plus ou moins leurs raisons et refusent de les dénoncer ? Alors que le premier suivrait une rhétorique de « progrès » – désormais nous pouvons –, les secondes marqueraient la disparition de l’efficace de ce thème, de la différenciation qu’il opérait entre les « braves gens » qui serrent les dents et font confiance, et les brebis galeuses. Et l’intentionnalité terroriste n’aurait pas seulement pour finalité de faire peur aux braves gens, mais traduirait que l’État lui-même a peur, ne peut plus se fier à ses organes de discernement. C’est une hypothèse. Le point n’est pas de savoir qui a raison et qui a tort, mais dans quelles perspectives nos deux hypothèses nous embarquent respectivement.
F. N. : Je propose ce terme de clairvoyance pour dire plusieurs choses : prévention, anticipations négatives, investissement spécial de la sphère temporelle ; mais aussi magie noire, pouvoir extra-sensoriel technologiquement assisté, donc en ce sens aussi « sorcellerie » ; mais aussi, parce que le nom est excessif, abusif, impossible, je veux dire cécité, incapacité de voir vraiment ce qui se passe et ce que nous avons fait du monde. Oui, je fais l’hypothèse d’un continuum produit, du terroriste au pré-délinquant, et ce n’est pas forcément en désaccord avec ce que tu dis. Car cette clairvoyance gouvernementale, l’anticipation qui cherche à « maîtriser la maîtrise » ne peut qu’échouer, que ce soit pour des êtres humains ou des êtres artificiels. Cet échec signifie exactement ce que tu dis : les organes de discernement de l’État ne peuvent qu’être atteints lorsqu’il s’agit de dresser des listes de terroristes potentiels ou d’individus potentiellement dangereux, car, tendanciellement, c’est tout le monde. Et cette tendance, je le crois, va s’accentuer, c’est une question de socius et de situation historique très alarmante, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors, et avant d’en venir à cette alarme, tu dis que l’État a peur. L’avantage de cette description, par rapport à ta remarque sur là où ça nous embarque, c’est qu’elle enlève de la puissance à l’État, elle montre sa faille, et donc indique par contraste là où existe une contre-puissance. Or cette peur risque précisément d’alimenter la volonté de clairvoyance, d’alimenter, donc, une forme de barbarie socio-juridique. Que faut-il faire avec cette peur ? Faut-il dire, selon toi, que nous sommes tous potentiellement dangereux ? Faut-il insister sur les zones d’indiscernabilités ? Ce serait peut-être là une réponse pratique pour contrer, sur son terrain même, la clairvoyance…
I. S. : Problème intéressant. Il faut donc d’abord affirmer que la clairvoyance est une prétention en un sens qui ne doit pas être généralisé à des prétentions similaires associées à la surveillance et au contrôle. Elle n’en est évidemment pas moins susceptible d’avoir des effets redoutables. Si je tente de penser selon le couple problématique introduit dans La Sorcellerie – à chaque époque, qu’est-ce que l’État laisse (accepte de laisser) faire au capitalisme, et qu’est-ce que le capitalisme fait (entreprend de faire) faire à l’État ? – la possibilité d’une « forme de barbarie socio-juridique » que tu appelles clairvoyance pourrait être prise comme une résultante de l’éclipse de la référence au progrès qui stabilisait ce couplage ? L’État serait d’autant plus dangereux qu’il fonctionnerait sur le régime de la prétention, incapable de produire des raisons qui ne laissent pas percer le « « je sais bien mais quand même. » Ce qui rappelle que l’éclipse du progrès n’est pas « bonne en soi », et cela d’autant moins qu’elle n’a pas été conquise par des luttes. Il s’agit alors que des luttes en fabriquent le sens, c’est-à-dire rompent avec la forme assez classique qui a pour enjeu l’opposition quant à la définition de ce que serait un véritable progrès. Il n’y a plus d’abonné au numéro que demande cette opposition. C’est dans cette perspective hypothétique que je me pose la question : l’antagonisme de la dangerosité potentielle n’est-il pas une manière de nourrir l’État, de lui fournir des raisons d’agir ? Dans « Au Temps des catastrophes » j’ai avancé, à l’essai, l’idée selon laquelle une forme de mépris apitoyé pourrait être plus efficace. Cela ne veut pas dire « ignorer » son pouvoir de nuire, plutôt performer l’inédit de la situation, le caractère désormais redondant de la dénonciation. Les raisons d’État sont, de fait, de l’ordre de la prétention, et la prétention ne se vérifie que par l’opposition frontale qui lui fait l’honneur de la prendre au sérieux.
2. Croyance, expérimentation et agencement
F. N. : Il y a donc des formes d’opposition frontales dont il faut se garder, et là tu viens d’en localiser deux, la première qui concernerait une autre idée du progrès, et la seconde, comment dire, une autre idée de l’État, du pouvoir ? Dans les deux cas, comme tu le proposes, il n’y a plus à en répondre, car c’est maintenir la ligne, demander son réabonnement. C’est de la respiration artificielle. Du Vaudou peut-être… Seulement, comme tu le dis, il y a une « éclipse » de la référence au progrès, on parlera plutôt d’efficacité, on mettra en avant des valeurs qui insistent sur l’opérationnalité immanente des processus. Effectivement cette croyance a disparu, même si le mot est difficile. Je dis d’abord le mot croyance avec William James, c’est ce sans quoi je tomberai, ce sans quoi je ne pourrai pas faire un pas, ce sans quoi aucun avenir mais aussi aucun présent n’est possible. À la place, la barbarie pour utiliser encore le mot que tu emploies, en l’occurrence l’adaptation : on sait que les changements climatiques, les pénuries alimentaires, vont être terribles, les Experts de Cour, je veux dire ceux qui se situent dans le même sillon que ceux que tu nommes les « Responsables », le savent, et il s’agit d’ores et déjà pour eux de se situer purement, simplement, efficacement n’est-ce pas, après. De survivre. Tel est, pour moi, le nom premier de la barbarie : Mad Max institué. Se posent ici un certain nombre de problèmes bien distincts : celui du déplacement de terrain vis-à-vis de la notion de progrès, quoi d’autre ? Car, en même temps, il peut être bon d’avoir des abonnements, sauf s’ils sont forcés. Je pense également qu’il est bon de vivre avec des croyances, celles qui nous permettent d’avancer, au présent, avec l’avenir (et c’est cela, le vrai crédit…). Qu’en penses-tu ? On peut construire une croyance ? On peut distinguer entre bonne et mauvaise croyance ? Le sens de ces distinctions se construit-il dans les luttes ? Je te propose de commencer par cela, avant de revenir sur l’État.
I. S. : Construire une croyance ? Cette proposition conjugue deux termes qui sont tous les deux terriblement vulnérables. Il s’agit de penser à partir de cette vulnérabilité, sinon les retours de manivelle ne nous rateront pas. La lecture usuelle de la croyance selon James est « subjectiviste » – d’où la vulnérabilité à « ce qu’il faut bien tolérer » si cela permet d’avancer. La tolérance implique que l’objet de la croyance a peu d’importance – du moment que cela marche. Et la question de la bonne et de la mauvaise croyance devient alors simplement relative au jugement porté sur le « çà marche ». Quant à la construction, elle porte toujours avec elle un parfum d’arbitraire. Cela peut être déconstruit – ou construit autrement. Ce qui peut communiquer avec une optique de supermarché – je me construis une croyance avec tels ou tels ingrédients choisis sur le marché de la « spiritualité mondiale ». Dans les deux cas, je crains les discussions « à propos de », qui situent les discutants comme parlant de ce que les autres croient. Et je crains aussi que la recherche de la croyance « aujourd’hui adéquate » se confonde avec celle de mots d’ordre susceptibles de faire une unité de rechange. Le progrès n’a pas été une croyance « subjective », plutôt un thème repris sur des modes multiples, et doté d’un pouvoir de capture impressionnant. Dire qu’on n’y croit plus, c’est dire qu’on a « perdu la boussole », avec des conséquences profondément indéterminées. Le pouvoir de la boussole est encore au centre de l’expérience de sa perte. On pourrait à cet égard employer le mot de Félix Guattari, « un affreux curetage », parce qu’il s’agit de se débarrasser de quelque chose qui nous tient, qui s’est insinué partout. Et le curetage de Guattari, dans l’Anti-Œdipe, était indissociable de l’évocation de ce qui, en même temps, se libère, le processus de la production désirante. « Nous croyons au désir », écrivent D et G (p. 455 de l’Anti-Œdipe). Voilà une croyance au sens plein que l’on peut trouver chez James : ce qui force à penser, suivre, sentir, expérimenter, toujours au cas par cas, toujours pris dedans, jamais par l’assignation d’un but qui donne légitimité et garantie. Pour moi c’est dans de tels termes que se pose ta question de la construction. Elle est l’affaire de ceux qui sont déjà engagés, et l’est aussi pour d’autre, mais dans des opérations toujours locales de prise de relais. Ma manière de prendre le relais est mon intérêt pour les agencements, et plus particulièrement pour ceux qui donnent à une situation le pouvoir de faire penser, sentir et agir ceux que cette situation rassemble. La croyance, dans ce cas, désigne ce que demande l’expérimentation d’agencement, désigne cette possibilité qu’une situation puisse faire penser au lieu d’être prise en otage de pensées toutes faites. Et ce n’est pas rien, c’est un événement qui est de l’ordre d’une transmutation, d’un double changement de nature, et de la situation et du « nous » qu’elle rassemble.
3. L’universel et Gaïa
F. N. : La recherche d’une croyance pourrait servir de mot d’ordre, faire « unité de rechange », être dangereuse. Mais tu nommes aussi du nom de « Gaïa » quelque chose à partir de quoi il faut tout repenser. Cela ne me choque pas, si ce nom participe du nouveau monde qu’il faut créer, des nouvelles sensations à éveiller, d’une nouvelle esthétique aussi. Tu ne l’utilises pas comme un nom magique, il ne s’agit donc pas de « réenchanter » le monde, car somme toute Gaïa ne se soucie pas de nous (comme les Dieux d’Epicure, me dis-je soudain !). Avec ce nom, nous sommes amenés à compter avec quelque chose en plus, qui fût dénié : si tu emploies dans ton livre le mot de « transcendance » pour parler de Gaïa, c’est peut-être comme conjuration du fantasme de la « maîtrise de la maîtrise ». Mais tout de même, on est là dans une dimension singulière, qu’il faut décrire. Ce n’est pas que je croie que tu crois, car j’ai plutôt en tête Schelling, quand il dit : « C’est en un sens supérieur que les Grecs ont tenu leurs dieux pour plus réels que tout autre réel ». Quel est donc ce réel pour toi ? Dans Les atmosphères de la politique, tu dis, si mes souvenirs sont bons, que tu n’as pas lâché le rapport à l’Universel, ne serait-ce que parce que tu as un rapport à l’Université. Alors, est-ce que tu relaies, dans ton travail d’écriture, quelque chose d’un universel ? Car Gaïa, tout de même, vaut ou devrait valoir pour tous les terriens ! « Nous sommes embarqués » ! Oui, l’Universel aura été le nom d’un massacre au long cours, cet universel que Jean-Claude Milner qualifie de « facile ». Et plus il est exsangue, plus il veut du sang. Mais peut-on se passer du processus d’universalisation ? Toi-même, t’en passes-tu vraiment, dans ce que tu fais ? Car nommer Gaïa a un effet-d’Un pour « nous », non ? Comme le changement climatique. Dont il faut combattre les causes, mais ces causes font système. Ne serait-ce pas aussi dangereux de laisser au « système », à ce qui s’est globalisé, la puissance de l’universel? N’est-on pas obligé, aujourd’hui, de se faire un universel, aussi feuilleté, troué, transcendé de toutes parts soit-il ?
I. S. : La question n’est évidemment pas de « croire à Gaïa », c’est pourquoi, dans « Au Temps des catastrophes », j’ai eu soin de souligner qu’elle est indissociable de la question de l’intrusion. Cette intrusion n’a certainement pas d’effet-Un, ni au sens concret (ce qui arrivera aux différentes régions du monde), ni au sens d’un « nous » qui aurait à répondre d’une seule voix. Plus précisément, c’est le capitalisme qui est susceptible de produire ce type d’effet, sur le mode du « nous n’avons pas le choix », et de l’ensemble des alternatives infernales qui vont se précipiter. Si j’ai parlé de transcendance, et pas d’universel, à propos de Gaïa, c’est précisément parce que l’intrusion signifie ce que l’universel cherche toujours à domestiquer, afin de constituer l’humanité en auteur de son histoire. Si j’ai, comme philosophe, maintenu un rapport à l’universel – création philosophique comme tous les arguments qui imposent que nous serions « obligés » de souscrire à un universel -, c’est précisément à cause de la virulence de ces arguments, qui font que celui qui croit en sortir est pris dans un véritable labyrinthe de rétorsion. Donc je ne nie pas l’universel, j’essaie d’en faire passer le goût. Gaïa n’est pas le signe d’un universel à construire, pas plus que le capitalisme, elle est « asignifiante » et le restera. La nommer, c’est tenter de conférer à la situation que désigne son intrusion, le pouvoir de faire penser, et cette opération, nommer, ne s’adresse pas à un « nous » porteur d’universalité, mais bien plutôt au « nous » de ceux qui sont sous l’emprise de cette idée de l’universel, qui ne peuvent s’empêcher de se faire les porte-parole de l’humanité, et qui seront prêts à me montrer que « je le suis aussi, malgré mes dénis. » Et bien sûr ils le peuvent, je fais partie de ce « nous », mais ce qui est annulé par la rétorsion, c’est la possibilité expérimentale de « civiliser » l’emprise, d’apprendre, et c’est un art de l’humour, à « faire avec » sans nous laisser dévorer par des alternatives tragiques. Et par exemple, dans le cas de cette discussion, de « faire avec » son efficace très particulière. J’ai nommé Gaïa, celle qui fait intrusion, pour conférer à la situation le pouvoir de faire penser, sachant que la tentation est un « je sais bien mais quand même » (je ne parle pas du capitalisme qui, lui, « sait » tout ce qu’il a à savoir) qui rend la barbarie inévitable. J’ai employé toutes les ruses de la syntaxe pour faire passer que ce n’est pas à Gaïa qu’il faut faire réponse – elle est sourde – mais à cette barbarie qui vient – c’est cela auquel j’essaie de conférer le pouvoir de « faire réel ». Il me reste la carte de l’humour, c’est-à-dire de l’aveu d’un échec qui, en lui-même fait monstration (je n’ai pas dit démonstration) : ce que j’ai essayé se heurte à quelque chose de plus fort, le souci de savoir si « vraiment » je peux me passer de l’universel. Et le résultat : la question de ce qui est en train d’arriver est rentrée dans le rang – « on sait bien que c’est en train d’arriver, mais quand même ce qui importe, ce qui nous oblige vraiment, c’est la découverte-construction-promotion d’un substitut aux universels qui se sont cassé la figure. » C’est la seule chose que je veux dire – l’emprise de l’universel a fait et continue à faire notre vulnérabilité au capitalisme.
4. « Pragmatiques de connexion »
F. N. : Il n’y aurait donc pas de réponse politique possible au capitalisme, et à la barbarie qui vient, sans défection totale de l’universel et de son emprise. Je laisse pour l’instant de côté cette question de l’universel, parce que ta réponse me déstabilise profondément, quitte à y revenir, pour aller vers l’autre mauvaise opposition frontale dont tu parlais tout à l’heure. Tu disais que l’éclipse du progrès n’est pas « bonne en soi », et cela d’autant moins qu’elle n’a pas été conquise par des luttes. Est-ce qu’il y a d’après toi des formes de luttes politiques qui seraient mieux adaptées que d’autres à l’intrusion de Gaïa et à la réponse, ou plutôt, au vu de ce que tu viens de dire, aux réponses à apporter à cette barbarie ? Est-ce qu’il y a des « cibles » privilégiées, une hiérarchie des luttes plus qu’une convergence à effectuer ? Est-ce que la situation que nous traversons aujourd’hui, avec son aggravation probable, exige de nouvelles réponses ? Mais peut-être que dire « la situation » ou « nous » serait encore trop dire…
I. S. : L’effet de déstabilisation dont tu prends acte est assez précisément ce que cherche à susciter cette formule, « l’intrusion de Gaïa », dès lors qu’elle est strictement associée à l’idée que ce n’est pas à elle qu’il s’agit de faire réponse – en ce cas la réponse devrait être « une », traduisant l’unité du nom. La barbarie, elle, ne correspond à aucun « un », et surtout pas à la figure d’une régression qui impliquerait encore et toujours le progrès. Elle n’a d’autre figure que celle des innombrables anesthésies qui s’installent lorsqu’on s’habitue à une situation qui auparavant aurait été vécue comme intolérable. Et tu as raison, dans le monde d’aujourd’hui, ceux qui diront « nous » et « la situation » sont « nos » responsables, lorsqu’ils demanderont qu’on accepte l’intolérable parce que la situation l’exige. J’essaie pourtant de m’adresser à « une » situation, qui m’inquiète profondément et qui touche directement ceux et celles qui se préoccupent des luttes à mener. C’est l’alternative entre la convergence et la dispersion, et plus précisément par la manière dont cette alternative commande la pensée. Il s’agit sans conteste d’un véritable problème, mais un problème ne commande pas la pensée, il suscite la pensée, il suscite la création de réponses. Ma conviction est que la capacité de lutter contre la barbarie implique un refus de la hiérarchie des luttes, parce que toute hiérarchie implique une sélection de ce qui compte et de ce qui compte moins. À la limite, on peut même arriver à une certaine forme de négationnisme. De la même manière qu’il y a eu un négationnisme d’ultra-gauche à propos du génocide, il y a aujourd’hui des voix qui proclament que si les perspectives de dérèglement climatique troublent les perspectives de la lutte, c’est parce qu’elles sont faites pour les troubler, c’est-à-dire qu’elles ne sont que mensonge et fumisterie. Moins caricatural mais tout aussi redoutable est la reconnaissance qu’il y a problème, mais un peu comme une note en bas de page, c’est-à-dire sans conséquence. D’autre encore prétendent que, puisque c’est le capitalisme qui a créé le problème, c’est à lui de réparer – c’est d’un grand bon sens, et c’est bien d’ailleurs le rôle qu’il va revendiquer, or, c’est précisément cela, la barbarie qui vient. Le « il faut une convergence » – avec hiérarchie puisque les questions qui permettent la convergence seront privilégiées – est également d’un grand bon sens, sauf que la question de la barbarie n’entre pas dans le schéma des rapports de force. Elle est parfaitement susceptible de passer par ce qui est censé compter moins, et redéfinira le paysage de telle sorte que ce qui était censé compter de manière décisive s’effondrera d’un seul coup dans la dérision et les ricanements. C’est par rapport à un travail de sape qu’il s’agit de penser, et dans ce cas, c’est peut-être la texture qui compte, la connexion entre production de résistances locales positives, qui explorent et fabriquent les moyens de faire autrement à partir d’une question partielle, et un « nous » qui est celui auquel Deleuze, me semble-t-il, faisait allusion lorsqu’il disait qu’il y a une différence de nature entre la gauche et la droite, parce que la gauche a besoin « que les gens pensent ». Et penser, ici, c’est à peu près le contraire de ce qu’on apprend à l’école, de ce que garantit un diplôme. Cela passe par un appétit et une confiance qui sont requises à la fois pour créer localement et pour produire une convergence mobile, susceptible de s’actualiser en tout point. Parce que chaque point importe, et parce que, en chaque point, ceux et celles qui œuvrent savent que, ce faisant, ils ne fabriquent pas leur petit monde mais ce qui n’a la force de tenir que parce que cela importe à d’autres, comme ce que font les autres leur importe. Penser, c’est passer à travers l’alternative dramatique entre dispersion et convergence, et être capable de « faire convergence » là où il le faut, qu’il s’agisse de résister à une mesure gouvernementale, à une manœuvre patronale ou à l’expropriation d’un potager collectif. Et penser en ce sens, cela s’apprend, mais pas comme on passe de l’ignorance au savoir, ni même à la prise de conscience. Apprendre, dans ce cas, demande les pratiques et les productions de dispositifs capables de susciter et de nourrir l’appétit et la confiance, ce qu’implique ce que les anglo-américains appellent « reclaiming ». Bien sûr tout cela exige une forme d’organisation politique, mais il s’agit de rompre avec la vieille distinction hylémorphique forme/matière. Il s’agit plutôt d’activation, de mise en aguets, de catalyse des vigilances, de production de dynamiques de répercussions et de transduction, comme dirait Simondon.
F. N. : Résistance, reclaiming, catalyse des vigilances… Par rapport à tous ces mots qui désignent des formes d’ « activation » politique, il y aurait à l’origine le refus de l’intolérable, et donc une sensibilité à l’intolérable.
On voit en France se multiplier en ce moment de nombreuses actions qui emploient le terme de « désobéissance », et qui se rattachent souvent à l’idée de désobéissance civile. J’aimerais savoir ce que tu penses bien sûr du mot et du concept, mais plus encore : est-ce que cela traduit selon toi une certaine situation, un certain désir ou refus ? Ce type d’action implique d’agir à visage découvert, de façon non anonyme et non violente, dans le cadre démocratique. Cela semble s’opposer à ce que serait l’action clandestine, ou le « recours aux forêt ». Ombre et Lumière, peut-être. Plusieurs fois pendant l’entretien j’ai pensé à Antigone, à son refus de la toute-puissance de la « loi publiquement en vigueur sous le soleil », à son refus de l’Universel, à son appel à des « lois non-écrites » que certains, Hölderlin d’abord, auront interprété comme la marque de son autonomie. Est-ce qu’il y a, selon toi, toujours une Part d’Ombre en présence dans les luttes politiques ? Pour de nombreuses personnes, l’idée même d’une Part d’Ombre dans un monde sans dehors, sans extérieur, furieusement démocratique, électriquement connecté n’aurait sans doute aucun sens, ou serait à proscrire de façon préventive je dirais. De même qu’une idée d’atopie, d’insulation, de « vacuole de non-communication », ou de « démobilisation ». Peut-on vraiment connecter, faire place aux puissances de l’innombrable qui dépassent toute revendication politique particulière sans laisser place aux Parts d’Ombre ?
I. S. : Il me semble que la pratique de la désobéissance civile ne se situe pas dans le cadre démocratique, si l’on entend en tout cas par là le cadre institué. Elle met plutôt au défi ce cadre, et ce qu’il définit comme légitime et illégitime, sur un mode qui implique et parie sur la manière dont les actions, posées au grand jour, feront écho et résonance. La réussite des faucheurs, c’est que le gouvernement n’a pas pu les traiter d’éco-terroristes, que les procès ont servi de caisse de résonance à des thèses sur lesquelles les media sinon auraient fait l’impasse, et que le doute a même fini par infecter le politique. Opération réussie de « démoralisation ». Et dans ce cas, non seulement le choix de l’objectif de démonstration de désobéissance, mais la manière dont cette démonstration est produite sont cruciaux. C’est à ce sujet que les activistes U.S. et anglais, qui ont un temps d’avance sur nous, ont mis au point des procédures de décision qui donnent un sens concret et inédit à l’idée de démocratie, des procédures qui inventent les moyens de conférer à la situation qu’il s’agit de créer, et à ses suites répressives, le pouvoir de faire penser les participants. Comment décider et organiser sur un mode tel que les effets de terreur, de prise en otage, d’entraînement subi dans une dynamique de radicalisation abstraite soient évités, cela n’a rien à voir bien sûr avec un monde « furieusement démocratique ». Et c’est par rapport à ces pragmatiques de connexion que je m’interroge sur tes « vacuoles de non communication ». Il me semble que ton allusion à Antigone est en danger de nous ramener à une opposition entre la Part d’Ombre et Créon, la Lumière du constructible, l’affairement pragmatico-démocratique. Ce que « de nombreuses personnes » pensent ou ne pensent pas ne me semble pas une raison pour opposer Ombre et Lumière, pour faire resurgir ce qui me semble très mal protégé contre une « grandeur tragique » que sans doute tu récuserais mais qui ravira d’aise tous ceux qui en profiteront pour mépriser, encore et toujours, le chœur parce qu’il « préférerait ne pas » se laisser broyer dans l’affrontement entre les héros. Nommer est chose sérieuse, et ta Part d’Ombre est redoutable, éveillant un véritable réseau de réflexes conditionnés bien de chez nous, avec à la clef le sens d’une Vérité dont la grandeur est de refuser toute connexion. Sais-tu que le titre original du livre de Starhawk, « Femmes, magie, et politique », est « Dreaming the Dark » ? Leur Déesse a de nombreux nom, et Hécate est l’un d’entre eux, mais dans ce cas, rêver l’Obscur, c’est justement défaire son opposition avec la Lumière. Et ce n’est peut-être pas sans rapport avec le fait que, dans un texte repris dans « Parcours d’une altermondialiste », et qui se situe juste après Gènes, elle plaide contre la tentation d’opposer les bons-non-violents et les méchants-violents : il ne faut surtout pas tomber dans le piège et dénoncer le Black Bloc, il faut faire de la place pour leur rage, pour leur impatience – « si nous nous coupons de cela, nous nous affaiblirons ». C’est un cri pragmatique : si nous nous coupons d’Hécate, Antigone reviendra et « nous » serons, face à elle, comme Créon. Quant à un monde sans-dehors, à des mobilisations « pour une revendication politique particulière », où sont-ils lorsque les anciens dieux du Mexique et les morts sont dans les rues de Cancun, lorsque les activistes plantent des jardins (illégaux) dans les quartiers pauvres de San Francisco, lorsque les sorcières entraînent les manifestants à Québec dans une danse spirale sous les lacrymogènes, lorsque les participants à un camp de protestation à l’occasion d’un G je ne sais plus combien sont initiés, entre deux affrontements avec les flics, au traitement des eaux usées avec les techniques de permaculture ? Même lorsqu’un groupe organise un potager collectif, il ne se borne pas à la construction d’ententes entre humains. Si les légumes ne sont pas forcés par des intrants chimiques, il faut aussi apprendre à penser avec ce qu’ils demandent.